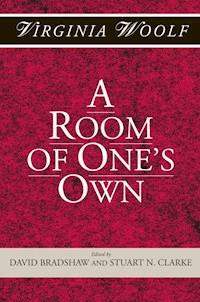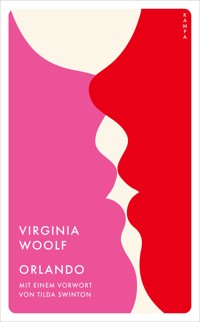3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: anna ruggieri
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Cette édition est unique;
- La traduction est entièrement originale et a été réalisée pour l'Ale. Mar. SAS;
- Tous droits réservés.
The Moment and Other Essays est un recueil de trente essais de Virginia Woolf, publié pour la première fois en 1947, six ans après sa mort. Édité par son mari, Leonard Woolf, les essais du recueil sont les suivants : The Moment : Summer's Night ; On Being Ill ; The Faery Queen ; Congreve's Comedies ; Sterne's Ghost ; Mrs. Thrale ; Sir Walter Scott. Gas at Abbotsford ; Sir Walter Scott. The Antiquary ; Lockhart's Criticism ; David Copperfield ; Lewis Carroll ; Edmund Gosse ; Notes sur D. H. Lawrence ; Roger Fry ; The Art of Fiction ; American Fiction ; The Leaning Tower ; On Rereading Novels ; Personalities ; Pictures ; Harriette Wilson ; Genius : R. B. Haydon ; L'orgue enchanté : Anne Thackeray ; Deux femmes : Emily Davies et Lady Augusta Stanley ; Ellen Terry ; En Espagne ; La pêche ; L'artiste et la politique ; et La royauté.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Table des matières
Note éditoriale
Le moment : Nuit d'été
Sur le fait d'être malade
La reine des fées
Les comédies de Congreve
Le fantôme de Sterne
Mme Thrale
Sir Walter Scott. Le gaz à Abbotsford
Sir Walter Scott. L'antiquaire
La critique de Lockhart
David Copperfield
Lewis Carroll
Edmund Gosse
Notes sur D. H. Lawrence
Roger Fry
L'art de la fiction
Fiction américaine
La tour penchée
Sur la relecture des romans
Personnalités
Photos
Harriette Wilson
Génie
L'orgue enchanté
Deux femmes
Ellen Terry
Vers l'Espagne
Pêche
L'artiste et la politique
Redevance
Redevance
Le moment et autres essais
VIRGINIA WOOLF
1947
Traduction 2021 édition par Ale. Mar.
Tous droits réservés
Note éditoriale
Dans ma note éditoriale sur The Death of the Moth, j'ai écrit que Virginia Woolf "a laissé derrière elle un nombre considérable d'essais, de croquis et de nouvelles, certains inédits et d'autres déjà publiés dans des journaux ; il y en a, en effet, assez pour remplir trois ou quatre volumes". Depuis lors, les nouvelles ont été publiées dans A Haunted House. Le présent volume contient une nouvelle sélection d'essais. J'ai suivi la même méthode de sélection que pour The Death of the Moth, en incluant quelques-uns des différents types d'essais - esquisse, critique littéraire, biographie, "politique" - et sans essayer de choisir selon une quelconque échelle de mérite ou d'importance. En conséquence, le niveau de réussite me semble aussi élevé dans ce volume qu'il l'était dans The Common Reader ou dans The Death of the Moth, et il en va de même pour les essais que je n'ai pas inclus, mais qui suffiraient à remplir un autre volume.
Certains de ces essais sont publiés aujourd'hui pour la première fois ; d'autres sont parus dans The Times Literary Supplement, The Nation, the New Statesman and Nation, Time and Tide, the New York Saturday Review, New Writing. J'ai inclus deux essais portant le même titre, Royalty ; le premier a été commandé, mais, pour des raisons évidentes, non publié par Picture Post ; le second a été publié dans Time and Tide.
Ce que j'ai dit à propos de l'état non révisé des essais dans la note éditoriale de The Death of the Moth s'applique aux essais inclus dans ce volume. Si Virginia Woolf avait vécu, elle aurait révisé ou réécrit presque tous ces essais. Les essais diffèrent considérablement dans leur état de "finition". Tous ceux qui ont été effectivement publiés dans des journaux ont été écrits et réécrits et révisés, bien qu'il ne fasse aucun doute que le processus se serait poursuivi. Certains d'entre eux - par exemple On Re-reading Novels - ont en fait été révisés et réécrits après leur publication en vue d'être inclus dans un volume. D'autres, comme Le Moment, n'existent qu'à un stade beaucoup plus précoce, sous la forme d'un tapuscrit assez grossier, fortement corrigé à la main. J'ai imprimé ces textes exactement comme ils ont été laissés, à l'exception de la ponctuation et de la correction d'erreurs évidentes, mais je l'ai fait avec une certaine hésitation, ne serait-ce que parce que l'écriture est parfois extrêmement difficile à déchiffrer.
LEONARD WOOLF
Le moment : Nuit d'été
La nuit tombait, de sorte que la table du jardin, parmi les arbres, devenait de plus en plus blanche, et les gens qui l'entouraient de plus en plus indistincts. Une chouette, émoussée, à l'aspect désuet, lourdement lestée, traversa le ciel déclinant avec une tache noire entre ses griffes. Les arbres murmurent. Un avion ronronnait comme un morceau de fil plumé. Il y avait aussi, sur les routes, l'explosion lointaine d'une moto, filant de plus en plus loin sur la route. Mais qu'est-ce qui compose le moment présent ? Si vous êtes jeune, l'avenir repose sur le présent, comme un morceau de verre, le faisant trembler et frémir. Si vous êtes vieux, le passé repose sur le présent, comme un verre épais, le faisant vaciller, le déformant. Pourtant, tout le monde croit que le présent est quelque chose, cherche les différents éléments de cette situation afin d'en composer la vérité, le tout.
Pour commencer : elle est largement composée d'impressions visuelles et sensorielles. La journée a été très chaude. Après la chaleur, la surface du corps est ouverte, comme si tous les pores étaient ouverts et que tout était à découvert, et non pas scellé et contracté, comme par temps froid. L'air souffle le froid sur la peau sous les vêtements. La plante des pieds se dilate dans des pantoufles après avoir marché sur des routes dures. Puis la sensation de la lumière qui retombe dans l'obscurité semble éteindre doucement, avec une éponge humide, la couleur de ses propres yeux. Puis les feuilles frissonnent de temps à autre, comme si une ondulation de sensation irrésistible les traversait, comme un cheval fait soudain onduler sa peau.
Mais ce moment est aussi composé d'un sentiment que les pieds de la chaise s'enfoncent au centre de la terre, passant par la riche terre du jardin ; ils s'enfoncent, alourdis. Puis le ciel perd perceptiblement sa couleur et une étoile, ici et là, fait un point lumineux. Puis des changements, invisibles dans la journée, se succèdent et semblent rendre un ordre évident. On prend conscience que nous sommes des spectateurs et des participants passifs à un spectacle. Et comme rien ne peut interférer avec l'ordre, nous n'avons rien d'autre à faire que d'accepter et de regarder. Maintenant, de petites étincelles, qui ne sont pas stables, mais irrégulières, comme si quelqu'un avait des doutes, traversent le champ. Est-ce le moment d'allumer la lampe, disent les femmes de paysans : puis-je voir encore un peu ? La lampe s'enfonce ; puis elle s'enflamme. Tout doute est levé. Oui, le moment est venu dans toutes les chaumières, dans toutes les fermes, d'allumer les lampes. Ainsi donc, le moment est rythmé par ces allers et retours, ces inévitables descentes, vols, allumages de lampes.
Mais il s'agit là de la circonférence la plus large du moment. Ici, au centre, se trouve un nœud de conscience ; un noyau divisé en quatre têtes, huit jambes, huit bras et quatre corps distincts. Ils ne sont pas soumis à la loi du soleil, du hibou et de la lampe. Ils l'assistent. Car tantôt une main se pose sur la table, tantôt une jambe se jette sur une jambe. Maintenant, le moment devient tiré par la flèche extraordinaire que les gens laissent voler de leur bouche - quand ils parlent.
"Il fera bien avec son foin."
Les mots laissent tomber cette graine, mais aussi, venant de ce visage obscur, et de la bouche, et de la main qui tient si caractéristiquement la cigarette, frappent maintenant l'esprit d'une liasse, puis explosent comme un parfum suffocant le dôme entier de l'esprit avec son encens, sa saveur ; laissent tomber, de leur enveloppe ambiguë, la confiance en soi de la jeunesse, mais aussi son désir urgent, pour l'éloge, et l'assurance ; si on disait : "Mais tu n'es pas plus laid que beaucoup d'autres, tu n'es pas différent, les gens ne te marquent pas pour se moquer de toi" : qu'il soit à la fois si coquet et si disgracieux fait basculer l'instant dans le rire, et dans la méchanceté qui naît de l'oubli des motifs des autres, et de la vision de ce qu'ils cachent, si bien que l'on prend parti ; il réussira, ou non ; et encore, ce succès signifiera-t-il ma défaite, ou non ? Tout cela traverse l'instant, le fait frémir de malice et d'amusement ; et le sens de la surveillance et de la comparaison ; et le frémissement rencontre le rivage, quand la chouette s'envole, et met fin à ce jugement, à cette surveillance, et avec nos ailes déployées, nous aussi nous volons, nous prenons notre envol, avec la chouette, au-dessus de la terre et examinons la quiétude de ce qui dort, plié, assoupi, le bras tendu dans la vaste obscurité et suçant son pouce aussi ; l'amoureux et l'innocent ; et un soupir s'élève. Ne pourrions-nous pas voler aussi, avec de larges ailes et avec douceur ; et être tous d'une seule aile ; tout embrassant, tout rassemblant, et ces frontières, ces ouvertures au-dessus de la haie dans des compartiments cachés de couleurs différentes seraient toutes balayées en une seule couleur par le pinceau de l'aile ; et ainsi visiter dans la splendeur, auguste, les sommets ; et là se trouver exposés, nus, sur l'échine, très haut, à la froide lumière de la lune qui se lève, et quand la lune se lève, seule, solitaire, la voir, une, éminente au-dessus de nous ?
Ah, oui, si nous pouvions voler, voler, voler... Ici, le corps est saisi ; et secoué ; et la gorge se raidit ; et les narines picotent ; et comme un rat secoué par un terrier, on éternue ; et l'univers entier est secoué ; les montagnes, les neiges, les prairies ; la lune ; higgledly, piggledy, à l'envers, les petits éclats volant ; et la tête est secouée de haut en bas. "Le rhume des foins - quel bruit!- il n'y a pas de remède. Sauf à passer le temps des foins sur un bateau. C'est peut-être pire que la maladie, même si c'est ce que faisait un homme - traverser et retraverser, tout l'été."
Sortant d'un bras blanc, une forme allongée, couchée, dans une pellicule de noir et de blanc, sous l'arbre qui, en bas, semble faire partie de cette courbe, de cette coulée, la voix, avec son ridicule et son sens, révèle au terrier secoué sa propre insignifiance. Il ne fait plus partie de la neige ; il ne fait plus partie de la montagne ; il n'est pas le moins du monde vénérable pour les autres êtres humains ; il est ridicule ; c'est un petit accident ; c'est une chose dont on se moque ; on le discrimine ; on le voit clairement découpé, on l'éternue, on le juge et on le compare. C'est ainsi que le moment de l'affirmation de soi survient ; ah, encore l'éternuement ; le désir d'éternuer avec conviction ; magistralement ; se faire entendre ; se faire sentir ; si ce n'est pas de la pitié, alors quelqu'un d'important ; peut-être se détacher et partir. Mais non, l'autre forme a envoyé de sa flèche un autre fil conducteur : "Dois-je aller chercher mon Vapex ?". Elle, l'observatrice, la discriminatrice, qui garde toujours à l'esprit d'autres exemples, de sorte qu'il n'y a rien de singulier dans un cas particulier - qui refuse de se laisser emporter par l'extravagance ; et aussi sceptique ; elle ne peut pas croire aux miracles ; elle voit la vanité de l'effort là ; peut-être alors serait-il bon d'essayer ici ; pourtant, si elle isole des cas dans les brumes de l'immensité, elle voit ce qui est là de façon d'autant plus nette ; elle refuse de se laisser embobiner ; pourtant, dans cette discrimination nette, elle montre une certaine amplitude. C'est pourquoi le moment devient plus dur, s'intensifie, s'amoindrit, commence à être souillé par un jus personnel exprimé ; par le désir d'être aimé, d'être serré contre l'autre forme ; d'enlever le voile de l'obscurité et de voir des yeux brûlants.
Puis une lumière est allumée ; on y voit apparaître un visage brûlé par le soleil, maigre, aux yeux bleus, et la flèche vole comme l'allumette s'éteint :
"Il la bat tous les samedis ; par ennui, je devrais dire ; pas pour boire ; il n'y a rien d'autre à faire."
L'instant se précipite comme un vif-argent sur une planche inclinée dans le salon du cottage ; il y a les ustensiles de thé sur la table ; les chaises dures de style windsor ; les boîtes à thé sur l'étagère pour l'ornement ; la médaille sous un abat-jour en verre ; la vapeur de légumes qui s'échappe de la casserole ; deux enfants qui rampent sur le plancher ; et Liz entre et John lui donne un coup sur le côté de la tête alors qu'elle passe devant lui, sale, les cheveux détachés et une épingle à cheveux qui dépasse sur le point de tomber. Et elle gémit d'une manière chronique et animale ; et tes enfants lèvent les yeux et font un bruit de sifflet pour imiter le moteur qu'ils traînent à travers les drapeaux ; et John s'assoit avec un bruit sourd à la table et coupe un morceau de pain et mâche parce qu'il n'y a rien à faire. Une vapeur s'élève de son carré de choux. Faisons donc quelque chose, quelque chose pour mettre fin à ce moment horrible, ce moment plausible et brillant qui reflète dans ses côtés lisses cette cuisine intolérable, cette misère ; cette femme qui gémit ; et le cliquetis du jouet sur les drapeaux, et l'homme qui grignote. Cassons-la en craquant une allumette. Voilà, c'est fait.
Et puis vient la voix basse des vaches dans le champ ; et une autre vache à gauche répond ; et toutes les vaches semblent se déplacer tranquillement dans le champ et la chouette fait retentir sa bulle aqueuse. Mais le soleil est profondément enfoui sous la terre. Les arbres deviennent plus lourds, plus noirs ; aucun ordre n'est perceptible ; il n'y a aucune séquence dans ces cris, ces mouvements ; ils ne viennent d'aucun corps ; ce sont des cris à gauche et à droite. On ne peut rien voir. Nous ne pouvons nous voir que comme des silhouettes, cadavériques, sculpturales. Et il est plus difficile pour la voix de porter à travers cette obscurité. L'obscurité a enlevé l'élan de la flèche - les vibrations qui s'élèvent et frissonnent en nous traversant.
Puis vient la terreur, l'exaltation ; le pouvoir de s'élancer inaperçu, seul ; d'être consumé ; d'être emporté pour devenir un cavalier sur le vent aléatoire ; le vent ballotant ; le vent piétinant et hennissant ; le cheval à la crinière ébouriffée ; le culbuteur, le butineur ; celui qui galope pour toujours, voyageant de loin en loin, indifférent ; faire partie de l'obscurité sans yeux, être ondoyant et ruisselant, sentir la gloire couler en fusion le long de la colonne vertébrale, le long des membres, faire briller les yeux, brûlants, brillants, et pénétrer les vagues du vent.
"Tout est trempé. C'est la rosée de l'herbe. Il est temps d'y aller."
Et puis une forme se soulève, s'élance et s'élève, et nous passons, traînant des manteaux, le long du chemin vers les fenêtres éclairées, la faible lueur derrière les branches, et nous entrons ainsi dans la porte, et le carré dessine ses lignes autour de nous, et voici une chaise, une table, des verres, des couteaux, et ainsi nous sommes mis en boîte et logés, et nous aurons bientôt besoin d'un verre d'eau gazeuse et de trouver quelque chose à lire au lit.
Sur le fait d'être malade
Première publication en 1930
Si l'on considère combien la maladie est fréquente, combien est considérable le changement spirituel qu'elle apporte, combien sont étonnants, lorsque les lumières de la santé s'éteignent, les pays non découverts qui sont alors révélés, quels sont les déserts de l'âme qu'une légère attaque de grippe fait apparaître, quels sont les précipices et les pelouses parsemés de fleurs éclatantes que révèle une petite élévation de température, quels sont les chênes anciens et obstinés qui sont déracinés en nous par l'acte de la maladie, comment nous descendons dans le gouffre de la mort et sentons les eaux de l'annihilation se rapprocher de nos têtes, et comment nous nous réveillons en pensant que nous sommes en présence des anges et des harpistes, quand nous avons une dent arrachée et que nous remontons à la surface dans le fauteuil du dentiste et que nous confondons son "Rincez la bouche-rincez la bouche" avec le salut de la Déité qui se baisse du sol du Ciel pour nous accueillir - quand nous pensons à cela, comme nous sommes si souvent obligés d'y penser, il devient étrange que la maladie n'ait pas pris sa place avec l'amour, la bataille et la jalousie parmi les thèmes principaux de la littérature. On aurait pu penser que des romans auraient été consacrés à la grippe, des poèmes épiques à la typhoïde, des odes à la pneumonie et des textes aux maux de dents. Mais non ; à quelques exceptions près, De Quincey a tenté quelque chose de ce genre dans Le Mangeur d'opium ; il doit y avoir un ou deux volumes sur la maladie éparpillés dans les pages de Proust - la littérature fait de son mieux pour maintenir qu'elle se préoccupe de l'esprit ; que le corps est une feuille de verre ordinaire à travers laquelle l'âme regarde droit et clair et, à l'exception d'une ou deux passions telles que le désir et la cupidité, est nulle, négligeable et inexistante. Au contraire, c'est tout le contraire qui est vrai. Toute la journée, toute la nuit, le corps intervient ; il s'émousse ou s'aiguise, se colore ou se décolore, se transforme en cire dans la chaleur de juin, se durcit en suif dans le brouillard de février. La créature qui se trouve à l'intérieur ne peut que regarder à travers la vitre, tachée ou rose ; elle ne peut pas se séparer du corps comme la gaine d'un couteau ou la cosse d'un petit pois pendant un seul instant ; elle doit passer par tout le cortège sans fin de changements, la chaleur et le froid, le confort et l'inconfort, la faim et la satisfaction, la santé et la maladie, jusqu'à ce que vienne l'inévitable catastrophe ; le corps se brise en morceaux, et l'âme (dit-on) s'échappe. Mais il n'existe aucune trace de ce drame quotidien du corps. Les gens écrivent toujours sur les actions de l'esprit, les pensées qui lui viennent, ses nobles plans, comment l'esprit a civilisé l'univers. On le montre ignorant le corps dans la tourelle du philosophe, ou frappant le corps, comme un vieux ballon de football en cuir, à travers des lieues de neige et de désert à la poursuite d'une conquête ou d'une découverte. Ces grandes guerres que le corps mène avec l'esprit qui en est l'esclave, dans la solitude de la chambre à coucher contre l'assaut de la fièvre ou l'arrivée de la mélancolie, sont négligées. La raison n'est pas loin à chercher. Pour regarder ces choses en face, il faudrait le courage d'un dompteur de lions, une philosophie robuste, une raison enracinée dans les entrailles de la terre. Faute de quoi, ce monstre qu'est le corps, ce miracle qu'est sa douleur, nous feront bientôt basculer dans le mysticisme, ou nous élèveront, à grands coups d'ailes, dans les ravissements du transcendantalisme. Le public dirait qu'un roman consacré à la grippe manque d'intrigue, il se plaindrait qu'il n'y ait pas d'amour, à tort, car la maladie se déguise souvent en amour, et joue les mêmes tours. Elle divinise certains visages, nous fait attendre, heure après heure, le craquement d'un escalier, et donne une signification nouvelle aux visages des absents (qui sont assez simples dans la santé, Dieu sait), tandis que l'esprit leur concocte mille légendes et romances pour lesquelles il n'a ni le temps ni le goût dans la santé. Enfin, pour entraver la description de la maladie dans la littérature, il y a la pauvreté de la langue. L'anglais, qui peut exprimer les pensées d'Hamlet et la tragédie de Lear, n'a pas de mots pour le frisson et le mal de tête. Tout s'est développé à sens unique. La plus simple des écolières, lorsqu'elle tombe amoureuse, a Shakespeare ou Keats pour dire ce qu'elle pense à sa place ; mais qu'un malade essaie de décrire à un médecin une douleur à la tête et la langue se tarit aussitôt. Il n'y a rien de tout fait pour lui. Il est obligé d'inventer des mots lui-même et, prenant sa douleur dans une main et un morceau de son pur dans l'autre (comme l'ont peut-être fait les gens de Babel au début), de les écraser ensemble de manière à ce qu'un mot tout nouveau en sorte. Ce sera probablement quelque chose de risible. Car qui, d'origine anglaise, peut prendre des libertés avec la langue ? Pour nous, c'est une chose sacrée et donc condamnée à mourir, à moins que les Américains, dont le génie est tellement plus heureux dans la création de mots nouveaux que dans la disposition des anciens, ne viennent à notre aide et ne fassent jaillir les sources. Mais ce n'est pas seulement d'une langue nouvelle, plus primitive, plus sensuelle, plus obscène, dont nous avons besoin, c'est d'une nouvelle hiérarchie des passions ; l'amour doit être supprimé au profit d'une température de 104 ; la jalousie doit céder la place aux affres de la sciatique ; l'insomnie doit jouer le rôle du méchant, et le héros devenir un liquide blanc au goût sucré - ce Prince puissant aux yeux de mites et aux pieds emplumés, dont l'un des noms est Chloral.
Mais revenons à l'invalide. "Je suis au lit avec la grippe" - mais qu'est-ce que cela transmet de la grande expérience ; comment le monde a changé de forme ; les outils des affaires sont devenus lointains ; les sons de la fête deviennent romantiques comme un manège entendu à travers des champs lointains ; et les amis ont changé, certains ont acquis une beauté étrange, d'autres se sont déformés jusqu'à devenir des crapauds, tandis que tout le paysage de la vie est lointain et beau, comme le rivage vu d'un navire au large, et il est maintenant exalté sur un sommet et n'a pas besoin de l'aide des hommes ou de Dieu, l'expérience ne peut être transmise et, comme c'est toujours le cas avec ces choses muettes, sa propre souffrance ne sert qu'à réveiller dans l'esprit de ses amis le souvenir de leurs influences, de leurs maux et de leurs douleurs qui n'ont pas été pleurés en février dernier, et qui crient maintenant à haute voix, désespérément, en réclamant le soulagement divin de la sympathie. Mais la sympathie, nous ne pouvons pas l'avoir. Le plus sage des destins dit non. Si ses enfants, déjà accablés par le chagrin, se chargeaient de ce fardeau, ajoutant en imagination d'autres douleurs aux leurs, les bâtiments cesseraient de s'élever, les routes se transformeraient en chemins herbeux, la musique et la peinture cesseraient d'exister, un seul grand soupir s'élèverait vers le ciel, et les seules attitudes des hommes et des femmes seraient celles de l'horreur et du désespoir. En réalité, il y a toujours une petite distraction - un orgue de Barbarie au coin de l'hôpital, une boutique de livres ou de bibelots pour nous faire passer devant la prison ou l'hospice, une absurdité de chat ou de chien pour nous empêcher de transformer le vieux hiéroglyphe de misère du mendiant en volumes de souffrance sordide ; et ainsi, le vaste effort de sympathie que ces baraques de douleur et de discipline, ces symboles desséchés de la douleur, nous demandent d'exercer en leur faveur, est malencontreusement remis à plus tard. De nos jours, la sympathie est surtout dispensée par les traînards et les ratés, des femmes pour la plupart (chez qui le désuet côtoie si étrangement l'anarchie et la nouveauté), qui, ayant abandonné la course, ont du temps à consacrer à des excursions fantastiques et peu rentables ; C. L., par exemple, qui, assis sur une chaise, s'est mis à faire de l'exercice. L., par exemple, qui, assis au coin du feu de la chambre de malade, reconstitue, par touches à la fois sobres et imaginatives, le garde-manger, le pain, la lampe, les orgues de Barbarie dans la rue, et tous les contes simples de vieilles femmes, de pinafores et d'escapades ; A. R., le téméraire, le magnanime, qui, s'il vous prenait l'envie d'une tortue géante pour vous consoler ou d'un théorbe pour vous égayer, mettait à sac les marchés de Londres et se les procurait d'une manière ou d'une autre, enveloppés dans du papier, avant la fin des jours ; le frivole K. T., qui, vêtue de soies et de plumes, poudrée et peinte (ce qui prend aussi du temps) comme pour un banquet de rois et de reines, passe toute sa clarté dans la pénombre de la chambre du malade, et fait sonner les flacons de médicaments et s'enflammer les flammes avec ses ragots et ses mimiques. Mais de telles folies ont fait leur temps ; la civilisation vise un autre but ; et alors quelle place y aura-t-il pour la tortue et le théorbe ?
Il y a, avouons-le (et la maladie est le grand confessionnal), un franc-parler enfantin dans la maladie ; on dit des choses, on laisse échapper des vérités, que la respectabilité prudente de la santé dissimule. La sympathie, par exemple - nous pouvons nous en passer. Cette illusion d'un monde si façonné qu'il fait écho à chaque gémissement, d'êtres humains si liés par des besoins et des craintes communs qu'un tic à un poignet en fait trembler un autre, où, si étrange que soit votre expérience, d'autres l'ont vécue aussi, où, si loin que vous alliez dans votre propre esprit, quelqu'un y est passé avant vous, tout cela est une illusion. Nous ne connaissons pas nos propres âmes, et encore moins celles des autres. Les êtres humains ne vont pas main dans la main tout au long du chemin. Il y a une forêt vierge dans chacun d'eux ; un champ de neige où même l'empreinte des pattes des oiseaux est inconnue. Ici, nous allons seuls, et c'est mieux ainsi. Avoir toujours de la sympathie, être toujours accompagné, être toujours compris serait intolérable. Mais dans la santé, il faut continuer à faire semblant d'être sympathique et renouveler l'effort - communiquer, civiliser, partager, cultiver le désert, éduquer l'indigène, travailler ensemble le jour et la nuit pour faire du sport. Dans la maladie, ces faux-semblants cessent. Dès que le lit est réclamé, ou que, enfoncés dans les coussins d'un fauteuil, nous levons les pieds d'un pouce au-dessus du sol sur un autre, nous cessons d'être des soldats dans l'armée des droits, nous devenons des déserteurs. Ils marchent au combat. Nous flottons avec les bouts de bois sur le ruisseau, dans le désordre avec les feuilles mortes sur la pelouse, irresponsables et désintéressés et capables, peut-être pour la première fois depuis des années, de regarder autour de nous, de lever les yeux, de regarder le ciel, par exemple.
La première impression de ce spectacle extraordinaire est étrangement bouleversante. D'ordinaire, il est impossible de regarder le ciel pendant un certain temps. Les piétons seraient gênés et déconcertés par un observateur public du ciel. Les bribes que nous en obtenons sont mutilées par les cheminées et les églises, servent de fond à l'homme, signifient le temps humide ou le beau temps, dorent les fenêtres et, en remplissant les branches, complètent le pathos des platanes d'automne échevelés dans les places d'automne. Et voilà qu'en s'allongeant, en regardant droit devant soi, on découvre que le ciel est si différent de tout cela que c'en est vraiment choquant. C'est donc ce qui s'est passé pendant tout ce temps sans que nous le sachions !Cette incessante création de formes et leur rejet, ce brassage de nuages qui attire de vastes trains de navires et de wagons du Nord au Sud, ce va-et-vient incessant de rideaux d'ombre et de lumière, cette interminable expérience avec des rayons d'or et des ombres bleues, avec le voilement et le dévoilement du soleil, avec la création de remparts de roches et leur rejet, cette activité sans fin, avec le gaspillage de Dieu sait combien de millions de chevaux-vapeur d'énergie, a été laissée à sa volonté année après année. Ce fait semble appeler un commentaire et même une censure. Ne faudrait-il pas que quelqu'un écrive au Times ? Il faut s'en servir. On ne devrait pas laisser ce gigantesque cinéma jouer perpétuellement devant une salle vide. Mais regardez un peu plus longtemps et une autre émotion noie les remous de l'ardeur civique. Divinement beau, il est aussi divinement sans cœur. Des ressources incommensurables sont utilisées dans un but qui n'a rien à voir avec le plaisir ou le profit humain. Si nous étions tous allongés, raides, immobiles, le ciel expérimenterait ses bleus et ses ors. Peut-être alors, si nous regardons quelque chose de très petit, proche et familier, nous trouverons de la sympathie. Examinons la rose. Nous l'avons si souvent vue fleurir dans des boules, nous l'avons si souvent associée à la beauté dans sa primeur, que nous avons oublié comment elle se tient, immobile et stable, pendant tout un après-midi dans la terre. Elle conserve un comportement d'une dignité et d'une assurance parfaites. L'étalement de ses pétales est d'une justesse inimitable. Maintenant, peut-être une tombe-t-elle délibérément ; maintenant, toutes les fleurs, les voluptueuses violettes, les crémeuses, dans la chair cireuse desquelles la cuillère a laissé un tourbillon de jus de cerise ; les glaïeuls ; les dahlias ; les lys, sacerdotaux, ecclésiastiques ; les fleurs aux cols de carton apprêté teintés d'abricot et d'ambre, toutes inclinent doucement leur tête vers la brise - toutes, à l'exception du lourd tournesol, qui reconnaît fièrement le soleil à midi et qui, peut-être à minuit, rabroue la lune. Elles sont là, et c'est de ces choses, les plus calmes, les plus autonomes, que les êtres humains ont fait des compagnes, celles qui symbolisent leurs passions, décorent leurs fêtes et reposent (comme si elles connaissaient le chagrin) sur les oreillers des morts. Merveilleux à raconter, les poètes ont trouvé la religion dans la nature ; on vit à la campagne pour apprendre la vertu des plantes. C'est dans leur indifférence qu'elles sont réconfortantes. Ce champ de neige de l'esprit, où l'homme n'a pas marché, est visité par le nuage, embrassé par le pétale qui tombe, comme, dans une autre sphère, ce sont les grands artistes, les Miltons et les Papes, qui consolent non par leur pensée de nous, mais par leur oubli.
Pendant ce temps, avec l'héroïsme de la fourmi ou de l'abeille, quelle que soit l'indifférence du ciel ou le dédain des fleurs, l'armée des hommes droits marche au combat. Mme Jones attrape son train. M. Smith répare son moteur. Les vaches sont conduites à la maison pour être traites. Les hommes couvrent le toit de chaume. Les chiens aboient. Les corbeaux, s'élevant en filet, tombent en filet sur les ormes. La vague de la vie se jette inlassablement. Seuls les gisants savent ce que, après tout, la nature ne se donne pas la peine de cacher, à savoir qu'elle finira par vaincre ; la chaleur quittera le monde, nous cesserons de nous traîner dans les champs, la glace s'épaissira sur les usines et les machines, le soleil s'éteindra. Même ainsi, lorsque la terre entière sera recouverte d'une pellicule glissante, quelque ondulation, quelque irrégularité de surface marquera la limite d'un ancien jardin, et là, dressant sa tête imperturbable à la lumière des étoiles, la rose fleurira, le crocus brûlera. Mais avec le crochet de la vie encore en nous, nous devons encore nous tortiller. Nous ne pouvons pas nous raidir paisiblement dans des monticules vitreux. Même les personnes couchées se lèvent à la simple imagination du gel sur les orteils et s'étirent pour profiter de l'espoir universel - le ciel, l'immortalité. Il est certain que, puisque les hommes ont souhaité tout au long de ces âges, ils ont souhaité que quelque chose existe ; il y aura quelque île verte sur laquelle l'esprit pourra se reposer, même si le pied ne peut s'y planter. L'imagination coopérative de l'humanité doit avoir dessiné quelque contour ferme. Mais non. On ouvre le Morning Post et on lit l'évêque de Lichfield sur le paradis. On regarde les fidèles se ranger dans ces temples galants où, le jour le plus sombre, dans les champs les plus humides, les lampes brûleront, les cloches sonneront, et même si les feuilles d'automne s'agitent et que les vents soupirent à l'extérieur, les espoirs et les désirs se transformeront en croyances et en certitudes à l'intérieur. Ont-ils l'air serein ? Leurs yeux sont-ils remplis de la lumière de leur conviction suprême ? L'un d'entre eux oserait-il sauter directement au ciel depuis Beachy Head ? Seul un simplet se poserait de telles questions ; la petite compagnie de croyants traîne, traîne et s'égare. La mère est usée, le père fatigué. Quant à imaginer le paradis, ils n'ont pas le temps. La création du ciel doit être laissée à l'imagination des poètes. Sans leur aide, nous ne pouvons qu'imaginer Pepys au Paradis, faire de petits entretiens avec des personnes célèbres sur des touffes de thym, tomber bientôt dans le bavardage sur ceux de nos amis qui sont restés en Enfer, ou, pire encore, revenir sur terre et choisir, puisqu'il n'y a pas de mal à choisir, de vivre encore et encore, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que capitaine de navire, en tant que dame de la cour, en tant qu'empereur ou en tant que femme de fermier, dans des villes splendides et sur des landes éloignées, à l'époque de Périclès ou d'Arthur, de Charlemagne ou de Georges IV - pour vivre et vivre jusqu'à ce que nous ayons épuisé ces vies embryonnaires qui nous entourent dans notre prime jeunesse jusqu'à ce que "je" les supprime. Mais "je" n'usurpera pas non plus le Ciel, si l'on veut, et ne nous condamnera pas, nous qui avons joué notre rôle ici en tant que William ou Alice, à rester William ou Alice pour toujours. Livrés à nous-mêmes, nous spéculons ainsi charnellement. Nous avons besoin que les poètes imaginent pour nous. Le devoir de créer des cieux devrait être attaché à la fonction de poète lauréat.
C'est en effet vers les poètes que nous nous tournons. La maladie nous rend peu enclins aux longues campagnes qu'exige la prose. Nous ne pouvons pas faire appel à toutes nos facultés et garder notre raison, notre jugement et notre mémoire au garde-à-vous pendant que les chapitres se succèdent et que, lorsqu'un chapitre se met en place, nous devons guetter l'arrivée du suivant, jusqu'à ce que l'ensemble de la structure - arches, tours et créneaux - repose fermement sur ses fondations. Le Déclin et la Chute de l'Empire romain n'est pas le livre de la grippe, pas plus que Le Bol d'or ou Madame Bovary. D'un autre côté, avec la responsabilité mise de côté et la raison en suspens - car qui va exiger la critique d'un invalide ou le bon sens d'un grabataire ? - d'autres goûts s'affirment, soudains, irréguliers, intenses. Nous privons les poètes de leurs fleurs. Nous brisons une ligne ou deux et les laissons s'ouvrir dans les profondeurs de l'esprit :
et souvent, la nuit
visite les troupeaux le long des prairies crépusculaires
errant en troupeaux épais le long des montagnes
guidés par le vent lent et réticent.
Ou bien il y a tout un roman en trois volumes à méditer dans un vers de Hardy ou une phrase de La Bruyère. Nous nous plongeons dans les Lettres de Lamb - certains prosateurs doivent être lus comme des poètes - et trouvons "Je suis un meurtrier sanguinaire du temps, et je le tuerais bien à l'instant. Mais le serpent est vital", et qui expliquera ce plaisir ? ou ouvrons Rimbaud et lisons :
O saisons o châteaux
Quelle âme est sans défaut ?
et qui va rationaliser ce charme ? Dans la maladie, les mots semblent posséder une qualité mystique. Nous saisissons ce qui se trouve au-delà de leur signification superficielle, nous recueillons instinctivement ceci et cela - un son, une couleur, ici un accent, là une pause - que le poète, sachant que les mots sont maigres par rapport aux idées, a éparpillés sur sa page pour évoquer, une fois rassemblés, un état d'esprit que ni les mots ne peuvent exprimer ni la raison expliquer. L'incompréhensibilité a un pouvoir énorme sur nous dans la maladie, plus légitimement peut-être que le droit ne le permet. Dans la santé, le sens a empiété sur le son. Notre intelligence domine nos sens. Mais dans la maladie, la police n'étant pas en service, nous nous glissons sous quelque obscur poème de Mallarmé ou de Donne, quelque phrase en latin ou en grec, et les mots dégagent leur parfum et distillent leur saveur, et alors, si finalement nous saisissons le sens, il est d'autant plus riche qu'il nous est venu d'abord sensuellement, par le palais et les narines, comme une odeur étrange. Les étrangers, à qui la langue est étrangère, sont désavantagés. Les Chinois doivent connaître le son d'Antoine et Cléopâtre mieux que nous.
L'audace est l'une des propriétés de la maladie - hors-la-loi que nous sommes - et c'est d'audace dont nous avons besoin pour lire Shakespeare. Ce n'est pas que nous devions nous assoupir en le lisant, mais que, pleinement conscients et conscientes, sa renommée intimide et ennuie, et que toutes les opinions de tous les critiques émoussent en nous ce coup de tonnerre de conviction qui, s'il est une illusion, est encore une illusion si utile, un plaisir si prodigieux, un stimulant si vif dans la lecture des grands. Shakespeare est en train de s'envoler ; un gouvernement paternel pourrait bien interdire d'écrire sur lui, comme il a mis son monument à Stratford hors de la portée des doigts qui griffonnent. Avec tout ce bourdonnement de critiques, on peut hasarder ses conjectures en privé, prendre des notes dans la marge ; mais, sachant que quelqu'un l'a déjà dit ou l'a mieux dit, l'enthousiasme disparaît. La maladie, dans sa sublimité royale, balaie tout cela et ne laisse que Shakespeare et soi-même. Avec son pouvoir démesuré et notre arrogance démesurée, les barrières tombent, les nœuds s'aplanissent, le cerveau sonne et résonne avec Lear ou Macbeth, et même Coleridge lui-même couine comme une souris lointaine.