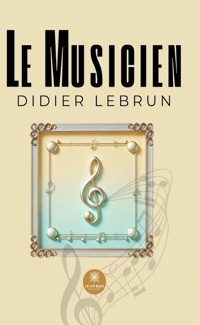
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
"Le Musicien" est une œuvre, au carrefour de la psychologie et de la sociologie, invitant à une immersion dans les méandres de l’âme d’un homme en proie à un déchirement intérieur. Poursuivi par une quête insatiable de perfection artistique, il se heurte à une succession d’échecs qui nourrissent une amertume sans cesse croissante. Ses frustrations le conduisent à envisager l’impensable : éliminer ses rivaux pour s’affranchir de la souffrance qu’ils provoqueront. Cependant, le sort le prive de cette ultime libération. À travers une écriture ciselée, le lecteur est entraîné dans un voyage au cœur d’un esprit tourmenté, où la musique, tour à tour refuge et geôle, façonne une existence dont il semble impossible de se défaire. Un récit, à la croisée de la passion et de la tragédie, qui dévoile les abîmes de la psyché humaine, dans ses combats avec l’Histoire.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Fort de quarante années d’écriture en parallèle de sa carrière dans les sciences humaines,
Didier Lebrun publie son premier roman, "Le Musicien". Inspiré par les récits de ses proches, il réinvente librement leur histoire tout en respectant l’authenticité du contexte et les bouleversements du XXᵉ siècle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Didier Lebrun
Le Musicien
Roman
© Lys Bleu Éditions – Didier Lebrun
ISBN : 979-10-422-4840-6
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
On ne doit parler, on ne doit écrire que pour l’instruction ; et s’il arrive que l’on plaise, il ne faut pas néanmoins s’en repentir, si cela sert à insinuer et à faire recevoir les vérités qui doivent instruire.
Les Caractères, Jean de La Bruyère
Ouverture
Un univers s’effondre en vous, dont l’abondance à souffrir est inouïe.
Londres, Louis-Ferdinand Céline
Le Musicien aimait le travail bien fait. Il ne s’était jamais connu autrement.
Il n’est pas exagéré de le qualifier de perfectionniste. Le perfectionniste est celui qui cherche une efficacité sans faille au regard d’un résultat strictement défini ; c’est aussi celui qui ne peut s’empêcher de trouver à son geste une dimension esthétique, comme si celui-ci était à lui-même sa propre référence, à la manière de la poésie qui, par le rythme qu’elle imprime au langage, ne se réfère qu’à lui et non au monde (pour le dire néanmoins, mais autrement).
Et ça se complique quand on s’aperçoit que les deux, efficacité et esthétique, doivent concourir sans s’annihiler !
Mais ce n’est pas tout. Chez notre musicien, cela s’épaississait du fait qu’un travail résultait d’un engagement : quelqu’un attendait de lui qu’il répondît à sa demande, et si ce quelqu’un était lui-même, l’engagement se trouvait saturé d’exigences éthiques qui devaient traverser son geste de part en part. Il valait mieux ne rien faire plutôt que mal le faire.
Autrement dit, c’était sa vie qu’il y mettait en jeu : en toutes choses à faire, il mettait un point d’honneur à se trouver en accord avec ses valeurs.
De tout cela, il ne parlait pas, mais se morfondait jusqu’à la culpabilité quand le poids des circonstances l’obligeait à déroger.
Aussi, bouillonnaient en lui des tourbillons de réflexions agitées qu’il aurait été bien en peine d’expliciter, mais qui lui procuraient une sensibilité de radar pour détecter le moindre écart à la norme qu’il se donnait du monde et son train.
Dès lors, comprendra-t-on qu’en matière d’assassinat, là, moins que pour d’autres savoir-faire, il n’ait recherché la perfection.
Mais tuer un être vivant, humain ou animal, n’était pas dans ses habitudes ; il n’était ni rodé, ni même enclin. Quand un poulet ou un lapin devait être sacrifié, il portait la bête chez un ancien de la primaire qui se faisait un malin plaisir de le moquer pour tant de délicatesse.
C’est dire si, pour cette première et unique expérience de la mort à donner – et il ne voyait aucune autre raison d’y recourir à nouveau –, il se sentait soulevé par une motivation qui le dépassait ; ce n’était plus une motivation d’ailleurs, s’était-il dit, mais un impératif, une obligation, un devoir, qui ne souffraient d’aucune hésitation. Ne pas s’y soumettre eût été effacer du monde le sens que sa vie y avait trouvé.
La motivation, il alla la chercher dans le choix du modus operandi. Il redoubla de précautions ; pour ne pas rater son coup, certes, mais bien plus, dans le respect de la hiérarchie de ses valeurs, pouvoir encore se dire que le travail serait bien fait. Il s’était documenté sur l’art et la manière d’exécuter un crime parfait, et qui par surcroît le satisfît du point de vue esthétique. De Jack l’Éventreur à Landru, il avait tout étudié dans les moindres détails, repérant les erreurs à ne pas commettre et critiquant les fautes de goût. Ce qu’il voulait en premier lieu, pour asseoir sa vengeance (c’était son moteur premier), que la mort ne fût pas spontanée, mais qu’elle arrivât lentement pour que la cible pût à son tour sentir, jusqu’au fond des tripes, les morsures de l’injustice, ce qui pour lui ne devait être qu’un juste retour des choses. Son tribunal intérieur n’était plus, alors, en phase avec les lois communes.
Tout avait été répété dans sa tête à de multiples reprises, comme un morceau de musique, s’était-il dit, l’action devant se dérouler comme par automatisme, sans qu’il eût à penser à ce qu’il faisait. Trop conscient de son statut de débutant, il n’était pas question qu’il se laissât aller à un jeu d’improvisation par trop risqué – ce pour quoi il avait été reconnu au cours de sa carrière, mais il était alors armé de son instrument avec lequel il n’avait jamais eu qu’à tuer quelques canards, et encore il y avait bien longtemps, du temps de son apprentissage…
Malheureusement – en réalité heureusement pour lui –, la vie ne se règle pas comme du papier à musique. Là où, dans l’interprétation d’une partition, tout dépendait de lui, de la conception à la réalisation – aucun écart envisageable –, ici, bien d’autres paramètres qu’il ne pouvait maîtriser étaient susceptibles de venir enrayer la belle mécanique qu’il avait échafaudée.
C’est pourquoi, en cette fin d’après-midi, perçut-il très vite, au débouché de la rue où il se rendait de son pas lent, déterminé, bien qu’alourdi de chaussures trop grandes et d’une gabardine empesée, qu’un grain de sable s’était introduit faisant planer une menace pour la bonne exécution de son plan.
La rue devait être déserte, comme la plupart du temps. Or, en y arrivant, de loin, il aperçut un halo intermittent de lumières bleues, puis, en se rapprochant, un attroupement ; comme une manifestation. Contrarié, mais poussé par les forces telluriques de son projet, il se dit tout de même que cela pouvait être négligé, et il s’était fondu dans la foule coagulée devant lui. Ça se gâtait, il n’y avait pas que la populace, les pompiers et deux ambulances étaient là aussi, noyau spectaculaire de l’événement. Il avait dû longer la file des véhicules dont les premiers, stoppés par la curiosité, avaient formé un bouchon aux suivants qui s’étaient complaisamment prêtés à l’aubaine de cette possibilité de distraction voyeuriste. L’artère, qui s’étirait en ligne droite jusqu’aux confins d’une campagne déserte, n’était habituellement jamais encombrée ; elle s’était embolisée. Les gyrophares ne laissaient pas de doute, il y avait eu un accident ; pour amasser tant de gens, ça devait être grave. Et pour combler le tout, les gendarmes étaient de la partie. De loin, il en vit trois qui contenaient les curieux agglutinés pour permettre aux hommes de l’art d’accomplir leur tâche en toute tranquillité.
D’un coup, le Musicien se sentit vidé. De l’accident, il se contrefichait. Mais pourquoi fallait-il que tous ces imbéciles soient venus se planter juste à cet endroit, et ce jour-là, à l’heure exacte du déroulement de son scénario ?
Il se faufila aussi près qu’il le put vers les premiers rangs, toujours plus compacts. Des habitants du quartier. Il en reconnaissait. Du bas de sa petite taille et du haut de ses soixante-douze ans, il fut vite bloqué. Les traits exprimaient la stupéfaction ; on s’interpellait du regard, on se retournait pour chercher un visage connu, se rassurer : « Ouf, il est là, c’est pas lui. » On tendait le cou pour profiter du spectacle et témoigner, ça y allait : « Vous voyez quelque chose ? Qu’est-ce qui se passe ? On pourrait nous dire ce qui se passe… » Des corbeaux… mais qui croassaient en sourdine, posant sur la rue une couverture ouatée d’où les sons ne sortaient que contenus, en retrait des énonciations claires, de ceux qui se propagent dans les églises, venus de touristes ébahis et que la force du lieu retient de s’exclamer. Ici, c’était la force de l’événement, qui sentait le drame. Un échange lui parvint :
« Il y a combien de voitures, un gars saoul qui s’est planté tout seul ?
— Mais non, pas plus d’accidents que de beurre en branche, vous n’y êtes pas, c’est au 176… »
Le 176, c’était la plus belle et la plus grande maison du quartier. Les propriétaires avaient aussi acheté le 174, fait abattre les deux maisons mitoyennes et construire leur vaste demeure qu’on regardait maintenant avec envie ou respect. Tout le monde s’accordait pour dire qu’il y avait là un signe manifeste de richesse. Le Musicien avait ses certitudes sur l’origine de cette richesse et quand il comprit que l’événement qu’il n’avait pas prévu et qui venait bousculer ses plans se produisait justement à ce fameux 176, il perdit pied et tenta de se raccrocher au bras de son voisin qui, trop envoûté par l’intensité du moment, ne s’aperçut de rien. Il sentit son menton trembler. Au 176 ! Un temps, la scène à laquelle il assistait s’évanouit dans le fond de son cerveau, pris dans un tourbillon de pensées au carrefour de l’effarement, de la stupéfaction, de l’impuissance et d’une colère blanche poussée au levain d’un ressentiment qu’une vie entière consacrée à l’Art, et flouée, avait fait naître. Comment cela était-il possible, le mauvais œil était sur lui, ou quoi, la justice divine s’abattait ? Il ne croyait à rien qu’à ce qu’il avait vécu et qu’il était venu là parachever (racheter aussi, car il plaçait ses exigences morales à la hauteur de ses exigences techniques, pour lui c’était tout un) ; et le destin se mettait – encore – en travers de sa route. Quelques secondes, il refit surface, crut se reprendre en se disant que tout n’était peut-être pas perdu, qu’une autre occasion se présenterait. Il n’allait pas tarder à se rendre compte en quoi ses tentatives de raisonnement avaient perdu toute assise logique.
Des questions, des réponses, des remarques lui parvenaient, sorties en minces filets incandescents du magma feutré que cent bouches sidérées se retenaient d’expulser :
« Ils ont déjà sorti une civière, mais on ne voyait rien, il y avait un corps, c’est sûr, empaqueté dans une housse blanche…
— Les pompiers ont des masques, ça doit puer…
— Ça ne m’étonne pas, fallait bien que ça arrive un jour…
— Depuis le temps qu’on ne les avait pas vus…
— Mais pourquoi vous n’avez pas donné l’alerte, alors, on laisse pas les gens comme ça…
— Peut-être, mais vous pouvez pas les forcer non plus. C’étaient de vrais solitaires, ils avaient de quoi pourtant, c’est pas l’argent qui manquait, ils auraient pu avoir au moins une employée de maison, mais non, ils voulaient rester seuls et puis, je crois que c’étaient aussi de vrais macbruns…
— Des quoi ?
— Des macbruns, des mangeurs de merde, des radins si vous voulez, des rapias, des grippe-sous.
— En tout cas, y en a un qui est mort, c’est sûr, mais l’autre est mort aussi, c’est ça ?
— Taisez-vous, le capitaine parle… »
Le Musicien réussit à se glisser jusqu’au deuxième rang, et entre deux épaules, à voir sortir de la maison à colonnades une autre civière sur laquelle un corps invisible moulait sommairement une housse blanche identique à la première. Un pompier, jeune, suivait ses collègues porteurs. Tous avaient un masque. Il enleva le sien. Il était aussi blanc que le linceul de plastique et en franchissant le pas de la porte, comme il n’avait rien à faire d’autre qui eût pu lui permettre de se mobiliser et de vaincre le dégoût qui le submergeait, il se mit à vomir en se retournant contre le mur.
« … je comprends que vous soyez choqués, mais il ne sert à rien de rester là, vous en apprendrez certainement davantage dans la presse, tout ce que je peux vous dire c’est que la procédure va nous obliger à demander une autopsie des corps et…
— … et la presse, comment elle va pouvoir informer si vous ne lui dites rien ? (C’était le localier du Courrier qui se sentait tout aussi frustré que le peuple en émoi.)
— Mais… et le rapport ? Vous passerez à la brigade… »
Ce fut tout ce que le Musicien fut capable d’entendre. Il verrouilla ses sphincters, pour contenir une douleur affreuse qui lui vrillait le bas ventre ; lui aussi allait tout lâcher.
La foule le compressait, il se sentit étouffé. Avec difficulté, il quitta le noyau des curieux, pour retrouver un air respirable parmi les électrons qui gravitaient autour, certains se dandinant sur la pointe des pieds pour capter des bribes de l’action, d’autres plus fouineurs cherchant un passage, les derniers tournoyant à distance dans l’attente d’un dénouement. Plus rien ne le retenait dans cette orbite. Il sentit de nouveau son menton trembler, irrépressiblement, qu’il dissimula dans son col, accentuant la voussure de son dos, tout en enfonçant ses mains dans les poches de son manteau ; puis une vague monta de ses entrailles, une douleur aiguë passa l’isthme de sa gorge et ressortit sous la forme de grosses larmes dans le sillage desquelles deux lits, sans cesse alimentés, creusaient maintenant plus profondément ses joues déjà parcheminées.
Sa trajectoire excentrée et zigzagante fut remarquée par plusieurs. Une femme qui l’avait reconnu s’en inquiéta et l’aborda :
« Ho ! Le Musicien, ça vous touche forcément, ça ne va pas ? Vous voulez vous asseoir ? C’est bien vous qui leur avez appris la musique aux frères Duret ; en fait, leur école de musique, c’est grâce à vous qu’ils ont pu l’ouvrir, c’est un peu la vôtre, non… Voyant qu’il ne réagissait pas, qu’au contraire à cette dernière évocation il se renfermait davantage sur lui-même, elle tenta une autre voie d’accès pour le faire sortir de son mutisme… Ah ! On peut dire que vous nous avez fait danser ! Je me rappelle au Bamako, qu’est-ce que c’était bien ! Même que quand vous jouiez un morceau de jazz, on restait scotchés sur place, tellement c’était bien, c’était le bon temps… Il ne réagissait toujours pas… D’ailleurs, c’est là qu’on s’est rencontrés avec mon mari… » tenta-t-elle une dernière fois pour le dérider.
Il ne s’arrêta même pas, emporté par son torrent de chagrin qui ne pouvait contenir et dont elle venait d’augmenter le débit en croyant lui témoigner la marque de compassion attendue à la perte d’un proche.
Elle le regarda s’éloigner, d’abord stupéfaite ; puis un brin agacée, se disant pour elle-même : « Pfff… pourrait dire quelque chose tout de même… »
Le rapport du capitaine établit que ce vendredi 14 février 2003, à 18 heures, Mme Émilie J., signala par téléphone à la gendarmerie ce qu’elle considérait être une situation inquiétante concernant ses voisins, les frères Paul et Jean-Paul Duret, 68 ans, habitants au 176 de la rue de Lille, tous deux célibataires, qu’elle ne voyait plus depuis deux semaines environ, tout au moins Jean-Paul, qui seul sortait, car son frère handicapé depuis plusieurs années ne se montrait plus ; et circonstance aggravante, en passant devant leur pas de porte, elle précisa qu’elle sentit « comme une forte odeur de charogne » qu’ils ne purent lui expliquer puisque ses coups de sonnette restèrent sans réponse et que leur porte, selon toute vraisemblance, était fermée à clé. La gendarmerie, après avoir prévenu les pompiers et réquisitionné un serrurier, découvrit les corps sans vie des deux frères, dont l’un gisait au sol dans la cuisine, et l’autre, attablé dans la salle à manger et arrimé à son fauteuil roulant, semblait attendre dans une douleur figée un repas qui avait dû tarder à venir, pour ne jamais arriver à son destinataire. Le début de décomposition des cadavres et la forte odeur de charogne très justement signalée, qui prit à la gorge les différents intervenants, permirent au médecin des pompiers d’établir rapidement que la mort remontait bien à au moins quinze jours, avec un décalage de deux ou trois jours entre les deux personnes concernées, la dernière décédée étant celle retrouvée dans son fauteuil roulant.
Le Musicien était rentré chez lui, dégoulinant de larmes alourdies de souvenirs…
Premier mouvement
Dire/Ne pas dire
Ou
Langue maternelle et main paternelle
Ô Français ! Serez-vous donc toujours des enfants ?
L’Ami du peuple, Jean-Paul Marat, 13 août 1792
Ce samedi 26 mai 1945, au soir de son quinzième anniversaire, le Musicien animait pour la première fois un bal de quartier, dans le café Lessure transformé en boîte de nuit, tout à côté de la Sainte Famille où de jeunes filles s’étaient regroupées autour des fenêtres sur rue pour écouter les échos amaigris des airs à la mode.
Il était loin d’imaginer que l’accordéon sur lequel ses mains araignées sautillaient avec allégresse le pousserait, bien des années après, à se voir en assassin. Mais pour l’heure, il commençait d’écrire sa partition, hymne à la joie, du début à la fin ; à la vie, au bonheur, malgré ces années empuanties d’angoisse dont il avait fallu s’extraire, comme un mineur pris sous l’éboulement, avec les dents.
Le point final de la guerre en Europe avait été posé et tout le monde voulait danser. Comme les fleurs au printemps, les salles de bal avaient ouvert les unes après les autres, parfois l’une en face de l’autre, chacune avec sa clientèle ; on ne mélange pas les serviettes et les torchons, c’est comme une loi de physique sociale, même pendant ces moments, qu’on a qualifiés de liesse populaire à la Libération. Quand il fallait sauver sa peau, on était moins regardant sur celui ou celle qui vous tendait la main, mais maintenant que les urgences vitales étaient maîtrisées, le quant-à-soi reprenait force de loi. Et si le geste d’un curé de la ville avait étonné le Musicien, au jour de l’annonce du débarquement allié, c’était bien parce qu’il se posait en marge de cette loi : en passant devant la fenêtre ouverte de l’atelier de son père, l’homme de foi lui avait chaleureusement serré les mains qu’il savait être celles d’un anticlérical affiché, pour un peu, il l’aurait embrassé. Depuis, chacun avait signifié sa position, celle qu’il n’avait en réalité jamais quittée, et les nouveaux riches mettraient du temps à faire oublier les circonstances de leur ascension, plus de temps qu’il n’en faudra même aux cheveux des femmes tondues pour qu’ils repoussent.
Tout cela tapissait son quotidien, mais comme une toile de fond obligée, et pour l’instruire, son paternel en remettait régulièrement une couche. Mais lui était ailleurs.
Depuis longtemps, le Musicien avait rêvé d’être le maître de cérémonie, celui capable d’entraîner les gens dans leur ronde enivrante, lui en pleine lumière, eux fondus dans la pénombre de leur masse dansante. Peu importe si ce soir-là, la scène était réduite à deux bancs rapprochés l’un de l’autre sur lesquels il s’était installé, dominant la petite salle à l’arrière du café ; il voyait ainsi les têtes tournoyer deux à deux dans l’agencement d’une mécanique bien huilée, la sienne, formant une communauté de joie trop longtemps contenue, perturbée de temps en temps par le mouvement hésitant d’un couple maladroit qui provoquait tout à la fois une vague parasite et des éclats de rire.
Cette joie qu’il procurait par le flot des notes qui sortaient de son instrument était redoublée du plaisir qu’il avait d’en être l’exécutant. Plaisir parfois perverti par un canard qu’il était seul à remarquer, et qu’il ponctuait d’un froncement de sourcils, traduction physique d’une admonestation muette, tout intérieure. Mais le canard passait bien vite et il replongeait dans l’ivresse collective.
Il savait qu’il devait encore progresser ; il travaillait dur. Et encore, se disait-il, dur, non. Ce qui aurait été dur ç’aurait été de se sentir bloqué, incapable d’avancer dans la maîtrise de son instrument, malgré les efforts. Mais il en voulait toujours plus, il apprenait des morceaux de plus en plus difficiles, cherchait des accords compliqués. Tout passait, tout le remplissait. Ses professeurs, Monsieur Orlovsky, un Russe blanc que la diaspora avait déposé là en 1919, sous sa chapka et engoncé dans une immense pelisse sombre, pour le solfège, et Monsieur Debart pour l’accordéon, ne pouvaient plus rien lui apprendre. Il travaillait seul maintenant, des heures durant, dès qu’il le pouvait. De sa chambre où il répétait, sa mère affairée à la cuisine ou à ses travaux de couture était sa première auditrice, puis le son parvenait jusqu’à son père qui travaillait dans l’atelier de cordonnerie, mais n’entendait qu’un écho lointain, perturbé par les bruits de la rue et de ses machines ; son père partagé entre l’agacement de ne percevoir qu’un bruit discontinu d’où toute beauté avait été gommée, et la satisfaction de le voir s’adonner à un honnête loisir. Confort moral qui compensait aussi les approximations, les passages hachés par les fausses notes que le Musicien tenait à rattraper, reprenant inlassablement son erreur jusqu’à atteindre l’harmonie préétablie du morceau. Ça ne s’appelait pas répétition pour rien.
Mais ce 26 mai, il n’était plus seul avec son instrument, il avait un public, il pouvait enfin partager ce bonheur au-delà des mots, communiquer aux autres, par l’énergie contenue dans le soufflet de son accordéon, cet art éphémère de l’espace et du temps au carrefour desquels la musique et la danse célébraient leurs noces.
Il y avait là des têtes connues, d’autres moins ou pas du tout, venues de différents quartiers de la ville. Des soldats américains aussi. Les plus jeunes avaient son âge, qui recevaient les encouragements de leurs aînés, mais aussi des regards où se mêlaient bienveillance hypocrite et réprobation muette. C’étaient ceux des adultes qui avaient l’âge de leurs parents, et n’auraient pas permis à leur engeance de venir se dévergonder.
John, son grand copain de classe, d’un an plus vieux, était là avec Colette, sa toute nouvelle amie.
Girlfriend, disait-il en se délectant de pouvoir utiliser un mot anglais, lui qui depuis les quelques années de son arrivée en France avait dû, sans les oublier, les mettre en réserve. Sauf à la maison, où son père tenait à entretenir la langue maternelle de son fils. Il avait fait de même pour le français, outre-Manche, avant son retour en France avec lui, après la tuberculose de sa femme, morte en 36 ; il l’avait rencontrée chez Havilland, à Londres, où le patron de l’Usine l’avait envoyé faire un stage de bureau d’étude, en 28 ; elle, secrétaire de direction ; ils s’étaient plus, s’étaient mariés, John était né l’année suivante ; il était devenu bilingue, elle ne l’était pas, décision fut prise de rester en Angleterre ; le patron ne lui en avait pas tenu rigueur, il avait même été conciliant, au point de le réembaucher après son veuvage. C’était peu avant les nationalisations, la porte s’était refermée juste derrière lui et son fils.
John et Colette se connaissaient depuis deux mois à peine, et la chance leur avait souri ; son père, militaire en retraite, avait laissé libre cours à leur amourette le jour où il avait découvert le pedigree de John. En plus, celui-ci lui témoignait du respect, comme un soldat à son supérieur, et le port britannique hérité de sa mère avait étouffé toutes les craintes du père de Colette : il était reconnaissant aux Anglais, il s’était battu à leurs côtés, ils avaient payé le prix du sang en 1916. Colette était petite, toujours souriante et prête à rendre service. Elle ne voyait le mal nulle part. Son père la tenait pour naïve, mais elle savait dire non quand elle était confrontée à un comportement déplacé.
John s’était enhardi à l’inviter sur la piste et tournait autour d’elle avec plus ou moins de bonheur. Cela faisait en tout cas celui du Musicien qui n’aurait échangé sa place pour aucune femme au monde. Faire danser les autres, là était son plaisir.
Même si la guerre n’avait pas empêché la musique, elle avait pourtant muselé les enthousiasmes. Malgré les alertes, le couvre-feu, on avait continué de jouer, et de danser, mais comme entre les gouttes, plutôt par la force des choses, par instinct, en douce. Tout comme il avait bien fallu respirer, mais avec des poumons plombés, rétrécis. La vie en temps de guerre. Dès les premières semaines où la Bête avait été terrassée, chacun avait senti la camisole qui entravait la vie se desserrer, s’envoler comme une vieille peau morte, métamorphosée en joyeuse guirlande de Noël. Quand les Allemands étaient encore là, mais leurs préparatifs de départ visibles de tous, pas une façade de maison qui n’abritait un petit atelier de confection de drapeaux, de calicots bleus, blancs, rouges, prêts à pavoiser les rues, les places, les balcons, les cafés, les échoppes les plus modestes dès qu’ils auraient tourné les talons. D’un coup, l’acte même d’écouter de la musique, ou de danser, perdait sa signification conjuratoire ; si on écoutait à nouveau de la musique, si on dansait à nouveau, c’était parce qu’on le voulait librement, débarrassés du poids de la peur. Et cette liberté pleinement assumée décuplait la sensation du plaisir personnel, centuplé du fait d’être vécu avec d’autres, tout un peuple.
Une carmagnole autour du cadavre de la Bête, tout d’abord, puis la valse autour du Monde. Moment rare de communion dont le Musicien se sentait l’officiant, tout juste sorti d’une ténébreuse gestation pendant laquelle l’avenir qu’il s’était préparé dans l’ombre n’avait pas été vain.
Dès l’enfance, il s’était rêvé musicien ; et comme d’autres jouaient aux cowboys et aux Indiens, lui avait réussi à entraîner quelques voisins dans une tournée du quartier où ils mimaient les gestes d’un orchestre imaginé dont il guidait les mouvements. Depuis qu’il savait que le père de sa tante possédait un accordéon qui moisissait dans leur grenier, il ne pensait qu’à une chose, le récupérer. Mais pour en jouer, il fallait savoir en jouer. Il avait bien conscience qu’il devrait en passer par la case apprentissage. La fée Musique lui fit faire connaissance d’un nouvel ami, Jacques, fils des tenanciers du café le plus en vue, la Rotonde. Jacques avait le suprême attrait d’apprendre la musique, déjà. Le violon. Ça n’était pas l’instrument dont il rêvait, mais peu importe. L’autre lui dit que de toute façon, il fallait « commencer par le solfège, la théorie, si tu veux. Va à la Baraque, et demande Monsieur Orlovsky, c’est lui le professeur ».
Il connaissait l’endroit. En effet, quand on passait devant, on entendait des bribes de musique. La course d’obstacles ne lui faisait pas peur ; ses parents n’en furent pas un qui acceptèrent aussitôt, se disant que le temps d’une passade était toujours ça de gagné sur les bêtises. Et c’est tout tremblant qu’il se présenta chez ce Monsieur Orlovsky, impressionnant du haut de son mètre quatre-vingt-cinq d’où jaillissait une voix caverneuse et des « r » qui roulaient comme des cailloux. Il habitait à côté de la fameuse Baraque. Le courant passa tout de suite entre eux. Semaine après semaine, les leçons s’enchaînèrent, ses parents surpris d’une telle assiduité. Seul Orlovsky n’était pas étonné. Il l’invita rapidement à assister aux répétitions de son orchestre qui se déroulaient tout à côté, dans la Baraque. Il jouait du saxophone. Ce fut la consternation, l’éblouissement, une sorte de traversée du miroir qui faisait pénétrer dans un autre monde, le vrai monde, celui de la vie qu’il savait et sentait entamée, de l’autre côté, par la guerre et l’occupation. C’était un orchestre de zazous ; drôle de mot, lancé dès les années trente par Johnny Hess et Charles Trenet pour rallier les amateurs de swing, que par atavisme juvénile les moins de vingt ans s’appropriaient comme un drapeau, mais que les anciens, dont ils bousculaient les goûts musicaux, prononçaient avec une moue de dégoût. Le swing, le vrai, c’était leur credo. « Tu vois Petit, disait Orlovsky, le swing, c’est autre chose que la soupe qu’on nous sert à Radio Paris, Raymond Legrand, il a son rond de serviette là-bas, ils disent que c’est du jazz, mais c’est que de la musique de danse, du simili jazz symphonique, pour nous endormir, ça divertit, et la propagande nazie passe en douce comme ça. Le swing, c’est autre chose, crois-moi, t’en entendras pas à Radio Paris, ça leur fait trop peur, le swing c’est la pureté des nègres, c’est sauvage, ça bouscule. Et les nazis, ils aiment pas les nègres, pour eux, le swing, le jazz c’est de la musique de dégénérés. Tu comprends ? »
Il ne comprenait pas tout. Mais suffisamment pour envier cette façon de faire de la musique qui ouvrait d’autres horizons, et avait aussi l’avantage de venir planter un coin dans l’ordre voulu par l’occupant. Instinctivement, c’était enviable, et dans les mots de son professeur il sentait que lui et ses musiciens se vivaient résistants. Et il sentait bien : si le jazz avait été toléré par les nazis, depuis l’attaque de Pearl Harbor les morceaux américains étaient proscrits, alors, Orlovsky et les siens se faisaient un malin plaisir – mais c’était de toute façon un réel plaisir – de tonitruer du Armstrong, du Ellington, du Bechet…
Aux répétitions, il y avait une jeune fille de dix-neuf ans, spectatrice comme lui. Claudine. Il la trouvait belle, mais sut rapidement qu’il ne pouvait rien espérer d’autre que la regarder. Elle attendait la fin de la session pour partir ensuite avec un du groupe, son fiancé. S’il s’est longtemps souvenu d’elle, c’est qu’au moment des bombardements, à la Libération, elle a été retrouvée morte dans une cave.
Le dimanche suivant, l’accordéon du grand-oncle était devenu le sien, en promettant d’en prendre grand soin. Ça n’était qu’un diatonique, mais déjà un vrai instrument. Il ne fut pas long à se rendre compte qu’il n’était pas d’une grande fraîcheur, le soufflet essoufflé, quelques notes foireuses, autant de boutons inertes. Mais il avait un instrument, et comme il était doublement armé, d’une théorie normative, le solfège qu’il commençait d’apprendre sans effort, et d’une oreille absolue dont il n’avait pas encore conscience, il jouait dans sa tête autant que de son instrument. Mentalement, il bouchait les trous. D’autres se seraient lassés, lui réussissait à faire abstraction de ces défauts, et apprenait, apprenait, un rêve en coin pour le jour où il pourrait jouer de son propre accordéon, celui qu’il aurait élu parmi les autres.
Ce jour arriva en 1943 quand son père s’aperçut que ce qu’il prenait pour une passade était une vraie passion, et qu’il décida d’aller voir son professeur pour vérifier son intuition.
« Mais, Monsieur, vous ne vous rendez pas compte, lui dit Orlovsky, il a l’oreille absolue.
— L’oreille absolue, c’est quoi ça ?
— Ça veut dire que votre fils est capable de reconnaître les notes des sons sans référence à une note de base. On a tous au moins une oreille relative, c’est pour ça que tout le monde peut apprendre la musique, mais certains, une petite minorité, ont l’oreille absolue. Ceux-là n’apprennent pas la musique, l’apprentissage ne fait que la révéler, parce qu’elle est déjà en eux si vous voulez. »
Il regarda son fils avec l’incrédulité de celui qui venait de se rendre compte qu’il avait engendré une bête de foire, un animal rare.
Rassuré, il l’emmena à trente kilomètres de là, au chef-lieu, chez un marchand italien, Silvio Armandi, qui les accueillit à bras ouverts. Il n’avait plus beaucoup de clients et il y avait longtemps qu’on ne trouvait plus d’accordéons neufs – l’effort national de production avait banni les futilités. Il lui en proposa un qui lui sembla un bijou. Il n’avait que quarante-huit basses, trois rangées à la main droite, mais c’était son premier accordéon chromatique. « Papa, c’est celui-là que je veux. » Et son père l’acheta. Un bras. Il en prit conscience, et poussé par cet immense sacrifice financier pour ses parents, il se jura de leur montrer qu’ils n’avaient pas eu tort.
De ce jour, tout son temps libre y passa. Il abandonna ses lectures qu’il adorait pourtant, les livres de la Bibliothèque verte, Victor Hugo, Hector Malot, Erckmann-Chatrian, Jules Verne, Alexandre Dumas qui n’avaient été là que pour entretenir les capacités de son petit cerveau bouillonnant. Le jeudi, le dimanche, mais les jours d’école aussi, il se levait avant tout le monde et, posé dans l’escalier, réveillait la maisonnée au son de son accordéon. Il voulait la musique, toute la musique. Il accumulait les feuilles à portée de partition qui finirent par tapisser le sol de sa chambre. Grimoires cabalistiques que sa mère lui intima de ranger : « On ne peut plus circuler dans cette chambre, c’est devenu un vrai dépotoir », lui dit-elle sans agressivité. Il tendit des fils à linge auxquels il les accrocha. Le brassage de l’air les faisait voleter, et pour lui c’était comme si les notes en pattes de mouche qui envahissaient l’espace étaient aspirées par les boutons de l’accordéon quand il l’étirait, bientôt recrachées par le soufflet soudain rétracté.
Les progrès allèrent crescendo ; sa réputation aussi. Pour fêter le certificat d’études, et peut-être aussi galvanisés par la nouvelle toute récente du débarquement en Normandie, avec la fin probable du cauchemar, ses copains de classe le décidèrent à les accompagner avec son accordéon pour aller en jouer un air chez l’instituteur, en signe de reconnaissance. Et ce fut son premier auditoire. Il était rouge de jubilation, et estima qu’il n’avait pas massacré les quatre morceaux qu’il leur interpréta. De ce jour, il ne fut plus appelé que le Musicien, et l’envie de scène ne le quitta plus.
Hitler avait bien fait les choses. Il avait tiré sa révérence, et lui était prêt à entrer pour saluer le public. Il était seul encore sur cette scène du café Lessure qui n’en était pas une ; et pour cause, où se serait logé un autre musicien, dans le fatras des partitions qui là aussi encombraient les deux bancs qu’on lui avait installés, d’où il dominait la salle ? Il faisait ses armes, et ça le faisait rire tout en renforçant son enthousiasme, à moi maintenant de faire parler la poudre, se disait-il, alors que le cessez-le-feu avait été décrété. Mais il savait qu’un jour on lui ferait confiance, on reconnaîtrait son talent, et qu’il aurait sa place dans un orchestre, peut-être même son orchestre. Il se voyait déjà…
En attendant, ici ça tournait et ça chantait. Il ne comptait plus les Petit vin blanc, enfilés à la demande. À se saouler. Puis deux soldats américains s’étaient approchés. Le plus grand, une armoire à glace d’au moins deux mètres – c’est pas compliqué, lui debout sur ses bancs l’autre pouvait lui parler sans lever les yeux – s’est mis à se pencher sur ses partitions, à fouiller dedans. Ça ne lui plaisait pas, mais il n’allait pas se fâcher avec une armoire à glace qui avait traversé l’Atlantique pour le libérer. Surtout qu’il l’a vu se décorer le visage d’un sourire émerveillé, presque à en pleurer en se saisissant d’une feuille, à la regarder sous toutes les coutures, incapable de la déchiffrer, tout en attendant qu’il ait fini son morceau pour s’adresser à lui. Une armoire à glace émue, ça le surprit, il en fut ému aussi. Il ne comprenait évidemment rien à ce que l’autre lui racontait. Il appela John qui fit le pont entre eux deux. « Il dit que cette chanson vient de son État, et que si tu pouvais la jouer il serait le plus heureux des hommes. » C’étaitIt can’t be wrong. Il la joua. Et là, il n’en crut pas ses yeux, l’Américain lui avait glissé un billet sous la chaussure. Il ne pouvait pas s’arrêter de jouer pour ramasser cette obole, bien sûr, mais il bougea légèrement le pied sans pour autant risquer de la voir s’envoler et vérifia d’un coup d’œil discret qu’il ne s’était pas trompé, que l’autre ne lui avait pas refilé de la monnaie de singe, de celle que Roosevelt avait voulu inonder le marché français ; c’était bien du Franc qu’il avait là sous le pied. Il lui fit un It can’t be wrong d’anthologie, et quand il eut fini, avec les applaudissements des Américains repris par toute la salle, il n’eut pas besoin de la traduction de John pour comprendre que son client était enchanté et qu’il demandait à la réentendre. Un deuxième billet vint rejoindre le premier. À la fin de la soirée, il avait toute une liasse sous la chaussure, et quand il fit le compte, il n’en croyait pas ses yeux, et se dit qu’avec une seule chanson il venait de gagner en s’amusant bien plus que son père en travaillant dur pendant une semaine entière.
C’était l’euphorie, et la sienne avait un goût particulier. Il voyait les fêtards sortir de partout, en grappes bruyantes, comme des essaims bourdonnant ; en se croisant, ils s’apostrophaient d’un trottoir à l’autre, avec des « Vive la liberté » qu’ils mettraient encore quelques mois à épuiser. Le Musicien se sentait doublement euphorique. Comme tout le monde, il goûtait le miel d’une séquence historique exceptionnelle, mais il ne se voyait pas comme tout le monde. Avec un brin d’orgueil au fond de lui, il se voyait comme une sorte d’apiculteur qui avait su transformer la matière brute de la liberté retrouvée en l’expression raffinée d’un bonheur partagé. Il ne faisait pas que vivre cet instant unique, il en était aussi le producteur, pour les autres. La musique c’était son miel, il l’avait fait couler de ses doigts, il en était la source et comme toute source elle ne devait jamais se tarir.
En fin de soirée, tout le monde était encore là, et aurait encore dansé s’il n’avait fallu se résoudre à la fermeture. Les Américains sont sortis les premiers, John à leur suite, content de remettre un peu d’anglais dans sa bouche, puis progressivement tous les danseurs épuisés qui lançaient des remerciements au Musicien. Ceux du patron Lessure furent sonnants et trébuchants, et avec la générosité de l’Américain, il s’est cru tout d’un coup auréolé des attributs de la richesse.
La vie, qui jusque-là s’était écoulée sans raison, sans qu’il ait pu lui donner un sens – hormis celui imposé par les événements, et ses parents – prenait tout d’un coup une consistance, se bardait d’une épaisseur d’être qui lui procurait un sentiment de puissance inconnu. Il n’avait rien bu, mais la tête lui tournait. L’avenir s’y dessinait, il était armé maintenant pour en définir les contours, prendre en main son destin ; c’était la musique, ce ne serait que la musique. La Libération et la fin de la guerre se doublaient pour lui d’un sentiment de réalisation. Les réponses aux questions d’un adolescent de quinze ans placé à la porte d’entrée de son futur lui étaient apportées sans aucun doute possible. L’argent qu’il avait gagné ce soir révélait l’Homme en train de naître, qui regardait maintenant l’enfant qu’il avait été avec condescendance, pour un peu avec nostalgie, comme si cette première séquence de la vie était déjà du passé révolu.
Eh ! oui ! Il avait gagné de l’Argent. À ce moment-là, il l’aurait écrit avec un A majuscule. L’argent qui, au-delà de la préoccupation de chercher à se protéger des bombes, pendant toutes ces années, avait été le souci principal. De lui avait dépendu la capacité de s’approvisionner, de compléter le minimum vital autorisé par les tickets de rationnement. C’était le marché noir, il savait que ses parents n’avaient pas hésité à y recourir pour les nourrir du mieux possible. Maintenant, cet argent symbolisait tout à la fois la sortie des privations, et son entrée triomphale dans le monde adulte. Le monde s’ouvrait, et l’éclat du métal argenté donnait ses couleurs aux temps nouveaux qu’il comptait bien imprimer de sa marque.
En sortant du café, il ne se sentit même pas fatigué. Les dix kilos de son accordéon ne pesaient rien. Il avait hâte de rentrer, de montrer à ses parents ce qu’il avait gagné, qui viendrait contribuer aux ressources de la famille, et surtout de leur faire part de ses intentions. Il imaginait toute la fierté dont il était rempli se diffuser vers son père et le remplir à son tour.
Pauvre père. Il ne se voyait pas passer sa vie comme lui, à l’user sur ses machines du matin au soir, ne s’accordant de toute l’année – et encore – que le repos du dimanche.
Sans doute n’avait-il pas eu d’autres moyens de gagner sa croûte. Pourtant, le Musicien savait que son père s’estimait heureux d’avoir pu devenir cordonnier, le laissant libre de ses mouvements, libre de travailler comme il l’entendait, libre de choisir ses fournisseurs de cuir, de cordes, de colles, de formes. Libre de houspiller un client mauvais payeur. Libre de toute attache, de toute hiérarchie. Il était son propre patron et n’avait de compte à rendre qu’à lui-même. « Je suis propriétaire de mes bras, disait-il, même si je ne suis pas instruit, je suis propriétaire de mes bras. »
Le Musicien pouvait dire qu’il en avait entendu parler de cette fierté. Une vraie ritournelle. Tout gamin, il lui semblait avoir été comme évangélisé par l’histoire de son père. Et depuis les premiers bruits de botte des Boches, c’était revenu dans sa bouche, comme une obsession, une sorte de long mantra qui aidait à faire face à l’adversité.
Tout y était passé, et repassé. Il pouvait maintenant réciter par cœur les étapes de la vie de ce père qui à chaque fois venait sculpter dans son cerveau de cire les contours de sa statue. Comme si lui et le monde étaient partis ensemble de là, point d’origine absolu de l’univers. Et pourtant, ce surgissement des limbes avait un parfum d’irréalité. La passion que son père mettait à raconter son histoire l’avait tellement impressionné qu’il sentait un gouffre se creuser entre les représentations qu’il s’en donnait et la réalité de ce que lui aurait à vivre. Comme s’il n’arriverait jamais aux chevilles du paternel. Tout était forcément vrai, conférant au récit la solidité de la pierre, nourrissant en lui une admiration que les soubresauts de son adolescence ne réussissaient pas à entamer. Mais ça résistait dans sa tête ; pour lui, que ça se soit passé il y a vingt, trente, quarante ans, ou du temps de Jules César, c’était confondu dans la même nébuleuse d’un temps auquel il n’aurait jamais accès.
Comment se représenter une enfance sans école, sans lecture, lui qui des livres à la musique s’en était gavé ?
Souvent, cette histoire, avec les mots de son père, comme au cours de cette nuit enchantée, repassait dans sa tête.
« Hé ! oui ! Le Musicien, je ne savais pas lire. Et quand il le disait, une étincelle allumait son regard. J’étais d’une famille de forains, dans un cirque. Un petit cirque, quatre chevaux, qui tiraient autant de carrioles. On passait de ville en ville, une semaine là, une semaine ailleurs. De Lille à la banlieue de Paris, on est allé partout. Ma cour d’école, ça a été la piste. À huit ans, je faisais déjà des sauts périlleux. Mon père était au trapèze. Au début, pour m’amuser, il me faisait m’accrocher à ses poignets, je sentais ses mains de fer se refermer sur les miens, alors il se balançait et me lançait en l’air, pas trop haut, c’était pour que je m’habitue au vide et que je sache me réceptionner au sol. Et puis, il m’a lancé plus haut et il fallait que je fasse un tour sur moi-même et que j’essaie de tomber droit sur mes pieds, on tendait une toile si on voyait que j’allais mal retomber. Mais c’est venu vite. Et c’est comme ça qu’à la fin il me rattrapait au vol, qu’on s’élançait encore et on recommençait. C’était facile, j’étais léger. À dix ans, j’ai fait mon premier spectacle, avec toute la troupe. En plus du trapèze, j’effectuais des exercices au sol, je participais aux pyramides, et comme j’étais le plus léger j’allais tout en haut. Tout le monde faisait tout. On était acrobates, mais aussi clowns, dresseurs d’animaux et un peu magiciens. Et puis il fallait mettre la main à la pâte, monter, démonter le chapiteau, soigner les chevaux, les chiens, les singes. Ça a duré jusqu’à mes quatorze ans. Jusqu’au jour où mon père m’a lâché en voulant me rattraper, j’étais peut-être devenu plus lourd, ça l’a peut-être surpris, il m’a lâché, mais surtout ça l’avait tellement secoué au moment de me prendre aux poignets que ses pieds ont d’abord glissé du trapèze et qu’on s’est retrouvé tous les deux par terre. J’ai rien eu, un miracle… »
À ce moment-là de son récit, les yeux d’Henri s’embuaient.
« … Mais lui était tombé la tête en bas, il est mort sur le coup, en plein spectacle. Peut-être la meilleure mort pour lui. Ça a été aussi la mort de notre cirque. Je n’avais que mon père à l’époque, ma mère était morte en accouchant. Ce que j’ai compris quand c’est arrivé, c’est que l’accident a semé la zizanie entre tout le monde. Les frères, les sœurs de mon père, plus personne ne s’entendait. Toute la troupe s’est éparpillée, et personne n’a voulu de moi, soi-disant que je portais malheur. Ça s’est passé ici, et c’est pour ça que ton grand-père a été enterré ici, que je suis là, et toi aussi, disait Henri. L’enterrement, ça a été tout un cirque, si j’ose dire. Le maire qui était là au moment de la représentation a bien été obligé d’accepter qu’on l’enterre dans son cimetière, mais il n’a pas fait de cadeau, ça a obligé la vente d’une partie du cirque, ça a accéléré la dispute entre tous les autres qui se sont pourtant entendus pour une dernière fois : ils sont allés voir le maire, après l’enterrement, pour lui demander s’il ne pouvait pas me trouver une famille d’accueil. Il aurait pu se tourner vers la préfecture, et je me serais retrouvé chez les Orphelins, mais finalement je ne regrette pas ce qu’il a fait. Il connaissait un cordonnier qui cherchait un apprenti, et il m’a dit, Petit, je te laisse le choix, tu vas en pensionnat chez les Orphelins, ou tu vas apprendre la cordonnerie ; sinon, il m’a dit d’un air taquin et sûr de lui, tu peux faire vagabond…
Le cordonnier c’était son frère, Monsieur Savary. Il avait un ouvrier qui était parti tenter sa chance à Paris. Il avait entendu que là-bas c’était la fête, la Belle Époque qu’on l’appelait. Et il aimait faire la fête. Quand on est arrivé avec le maire pour les présentations, au début il ne disait pas un mot et il m’a regardé fixement, ça me faisait peur. C’était son frère qui parlait, il essayait vraiment de me placer. Au bout de longues minutes, il m’a demandé ce que je savais faire. En cordonnerie, rien, j’ai répondu, ça servait à rien de mentir. En fait, il s’en doutait bien, et quand je lui ai dit que je savais faire de la gymnastique, il s’est mis à sourire et m’a dit. Mais pourquoi tu le disais pas plus tôt. On a une compagnie de pompiers qui vient de créer une association de gymnastique, on va t’y inscrire, ça t’évitera de traîner au café…
Je n’ai rien dit, mais j’étais content. C’est comme ça que j’ai commencé à apprendre la cordonnerie.
Le plus dur, c’étaient les murs ; dans la roulotte, les murs sont pas des murs, par la fenêtre le paysage défile, c’est jamais pareil. Dans l’atelier de Monsieur Savary, il y avait bien une fenêtre, mais elle n’était ouverte que l’été, le reste du temps elle restait fermée et on ne voyait plus rien au travers, il y avait tellement de poussière accumulée, mais même ouverte rien ne bougeait, elle donnait sur une cour, alors ouverte ou fermée, pas de distraction possible. À certains moments, je me demandais si je n’allais pas devenir fou, du matin au soir je vivais dans la cordonnerie, je pensais cordonnerie, je respirais cordonnerie, le patron m’avait installé un matelas dans sa remise, où il entreposait les peaux, on mangeait dans l’atelier, on ne parlait que cordonnerie, alors je suis devenu fou de cordonnerie. Au bout de trois ans, je savais tout faire, chaussures de ville, pour hommes, pour femmes, bottes de cheval, croquenots, brodequins. Le patron était content. Il disait à son frère, “T’as eu une riche idée de me l’amener”, alors de temps en temps il me donnait quelques sous. Je pense pas que je l’ai rendu riche, mais son affaire tournait bien. Ce que je préférais c’était les jours d’approvisionnement, on partait le matin de bonne heure assis sur sa voiture attelée au cheval, et on allait jusqu’au chef-lieu, chez Levasseur, le tanneur, et les autres marchands. Il passait commande, on dormait chez sa sœur, mais on attendait le lendemain pour charger, parce qu’une fois il s’était fait tout voler, on refaisait la tournée le matin, la carriole remplie, et on rentrait. À chaque fois, de respirer l’air vif, j’avais l’impression de revenir avec des poumons neufs.
Heureusement, y a eu la gymnastique, ça aussi ça m’a fait respirer, et bouger. Parce qu’à l’atelier, même si j’ai pris goût au métier, tu fais toujours les mêmes gestes, des mains, des bras, mais le reste c’est comme si ça n’existait pas. Je suis sûr que si j’étais revenu de la guerre sur un fauteuil roulant j’aurais pu reprendre le travail.
La gymnastique c’était autre chose. On avait une séance le vendredi soir. Toute la compagnie de pompiers était là, en tenue blanche ; Monsieur Savary me l’avait achetée. Quand je suis arrivé, ils me prenaient pour un débutant. Je leur ai dit qu’au cirque j’effectuais des exercices de gymnastique, ils ont rigolé, en me disant qu’au cirque c’était du spectacle, du chiqué, alors qu’eux, c’était plus sérieux, que leurs exercices, c’était fait pour l’hygiène du corps et la discipline militaire. La méthode Amoros qu’ils appelaient ça. Méthode ou pas, il n’empêche que j’en pouvais autant qu’eux, même si eux en savaient plus que moi. Ils s’en sont rendu compte, alors ils m’ont accepté. C’était vrai que pour la discipline c’était mieux, alors je m’y suis mis aussi. Mais au bout d’un moment, j’avais l’impression qu’on tournait en rond. Surtout à la barre fixe, disait-il en riant. Alors je leur ai parlé de ce que je faisais au cirque, de la voltige en plus des exercices de force. Et eux aussi s’y sont mis.
Évidemment, comme ils étaient tous pompiers, ils ont fini par me convaincre de les rejoindre. Ça supposait que je parte du travail à n’importe quel moment en cas d’incendie, mais Monsieur Savary a été d’accord. Aux fêtes le dimanche, on faisait des démonstrations, des exercices de force, des alignements, des mouvements collectifs, des pyramides, c’est ce que les gens préfèrent.
Mais surtout, ça nous préparait au service militaire. J’ai eu de la chance, de mon temps ça avait été réduit à deux ans, mais obligatoire pour tout le monde, et après c’est passé à trois ans. Comme quoi, ils savaient bien ce qu’ils faisaient, ils savaient bien que la guerre allait éclater. »
Arrivé là de son histoire, il se fermait. Et ça n’est que progressivement, en interrogeant surtout sa mère, que le Musicien apprit ce qui s’était passé : la fleur au fusil, la der des der, saletés de Boches, ça va pas traîner ; l’enrégimentement, le Groupe Cycliste de la 5e DC, l’anonymat, le marquage comme au fer rouge du numéro matricule, 0638 ; et puis très vite les tranchées, la Somme, la boue, les rats, le froid ; sa marraine de guerre qui lui écrivait des lettres qu’il était incapable de lire, obligé de demander à des camarades ; pour la réponse, ne pas tout dire, par pudeur ; surmonter la honte de l’ignorance, aller voir un caporal instituteur, qui ne s’est pas moqué, lui a appris, petit à petit, entre deux attaques, ça trompait l’ennui aussi ; le carnage de 1916, pour gagner quelques mètres, les Boches qu’on pouvait entendre de l’autre côté ; un assaut, en février 17, les grenades qui percent les tympans, transpercent les corps, soulèvent des gerbes de terre, font gicler des gerbes de merde dans les pantalons, de la merde verte comme une peste du Moyen-âge, l’instituteur caporal et tant d’autres qui s’écroulent, des guirlandes de bras et de jambes dans les barbelés, aller le rechercher, le tirer jusqu’à la tranchée, se sentir soulevé par le souffle meurtrier, enseveli sous les corps morts, l’instituteur aussi, l’apocalypse comme au cinéma muet, en noir et blanc, et se sentir exténué derrière un grand rideau noir qui tombe d’un coup ; se réveiller, comme à regret, le bras en écharpe, la tête momifiée de bandelettes, pleurer de dégoût ; et pour faire passer la pilule du dévouement – pour qui, pour quoi, pourquoi – la Citation à l’Ordre du Groupe, « Excellent chasseur, très courageux, faisant partie de l’équipe des grenadiers, a été grièvement blessé dans son poste avancé au cours d’un combat à la grenade », merci mon Capitaine, merci mon Général, mon Maréchal, merci mon Ministre, mon Président, merci la France…
Une fois démobilisé, il a repris l’affaire du père Savary. Il avait un bon métier entre les mains. S’il était fier de quelque chose, c’était bien de ça.
Et puis de sa gymnastique, et des pompiers. S’il n’était pas passé au travers des gouttes de l’instruction obligatoire, il serait peut-être devenu professeur, il aurait peut-être pu entrer au Bataillon de Joinville, à transmettre toute la rigueur de sa discipline. Mais le goût qu’il en avait lui suffisait. Au service militaire, son don avait vite été repéré, et il était devenu un as de la pirouette et des équilibres. Bon soldat, bon gymnaste, au retour de la guerre, tout en installant son atelier de cordonnerie, il avait pris du grade chez les pompiers : c’est lui qui dirigeait maintenant la section de gymnastique qu’il menait « d’une main de fer, mais juste, disait-il avec le souci de son image. Tu te rends compte, le Musicien, que dans les années trente, à quarante-cinq ans, je tournais encore le grand soleil à la barre fixe. » Le Musicien sentait que ça devait être admirable, mais en le manifestant il se rendait compte aussi qu’il réalisait une sorte de figure imposée par la relation filiale. Les exploits sportifs le laissaient indifférent. « Et puis, tu sais qu’un jour, en présentation officielle, le président de la République m’a serré la main… » Un haut fait de reconnaissance sociale qui l’impressionna davantage. Jusqu’au jour où il s’aperçut que ce dernier avait aussi présidé au délitement de la Troisième République pour leur faire vivre l’enfer d’une nouvelle guerre, et quelle guerre ! Il ne se serait pas vanté de lui avoir serré la main à celui-là. Mais pour son père, c’était quelque chose.
Parmi les motifs d’admiration, le Musicien avait pu constater que le docteur Moreau considérait son père comme une aide précieuse dans son travail ; il lui envoyait régulièrement des accidentés aux fins de les rééduquer, leur faire retrouver la mobilité normale d’un membre longtemps maintenu dans les bandes ou le plâtre.





























