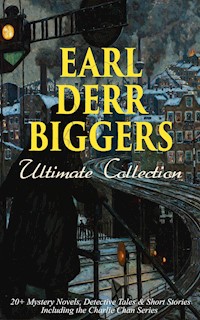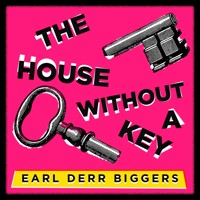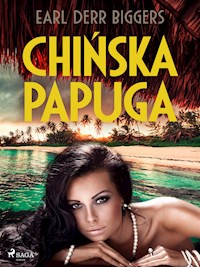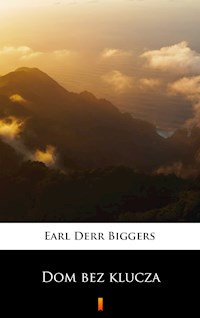0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Französisch
De la rue brumeuse, Alexandre Eden pénétra dans le vaste hall aux piliers de marbre où la firme Meek et Eden offrait à sa riche clientèle ses collections de bijoux et d’orfèvrerie. Derrière les vitrines où étincelaient pierres précieuses, argent, platine et or, quarante employés solennels se tenaient rigides comme des soldats au garde-à-vous. Le revers gauche de leurs jaquettes de coupe impeccable s’ornait d’un œillet rose aussi frais que s’il venait de s’épanouir sur leur boutonnière.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Le Perroquet chinois
Earl Derr Biggers
1926
© 2021 Librorium Editions
ISBN : 9782383830573
TABLE DES CHAPITRES :
I – Les Perles des Phillimore
II — Le Détective d’Hawaï
III — Une visite à Chan-Kee-Lim
IV — « L’Oasis »
V — Le Ranch de Madden
VI — « Hou malimali »
VII — Le facteur se met en route
VIII — Un petit jeu de société
IX — Retour dans la nuit
X — Le Capitaine Bliss
XI — Thorn part en mission
XII — Le Vieux Tramway
XIII — Ce que vit M. Cherry
XIV — Le Troisième Homme
XV — L’Hypothèse de Holley
XVI — On tourne
XVII — Sur les traces de Madden
XVIII — Le Train de Barstow
XIX — Une voix aérienne
XX — La Mine du Jupon
XXI — Où l’on touche au but
XXII — Le Chemin d’Eldorado
I – Les perles des Phillimore
De la rue brumeuse, Alexandre Eden pénétra dans le vaste hall aux piliers de marbre où la firme Meek et Eden offrait à sa riche clientèle ses collections de bijoux et d’orfèvrerie. Derrière les vitrines où étincelaient pierres précieuses, argent, platine et or, quarante employés solennels se tenaient rigides comme des soldats au garde-à-vous. Le revers gauche de leurs jaquettes de coupe impeccable s’ornait d’un œillet rose aussi frais que s’il venait de s’épanouir sur leur boutonnière.
Eden inclina aimablement la tête à droite et à gauche et continua son chemin, frappant allègrement du talon le dallage qui était d’une propreté éblouissante. Cet homme de petite taille, aux cheveux gris, au costume élégant et à l’œil vif, affectait les manières hautaines qui convenaient à son rang social. En effet, le dernier descendant des Meek héritier légitime d’une immense fortune, avait dû abandonner ses biens terrestres pour passer dans un monde meilleur, laissant Alexandre Eden seul propriétaire de la bijouterie la plus fameuse de toute la région située à l’ouest des montagnes Rocheuses.
Au fond du magasin, il monta quelques marches qui le conduisirent à l’entresol dans les bureaux somptueux où s’écoulait la plus grande partie de ses journées. Dès l’antichambre, il rencontra sa secrétaire.
— Bonjour, miss Chase.
La jeune Fille répondit en souriant.
Sa profession de joaillier contribuait à développer chez Eden un août naturel pour la beauté, qui se manifesta une fois de plus le jour où il choisit comme employée miss Chase : cheveux cendrés yeux violets, manières et toilette exquises.
Bob Eden, le fils du patron, que rebutaient les occupations paternelles, prétendait que le bureau de son père ressemblait à un salon où des gens du monde se réuniraient à l’heure du thé, Alexandre Eden jeta un coup d’œil à sa montre.
— Dans dix minutes j’attends une visite, dit-il à sa secrétaire. Une vieille amie, Mme Jordan, d’Honolulu. Dès son arrivée, veuillez m’avertir.
— Bien, monsieur Eden, répondit la jeune fille.
Il pénétra dans son bureau directorial et se débarrassa de son chapeau, de son manteau et de sa canne. Sur la table se trouvait le courrier du matin ; il le parcourut distraitement. Bientôt il se dirigea vers une des fenêtres où il demeura en contemplation devant la façade du building situé de l’autre côté de la rue.
Le brouillard, qui avait enveloppé la ville de San Francisco la nuit précédente, s’attardait encore dans les rues. Sur cet écran d’un gris terne se dessinait aux yeux d’Eden un tableau saisissant de couleur, de lumière et de vie. Son imagination le reportait quarante années en arrière, et il se revoyait jeune homme de dix-sept ans, aux cheveux bruns et au corps souple. Une nuit à Honolulu – le joyeux Honolulu du temps de la monarchie – derrière un rideau de fougères, dans un coin du grand salon des Phillimore, l’orchestre jouait et, sur le parquet ciré, Alec Eden et Sally Phillimore dansaient ensemble. De temps à autre le cavalier faisait un faux pas, car la nouvelle danse, appelée two-step, venait d’être introduite à Hawaï par un jeune enseigne du Nipsic. Mais peut-être n’était-ce pas seulement son inexpérience du two-step qui troublait Alec Eden… Ne tenait-il pas dans ses bras la plus jolie fille des îles ?
Les fées semblaient avoir présidé à la naissance de Sally. Outre sa beauté, qui l’eût fait remarquer dans cette aimable société d’Honolulu, elle était l’héritière d’une fortune fabuleuse. Les navires des Phillimore sillonnaient les sept océans et leurs plantations de cannes à sucre promettaient une récolte douce et dorée. Les yeux baissés d’Alec aperçurent sur la gorge blanche de la jeune fille un symbole de son rang et de sa richesse : le fameux collier de perles rapporté de Londres par Marc Phillimore et dont le prix avait stupéfait tout Honolulu.
Eden, de la firme Meek et Eden, regardait toujours dans le brouillard. Il revivait avec plaisir cette nuit de Hawaï ; nuit magique, chargée des parfums de la flore exotique ; il entendait encore les rires insouciants, le murmure lointain du ressac et les notes mélancoliques de l’orchestre hawaïen. Vaguement il se souvint des yeux bleus de Sally. Homme d’affaires approchant de la soixantaine, il revoyait maintenant de façon plus nette les énormes perles qui chatoyaient sur la poitrine de sa danseuse et reflétaient la lumière avec éclat.
À quoi bon évoquer ce passé ? Alexandre Eden haussa les épaules. Depuis, quarante ans s’étaient passés : Sally avait épousé Fred Jordan ; quelques années plus tard était né Victor, leur unique enfant. Eden fit la grimace. Vraiment, Sally avait été fort mal inspirée en donnant le nom de Victor à ce garçon stupide et débauché.
Il s’assit et songea qu’il devait sans doute imputer à une escapade du fameux Victor la scène qu’il prévoyait et qui, dans un moment, se déroulerait ici même, dans son bureau de Post Street. Victor, dissimulé dans les coulisses, laisserait tomber le rideau sur le dernier acte du drame des perles des Phillimore.
Quelques instants après, pendant qu’Eden s’absorbait dans la lecture de son courrier, sa secrétaire ouvrit la porte et annonça :
— Monsieur, voici Mme Jordan.
Eden se leva. Sally Jordan s’avançait vers lui, vive et enjouée comme toujours. Vaillamment elle luttait contre les années.
— Bonjour, Alec, mon cher ami…
Il prit ses deux mains fragiles dans la sienne.
— Sally ! Quel plaisir de vous revoir ! Asseyez-vous. – Il approcha un grand fauteuil de cuir. – À vous la place d’honneur, toujours…
Elle s’assit et remercia d’un sourire. Eden reprit sa place derrière son bureau. Il jouait machinalement avec un coupe-papier et, pour un homme pondéré comme lui, il paraissait nerveux.
— Ah… hum… depuis combien de temps êtes-vous à San Francisco ?
— Il y a eu exactement quinze jours lundi dernier.
— Vous avez failli à votre promesse, Sally. Vous deviez me prévenir dès votre arrivée.
— Oh ! le temps passe si vite ! protesta-t-elle. Victor se montre toujours si gentil pour moi.
— Ah ! oui… Victor ! Il se porte bien, j’espère ? – Eden regarda du côté de la fenêtre. – Le brouillard se lève. La journée sera belle.
— Pauvre cher Alec ! Pourquoi chercher midi à quatorze heures ? Cela ne sert à rien. Droit au but… voilà ma devise. Comme je vous le disais l’autre jour au téléphone, je veux vendre les perles des Phillimore.
— Pourquoi pas ? Autant vous en défaire puisque vous ne les portez plus.
— Là n’est pas la raison… Certes, une femme doit s’habiller suivant son âge… et ces perles magnifiques conviennent à la jeunesse. Cependant, je les conserverais si je le pouvais. Mais… je n’ai plus le sou, Alec.
De nouveau les yeux d’Eden se tournèrent vers la fenêtre.
— Cela vous paraît incroyable, n’est-ce pas ? continua-t-elle. Tous les navires des Phillimore, les plantations… évanouis en fumée. La grande maison au bord de la plage… grevée d’hypothèques. Victor a effectué de désastreux placements. Alors, vous comprenez…
— Oui, je comprends, fit Eden d’une voix douce.
— Oh ! je devine vos pensées, Alec. Victor est un mauvais fils, un sot, un insouciant… pire peut-être. Mais… depuis la mort de Fred, il ne me reste que lui… lui seul me rattache à l’existence.
— Comme une bonne mère que vous êtes, remarqua Eden en souriant.
Non, Sally, je ne veux nullement accabler Victor. J’ai… j’ai moi-même un fils.
— Pardonnez-moi. J’aurais déjà dû vous demander de vos nouvelles. Comment va Bob ?
— À merveille. Peut-être viendra-t-il ici avant que vous partiez, s’il a déjeuné de bonne heure.
— S’intéresse-t-il à vos affaires ?
Eden haussa les épaules.
— Pas précisément. Bob a quitté le collège voilà trois ans ; la première année il a voyagé dans les mers du Sud, la seconde, en Europe, et la troisième – autant que je sache – il l’a passée dans la salle de jeu de son club. Toutefois, le choix d’une carrière semble maintenant le préoccuper. Il paraît que le journalisme l’attire. Il a quelques amis dans les rédactions. Tout ceci – et le joaillier étendit la main vers les bureaux –, cette profession à laquelle j’ai consacré mon existence, ennuie Bob au possible.
— Pauvre Alec ! La nouvelle génération me semble incompréhensible. Mais… je venais vous parler de mes propres soucis. Je vous le répète, je suis complètement à sec. Ces perles représentent tout ce que je possède au monde.
— C’est quelque chose !
— Assez pour tirer Victor d’embarras. Père les acheta pour la somme de quatre-vingt-dix mille dollars ; une fortune à l’époque ; aujourd’hui…
— Aujourd’hui, comme tout le reste, les perles ont augmenté de valeur. Aujourd’hui ce collier vaut au bas mot trois cent mille dollars.
— Pas possible ! En êtes-vous certain ? Vous ne connaissez pas le collier.
— Je le connais. Vous avez oublié… Un peu avant votre arrivée, je me reportais en imagination quarante années en arrière, au jour où je rendis visite à mon oncle, dans les îles Hawaï. Dix-sept ans – c’est tout ce que j’avais. Je vins à votre soirée dansante et vous m’avez appris le two-step. Vous portiez le fameux collier à cette soirée, un des moments les plus mémorables de ma vie.
— De la mienne aussi, Alec. Je me souviens parfaitement à présent… Père avait apporté le collier de Londres et je le mettais pour la première fois à mon cou. Quarante ans passés ! Oh ! Alec… Revenons au temps présent ; parfois les souvenirs nous blessent. – Elle demeura un instant silencieuse. – Trois cent mille dollars, dites-vous ?
— Je n’affirme pas que je les obtiendrai. Le collier les vaut. Mais on ne trouve pas aisément l’acheteur prêt à payer un tel prix. L’homme que j’attends…
— Vous avez déjà quelqu’un en vue ?
— Oui. Mais il refusera de payer plus de deux cent vingt mille. Bien entendu, si vous êtes pressée de vendre…
— Je le suis. Qui est cette personne ?
— Il s’appelle Madden… P.J. Madden.
— Le fameux spéculateur de Wall Street ?
— Lui-même. Vous le connaissez ?
— Seulement par les journaux. Je ne l’ai jamais vu.
Eden fronça le sourcil.
— C’est bizarre. Il semble vous connaître. Je savais qu’il était à San Francisco et, après votre coup de téléphone, je courus à son hôtel. Il me dit qu’il cherchait un collier pour offrir à sa fille ; mais il se tint sur la réserve. Cependant, quand je mentionnai les perles des Phillimore, il se dérida. « Les perles des Phillimore, je les prends ! – Trois cent mille dollars. – Deux cent vingt et pas un cent de plus », riposta-t-il. Il me dévisageait de ses yeux froids. Autant essayer de discuter avec ce poussah.
Et il montra du doigt un petit bouddha en bronze sur son bureau.
Sally Jordan paraissait intriguée.
— Mais, Alec… comment me connaîtrait-il ? S’il offre une fortune, j’accepte… j’en ai grand besoin. Je vous en prie, hâtez-vous de conclure l’affaire avant qu’il reprenne le train.
De nouveau, la porte s’ouvrit et la secrétaire annonça :
— M. Madden, de New York.
— Bien. Dans un instant. – Il se tourna vers sa vieille amie. – Je l’ai prié de venir ici ce matin. Suivez mon conseil, Sally : ne vous montrez pas trop pressée. Peut-être tirerons-nous davantage. J’en doute, car les histoires que racontent sur lui les journaux ne sont que trop vraies. Il est dur comme un roc.
Alexandre Eden s’arrêta court, car l’homme inflexible dont il parlait se tenait debout à la porte… le célèbre Madden en personne, le héros de milliers de batailles à Wall Street. Haut de plus de six pieds, il se dressait comme un bloc de granit dans son costume d’une couleur grise, qu’il aimait tout particulièrement. Le regard de ses yeux d’un bleu d’acier produisit dans cette pièce un effet glacial.
— Veuillez entrer, monsieur Madden, fit Eden en se levant.
Madden avança, suivi d’une grande jeune fille à l’air languissant, habillée de riches fourrures, et d’un homme maigre, aux manières cérémonieuses, vêtu d’un costume bleu marine.
— Madame Jordan, je vous présente M. Madden, dont nous venons de parler, fit Eden.
— Madame Jordan, répéta Madden en s’inclinant légèrement.
À force de spéculer sur l’acier, il conservait dans la voix quelque chose de métallique.
— J’amène avec moi ma fille, Evelyne, et mon secrétaire, Martin Thorn.
— Enchanté, fit Eden.
Pendant un instant il observa ce groupe qui venait d’envahir son paisible bureau : le fameux financier, froid, retors, conscient de sa force ; l’altière jeune fille à qui Madden prodiguait toute son affection ; puis le secrétaire, à l’air décidé, qui se tenait respectueusement au dernier plan et qui n’était pas aussi insignifiant qu’on aurait pu le croire.
— Veuillez vous asseoir, dit le joaillier en approchant des sièges.
Madden s’assit tout près du bureau. Sa présence écrasait les autres personnages et semblait alourdir l’atmosphère.
— Ne perdons point de temps en préambules, dit-il. Nous venons examiner ces perles.
Eden sursauta.
— Vous faites erreur, mon cher monsieur. Les perles ne sont pas encore à San Francisco.
Madden le regarda fixement.
— Lorsque vous m’invitiez à venir voir ici la propriétaire…
— Je ne voulais pas dire autre chose.
Sally Jordan le tira d’embarras.
— Voici les faits, monsieur Madden. En quittant Honolulu je ne songeais nullement à vendre le collier. Des circonstances imprévues m’y ont décidée et je l’ai envoyé chercher…
Le col de son manteau de fourrure rejeté sur ses épaules, la jeune fille parla à son tour. Assurément elle était belle, mais froide et sèche comme son père et en ce moment la contrariété ; durcissait ses traits.
— Si j’avais su que vous n’aviez pas les perles, je ne me serais pas dérangée.
— Ce ne sera pas un grand retard, fit le père, puisque Mme Jordan a envoyé chercher ces perles, n’est-ce pas ?
— Oui, le collier partira d’Honolulu cette nuit même et, si tout va bien, il sera ici dans six jours.
— Malheureusement ma fille prend ce soir le train pour Denver, et moi pour le Sud, demain matin. La semaine prochaine je pense la rejoindre au Colorado et, de là, nous voyagerons dans l’Est.
— Qu’à cela ne tienne, suggéra Eden, je vous remettrai les perles où vous le voudrez.
— Entendu. – Madden sembla réfléchir, puis se tourna vers Mme Jordan. – Ce collier est-il celui que vous portiez au Palace Hôtel en 1889 ? demanda-t-il.
Toute surprise, elle le regarda.
— Parfaitement.
— Je parie qu’il est encore plus beau, fit Eden en souriant. Monsieur Madden, vous connaissez sans doute la légende selon laquelle les perles se ternissent ou brillent davantage selon l’humeur de la personne qui les porte. Si c’est vrai, ce collier n’a fait qu’embellir d’année en année.
— Des fadaises ! remarqua Madden. Oh ! pardon ! Mme Jordan est charmante ; mais je n’ajoute aucune foi à ces fables. Je suis avant tout un homme d’affaires. Je prendrai le collier au prix que je vous ai proposé.
Eden hocha la tête.
— Il vaut trois cent mille dollars au bas mot.
— Pas pour moi. Deux cent vingt mille : vingt mille à la conclusion du marché et le reste trente jours après la livraison du collier. À prendre ou à laisser.
Madden se leva et observa le joaillier. Devant cet homme inébranlable l’esprit mercantile d’Eden l’abandonna. Il tourna vers sa vieille amie un regard découragé.
— C’est très bien, Alec, j’accepte, fit Mme Jordan.
— Bon, soupira Eden. Vous l’obtenez à bon compte, monsieur Madden.
— Je n’achète jamais autrement.
Il prit son carnet de chèques.
— Voici vingt mille dollars, selon nos conventions.
Pour la première fois le secrétaire prit la parole. Sa voix froide et aigrelette affectait une politesse onctueuse.
— Vous disiez, madame, que les perles arriveraient dans six jours ?
— Environ six jours, rectifia Mme Jordan.
— Ah, oui ! fit-il d’un ton conciliant. Et elles viendront par…
— Un messager privé, répondit Eden d’un ton sec.
Jusque-là il n’avait prêté aucune attention à Martin Thorn. Un peu tardivement il l’examina : un grand front, des yeux vert pâle, qui, par instants, lançaient un regard déconcertant, des mains longues et crochues. Un individu à éviter, songea Eden.
— Elles viendront par un messager privé, répéta-t-il avec énergie.
Madden posa le chèque sur le bureau devant le joaillier.
— Monsieur Madden, permettez-moi une petite suggestion, continua Thorn. Si miss Evelyne doit revenir passer la fin de l’hiver à Pasadena, elle désirera sans doute porter le collier. Comme dans six jours nous serons encore dans ces parages, il me semble que…
— Qui achète ce collier, vous ou moi ? interrompit Madden. Je ne veux pas qu’on promène ce bijou d’un bout à l’autre du pays… surtout à notre époque où sur deux hommes on compte un escroc.
— Père, je voudrais bien, en effet, le porter cet hiver…
Elle n’en dit pas davantage. Le visage écarlate de P.J. Madden s’empourpra et il secoua sa grosse tête, selon son habitude lorsqu’on lui résistait.
— Le collier devra être livré à New York, dit-il à Eden sans tenir compte des remarques de sa fille et de Thorn. Je passerai quelque temps dans le Sud – j’ai une propriété à Pasadena et un ranch dans le désert – à quatre miles d’Eldorado. Je n’y suis pas retourné depuis plusieurs mois et, si de temps à autre je n’y jette pas un coup d’œil, les intendants en prennent à leur aise. Dès mon retour à New York, je vous télégraphierai et vous pourrez faire livrer le collier à mon bureau. Trente jours après, vous recevrez un chèque de deux cent mille dollars.
— Parfait ! approuva Eden. Si vous voulez bien attendre un instant, je vais demander qu’on vous prépare l’acte de vente suivant nos conditions. Les affaires sont les affaires : vous le savez mieux que personne.
Le joaillier quitta la pièce.
Evelyne Madden se leva.
— Père, je t’attends en bas. Je voudrais voir la collection de jades. Savez-vous, continua-t-elle en se tournant vers Mme Jordan, que le plus beau jade se trouve à San Francisco ?
— Vraiment ?
La vieille dame sourit en se levant elle aussi et elle prit la main de la jeune fille.
— … Je disais justement, avant votre arrivée, que les perles des Phillimore voulaient de la jeunesse. Cette fois, elles l’auront ! Je vous souhaite de les porter pendant de longues années de bonheur.
— Merci, madame, et au revoir, fit la jeune fille en s’en allant.
— Attendez-moi dans la voiture, ordonna Madden à son secrétaire.
Une fois seul avec Mme Jordan, il lui demanda :
— Vous ne m’aviez jamais vu, n’est-ce pas ?
— Excusez-moi, je ne m’en souviens pas.
— Mais moi, je vous ai déjà vue. Oh ! à présent que nous prenons de l’âge, nous pouvons sans danger aborder certains sujets. Sachez que la possession de ce collier fermera chez moi une ancienne profonde plaie.
Elle le regarda fixement.
— Je ne comprends pas…
— Évidemment, vous ne pouvez comprendre. Mais autrefois, lorsque vous et votre famille quittiez les îles, vous descendiez au Palace Hôtel. À cette époque je… j’étais petit groom dans ce même hôtel. Je vous voyais souvent. Une fois vous portiez ce fameux collier. Je vous trouvais la plus belle femme du monde… oh ! pourquoi pas… ? Tous deux nous sommes… hum…
— Oui, nous sommes vieux tous deux à présent, acheva-t-elle.
— C’est cela. Je vous adorais alors, mais j’étais… un simple groom ; pour vous, un meuble de l’hôtel, rien de plus. Oh ! comme je souffrais dans ma fierté ! Je fis le serment de devenir riche et de vous épouser. Maintenant nous pouvons en rire. Mes projets mirent du temps à se réaliser. Mais aujourd’hui je possède vos perles ; elles orneront le cou de ma fille. C’était ce que je pouvais faire de mieux. Je vous apporte de l’argent. La blessure de mon orgueil est enfin guérie.
Elle le dévisagea et secoua la tête. Jadis elle eût mal accueilli cette révélation, mais elle répondit seulement :
— Vous êtes un homme étrange, monsieur Madden.
— Je suis ce que je suis. Je devais vous faire cet aveu pour que mon triomphe fût complet.
Eden rentra dans le bureau.
— Voici l’acte, monsieur Madden. Voulez-vous en prendre connaissance et le signer… Merci.
— Vous recevrez un télégramme, dit Madden, vous m’enverrez le collier à New York, pas ailleurs ! Au revoir.
Il se tourna vers Mme Jordan et lui tendit la main.
— Au revoir, répondit-elle en souriant. Maintenant, je ne vous regarde plus sans vous voir.
— Et que voyez-vous ?
— Un homme épouvantablement orgueilleux, mais au demeurant très sympathique.
— Merci du compliment. Je m’en souviendrai. Au revoir.
Il sortit. Eden tomba lourdement dans son fauteuil.
— Ma foi, l’affaire est conclue. Ce Madden vous exaspère. J’aurais été heureux d’obtenir un meilleur prix, mais il obtient toujours ce qu’il veut.
— Toujours ? demanda Mme Jordan.
— À propos, Sally. Je ne tenais point à vous entendre dire devant son secrétaire le nom de celui qui apportera les perles. À présent vous pourriez me le faire connaître.
— Certainement : j’ai confié cette mission à Charlie.
— Qui ça, Charlie ?
— Le détective Charlie Chan, sergent de la police d’Honolulu. Autrefois, dans notre propriété de la côte, il exerçait l’emploi de maître d’hôtel.
— Charlie Chan… un Chinois ?
— Oui. Charlie nous quitta pour entrer dans la police où il occupe une belle situation. Comme depuis longtemps il désire venir en Amérique, j’ai songé à lui et je lui ai fait obtenir un congé. Où aurais-je trouvé un messager plus dévoué ? Je confierais ma vie à Charlie ; bien plus, je lui confierais la vie de mon enfant.
— Et Chan quitte Honolulu ce soir ?
— Oui. Il s’embarque sur le Président Pierce attendu ici jeudi prochain vers la fin de l’après-midi.
La porte s’ouvrit et un élégant jeune homme apparut sur le seuil. Son visage était fin et son teint bronzé ; son allure pleine de distinction et d’assurance. Miss Chase demeura rêveuse à la vue de son sourire.
— Oh ! pardon, papa… tu es occupé. Mais c’est Mme Jordan !
— Bonjour, Bob. Je suis heureuse de vous voir. Comment allez-vous ?
— La vie est belle et je nage dans la joie, répondit-il. Et vous, madame ?
— Très bien, merci. Si vous étiez venu quelques minutes plus tôt, vous auriez rencontré une très jolie personne.
— Vous faites allusion sans doute à Evelyne Madden… Je l’ai vue en entrant, elle parlait à un de ces grands ducs exilés que nous mettons dans nos magasins au service de la clientèle. Je ne me suis pas attardé à faire la conversation… La semaine dernière je l’avais croisée partout sur ma route.
— Je la trouve charmante, fit Mme Jordan.
— Oui, mais c’est un vrai glaçon, objecta le jeune homme. Brr ! le vent du nord souffle quand elle approche.
— Avez-vous jamais essayé sur elle l’effet de votre sourire ?
— Le sourire commercial ? Où voulez-vous en venir ? Désirez-vous m’embrigader dans l’institution surannée du mariage ?
— Tous les jeunes gens devraient y songer.
— Dans quel sens ?
— Comme un stimulant, un aiguillon, pour vous amener à tirer de l’existence le plus de joie possible.
Bob éclata de rire.
— Permettez, chère madame. Lorsque le brouillard franchit la Porte d’Or et s’amoncelle sur la ville et que les lumières scintillent dans O’Farrell Street, je ne tiens nullement à m’embarrasser de soucis matériels. D’autre part, les jeunes filles ne sont plus ce qu’elles étaient au temps où vous brisiez les cœurs.
— Elles sont bien plus gentilles aujourd’hui. Ce sont les jeunes gens qui deviennent stupides. Alec, je m’en vais.
— Je vous reverrai jeudi prochain, dit le joaillier.
Les yeux de Mme Jordan s’humectèrent : – Vous m’avez rendu un immense service, dit-elle ; et elle sortit précipitamment.
Eden regarda son fils.
— Eh bien, tu n’es pas encore journaliste, à ce que je vois ?
— Pas encore. Bien entendu, tous les directeurs de journaux sollicitent ma collaboration ; mais je repousse leurs offres.
— Continue quelque temps. Garde ta liberté deux ou trois semaines. Je vais te proposer un petit travail.
— Si cela t’arrange, papa, ce n’est pas de refus.
Il jeta l’allumette de sa cigarette dans un vase Kang-Hsi d’une valeur inestimable.
— Quel genre d’occupation ? Quel rôle jouerai-je ?
— D’abord, jeudi après-midi tu te trouveras au quai à l’arrivée du President Pierce.
— Beau début ! Une jeune femme voilée débarque…
— Non. Un Chinois.
— Un quoi ?
— Un détective chinois d’Honolulu, qui portera sur lui un collier de perles lequel vaut plus de deux cent cinquante mille dollars.
Bob Eden acquiesça d’un mouvement de tête.
— Bien. Et après ?
— Après, fit Alexandre Eden, pensif, qui sait ? Ce n’est peut-être là qu’un commencement.
II — Le détective d’Hawaï
Le jeudi suivant, à six heures du soir, Alexandre Eden se rendit à l’hôtel Stewart. Durant toute cette journée de février, la pluie se déversant sur la ville y avait répandu comme un crépuscule. Eden demeura un moment debout à la porte de l’hôtel et regarda la procession de parapluies le long de Geary Street et les lumières qui trouaient de clarté jaune l’épais brouillard.
À San Francisco l’âge importe peu, et il se sentait redevenu jeune homme lorsque l’ascenseur le conduisit à l’appartement de Sally Jordan.
Elle l’attendait sur le seuil de son salon, gracieuse comme une jeune fille dans sa robe de soie gris perle. Eden songea que, chez les femmes, la distinction s’affirmait encore davantage vers la soixantaine. Il prit la main qu’elle lui tendait en souriant.
— Bonjour, Alec. Entrez donc. Vous vous souvenez de Victor ?
Victor s’avança et Eden l’observa avec curiosité. Depuis des années il n’avait pas vu le fils de Sally et il remarqua chez Victor, âgé seulement de trente-cinq ans, les traces d’une existence de citadin écervelé et noceur. Les traits de son visage s’empâtaient ; sa taille s’épaississait ; et sa vie de noctambule dans les lieux de plaisir éclatants de lumière avait fatigué ses yeux. Mais son costume atteignait la perfection : de toute évidence, son tailleur ignorait encore les embarras financiers des Phillimore.
— Entrez ! entrez ! fit aimablement Victor. Alors, monsieur Eden, le grand événement doit se produire ce soir ?
La grosse somme d’argent en perspective lui rendait le cœur joyeux.
— Quel bonheur de me sentir délivrée de ce souci ! déclara Sally. À mon âge, ce collier représentait une trop lourde charge.
Eden s’assit.
— J’ai envoyé Bob au quai, à l’arrivée du Président Pierce, en lui recommandant de se rendre directement ici avec votre ami chinois.
— Excellente idée ! dit Sally Jordan.
— Voulez-vous prendre un cocktail ? proposa Victor.
— Non, merci.
Eden se leva brusquement et se mit à arpenter la pièce.
Mme Jordan le regardait avec inquiétude.
— Qu’y a-t-il ? lui demanda-t-elle.
— Il y a qu’il se passe quelque chose de… bizarre.
— Au sujet du collier ? interrogea Victor.
— Oui.
Eden se tourna vers Sally Jordan.
— Vous rappelez-vous les dernières paroles de Madden lors de votre visite dans mon bureau ?… « À New York, et pas ailleurs ! »
— Oui, je m’en souviens.
— Eh bien, il a changé d’idée, fit Eden le sourcil froncé. Cela m’étonne de lui. Ce matin, il m’a téléphoné de son ranch dans le désert : il désire que le collier lui soit livré à cet endroit.
— Dans le désert ?
— Exactement. J’en suis très surpris. Mais les ordres sont formels et vous savez qu’on ne discute pas avec des individus de sa trempe. J’ai promis de me conformer à ses nouvelles instructions. Toutefois, l’appareil raccroché, j’ai réfléchi à ce qu’il m’avait dit devant vous au bureau. La voix paraissait être la sienne ; mais je ne voulais courir aucun risque. Je le rappelai au téléphone. J’eus toutes les peines du monde à découvrir son numéro. Je réussis à l’avoir par un de ses associés de San Francisco. Eldorado 76. Je demandai la communication avec P.J. Madden et je l’obtins. Pas de doute possible : c’était bien sa voix.
— Que dit-il ?
— Ses ordres étaient encore plus impératifs. Il me raconta que certaines histoires entendues par lui depuis notre entretien l’amenaient à croire qu’il serait dangereux d’envoyer les perles à New York. Le désert lui semblait l’endroit rêvé pour une transaction de ce genre. Personne ne songerait à y voler un collier de cette valeur. Naturellement, au téléphone, il s’exprimait en termes voilés.
— Son raisonnement me paraît logique, dit Victor.
— Si l’on veut. J’ai moi-même habité le désert assez longtemps. En dépit des romanciers, la loi y est respectée beaucoup mieux que partout ailleurs. Personne ne ferme sa porte à clef et on ne songe point aux voleurs. Demandez à un homme du ranch quelques renseignements sur la protection que lui assure la police, il se montrera tout ébahi et vous parlera vaguement du shérif, qui réside à plusieurs centaines de kilomètres. Malgré tout.
Eden se leva et de nouveau se mit à marcher, l’air inquiet.
— Malgré tout, l’idée d’envoyer le collier ne me sourit nullement. Si un escroc voulait opérer un mauvais coup, il aurait beau jeu sur cet océan de sable. Supposez que Bob se rende au ranch pour livrer les perles et qu’il tombe dans un guet-apens. Madden aurait peut-être quitté ce ranch solitaire avant l’arrivée de mon fils. Qui sait ? il peut être assassiné.
Victor fit entendre un rire moqueur.
— Votre imagination bat la campagne, cher monsieur Eden.
— Possible. On s’aperçoit que je vieillis, n’est-ce pas Sally ? Mais Bob devrait déjà être ici. Voulez-vous me permettre de téléphoner ?
Il demanda au bureau du port si le President Pierce était à quai et raccrocha l’appareil, l’air encore plus soucieux.
— Le bateau est là depuis plus de trois quarts d’heure, annonça-t-il ; une demi-heure lui suffisait pour se rendre ici.
— La circulation est plutôt difficile à cette heure de la journée, remarqua Victor.
— Oui, c’est juste. Sally, je vous ai mise au courant de la situation. Qu’en pensez-vous ?
— Que pourrait-elle dire ? intervint Victor. Madden a acheté le collier et désire qu’on le lui livre dans le désert. Inutile de discuter ses instructions. Si nous refusions de nous y conformer, peut-être s’en fâcherait-il et annulerait-il l’achat. Nous devons lui remettre le collier contre un reçu et attendre son chèque.
Ses mains boursouflées s’agitaient avidement. Eden regarda sa vieille amie.
— Est-ce votre avis, Sally ?
— Oui. Victor a raison.
— En ce cas, ne perdons pas de temps. Madden est pressé. Bob partira ce soir même par le bateau de onze heures ; mais je refuse de le laisser voyager seul.
— Voulez-vous que je l’accompagne ? proposa Victor.
— Non, merci. Je préfère un policier, même s’il vient d’Honolulu. Ce Charlie Chan… croyez-vous, Sally, qu’il accepterait d’escorter Bob ?
— J’en suis certaine. Charlie ferait n’importe quoi pour m’être agréable.
— Voilà un point réglé. Mais que diable font-ils ? Je commence à être inquiet…
La sonnerie du téléphone l’interrompit et Mme Jordan prit le récepteur.
— Oh ! bonjour, Charlie ! Venez tout droit à l’hôtel. Notre appartement se trouve au quatrième étage, numéro 492. Oui. Êtes-vous seul ?
Elle raccrocha l’appareil et revint au salon.
— Il me dit qu’il est seul, annonça-t-elle.
— Seul ? répéta Eden. Ma foi, je n’y comprends rien.
Un moment plus tard il levait les yeux sur un petit homme grassouillet que Sally et Victor accueillaient chaleureusement. Le détective d’Honolulu, silhouette sans élégance dans son costume occidental, avança au milieu du salon. Dans sa face joufflue, au teint d’ivoire, Eden remarqua des yeux expressifs et pétillants d’intelligence aux prunelles brillantes comme deux perles de jais.
— Alec, je vous présente mon vieil ami, Charlie Chan. Charlie, M. Eden.
Charlie s’inclina très bas.
— Les honneurs se multiplient pour moi : Mme Jordan m’appelle son vieil ami et me présente à M. Eden.
— Enchanté, fit Eden en se levant.
— La traversée a été bonne, Charlie ? demanda Victor.
— Le grand océan Pacifique paraissait souffrir d’une immense douleur et pour le prouver il nous bousculait sans répit. Par sympathie, sans doute, je souffrais également.
Eden fit un pas vers lui.
— Excusez-moi, monsieur Chan, si je vous interromps. Mais mon fils devait… vous rencontrer au bateau.
— Faut-il que je sois stupide ! Je n’ai remarqué personne qui m’attendît au débarcadère.
— Je n’y comprends rien, soupira Eden.
— Je me suis attardé un moment auprès de la passerelle. Il pleuvait ; il faisait obscur ; personne ne s’est avancé vers moi, et j’ai pris un taxi pour me rendre à cet hôtel.
— Et le collier ? demanda Victor.
— Le voici. En arrivant ici j’ai demandé une chambre et me suis déshabillé en partie pour enlever le collier dissimulé dans une ceinture.
Il lança sur la table un collier de perles d’apparence bien innocente.
— Contemplons les perles des Phillimore au terme de leur voyage. C’est avec une joie indicible que je me décharge de ce fardeau !
Eden, le joaillier, prit le collier et l’éleva au bout de ses doigts.
— Magnifique ! Splendide ! murmurait-il en admirant la transparence des perles. Sally, nous n’aurions jamais dû l’abandonner à Madden à un prix aussi dérisoire. Elles sont merveilleusement assorties. De ma vie je n’ai vu… – Il reposa le bijou sur la table. – Je me demande où est Bob ?
— Il va venir, répliqua Victor prenant à son tour le collier. Ils se sont manqués, voilà tout !
— Maintenant que les perles sont là, Sally, laissez-moi vous apprendre quelque chose. Je ne voulais pas vous tourmenter inutilement. Cet après-midi, vers quatre heures, quelqu’un m’appela au téléphone. « Madden », annonça mon interlocuteur. Une intonation bizarre dans la voix me mit sur mes gardes. « Les perles arrivent sur le President Pierce, n’est-ce pas ? – Oui. – Comment se nomme le messager ? » Je lui demandai pourquoi il voulait le savoir. Il me répondit que certains indices lui faisaient craindre que le collier ne courût un danger. Il insista, sous prétexte qu’il pourrait intervenir. Je répliquai : « Entendu, monsieur Madden. Raccrochez et dans dix minutes je vous rappellerai pour vous communiquer ce renseignement. » Après une courte pose, il raccrocha l’appareil. Mais au lieu de téléphoner au ranch, je demandai d’où provenait ce coup de téléphone, et j’appris qu’il m’était adressé de la cabine payante d’un marchand de tabac au coin de Sutter et de Keamy Streets.
Eden s’arrêta et remarqua l’attitude atterrée du Chinois.
— Comprenez-vous pourquoi je m’inquiète au sujet de Bob ? reprit le joaillier. Il se passe quelque chose de louche.
Un coup fut frappé à la porte et Eden lui-même courut ouvrir. Son fils, aimable et souriant, pénétrait dans l’appartement. L’angoisse paternelle, comme presque toujours en pareil cas, se mua en une vive colère.
— En voilà un fichu homme d’affaires ! rugit Eden.
— Je t’en prie, papa, trêve de compliments ! riposta gaiement Bob. Dire que depuis une heure je déambule dans tout San Francisco à ton service !
— Cela ne m’étonne pas de toi. Tu étais chargé de joindre M. Chan sur le quai.
— Un instant, papa, fit Bob en se débarrassant de son imperméable. Bonjour, madame Jordan, bonjour, Victor. Monsieur Chan, je vous salue.
— Excusez-moi de vous avoir manqué à l’arrivée du bateau, c’est ma faute, murmura Chan.
— Mais non ! protesta le joaillier. C’est sa faute à lui ; il ne changera jamais ! Pour l’amour de Dieu, quand donc acquerras-tu le sens de tes responsabilités ?
— C’est précisément le sens de mes responsabilités, comme tu le dis si bien, qui a déterminé ma conduite.
— Bon sang ! Que me chantes-tu là ? Es-tu seulement allé au-devant de M. Chan ?
— Oui et non.
— Comment ?
— L’histoire est longue et je te la raconterai si tu cesses de m’accabler de ton injustice. Permettez-moi de m’asseoir. Je tombe de fatigue.
« Vers cinq heures, lorsque je sortis du club pour me rendre au bateau, je n’aperçus dans la rue qu’un vieux taxi délabré. J’y sautai et, arrivé au quai, je constatai que le chauffeur avait une mine patibulaire, la joue balafrée, une oreille en chou-fleur. Plein d’empressement, il s’offrit à m’attendre. J’allai au débarcadère. Le President Pierce avançait dans le port et manœuvrait pour accoster. Au bout de quelques minutes, je remarquai un homme debout à côté de moi, un individu à l’air frileux, le col de son pardessus remonté sur ses oreilles, les yeux derrière des lunettes noires. Ce type-là me parut suspect… Je continuai mon chemin jusqu’à l’autre bout du quai ; l’individu me suivit. J’entrai dans une rue ; il était toujours derrière moi ; et il y était encore quand je retournai au débarcadère.
Bob Eden fit une pause et sourit à son auditoire, vivement intéressé.
— Je pris aussitôt une décision. Je n’avais pas les perles, mais M. Chan les portait sur lui. Pourquoi exposer M. Chan ? Je demeurai donc là debout, suivant des yeux le débarquement des passagers. Bientôt l’homme que je pris pour M. Chan descendit du vieux Président Pierce : je ne bougeai pas. Je l’observai qui, du regard, cherchait quelqu’un dans la foule, et je le vis s’éloigner du port. Le mystérieux individu ne cessait de scruter les gens à la sortie. Lorsque tous les passagers eurent quitté le bateau, je retournai vers mon taxi et payai le chauffeur. « Vous attendiez quelqu’un au bateau ? » demanda-t-il. « Oui, j’étais venu à la rencontre de l’impératrice douairière de Chine, mais on m’apprend qu’elle est morte. » Il me lança un coup d’œil rageur. Comme je partais, le type aux lunettes noires approcha. « Taxi, monsieur ? » fit l’oreille en chou-fleur. Et l’autre monta. J’eus toutes les peines imaginables à trouver une autre voiture. Suivi de Chou-Fleur dans son splendide équipage, je me rendis à l’hôtel Saint-Francis ; j’entrai par la porte principale et sortis par une porte de côté. J’y retrouvai Chou-Fleur qui me suivit à mon club. Je m’enfuis par la porte de la cuisine et me faufilai jusqu’ici. Mes amis m’attendent sans doute encore devant la porte du club… – Il fit une nouvelle pause. – Voilà pourquoi, mon cher papa, je n’ai pas été à la rencontre de M. Chan.
Eden sourit.
— Tu as plus d’idées que je ne le pensais. Je te félicite, Bob. Écoutez, Sally… cette affaire me tracasse terriblement. Votre collier n’est pas un bijou très connu sur le marché ; pendant des années il est resté à Honolulu. Un voleur s’en débarrasserait facilement. Si vous voulez suivre mon conseil, vous ne l’enverrez pas dans le désert…
— Pourquoi pas ? interrompit Victor. Le désert est l’endroit le plus sûr. Certainement San Francisco ne me dit rien qui vaille pour ce genre d’opération.
— Alec, fit Mme Jordan, nous avons besoin d’argent. Si Madden exige qu’on lui livre le collier dans l’Eldorado, envoyons-le lui, et lorsqu’il nous aura donné son reçu, à lui de prendre soin des perles. Pour moi, je désire m’en défaire le plus tôt possible.
Eden poussa un soupir.