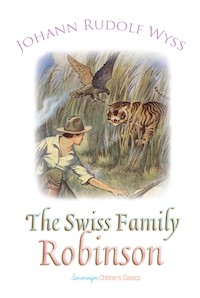Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait: "D'épais nuages noirs obscurcissaient le ciel. La mer était furieuse, les éléments déchaînés imprimaient des secousses terribles au navire. M. Arnold, un pasteur suisse qui émigrait, se trouvait à bord du bâtiment avec les siens. La famille se composait du père, de la mère et de quatre enfants en bas âge. Devant le danger, qui croissait de minute en minute, tous se pressaient effrayés autour du père, qui cherchait vainement à les rassurer."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335102321
©Ligaran 2015
D’épais nuages noirs obscurcissaient le ciel. La mer était furieuse, les éléments déchaînés imprimaient des secousses terribles au navire. M. Arnold, un pasteur suisse qui émigrait, se trouvait à bord du bâtiment avec les siens. La famille se composait du père, de la mère et de quatre enfants en bas âge. Devant le danger, qui croissait de minute en minute, tous se pressaient effrayés autour du père, qui cherchait vainement à les rassurer. Une secousse plus violente que les autres fut tout à coup suivie d’un tumulte indescriptible. Les mâts brisés s’effondrèrent ; il y eut un grand craquement suivi de cris d’angoisse ; puis on entendit le bruit des ballots, des tonnes, des barils, que le capitaine faisait jeter par-dessus bord pour alléger le navire. La situation était désespérée, le naufrage imminent ; on entendait à la fois des prières et des blasphèmes ; c’était, parmi l’équipage, un désordre indéfinissable. Le pont fut envahi et converti en chantier. On ne songea plus à sauver le navire ; on chercha seulement à organiser des moyens de sauvetage en vue d’un sinistre prochain et inévitable. Un instant, néanmoins, les voyageurs reprirent courage. Des côtes apparaissaient dans le lointain. Mais la vision fut de courte durée. Le navire, privé de sa mâture et lancé au hasard, errait, ballotté par les grandes lames furieuses qui menaçaient à tout moment de le submerger. On eut un dernier espoir : des voix confuses dominèrent le bruit de la tempête ; on entendit crier : « Terre ! terre ! » Puis ce fut un vacarme affreux, un tohu-bohu de gens qui se pressaient pour voir, au risque de s’étouffer. Mais, au même instant, le navire s’échoua, entrouvert par un obstacle invisible ! L’eau pénétrait de toutes parts ; on lança précipitamment les chaloupes à la mer, et l’on descendit le radeau. Le désordre était à son comble : les passagers affolés se bousculaient ; c’était à qui se sauverait le premier et empiéterait sur les chances de salut offertes au prochain ! Les gémissements des femmes, les cris déchirants des enfants à demi étouffés dans la bagarre venaient se confondre avec ceux des malheureux qu’un effort maladroit venait de précipiter dans la mer ; on entendait un concert de hurlements sauvages, un ensemble indescriptible de cris de terreur.
Le tableau était horrible ; le pasteur, debout sur le pont, tout pâle, assistait, terrifié, à l’embarquement des malheureux qui disputaient leur vie à la tempête. Voyant les siens prêts à se précipiter pour suivre leurs compagnons d’infortune, il les arrêta du geste et en disant :
Restons ici, Dieu est le souverain maître. Le salut peut être ici sur cette épave comme là-bas sur ce radeau déjà prêt à sombrer.
Comme il prononçait ces paroles, une vague gigantesque souleva le radeau et l’entraîna à une grande distance. Il ne fallait plus songer à fuir.
Le père, la mère, les quatre enfants demeurèrent seuls en face les uns des autres. Leur premier mouvement fut de s’embrasser. Ensuite ils portèrent leurs regards vers l’endroit où la côte venait d’apparaître.
Voilà où il nous faut atteindre, s’écria le pauvre ministre.
Le jour baissait, l’ouragan continuait de mugir. Les trois plus jeunes des quatre garçons, épuisés par les angoisses qu’ils venaient de subir, finirent par s’endormir. Mais l’aîné, Fritz, qui était assez grand pour se rendre compte du péril, demeura éveillé. Voyant que son père était dans l’anxiété, il lui demanda s’il ne serait pas à propos d’aviser aux moyens de gagner la côte. On fit des recherches, et l’on trouva quelques barils assez profonds pour soutenir chacun une personne à flot. Ces fûts, accouplés par paires avec de fortes cordes, furent placés de façon à servir de bouées de sauvetage en cas de danger. Ce travail accompli, Fritz, fatigué, s’endormit comme ses frères. Les parents seuls ne fermèrent pas l’œil de toute la nuit.
Vers le matin, l’ouragan se calma ; de légères teintes roses, les premières lueurs de l’aurore, vinrent se refléter sur la surface de la mer encore houleuse.
Toute la famille, rassemblée sur le pont, assistait à ce lever du soleil, qui venait éclairer les débris d’un naufrage.
La vue des pauvres enfants, que le ciel ne semblait avoir épargnés que pour les condamner à de nouvelles souffrances, arracha un soupir à la femme du ministre.
« Ayons confiance, » dit celui-ci, les yeux tournés vers l’horizon qui commençait à s’éclaircir.
Chacun eut sa tâche : tout d’abord le père recommanda de visiter en tous sens ce qui restait du navire. On chercha vainement des vessies, des ceintures de sauvetage. Jack s’était précipité vers la cabine du capitaine. Il y trouva deux superbes chiens, qui commencèrent par faire mine de dévorer leur libérateur. Mais leurs grognements se changèrent en caresses quand Jack leur eut donné à manger. Les autres enfants revinrent avec des objets en apparence plus utiles. Ils apportaient une ligne et des hameçons, du plomb et de la poudre, des outils de charpentier et des ustensiles de chasse.
Mes chiens rapporteront du gibier quand nous serons à terre, dit le petit Jack, un peu humilié de voir le peu de cas que l’on paraissait faire de sa trouvaille.
La terre, c’était bientôt dit ; il s’agissait avant tout de construire l’embarcation grâce à laquelle nos naufragés pourraient l’atteindre.
Heureusement, ils ne manquaient ni d’initiative ni de courage.
Ils descendirent dans la cale, y trouvèrent des tonneaux, les remontèrent sur le pont, et les coupèrent par la moitié, de façon à obtenir huit cuves. Ces huit cuves furent assujetties sur une planche longue et flexible. Deux autres planches jointes à la première donnèrent une sorte d’embarcation longue et étroite, à huit compartiments, et dont la quille était formée par le simple prolongement des planches qui avaient servi à relier les cuves entre elles. Pour plus de sûreté, le père avait imaginé de pourvoir les deux extrémités de son canot d’une sorte de balancier pareil à celui qui assure l’équilibre des embarcations de quelques peuplades sauvages. Ce travail dura toute la journée. On résolut d’attendre au lendemain pour tenter le périlleux trajet. La fatigue avait épuisé nos travailleurs. Après avoir dîné de bon cœur, ils s’endormirent d’un sommeil paisible, et le lendemain l’aube qui vint éclairer de ses premières lueurs la côte voisine les trouva pleins de gaîté et de courage.
Le père pensait aux moyens d’aborder ; la mère de famille, fidèle à son rôle, songea à emporter quelques provisions de bouche indispensables. Plusieurs gibecières vides furent bourrées de viande salée, de tablettes de bouillon, de biscuits de mer. De plus, on avait réuni tout ce qu’il fallait pour construire une tente. Il ne restait plus aux naufragés qu’à confier leur âme à Dieu et à s’embarquer. Mais, au moment de pousser au large, on entendit les cris des pigeons et des poules qui se démenaient dans leurs cages, et l’on fut d’avis de retourner chercher ces volatiles qui pouvaient offrir de grandes ressources. Ces petites dispositions prises, nos naufragés rentrèrent dans la barque, escortés d’abord par les oies et les canards, qui la suivaient à la nage, puis par les deux chiens, un Anglais appelé Turc, et une danoise qui répondait au nom de Bill.
Le trajet s’effectua sans accident, et l’île, qui de loin avait paru aride et couverte de rochers, ne tarda point à étaler ses côtes verdoyantes aux regards charmés de nos voyageurs. Ils abordèrent au fond d’une petite anse qui semblait placée là tout exprès pour offrir un débarcadère commode.
Grâces rendues au Tout-Puissant, qui venait de leur sauver la vie d’une façon aussi inespérée que merveilleuse, nos naufragés songèrent à se construire un abri pour la nuit. Ils dressèrent leur tente contre l’ouverture d’un rocher dont les parois solides garantissaient de l’âpreté des vents nocturnes. Les enfants furent chargés de la literie ; et, tandis qu’ils couraient chercher de la mousse et des herbes pour les faire sécher au soleil, leur papa s’occupa de la construction du fourneau indispensable pour la préparation du souper. Ce fut un bon moment, plein de promesses, que celui où le feu, alimenté par des espèces de fagots et des branches sèches, sortit tout pétillant d’un fourneau de forme primitive, qui vous faisait songer à certains autels dont l’image figure sur des gravures anciennes.
Il faut peu de chose pour égayer des gens qui viennent d’échapper à un grand danger. L’aspect réjouissant de la flamme qui s’élançait vers le ciel, l’odeur réconfortante du pot-au-feu qui mijotait sur les cendres, les bonds de cabri du petit Frantz, qui s’était, de son autorité privée, proclamé marmiton, et s’autorisait de cette dignité pour goûter la sauce : tout, jusqu’au beau soleil qui avait succédé à l’affreuse tempête, se réunissait pour faire renaître l’espérance dans les cœurs et le sourire sur les lèvres.
Tandis que le pot bouillait et que le jeune Frantz s’en constituait volontairement le gardien, les trois fils aînés du pasteur se mirent en devoir d’apporter leur écot au repas du soir.
Fritz, en vrai fils des montagnes, commença par charger son fusil et se dirigea du côté d’un ruisseau dont l’eau limpide serpentait sur un lit parsemé de cailloux aussi jolis et aussi brillants que des pierres fines. Jack, son frère, s’en alla flâner au bord de la mer, et Ernest, le plus jeune, s’enfonça, d’un air grave, parmi les sombres cavités des rochers. Le retour de Jack fut signalé par une scène amusante.
« Père, je tiens un crabe ! » s’écria le mauvais plaisant, qui avait le pied serré entre les pinces de l’animal.
Le père vola à son secours. « Si tu disais que le crabe te tient ! » dit-il en le dégageant des pinces de son adversaire.
Ernest, aux cris de son frère, était accouru les mains pleines de sel, qu’il venait de recueillir entre les fentes du rocher. Sa mère lui sut gré de sa trouvaille.
« Tu es un bon garçon, lui dit-elle, tu m’apportes de quoi saler la soupe. »
Le dîner fut très gai. On remplaça les assiettes et les plats absents par des coquillages. Chacun eut son histoire à conter, et tout d’abord Fritz, l’aîné des quatre garçons, parla en chasseur consommé d’un exploit cynégétique dont la victime était un cochon d’Inde. Chacun voulut voir ce fameux cochon d’Inde, qui, vérification faite, se trouva être un agouti, animal qui se nourrit d’herbes, de fruits, et ressemble quelque peu à un lièvre. Madame Arnold avait entendu dire que la chair de cet animal est succulente.
« Agouti ou cochon d’Inde, il vient à point pour nous fournir notre rôti de demain, » dit-elle en bonne ménagère soucieuse de ne rien laisser perdre.
Le coucher du soleil surprit nos colons au sortir de table. Le soleil reflétait ses dernières rougeurs dans la mer apaisée, et de petits flots teintés de rose venaient caresser le rivage avec une sorte de grâce enjouée et enfantine qui ne manquait pas de coquetterie. La nuit ayant succédé immédiatement au coucher du soleil, le pasteur pensa que l’île où l’on venait de débarquer devait être voisine de l’équateur.
On assista au coucher du petit monde ailé. Les uns cherchèrent un abri dans les creux du rocher ; les autres, sur les bords de la tente. Pigeons et poules demeurèrent dans le voisinage de leurs maîtres. Mais les canards et les oies, moins sociables, désertèrent bruyamment le poulailler improvisé où ceux-ci commençaient à s’endormir, pour s’en aller cancaner sur les bords marécageux d’une source voisine.
Nos colons étaient fatigués. Ils s’étendirent, non sans un regret donné à leurs bons matelas d’autrefois, sur la terre recouverte d’une maigre couche de feuilles. Mais les jours se suivent et ne se ressemblent guère. Il fallait bénir le ciel des secours qu’il avait envoyés, au lieu de regretter les biens dont il avait jugé à propos de priver nos amis.
Le chant du coq éveilla les dormeurs. Père, mère, enfants crurent sortir d’un rêve en se sentant sur la terre ferme, c’est-à-dire à l’abri du danger. Ils étaient trop heureux pour ne point donner un souvenir à leurs compagnons de voyage ; ils résolurent de rechercher les traces des rares malheureux qui pouvaient avoir survécu. D’ailleurs, M. Arnold jugeant nécessaire de faire un voyage d’exploration autour de l’île, Fritz accompagnerait son père dans cette tournée ; les trois autres, trop jeunes pour supporter la fatigue, resteraient auprès de leur mère, sous la garde du plus vigilant des deux chiens. L’autre chien avait suivi Fritz, qu’il considérait plus particulièrement comme son maître.
Je n’ai pas besoin d’insister sur le sentiment d’angoisse qui s’empara de madame Arnold. Elle ne cessa d’agiter son mouchoir jusqu’au moment où des rochers recouverts d’arbustes lui cachèrent les explorateurs.
Le chemin était rude, la rive du ruisseau si escarpée et les rochers tellement rapprochés, qu’il leur restait souvent tout juste assez de place pour poser le pied. Ils suivirent cette rive jusqu’au moment où une muraille de rochers vint leur barrer le passage. Là, grâce aux grosses pierres qui pavaient en quelque sorte le lit du ruisseau, ils parvinrent aisément au bord opposé. Les voyageurs, le regard tourné vers l’Océan, n’abandonnaient point l’espoir d’y découvrir quelques-uns de leurs compagnons d’infortune. Mais nul vestige d’embarcation ne paraissait. Seule, la trace à demi effacée d’un pied humain était empreinte sur le sable de la plage, et cette trace elle-même, si toutefois c’en était une, ne se reproduisait point ailleurs.
« Cette île est peut-être habitée par des sauvages, » s’écria Fritz.
Son père jugea à propos de le calmer. « S’ils nous attaquent, nous avons des fusils pour nous défendre, » lui répondit-il.
Au bout de deux heures de marche, ils atteignirent un petit bois assez éloigné de la mer. On y trouvait de la fraîcheur et de l’ombre. Un joli ruisseau passait au milieu des arbres touffus, et de beaux oiseaux aux couleurs vives comme celles des tulipes voltigeaient au milieu du feuillage enchevêtré de lianes.
C’était un bois de cocotiers. Fritz, qui s’imaginait n’avoir jamais rien vu d’aussi beau, regardait avec enthousiasme autour de lui ; tout en marchant, il heurta du pied un corps arrondi qui faillit le faire tomber. Il le montra à son père, et il se trouva que l’objet que tout d’abord le jeune garçon avait pris pour un œuf d’autruche était une noix de coco. Malheureusement, la noix étant mûre ne contenait plus une goutte de ce lait si vanté par quelques voyageurs, et qui sans doute a des vertus rafraîchissantes dont nos touristes regrettèrent de ne pouvoir faire l’essai.
Un calebassier chargé de ses fruits attira ensuite leur attention, et Fritz écouta avec intérêt les explications de M. Arnold, qui, chemin faisant, racontait à son fils comment l’écorce de ces fruits, en apparence assez semblables à ceux de la coloquinte, pouvait servir à fabriquer des bols, des plats, des gourdes et autres ustensiles de ménage. Les sauvages, disait-il, n’avaient point d’autres assiettes, et même M. Arnold ajouta qu’ils y faisaient bouillir l’eau en y jetant des pierres brûlantes, dont la chaleur chauffait le liquide sans entamer l’écorce de la bouilloire. L’idée de fabriquer peu à peu une petite provision d’ustensiles de ménage plut à Fritz. Il prit son couteau de poche et essaya de faire des entailles dans l’écorce de l’une des courges. Mais sur cette écorce très molle son couteau glissait.
« Ce : n’est point ainsi qu’il faut t’y prendre, » lui dit son père. Puis, joignant l’exemple au précepte, il tira de sa poche une ficelle, dont il se servit pour serrer fortement le fruit par le milieu. Le fruit céda bientôt à la pression de la ficelle, qui le partagea en deux parties égales.
Deux assiettes, plusieurs gourdes, sortirent bientôt des mains de l’habile ouvrier, et le soleil, à défaut de four, fut chargé de cuire cette porcelaine d’un nouveau genre.
Tandis que le père et le fils reprenaient leur course, ils s’amusèrent à tailler des cuillers, l’un dans un morceau d’écorce de calebasse, l’autre dans la coque d’une noix de coco. Se rappelant alors certains ustensiles de même provenance qu’ils avaient vus au Musée, ils furent forcés de convenir que les sauvages leur étaient supérieurs dans ce genre d’industrie. À la rigueur, les cuillers pouvaient servir, c’était le principal.
Après plusieurs heures de marche, ils atteignirent l’extrémité d’un promontoire assez avancé. Ce promontoire était surmonté d’une hauteur d’où l’œil embrassait une vue admirable.
Nulle trace des autres naufragés, nul soupçon d’habitations construites par la main de l’homme. En revanche, un tableau digne du Paradis terrestre, une vision semblable à ces images féeriques qui hantent parfois nos rêves.
C’étaient des forêts immenses, de grasses prairies qui descendaient par étages jusqu’au bord d’une mer aussi bleue que le ciel.
Toute médaille a son revers. Si le pays était beau et surtout assez riche pour nourrir une colonie humaine, les colons faisaient défaut. Le ministre ne put réprimer un soupir ni surtout s’empêcher de songer à l’étrangeté des décrets divins, qui souvent se manifestent d’une façon inexplicable et qui les avaient amenés où ils étaient, tandis qu’il avait peut-être jugé à propos de laisser périr leurs compagnons de voyage.
Il crut qu’il valait mieux ne pas s’appesantir sur ces pensées, et surtout ne point en entretenir son fils. L’heure du repas était arrivée. Ils se dirigèrent vers le petit bois de palmiers qui couronnait le sommet de la colline. Une sorte de chemin conduisait à travers un marécage hérissé de gros roseaux dont les touffes pouvaient donner asile à des serpents et autres bêtes venimeuses. On envoya Turc ouvrir la marche en guise d’éclaireur. Puis Fritz coupa en deux un de ces roseaux, duquel sortit un jus abondant et sucré. Le roseau se trouvait être une canne à sucre. Fritz se montra tout joyeux de cette heureuse découverte, et surtout du plaisir qu’il aurait à la communiquer à sa mère.
« Comme elle va être contente ! » dit-il en s’apprêtant à faire une provision de cannes.
Son père dut l’arrêter, en lui faisant remarquer que la route était longue et qu’il ferait bien de ne pas se charger d’un fardeau trop lourd. Fritz céda, mais à regret ; il ne se sentait point las, et, par conséquent, ne songeait point à ménager ses forces.
Une fois assis à l’ombre du petit bois de palmiers, il se mit à manger et à boire avec plaisir. Mais le repas fut bientôt interrompu par l’arrivée d’une troupe de singes ; ces animaux, se voyant poursuivis et pourchassés par Turc, essayèrent de lui échapper en gagnant la cime des arbres. Leurs cris et leurs grimaces faisaient ressembler à des diables ces vilains animaux velus. M. Arnold leva la tête pour mieux les examiner et s’aperçut que les arbres à l’ombre desquels il était assis étaient des cocotiers.
« Essayons, dit-il en désignant les singes, de nous servir de ces messieurs pour nous procurer notre dessert. »
Là-dessus, il lança une pierre à l’un d’eux, et reçut, en retour, une véritable pluie de noix de coco. Les singes, croyant se venger, avaient, au contraire, rendu service à nos colons. Mais M. Arnold et son fils, craignant de voir les singes découvrir leur ruse, jugèrent à propos de se soustraire à leur vue. Ils cherchèrent plus loin un petit endroit tranquille et se firent une sorte de petit plat sucré délicieux en mélangeant de la crème de coco avec du jus de canne à sucre.
Le repas terminé, nos voyageurs se remirent en route, munis d’un petit paquet de noix de coco et de cannes à sucre. Mais à peine eurent-ils fait quelques pas, qu’ils s’arrêtèrent. Les aboiements furieux de Turc venaient de répandre la terreur au milieu d’une nouvelle bande de singes.
Tandis que la plupart d’entre eux prenaient la fuite, le mâtin affamé s’élança sur une vieille femelle, l’éventra et se mit à la dévorer à belles dents. Un joli petit singe, probablement trop jeune pour rattraper ses camarades, assistait, accroupi sous un arbre, à ce repas horrible. Ses grincements de dents et ses grimaces indignées attirèrent l’attention de Fritz. Il voulut s’emparer du singe ; mais le malicieux animal lui échappa, et, lui sautant sur le dos, s’efforça de lui arracher une poignée de cheveux. On eut quelque peine à lui faire lâcher prise. Sa témérité criait vengeance. Néanmoins la gentillesse du petit scélérat plaidait pour lui. On résolut de l’épargner ; Fritz lui administra quelques coups de canne, puis, le supposant corrigé, lui permit de reprendre sa place sur le dos de son nouveau maître. Mais l’agitation inquiète du singe, qui, perché sur le dos de Fritz, semblait se croire sur une branche d’arbre, ne tarda pas à devenir gênante. Fritz comprit que, s’il avait eu le droit de punir le singe de sa méchanceté, il n’avait pas celui de s’opposer à ses gambades ; aussi songeait-il à se débarrasser de ce nouveau commensal, lorsque le retour du chien lui inspira une idée lumineuse. Il improvisa un harnais et des guides avec des bouts de ficelle, et posa le singe à califourchon sur le chien, à qui il fit la grosse voix pour l’engager à se tenir tranquille ; et le voilà en devoir d’apprendre au singe le métier de cavalier. Le petit animal montra d’abord peu de dispositions pour l’équitation, mais il finit par y prendre goût, et traita sa monture en vrai despote. Le cavalier et sa monture formaient un groupe grotesque, dont la vue était faite pour dissiper les plus tristes préoccupations.
Le retour eut lieu sans accident, et nos voyageurs, annoncés par les aboiements de Bill, la grosse chienne danoise, firent une entrée triomphale dans leurs nouveaux pénates. Fritz essayait d’imiter les allures d’un montreur d’ours empressé d’attirer les badauds, et faisait aller ses doigts tout le long d’une flûte imaginaire ; c’était le comble du comique.
« Je ne m’attendais pas à voir revenir une troupe de saltimbanques, » s’écria gaiement la femme du ministre.
On oubliait les soucis du passé et du présent pour faire fête au petit singe et l’on oubliait aussi les fatigues de la journée devant les préparatifs appétissants d’un repas abondant et varié. Madame Arnold avait fait de son mieux. Des deux côtés de l’âtre, où ronflait le pot-au-feu, on remarquait deux tournebroches d’une dimension respectable. Sur l’un, la maîtresse du lieu s’occupait à faire rôtir des poissons ; l’autre perçait les flancs d’une volaille que le pasteur prit pour une oie. Mais Madame Arnold se récria à cette supposition.
« Quoi ! dit-elle, j’aurais eu le cœur d’immoler sans nécessité une de nos pauvres bêtes ? » et elle ajouta que l’oie supposée était un produit de la chasse d’Ernest, et très probablement un animal pareil à ceux dont l’enfant avait vu l’image dans l’un de ses livres de classe. Vérification faite, on reconnut en effet dans ce palmipède un pingouin.
Le repas, animé par les récits du père et du fils, n’avait pas manqué de gaieté. On avait trinqué avec le lait des noix de coco ; on s’était servi, pour boire et pour manger, des ustensiles taillés dans l’écorce des calebasses. En somme, on n’avait pas perdu sa journée ; on pouvait goûter un repos d’autant plus doux qu’il était mérité, la famille se disposa donc à aller se coucher. Arrivés sous la tente, nos voyageurs s’aperçurent que leur gîte avait un autre aspect que le matin. La ménagère, en leur absence, avait pourvu au bien-être général. Non seulement la bonne âme s’était efforcée de préparer un bon dîner, mais elle avait eu soin de ramasser des herbes moelleuses pour rembourrer les couchettes. On ne fut pas longtemps à s’endormir ; mais le sommeil de nos colons devait être bientôt troublé par un concert de cris sauvages. Père, mère, enfants, tous furent debout en un clin d’œil. Ils se précipitèrent hors de la tente, armés jusqu’aux dents, et virent non sans effroi les chiens aux prises avec une bande de chacals. On en tua quelques-uns, ce qui effraya les autres, et produisit un sauve-qui-peut général. Les chiens finirent par rester maîtres de la place, et ils se mirent à déchirer avec avidité les restes de leurs congénères les chacals.
L’alerte n’eut pas d’autre suite, et le reste de la nuit fut paisible. Le lendemain, de bonne heure, le père et le fils aîné se préparèrent à une nouvelle expédition. Cette fois, il s’agissait de gagner le vaisseau échoué, qui pouvait être submergé d’un moment à l’autre, avec tout ce qu’il renfermait encore de provisions, de bestiaux et de vivres. Pour garder son mari et son fils auprès d’elle, madame Arnold eût volontiers fait l’abandon de tout ce que le navire pouvait contenir. Mais la prudence ordonnait de songer à l’avenir. Il pouvait s’écouler des années avant que l’on trouvât moyen de quitter l’île ; il fallait faire taire les craintes exagérées, savoir profiter des ressources que le sort laissait à leur portée et finalement prouver sa croyance en Dieu par sa confiance en lui.
On se sépara, non toutefois sans avoir planté sur le bord de la mer un poteau muni d’un large morceau de toile à voile. Quand on abaisserait ce poteau, ce serait signe que nos navigateurs devaient se hâter de revenir.
Il n’arriva rien de fâcheux ni sur terre ni sur mer. Bien au contraire : le courage de la femme et du mari qui s’étaient séparés pour le bien de leurs enfants reçut sa récompense ; car le voyage au navire contribua fort à améliorer la situation de la famille.
Le trajet avait été facilité par un courant d’eau douce qui se jetait dans la mer près de l’embarcadère. Ce courant avait doucement poussé nos voyageurs presque jusqu’à l’épave. Là, ils furent accueillis par les cris des animaux demeurés sur ce qui restait du navire. Il y avait un âne, une vache, des chèvres, dont une toute mignonne et toute gentille, qui fit aussitôt connaissance avec le petit singe de Fritz. Quand Fritz se fut bien amusé de la gourmandise du singe qui ne se lassait point de téter la chèvre et témoignait sa satisfaction par d’affreuses grimaces, il se mit en devoir d’aider son père à charger le radeau. Mais le pasteur reconnut bientôt qu’il était impossible de transporter une cargaison considérable sur un radeau à rames. Il fallut s’occuper de construire un mât, trouver le moyen d’adapter des voiles propres à une embarcation de construction fort irrégulière, et par conséquent fort incommode. Ces préparatifs exigeaient tout un travail de charpente long et minutieux. Il fallut se décider à passer la nuit à bord. Mais le cas était prévu, et la vue du pavillon déployé sur le pont du navire devait empêcher ceux qui étaient à terre de concevoir la moindre inquiétude.
Quand l’embarcation fut en état de porter sans danger un poids considérable, on employa le reste de la journée à remplacer le lest de sable devenu inutile par un chargement précieux d’étoffes de colon et de laine. La poudre, le plomb, les balles étaient des objets de première nécessité pour des gens destinés à vivre principalement du produit de leur chasse. Le père et le fils y joignirent tout ce qu’ils purent trouver d’armes offensives et défensives. Fritz surtout montrait les goûts et les penchants d’un Nemrod. Mais ils ne négligèrent point ce qui pouvait rendre la vie domestique plus confortable. Ils emportèrent donc des provisions de bouche et de chaudes couvertures. Ils formèrent une véritable collection d’ustensiles de cuisine et de ménage et firent main basse sur les couverts d’argent qui se trouvaient soit dans la cabine du capitaine, soi tailleurs. J’allais oublier les instruments aratoires le grain et les semences de toute sorte. Finalement, ils songèrent à transporter les animaux domestiques ; ce seraient des montures et des bêtes de somme, et ils peupleraient l’île. Comme ils nageaient naturellement, il suffirait de les lâcher. Pour plus de sûreté, on leur adapta des appareils de sauvetage autour desquels on fixa une corde destinée à les maintenir dans la bonne voie. L’essai ayant réussi sur le mouton, la truie et les chèvres, on s’occupa de la vache et de l’âne. Deux tonneaux vides, réunis par de la toile à voile, furent fixés sous le ventre des gros quadrupèdes. Rien n’était plus comique que de les voir ainsi affublés. Il eût été peut-être difficile de les faire descendre au niveau de l’eau, mais ce travail fut facile, grâce à une brèche que le choc contre les rochers avait ouverte dans les flancs du navire. Ce fut l’âne qui se montra le plus récalcitrant ; une secousse inattendue le précipita à la mer. La chute fut lourde, mais il se remit bien vite d’aplomb et nagea comme si de sa vie il n’eût fait autre chose.
Quand la vache, le dernier des gros animaux, fut à flot, le père et le fils eurent hâte de quitter l’endroit où ils avaient failli périr. Leur embarcation, grâce aux voiles qu’ils y avaient industrieusement adaptées, se trouvait en état de les amener au port. Néanmoins, ils eurent une très grande frayeur pendant le trajet, car ils virent une sorte de monstre qui nageait près d’eux. Ils sautèrent ensemble sur leurs armes : le monstre était un gros requin qui rasait la surface de l’eau. Fritz fit feu, atteignit l’animal à la tête, et le blessa mortellement, à en juger par les flots de sang qui s’échappaient de sa blessure. Le requin disparut, et nul autre incident ne vint troubler le reste du voyage.
Sans doute nos voyageurs avaient fait une rude besogne depuis vingt-quatre heures ; mais sur la terre ferme on n’était pas non plus demeuré inactif. La femme du ministre ne s’était pas montrée moins courageuse que son mari. Le signal du pavillon l’avait rassurée et lui avait donné la tranquillité d’esprit nécessaire pour qu’elle pût s’occuper, elle aussi, d’introduire des améliorations dans leur genre de vie. Tout bien pesé, elle avait reconnu qu’ils ne devaient pas songer à planter définitivement leur tente dans un endroit aride, absolument privé d’ombre, et, de plus, exposé aux incursions des animaux nuisibles. Les charmants souvenirs que Fritz avait rapportés de sa promenade de l’autre jour lui avaient donné l’idée d’entreprendre à son tour une petite excursion dans les terres. Elle avait fait déjeuner les trois enfants, puis, suivis de Bill et munis de bons gros bâtons bien solides, tous s’étaient dirigés vers, l’intérieur de l’île. Les quatre explorateurs étaient revenus pleinement satisfaits de leur découverte. Tout en marchant, et à une assez grande distance de la mer, ils avaient rencontré un endroit plein de fraîcheur et d’ombre. Des groupes de beaux arbres étaient dispersés sur un gazon doux et épais, et parmi ces arbres on en voyait un qui, par son feuillage comme par sa forme, avait éveillé chez madame Arnold des souvenirs de la Suisse. Il ressemblait, disait-elle, à un vieux châtaignier qui probablement se trouvait encore debout dans le jardin de la maison paternelle. Le châtaignier paternel, creusé par les ravages du temps, était un objet de curiosité pour tout le pays, car il était de proportions gigantesques ; on avait pratiqué dans l’intérieur un escalier, et dans le branchage un lieu de plaisance. Cet endroit était un balcon où plusieurs personnes à la fois pouvaient prendre leur calé. C’était comme une espèce de petite maison aérienne, et la vue des beaux arbres qui croissaient à l’intérieur de l’île avait donné à madame Arnold l’idée d’échanger leur tente contre une construction pareille. « Au moins, ajouta-t-elle, nous pourrons dormir tranquilles. Ni les chacals, ni les autres bêtes fauves ne viendront nous attaquer là-haut. Ensuite, ce sera frais et propre. Voyez-vous d’ici notre cabane perchée sur un tronc d’arbre et abritée par les masses d’un feuillage épais ? » Et comme son mari souriait d’un air d’incrédulité, elle entra dans tous les détails les mieux faits pour le convaincre.
« Comme force et comme hauteur, ces arbres, reprit-elle, dépassent de beaucoup celui dont je parlais tout à l’heure. Essaye, mon ami, d’imaginer un bouquet de dix à douze arbres merveilleusement soutenus en l’air par de forts arcs-boutants, formés de grosses racines qui semblent avoir poussé l’arbre tout entier hors de terre, de sorte que le tronc ne tient au sol que par une racine placée au centre et moins grosse que les autres. Jack a grimpé sur un des arcs-boutants et en a mesuré la hauteur avec une ficelle : cette hauteur est de trente-trois pieds ; depuis la terre jusqu’à la naissance des branches, soixante-six pieds ; le cercle formé par les racines a une circonférence de quarante pas. Je puis me tromper, mais, en somme, mon idée n’est point absurde. Il faut examiner avant de rejeter, et voir ensemble ce que nous pourrions faire pour notre établissement futur. »
Le mari avait commencé par rire un peu de l’idée de sa femme, mais, tout bien considéré, il trouva cette idée moins excentrique et même assez praticable.
« La première chose à faire, en supposant toutefois que nous allions nous établir là, serait, dit-il, de construire un pont solide et large au-dessus du ruisseau qui nous sépare de l’intérieur des terres et qui peut à tout moment devenir impraticable. »
Madame Arnold avait pensé qu’il suffirait de traverser le ruisseau à gué en transportant comme on pourrait les bagages. Mais elle ne tarda pas à se rendre aux raisons de son mari, quand celui-ci lui eut fait observer qu’il n’était pas prudent d’aventurer ainsi des bagages qui formaient leur unique richesse et constituaient, par conséquent, une véritable fortune. « Que deviendrions-nous, s’écria-t-il, si, par exemple, notre petit troupeau d’animaux domestiques venait à se noyer ? Je ne parle pas des difficultés sérieuses que pourrait faire naître un obstacle placé entre le lieu actuel de notre résidence et celui de notre résidence future. Changeons de place, j’y consens ; mais, avant tout, réservons-nous la possibilité de venir ici quand il nous plaira et quand nous le jugerons nécessaire. »
Madame Arnold fut de l’avis de son mari, et se mit aussitôt à réfléchir aux moyens d’effectuer le déménagement sans risque et sans danger.
Tandis qu’elle réunissait tous les paniers disponibles et se mettait à coudre des sacs pour transporter les vêtements et les étoffes, le bon ministre cédait au vœu de ses enfants qui l’avaient prié de se laisser conduire par eux à un endroit où ils étaient allés le matin. Les deux aînés avaient fait un butin magnifique.
Fritz, en habile tireur, avait tué un léopard qui, tapi dans les jungles, semblait friand de chair humaine ; il avait muselé un autre léopard de la grosseur d’un chat ; c’était une ravissante petite bête qui buvait du lait et ne griffait personne. Les enfants, qui prétendaient apprivoiser le petit léopard, l’avaient ramené à la maison ; il s’agissait à présent d’y transporter la pesante dépouille de l’autre. Le père leur conseilla d’emmener l’âne et la vache.
La petite troupe se mit en marche, et arriva bientôt à l’endroit où les enfants avaient laissé le cadavre du léopard. C’était une bête superbe ; son poil fauve était tacheté de noir et se détachait vigoureusement sur la verdure marécageuse des jungles. La dépouille était digne d’orner le palais d’un souverain ; mais l’endroit où gisait cette dépouille exhalait un air empoisonné et dangereux qui frappa le ministre. Tout à l’entour, entre des branches d’arbres au feuillage lustré et épais, on voyait poindre des têtes d’animaux inconnus et bizarres. Quelques-uns étaient ailés et ressemblaient aux dragons de la fable ; ailleurs, l’herbe, haute et comme soulevée par des mouvements souterrains, semblait cacher des nichées de serpents et de crocodiles.
On s’empressa de quitter un endroit dont le moindre inconvénient était d’exhaler des miasmes capables de donner la fièvre. Cependant M. Arnold s’était empressé de louer l’adresse et le courage de son fils aîné. Et comme la mère, à la vue du terrible animal, ne pouvait réprimer un cri de frayeur rétrospective, et tremblait à l’idée des dangers qui avaient menacé ses enfants, il l’engagea doucement à se calmer.
« Ce n’est pas pour rien, lui dit-il, que notre Fritz est un enfant des montagnes. Il faut le laisser libre de se perfectionner dans un métier où il excelle. S’il s’expose, la Providence l’a pourvu des moyens de se défendre. Qui ne risque rien n’a rien, et notre Fritz nous a été déjà d’un grand secours depuis notre malheur. Aujourd’hui, nous lui devrons peut-être tout à la fois un tapis superbe et un bon dîner. La chair du léopard est, dit-on, succulente et fort capable de restaurer des gens qui vivent au grand air et endurent de grandes fatigues. »
Pour construire le pont projeté, il fallait des matériaux qu’il était difficile de se procurer dans l’île. On songea d’abord à aller arracher des planches et des poutres au navire. Mais le vent et les vagues s’étaient chargés d’épargner ce soin à nos travailleurs. Des poutres, des planches, d’autres matériaux encore, provenant des débris du navire échoué, avaient été poussés à la côte, et séjournaient au fond d’une sorte d’anse qui n’était pas loin de la tente. Il paraissait facile d’aborder en cet endroit et par conséquent de retirer ces matériaux sans retourner au lieu du naufrage. Tout en examinant le terrain, M. Arnold et son fils aperçurent quelque chose de singulier, et dont, au premier abord, ils eurent peine à se rendre compte. De petits êtres encapuchonnés comme des moines et alertes comme des singes semblaient se disputer une proie volumineuse. Un instant, ils purent croire qu’une armée de Lilliputiens s’était abattue sur le rivage ; mais, en y regardant de plus près, ils reconnurent distinctement une nuée de mouettes.
La proie qui provoquait d’aussi vives disputes était un requin, celui-là même qui, le jour précédent, avait si fortement effrayé nos navigateurs. M. Arnold savait tout le parti qu’on peut tirer de la peau du monstre marin. On en peut faire des limes, ou bien le tanneur en adoucit les rugosités pour la rendre plus souple et en faire ce que les relieurs et quelquefois les cordonniers appellent de la peau de chagrin.