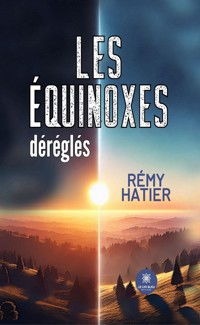Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Brice, conseiller financier dans une grande banque internationale, prend la fuite lorsque ses malversations sont révélées. Il se cache dans une bergerie délabrée au pied du Lan, montagne emblématique de la vallée de l’Ubaye. Sa survie, il la doit à Lily, gardienne de refuge, qui lui vient en aide. Sous le nom d’Aubin, il devient celui qui, par mauvais temps, accueille les randonneurs égarés. Un soir d’orage, il ouvre sa porte à Bastien, Blandine et Vénus. Mais qui est Vénus, celle pour qui il promet de fabriquer une paire de sabots avant le printemps ? N’est-elle pas celle qui l’obligera à faire face, une dernière fois, à un passé qu’il prétendait avoir laissé derrière lui ?
À PROPOS DE L'AUTEUR
Rémy Hatier signe sa première œuvre littéraire après une riche carrière professionnelle avec "Le paradoxe du verrou" en 2022. Il enchaîne rapidement avec "Le mâle des transports" en 2023, un recueil de nouvelles incisives, puis une duologie sensible et profonde : "Quand les ombres s’ensoleillent…" et "Les équinoxes déréglés" parus aux éditions Le Lys Bleu en 2023 et 2024. Grâce à sa nouvelle "Le parfum de Durance", il décroche le premier prix lors des « Rencontres Giono » en 2024. "Le sabot de Vénus", ancré en vallée de l’Ubaye, prolonge sa réflexion sur nos liens à autrui, au temps et aux valeurs qui façonnent nos vies.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Rémy Hatier
Le sabot de Vénus
Roman
Copyright
© Lys Bleu Éditions – Rémy Hatier
ISBN : 979-10-422-7123-7
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
À mon destin, désormais mon délice,
J’obéirai comme un prédestiné.
Charles Baudelaire
Un mal des mots
Nouvelle liminaire
L’imagination est trompeuse. Parée de ses atours aguichants, elle envoûte l’esprit et l’emmène en voyage vers des contrées brumeuses… Quand enfin l’horizon rêvé se révèle apparaît son vrai visage ; celui de notre simple humanité.
Car dans l’imaginaire, tout est vrai.
***
Les moulures travaillées qui, en façade, faisaient autrefois le prestige de la boutique étaient aujourd’hui délabrées ; malgré une vitrine décrépie dans laquelle ne trônaient que quelques présentoirs vides de toute substance, elle s’aventura à pousser la porte de la librairie. Non qu’elle eût un livre à acheter, mais cette morne devanture, où seule la délicate toile d’un faucheux donnait encore matière à rêver, acheva de l’intriguer. Qu’y avait-il donc là ?
L’odeur de papier moisi était prégnante, presque étouffante ; derrière une banque en bois témoignant des débuts de l’imprimerie, le libraire était assis, pas encore mort, mais plus tout à fait vivant.
Comme étranglée par l’atmosphère pesante, d’une voix soudainement enrouée, elle ne put qu’ânonner un faible « Non, merci » qui se désagrégea aussitôt en une volute enveloppée d’un rai de poussière. Pas le moins du monde surpris par cette réponse, l’homme désigna, figé dans l’obscurité de la boutique, un unique meuble portant encore quelques ouvrages.
Elle s’approcha et saisit un ouvrage ; il était blanc, étrangement blanc, ne portant aucune marque. Instantanément, en feuilletant à la volée les pages que tous les mots avaient désertées, elle fut submergée par une bouffée d’angoisse : ce livre était mort… Pas un mot, pas un seul, n’y était imprimé… Recueil inutile de pages vierges, de pages vides, s’il n’avait la rigidité du cadavre, il en avait bien la pâleur. Sa couverture était linceul.
Il posa alors sur elle un regard empli d’une incommensurable tristesse.
Elle frissonna, malgré elle, à la simple évocation de cette gangue de glace statufiant toute vie ; avant même qu’elle ne réagisse, il poursuivit :
Il lui présenta un nouvel ouvrage qu’il sortit d’un tiroir ; ne sachant à quoi s’attendre, elle tendit une main hésitante. Ses craintes furent confirmées quand elle découvrit un livre intégralement noir.
Le vieil homme sembla hésiter, comme si une superstition l’empêchait de révéler un secret.
Le libraire la fixa, sondant ainsi, avant de lui répondre, son honnêteté et sa sincérité par un suppliant regard porteur de serment.
Dans un léger sourire empreint d’un soupçon de désespoir, elle risqua :
Il se pencha sous la banque et posa devant elle une pile de livres dont les couvertures, éclatantes de vie, éclaboussèrent l’atmosphère lugubre d’un aveuglant halo de lumière. Seul, sur le dessus de cet empilement précaire, un livre semblait avoir déjà blanchi.
Avant même qu’elle ne repose le livre, il s’approcha d’elle et lui chuchota une phrase dans l’oreille.
Un peu tremblante et se sentant surtout stupide, elle se tenait droite devant le libraire, dans une attitude empruntée, s’apprêtant à lire un livre dans lequel aucun mot n’était imprimé. Devinant son désarroi, il insista avec bienveillance.
Bien que surprise par cette demande, elle répondit de bonne grâce.
Malgré tout peu convaincue, elle prit une ample respiration, mémorisant une ultime fois la courte phrase que le libraire lui avait apprise quelques instants plus tôt. Elle se lança enfin.
Avec toute l’application dont elle se montra capable, elle avait simulé la lecture de ce qui était, elle l’avait compris, la première phrase du livre. Mais la page resta blanche et sur son visage l’homme, lui, lut sa réelle déception ; elle pensait avoir échoué.
Elle, qui n’avait jamais fait de théâtre, se prit au jeu, emportée par le vibrant enthousiasme du libraire. La première surprise, elle récita, habillant sa voix d’une ardeur passionnée. Étreint par l’émotion, il articula difficilement.
Elle n’en crut pas ses yeux ; sur la page, encore vierge quelques instants auparavant, une phrase était maintenant imprimée ; celle qu’elle venait de réciter.
Elle revint vers l’ouvrage convalescent et, pour la première fois, en commença réellement la lecture.
Puis, alors que ses yeux progressaient d’un mot à l’autre, elle découvrit, d’abord surprise puis émerveillée, que les phrases revenaient à la vie, précédant son regard. Après un bref instant de silence traduisant son incrédulité, elle reprit la lecture.
Laissant cette dernière phrase en suspens dans l’atmosphère maintenant débarrassée de toute poussière, elle s’étonna de la douce fraîcheur et la tendre lumière qui baignaient la boutique, devenue clairière au printemps.
Inquiète, car se sentant comme investie d’une mission la dépassant, elle rétorqua :
Abandonnant sa banque, il se dirigea lentement vers la vitrine vide ; cherchant le ciel du regard à travers la vitre qui tamisait une lumière blafarde, il prophétisa :
***
À votre tour, dites « le sabot de Vénus », tournez la page et faites vivre les mots.
Le sabot de Vénus
***
C’est une fleur, une orchidée, vivace et rustique, qui de mai à juin enchante les clairières. J’ai lu quelque part qu’elle était superbe. Quel affront ! Quelle médiocrité ! J’avais renoncé à la décrire, tant les mots, une fois péniblement posés, se révèlent toujours dramatiquement arides… Je m’abandonne pourtant. Féminine, à l’élégance subtilement érotique, le sabot de Vénus s’offre à votre regard, s’invite dans votre imagination et y fleurit…
I
La bergerie du Lan
Les cimes des mélèzes se chamaillaient, chahutées par de courtes et violentes rafales ; Aubin fixait les joutes effrénées des branches, comme s’il espérait que tels des plumeaux, les pointes tendres et touffues des arbres allaient, par enchantement, nettoyer le ciel. Comme souvent à partir de la mi-août, en ce milieu d’après-midi, le soleil avait échauffé la masse d’air qui, voluptueusement attirée par l’air froid des sommets, consomma ses noces, s’arc-boutant langoureusement contre les brûlantes parois rocheuses. De l’étreinte tourbillonnante naquirent de magnifiques cumulus joufflus, se gonflant d’orgueil pour atteindre, en moins d’une demi-heure, l’âge de raison puis l’âge adulte ; alors mués en gigantesques cumulonimbus noircissant l’azur, leurs grondements ravivaient les plus profondes angoisses humaines.
Devinant que l’orage qui s’annonçait ne lui laisserait pas le temps d’abriter ses fagots de bois, Aubin se saisit des quelques bûches qui feraient la flambée du soir, quand un éclair bleuté zébra le ciel lugubre de la vallée. Il n’eut à compter que trois secondes avant qu’un puissant roulement de tonnerre, rebondissant d’ubac en adret, amplifié par de sourds échos se répondant sans fin du levant au couchant, ne fasse vaciller jusqu’aux plus solidement ancrés, les blocs de pierre qui se dressaient là-haut, sur les promontoires rocheux du Lan.
L’alpage, encore vert malgré la brûlure de l’été, était parsemé de ces blocs, qu’au fil des siècles le courroux de l’orage avait arrachés à la montagne. Immuablement, lorsqu’enfin les éléments libéraient leur trop-plein de fougue, Aubin entendait les prétentieux monstres de pierre tomber lourdement de leur piédestal. Après une chute vertigineuse, ils explosaient dans le pierrier, le nourrissant et le modelant de mille nouveaux éclats de roche, dont certains dévalaient jusqu’à l’orée de la forêt, en mutilant cruellement les premiers mélèzes.
Affolées par le bruit, désorientées par la charge électrique de l’air ambiant, les marmottes émirent une série de courts sifflements stridents puis plongèrent dans leurs terriers alors que les premières gouttes s’écrasaient lourdement, déchiquetant les colchiques à peine éclos. Prométhée, insensible à la colère de Zeus, Aubin bomba le torse, ouvrit les bras en croix et levant les yeux au ciel, prit quelques secondes pour s’imprégner de ce spectacle unique, unique, car à chaque fois renouvelé, de la nature restituant à l’homme le trop-plein d’énergie qu’il dissipait sans retenue dans l’atmosphère. Lily le répétait à l’envi : autrefois, avant la mise en eau du lac, avant le tourisme de masse et l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre, les orages n’étaient que de doux timides, étanchant la soif de l’herbe rase et des troupeaux en s’excusant de faire du bruit.
Malgré l’eau ruisselant sur son visage, Aubin aperçut un vol de choucas, puis une biche et son faon s’engouffrant, chacun à sa façon, dans l’enchevêtrement des ramures de mélèzes et se dit que plus haut, chamois et bouquetins allaient se regrouper dans quelques replis du relief connus d’eux seuls, par lesquels une nature déchaînée, mais indulgente à leur égard, offrirait sa bienveillante protection. Un dernier regard vers le Nord lui confirma que sur le versant adret, depuis la Tête de la Raisinière dans le lit du Riou Bourdoux, d’irascibles et tumultueuses vagues de lave torrentielle s’élançaient déjà vers le fond de la vallée.
Dans l’ancienne bergerie, il faisait maintenant nuit, à quatre heures de l’après-midi. Aubin rajouta deux morceaux de bois dans le foyer qu’il n’éteignait jamais, été comme hiver ; la bataille du feu n’était jamais gagnée. De nouvelles flammes apparurent, apportant un flux de lumière et de chaleur alors qu’il se défaisait de son tricot humide puis enfilait un vêtement plus épais. Il réalisa qu’il ne s’était pas encore préparé à l’hiver, se laissant bercer dans la torpeur d’un été radieux et par le souvenir de l’automne précédent dont la sournoise douceur avait anesthésié hommes et bêtes. Un simple regard vers le tas de bois qui attendait son heure à côté du foyer lui fit prendre conscience qu’il était grand temps de se réveiller. Il dressa alors la liste de tout ce qui lui restait à faire avant que les premières neiges ne le bloquent ici, à plus de deux mille mètres d’altitude.
Il tentait maintenant de regarder par la fenêtre donnant sur la vallée, mais restait hypnotisé par le déluge qui s’abattait. Sur les lauzes du toit, il entendait le martèlement de la pluie et, par les interstices de l’huis en mélèze mal ajusté au mur de pierre, de vifs courants d’air s’invitaient en sifflant. Il traversa l’unique pièce jusqu’à l’autre fenêtre qui, au Sud, admirait la fine crête en dentelle de schiste scellant l’union du Lan et de la Méa. Les rochers émergeaient de l’alpage, ressemblant à s’y méprendre à des crocs acérés se plantant avidement dans les nuages, comme pour les saigner. Au pied du délicat ruban rocheux, découpés dans l’herbe, Aubin apercevait quelques lacets du sentier qui, après encore plus d’une heure de marche, amenait les randonneurs éreintés au refuge de Cloche.
Quelques secondes durant, cherchant à apercevoir un randonneur en quête d’abri, il se retourna sur son passé, se disant que s’annonçait là son onzième hiver dans cet ancien refuge de berger posé au milieu d’une vaste clairière, qu’un rempart de mélèzes empêchait de s’abandonner sans pudeur à l’alpage ; une bergerie qu’il avait patiemment restaurée pour en faire sa demeure, sa dernière demeure. Il se revit, marchant sans but sous le déluge d’un après-midi de septembre ; cherchant malgré tout à s’abriter, il avait jeté ici son sac, contraint par les bourrasques de la pluie d’orage qui le fouettaient. Ne restaient alors dans ce paradis pour ronces, framboisiers sauvages et bouquets d’orties que quatre murs, un pan de toit pas encore tout à fait effondré ainsi que les vestiges noircis d’une porte et de fenêtres calcinées.
Il y eut cet après-midi de septembre. Le sentier de grande randonnée passait à quelques centaines de mètres des ruines de l’ancienne bergerie et, bien plus haut, se trouvait le refuge de Cloche que Lily faisait vivre, mais Aubin l’ignorait. Il était installé depuis une semaine, lorsqu’attirée par une fumée s’échappant de la clairière, elle quitta le sentier et se présenta devant lui. Montagnarde aguerrie, accompagnée de son chien et d’un mulet bâté lourdement chargé, elle s’approcha sans crainte et découvrit un ermite prêt à vivre là ses derniers jours.
Dix ans plus tôt…
Bien qu’alerté par le clair tintement du grelot pendant au collier du chien, le ton d’Aubin marqua la surprise et la méfiance.
La gardienne du refuge de Cloche était une petite bonne femme, dont le visage aux traits burinés par l’air sec de la montagne se faisait pourtant rieur, éclairé qu’il était par un regard miroitant douceur et bienveillance ; elle nouait ses longs cheveux, blanchis par les années, en un chignon qui tenait, comme par magie, planté sur son crâne par un fin morceau de branche, de mélèze certainement. Lily, n’ayant pas, malgré tout, un caractère à s’en laisser conter, attaqua sans ambages.
Elle jeta un rapide coup d’œil dans les restes de la bergerie effondrée pour constater qu’Aubin s’y était sommairement installé.
Elle fixa Aubin qui hésitait à parler.
Surprise, Lily regarda Aubin, se disant que ce citadin devait souffrir du mal des montagnes.
Bravache, Aubin répondit sur un ton très assuré.
Lily restait silencieuse, perplexe, ayant le plus grand mal à jauger exactement la situation. Elle en avait déjà côtoyé des centaines, de ces randonneurs mal préparés, pensant qu’il suffisait de s’équiper de tout un barda de matériel de montagne pour se confronter aux cimes en toute sécurité. Mais un citadin, plutôt légèrement équipé à ce qu’elle pouvait voir, qui avait la prétention de s’installer définitivement à plus de deux mille mètres d’altitude sur le versant ubac, elle n’en avait jamais croisé.
Aubin l’aida à transporter de larges morceaux de pierres plates dont il apprit qu’elles s’appelaient des lauzes. En quelques minutes, Lily avait bâti un foyer fermé, qu’elle avait adossé au pan de mur le plus solide restant de la bergerie.
Il ne répondit pas. Lily fit un dernier tour d’horizon de l’univers spartiate d’Aubin et déclara :
Aubin esquissa un sourire ; après une vie dans laquelle il avait tout eu, tout acheté, puis pris tout ce qui ne pouvait s’acheter, il recherchait, comme une rédemption, une vie faite du plus grand dénuement. Lily pouvait-elle le comprendre ?
Il se cachait, il fuyait et Lily l’avait deviné. Chercher et juger la raison de cette fuite n’était pas dans sa nature. Pour elle, cet homme venu se perdre en ce milieu hostile, espérant se retrouver, n’avait besoin que d’une chose : qu’on lui tende la main.
Dix ans déjà… Ou peut-être neuf, voir onze ou plus, il ne savait plus vraiment et avait délaissé depuis longtemps ce décompte futile. Des cris tirèrent Aubin de sa rêverie ; deux voix se mêlaient, dont les tonalités angoissées ou joyeuses trahissaient la composition du groupe qui, en courant, s’approchait du refuge. Sans attendre qu’ils tambourinent à sa porte, ou même qu’ils entrent sans y avoir été invités, Aubin entr’ouvrit le battant de mélèze et accueillit deux ponchos ruisselants.
Se défaisant de leurs impressionnants sacs de randonnée, rassurés de se trouver enfin à l’abri, mais quelque peu désarçonnés par la rudesse des propos qui venaient de leur être adressés, les deux se découvrirent et obtempérèrent sans un mot, déposant ensuite leurs effets trempés dans un vieux bac de douche, sommairement posé derrière la porte. Aubin les regardait froidement, essayant de jauger rapidement à qui il pouvait avoir affaire ; hésitant entre sourire confus ou gêne joyeuse, une femme et un homme se tenaient devant lui. C’est l’homme qui brisa le silence.
Aubin lui coupa la parole, sans ménagement.
Puis, les fixant sans chercher à les dévisager, il ordonna :
Soulagée de se sentir en sécurité, la femme tenta un trait d’humour.
Aubin ne broncha pas, manifestement blasé.
Presque penauds, ils enfilèrent chaussons et sabots puis restèrent plantés dans la pièce, toujours quelque peu réfrigérés par l’accueil revêche qu’Aubin leur avait réservé.
Dehors, l’orage avait étranglé la lumière et dans une pénombre tutoyant l’obscurité, Aubin ne distinguait plus que les traits de leurs visages éclairés par les flammes. Ils s’avancèrent prudemment vers le mur au sud, depuis lequel l’étroite fenêtre donnait sur l’alpage. Dans l’angle à droite, Aubin avait bâti une cheminée, plus exactement un foyer ouvert dont le but était de donner, certes un peu de chaleur, mais surtout de la lumière, quand l’angle opposé accueillait un antique poêle en fonte émaillée, émettant un rassurant ronronnement.
Il imagina un couple de bourgeois bohèmes, approchant la cinquantaine, s’étant lancé sur le chemin de randonnée sans trop de préparation. Passant entre eux, il se saisit de la bouilloire qui, posée sur le poêle, chuchotait en permanence. Ils étaient silencieux, s’échangeant des regards en coin, se demandant certainement s’ils n’étaient pas tombés dans les griffes d’un maniaque. Aubin, dont le flot de paroles et le goût pour la communication s’étaient taris à l’aune des années de solitude, décida pourtant de détendre l’atmosphère.
Bastien réagit le premier.
Entendant Aubin se lancer dans l’énumération des vertus médicinales d’Artemisia Umbelliformis, les visages des naufragés se décrispèrent ; derrière cet homme, capable de parler ainsi d’une plante de montagne, ne pouvait se cacher un dément prêt à les égorger.
Blandine répondit pour son mari.
Aubin n’eut pas le loisir d’achever sa phrase ; faisant trembler les murs et le toit de pierre, dans un vacarme assourdissant, la foudre s’abattit à proximité immédiate de la bergerie. Une fraction de seconde durant, l’air fut ionisé et depuis l’extérieur, par les deux fenêtres en mélèze qui s’ouvrirent sous la déflagration, une étrange lumière d’un aveuglant bleu électrique traversa la pièce. Terrorisée, Blandine se réfugia précipitamment dans les bras de Bastien qui lui aussi fit un bond, se recroquevillant au sol. Aubin resta impassible.
De la porte, des coups timides résonnèrent, à peine perceptibles, car couverts par le martèlement de la pluie qui redoublait de violence. Aubin ouvrit rapidement et, soudainement inquiet, s’effaça pour découvrir et laisser entrer une nouvelle randonneuse en perdition.
Il l’aida à se défaire de ses vêtements de pluie.
Aubin posa enfin son regard sur le visage de celle qu’il venait d’accueillir ; sur le ton de la confidence, elle déclara :
Il reprit calmement le service de l’infusion alors que le couple se relevait lentement, se remettant péniblement du choc subi.
Aubin revint vers Blandine avec le regard fermé de celui qui ne compte pas se soumettre à un interrogatoire.
Ne se laissant pas déstabiliser par le ton de la réponse, elle poursuivit.
Il l’interrompit, comme si le verbiage parfois un peu précieux de cette femme l’exaspérait.
Blandine décida de tenir tête à ce montagnard un peu trop obtus à son goût.
Écarquillant les yeux de stupeur, Bastien regarda sa compagne, comme si elle avait posé une question sacrilège.
Aubin eut envie de rajouter « un peu pompeux, un peu trop curieux, mal préparés et qui auraient mieux fait de rester chez eux ! » ; mais alors qu’il versait la première tasse et la tendait à Blandine, il choisit d’adoucir le ton.
Puis il rajouta :
C’est alors Bastien qui se lança, profitant du fait qu’Aubin lui semblait enfin enclin à parler.
Aubin lâcha, presque sur le ton de la confidence :
Blandine venait de porter la tasse à ses lèvres pour la première fois. Elle déglutit et Aubin la vit esquisser une grimace de surprise.
Il se dirigea vers le fond de la bergerie ; au mur faisant face au foyer, à gauche de la pile, un bloc de pierre creusé qui faisait office d’évier, un bahut vermoulu était adossé. De sa partie basse, Aubin sortit un pot de verre et d’un tiroir qui s’ouvrit en renâclant une cuillère.
Bastien désigna la troisième tasse qu’Aubin venait de poser sur la table.
Aubin regretta aussitôt cette saillie sur un mode mi-humoristique, mi-caustique et reprit aussitôt :
Il allait finir sa phrase par « comme je vous l’ai déjà expliqué ! », mais décida d’économiser ses paroles. La pluie qui tambourinait toujours sur le toit de pierre meubla alors le silence. Plus par politesse que par réel intérêt, levant les yeux, Bastien s’enquit de l’étanchéité de cette toiture minérale. Aubin lui répondit, toujours laconique.
Par instant, le tonnerre roulait encore dans la vallée, mais tous comprirent que la fureur de l’orage s’apaisait lentement. Finissant sa tasse d’infusion dans laquelle il avait dilué une grande quantité de miel, Bastien se leva.
Aubin venait de statuer ; ne manquait à sa déclaration que le bruit cassant d’un marteau de juge.