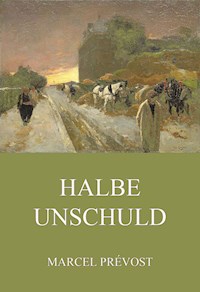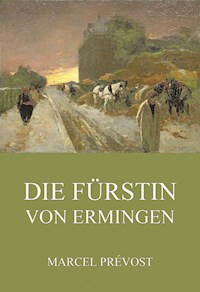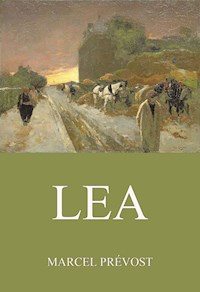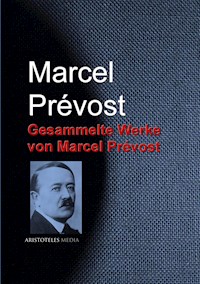0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Depuis qu’il avait tourné l’angle des quais de la Seine, en venant de la gare d’Orléans, pour suivre aux clartés du gaz la montée du boulevard Saint-Michel, – vingt fois déjà des exclamations pareilles avaient salué Auradou… Lui, égaré, affolé comme un oiseau de nuit jeté tout d’un coup en plein jour, continuait à se frayer une route entre les bandes d’étudiants et de femmes qui descendaient le long du trottoir, houleuses comme un flot… Rêvait-il ?… Il n’en savait rien… Autour de lui tourbillonnait une foule bizarre, – des hommes très jeunes, le masque tiraillé et vieillot, convulsé par un rire factice ; – des femmes aux mouvements d’automates, à la figure artificielle, d’un blanc de plâtre et d’un rouge sanglant… Justement, ce soir-là, le quartier était en effervescence ; dans la journée, quatre étudiants avaient été acquittés en correctionnelle, après une bataille à Bullier avec des souteneurs. On fêtait leur mise en liberté et le boulevard latin avait sa physionomie des jours de carnaval.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Marcel Prévost
LE SCORPION
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782385741884
À José-Maria de Hérédia
PREMIÈRE PARTIE
I
— Regarde donc ce curé qui déménage !
— Hé, mon petit père, faut-il te porter ta malle ?
— C’est pas un curé, çà, voyons ! Il est trop jeune !…
— C’est une farce de carabins… Coâ !… Coâ !…
Depuis qu’il avait tourné l’angle des quais de la Seine, en venant de la gare d’Orléans, pour suivre aux clartés du gaz la montée du boulevard Saint-Michel, – vingt fois déjà des exclamations pareilles avaient salué Auradou… Lui, égaré, affolé comme un oiseau de nuit jeté tout d’un coup en plein jour, continuait à se frayer une route entre les bandes d’étudiants et de femmes qui descendaient le long du trottoir, houleuses comme un flot… Rêvait-il ?… Il n’en savait rien… Autour de lui tourbillonnait une foule bizarre, – des hommes très jeunes, le masque tiraillé et vieillot, convulsé par un rire factice ; – des femmes aux mouvements d’automates, à la figure artificielle, d’un blanc de plâtre et d’un rouge sanglant… Justement, ce soir-là, le quartier était en effervescence ; dans la journée, quatre étudiants avaient été acquittés en correctionnelle, après une bataille à Bullier avec des souteneurs. On fêtait leur mise en liberté et le boulevard latin avait sa physionomie des jours de carnaval.
Derrière Auradou, qui traînait au milieu de ce tumulte sa soutane grise de la poussière du voyage et sa grande valise à forme ancienne, une bande s’était peu à peu formée – étudiants et filles, complètement saoûls. Ils le suivaient sans qu’il s’en aperçût, alignés en monôme, hurlant une romance du quartier :
Les p’tit’s fill’s de la Villette
Ne sont pas laides du tout,
Laides du tout,
Elles ont des chemisettes
Qui ne pass’nt pas le genou…
Entends-tu le coucou, Marinette,
Entends-tu le coucou ?…
La mélopée était étrange ; elle sautillait, aidant à la marche. D’instinct, sensible au rythme comme tous ceux de Gascogne, Jules Auradou avait réglé son pas sur la mesure de l’air, et il semblait vraiment conduire le monôme. Des gens attablés aux cafés, voyant passer cela, croyaient à une farce, la trouvaient plaisante, et riaient…
Au coin du boulevard Saint-Germain, Auradou hésita un peu. Le remous de la foule encombrait les abords des tramways… Il n’osait passer. La bande qui le suivait eut le contre-coup de son arrêt ; il y eut des bousculades et des cris. Lui, ayant vainement cherché des yeux un gardien de la paix qui lui indiquât sa route, se décida à traverser… Les autres le suivirent avec des gambades. La chanson déroulait toujours la série de ses couplets :
Elles ont des chemisettes
Qui ne pass’nt pas le genou,
Pas le genou ;
Le tailleur qui les a faites
A regardé par-dessous !
Entends-tu le coucou, Marinette,
Entends-tu le coucou ?…
Mais brusquement, une bande de jeunes gens, accrochés par le bras, se mit à dévaler des hauteurs, prenant le trottoir en travers, bousculant tout au milieu des protestations et des injures. Auradou se trouva pris dans le tourbillon, porté un instant avec sa valise, collé contre une belle fille qui, pour rire, se serrait sur lui, en lui faisant sentir tout le moulage de son corps. Enfin, on se dégagea ; des gardiens de la paix rompirent les bandes et firent circuler les curieux… Il s’était fait autour du jeune homme une sorte de vide, mais, de partout, la foule arrivait reformée… Auradou eut peur de se retrouver pris. Perdant la tête, il tourna à gauche, et enfila une des rues latérales qui s’ouvraient sur le boulevard, pleines de mystère et de nuit.
Là, tout changeait subitement. Presque personne. À peine quelques lumières aux fenêtres, – aux portes entrebâillées où se pressaient trois ou quatre filles de brasserie, curieuses de voir du côté du boulevard… Auradou s’avançait, le cœur troublé et douloureux… Une vague anxiété l’envahissait, à présent qu’il marchait dans cette ombre. Ses souvenirs de là-bas lui revenaient – ce qu’on disait de Paris au séminaire – la grande Babylone, la Sodome moderne. Derrière les façades lépreuses, son imagination devinait on ne sait quelles scènes monstrueuses – des choses comme on en voit dans les livres de confesseurs, – des crimes de Gomorrhe. Et, presque malgré lui, ses yeux plongeaient avidement par l’entrebâillement des portes, où il croyait apercevoir des formes confuses, enlacées…
Quelqu’un lui prit le bras dans l’ombre. Auradou tressaillit. C’était une femme.
Toute petite, grasse, sentant la parfumerie – elle lui disait :
— Viens-tu chez moi, mon bébé ? – J’ai un bon feu. Viens-tu… Allons, mignon, laisse-toi aimer…
Elle s’interrompit, – et s’esclaffa :
— Ah maman ! elle est bonne ! j’ai raccroché un curé !…
Tandis quelle s’éloignait, Auradou l’entendit longtemps encore rire bruyamment de la rencontre. Lui, cette aventure vulgaire l’avait secoué jusqu’aux profondeurs de son être. Il poursuivit sa route en se frappant le cœur :
— Mon Dieu, ayez pitié de moi ! Je suis un misérable et un lâche…
Il se signa, ayant regardé furtivement s’il était bien seul. La crainte le tenait maintenant d’avoir succombé un instant, – lorsque cette femme se pendait à lui. Alors, perdu dans le labyrinthe de ses remords et de ses désirs, il murmura le mot amer de saint Augustin :
« Je demandais la chasteté – et j’avais peur de l’obtenir… »
Cependant, la rue tourna presque d’équerre. La nuit se fit plus opaque. De loin, Auradou entendait encore bruire le boulevard, – poursuivi par le rythme cadencé de la chanson :
Entends-tu le coucou, Marinette,
Entends-tu le coucou ?
La rue sinueuse qu’il suivait s’était tout d’un coup ouverte sur une voie plus large… Sans s’en douter, il était revenu sur ses pas ; du trottoir qui longe le Collège de France, il revoyait maintenant la grande illumination du boulevard Saint-Michel, dont le tumulte lui parvenait.
Décidément, il s’était perdu.
Un polytechnicien passa, le pas rapide, la pèlerine flottante. Auradou le prit pour un gardien de la paix et, l’abordant timidement, lui demanda :
— Monsieur, la rue des Postes, s’il vous plaît ?…
Justement il était tombé sur un « postard ». Le jeune homme répondit :
— La rue Lhomond, vous voulez dire ? Suivez le Collège de France ; troisième rue à droite. Vous arriverez sur une grande place où il y a un monument ; le Panthéon. Tournez-le à gauche, et allez ensuite droit devant vous, jusqu’à ce que vous trouviez une rue perpendiculaire. C’est la rue des Postes.
Il salua et s’éloigna.
Auradou reprit sa marche. Il hâtait le pas, à présent, pressé d’arriver.
Il s’engagea dans de petites rues très étroites ; il y avait sur les portes des gens qui causaient, comme en province… L’écho du boulevard se faisait moins distinct. Seulement, en passant devant un débit, le jeune homme entendit le grincement d’un violon et les trépignements d’un quadrille… Tout cela lui rappelait Nicole, et les frairies du mois d’août, et les bals chez Hortense, dont le bruit venait les troubler dans leur retraite, son frère et lui, et dérangeait les gens pieux qui priaient à vêpres…
Auradou traversa la grande place, où le Panthéon dessinait ses contours puissants, comme une bête monstrueuse qui eût dormi là. Il se répétait les indications du polytechnicien :
— … Tourner à gauche… Puis tout droit jusqu’à une rue perpendiculaire…
À la lueur d’un réverbère d’angle, il lut sur une plaque, devant lui :
— Rue Lhomond.
Il était arrivé. Le cœur lui battit à se sentir si près du but. Comment allait-on le recevoir dans cette grande maison de prêtres, lui, étranger à la « province, » – presque inconnu ?…
Devant lui se dressait une muraille grise, surmontée de treillages comme pour défier toute escalade ; puis venaient des bâtiments aux fenêtres closes, – pas une lumière, pas un bruit. C’était bien ainsi qu’il s’était figuré cette maison des Postes, d’après les récits du P. Jayme… Il vit une porte cochère, enfoncée dans une arcade dont l’arc fléchissait : il chercha une sonnette ou un marteau et ne trouva rien.
À la porte suivante, il vit un marteau et frappa. Le bruit éveilla des résonances lointaines, comme s’il eût traîné parmi les espaces sonores de grandes salles inhabitées. Auradou attendait, à la porte, appuyé contre le battant. Mais rien ne venait ; c’était un silence mortel, plein d’épouvantements.
Alors il eut peur. Peur de s’être définitivement égaré ; peur d’être le jouet d’une illusion fantastique ; – peur de rêver on ne sait quel cauchemar incohérent ; – toutes les peurs confuses d’une imagination désordonnée que l’idée constante de surnaturel emplissait du doute des choses existantes… Ses lèvres murmurèrent avec tremblement la phrase – l’oraison jaculatoire par laquelle, d’habitude, se traduisaient toutes ses prières mentales :
— Mon Dieu ! ayez pitié de moi : Je suis un misérable et un lâche !
Il fit un effort sur lui-même et avança encore de quelques pas. Là, la rue s’éclairait d’un bec de gaz, au-dessus d’une porte voûtée, basse et massive. Comme le jeune homme allait se décider à frapper encore une fois, la porte eut un sourd tressaillement et s’entrouvrit d’elle-même.
Auradou, l’ayant poussée, se trouva dans un vestibule. Un vieux en lunettes lisait un gros livre, dans une loge vitrée. Il lui demanda, s’approchant du guichet :
— C’est bien ici la rue des Postes ?
Le vieux ne répondit pas. Il poursuivit sa lecture quelques instants après s’être levé, ouvrit la loge et précéda Auradou. Ils traversèrent ensemble une petite cour, puis d’immenses corridors éclairés d’espace en espace. Un religieux en soutane noire passa, le pas allongé et lent, les mains pendantes sur les grains du rosaire. Jules le salua, et le religieux souleva sa barrette.
Dix heures sonnaient. Devant une porte qu’éclairait une lampe d’applique, le vieux s’arrêta et dit à mi-voix ces deux mots :
— Père Préfet !…
Puis il frappa.
— Trez !… fit une voix à l’intérieur.
C’était une chambre banale de religieux, des murs, peints en vert, quelques lithographies pieuses ; le bureau de chêne blanc, l’alcôve à rideaux jaunes.
Le préfet, un petit homme gros et rond, était debout devant son bureau, examinant une facture. Sur le bureau, des patins américains, destinés aux élèves, s’entassaient, tirés d’un paquet éventré à terre dont la paille, les ficelles et le papier encombraient le plancher.
Il n’avait jamais vu Auradou. Mais, dès qu’il l’aperçut devant lui, il lui tendit les deux mains.
— C’est vous Jules ?… Fait bon voyage, n’est-ce pas ?… Plein de bonne volonté, de confiance ?… Besoin de vous peut-être bientôt, vous savez ?…
Et il l’embrassa d’un double baiser de prêtre, un sur chaque joue – un simple contact qui piqua désagréablement le jeune homme-comme le frôlement d’une râpe.
— Mais oui, mon père, murmura celui-ci. Bien sûr je suis tout à vous… Vous savez sans doute mon vif désir d’entrer dans la Compagnie.
Il s’attendait à quelques mots de pieux encouragements, mais le préfet éclata d’un gros rire.
— Ah ! fit-il : ce bel accent gascon, je le reconnais… Cela me rappelle Bordeaux, et le courss de l’Inteindeince, et le beau collège ogival de Tivoli… Poh !…
Il eut quelques instants d’hilarité, devant le jeune homme décontenancé. Enfin il reprit son sérieux.
— Ostiarius, n’est-ce pas ? murmura-t-il.
— Oui, mon Père. Depuis le 8 décembre dernier… Dans notre diocèse, à Agen, on donne séparément les petits ordres… Dans cinq ans j’aurais été prêtre…
— Maintenant, mon Jules, répondit le P. préfet, vous le serez dans treize, si vous restez avec nous. Trente-trois ans !… La mort de Notre-Seigneur… Il a bien attendu jusque-là pour célébrer le saint sacrifice. Vous pouvez bien faire comme lui, pas vrai ?… Poh !…
Il éclata de rire de nouveau, trouvant cette idée drôle. Il poursuivit :
— Cela vaut mieux comme cela, voyez-vous. Les novices entrant dans la compagnie n’ayant au plus que des ordres mineurs, – voilà ses vrais fils. Les autres n’en sont que les gendres. N’est-ce pas saint Ignace qui a dit cela, frère ?… Poh !…
Le Frère portier – ce vieux qui avait conduit Auradou et qui se tenait dans l’ombre, eut un sourire respectueux.
— Demain, reprit le préfet, vous commencerez à travailler… Vous allez refaire vos élémentaires avec les saint-cyriens. Ce n’est pas la première fois, ici, qu’un minoré suit les cours des élèves. Tous nos professeurs y ont passé. Les élèves ont même donné un nom à ces condisciples en soutane. Ils les appellent des scorpions.
Jules se taisait. Le Jésuite continua, s’adressant au frère :
— Allons, montrez-lui sa chambre, à cet enfant !… Vous allez être à votre aise, allez !… Au noviciat, si vous y êtes jamais, vous n’aurez pas des appartements comme cela pour vous tout seul… Pauvre enfant !…
Et, l’attirant contre lui, il le baisa avec une tendresse sincère, toute paternelle, et lui traça ensuite, du pouce, une croix sur le front.
— Conduisez-le, Frère… Vous savez, l’ancienne chambre du P. Chabrier.
Jules, ému sans s’expliquer pourquoi de cet accueil, s’en alla, suivant la longue redingote du frère par les corridors pleins de pénombre… Des tableaux encadrés s’accrochaient aux murs… Les deux hommes montèrent un escalier de pierre, bien large, usé des deux côtés aux piétinements des doubles files d’élèves…
Devant une lampe clignotante, qui veillait une statue de la Vierge, tous deux se signèrent.
Ensuite le corridor se faisait tout noir. C’était un silence de nécropole, – un silence prodigieux…
Le Frère, qui voyait clair dans cette nuit, s’arrêta, et ouvrit une porte en disant :
— Votre chambre !…
Leurs yeux, habitués à l’obscurité, distinguèrent à la demi-clarté qui tombait de la fenêtre une pièce assez vaste, avec alcôve et bureau, comme celle du préfet.
— Vous avez des allumettes sur votre table de nuit, dit le portier. Bonne nuit, sous la protection de la sainte Vierge et de votre ange gardien.
Et il disparut.
Auradou, demeuré seul, posa sa valise à terre et, sans allumer de lumière, s’approcha de la fenêtre. La rue s’éclairait vaguement devant lui. Sous ses yeux s’élevait le mur austère du collège des Irlandais. Des silhouettes d’arbres nus surmontaient sa crête, – et ces arbres et ce mur étaient tout ce qu’on voyait…
Les émotions de la soirée, les fatigues du voyage se résolvaient maintenant pour le jeune homme en une fièvre épuisante, qu’il sentait lui jaillir des doigts en effluves électriques… Très vite, il se déshabilla et ouvrit le lit… Mais, avant de s’y étendre, il s’agenouilla, malgré sa fièvre, et se mit à prier.
Prière très longue, qu’il recommençait cent fois, reprenant chaque oraison où il pensait qu’une distraction l’avait saisi… Onze heures sonnaient quand il se releva ; il se glissa dans la couchette, mais pour se jeter au dehors presque aussitôt : c’était une mortification quotidienne que cette relevée immédiate, et la prière grelottante qui suivait, à genoux nus sur le carreau… Celle-ci finie, il baisa plusieurs fois le sol, ayant écarté la descente de lit pour trouver le froid du carrelage, qu’il effleura de sa langue.
Et, lorsqu’il fut rentré dans ses draps, ce furent encore des embrassements de scapulaire, de longues litanies de demandes spéciales :
— Mon Dieu, très sainte Vierge, mon saint Patron, je vous offre cette nuit. Faites, je vous en prie, qu’il n’y ait ni pour Pierre, ni pour le père Jayme, ni pour tous ceux que nous aimons, de péché, de maladie ou de mort… Donnez-moi des affections pures et des rêves purs… Faites que je sois bientôt novice et éclairez-moi sur ma vocation…
Puis il tira le chapelet qu’il avait glissé sous son traversin et récita trois dizaines. Il baisait les grains avec une ferveur extraordinaire, et, après chaque dizaine, murmurait :
— Cœur de Jésus, faites qu’Elle reste chaste !… Je vous donne ma vie pour sa pureté.
Enfin, la longue série de ses oraisons étant close, – il se pelotonna sous les couvertures et chercha le sommeil…
Mais la fièvre le tenait toujours ; elle évoquait devant ses yeux fermés, pêle-mêle avec les derniers tableaux de Paris entrevu, – les souvenirs du village natal, quitté la veille… Un grand fleuve gris, couleur d’étain, traînant son ruban entre les peupliers et les « aoubas ; » – d’étranges cavernes, creusées dans la craie d’un roc ; et, au milieu de ce paysage apparu comme à travers un brouillard d’hiver, – une forme de fillette blonde, les cheveux en tresse, une robe à petits dessins blancs sur fond violet…
Tout le pays natal – le cher pays ! – se découvrait en courtes échappées, alternant avec les récentes visions du boulevard latin, de ce coin de Paris traversé tout à l’heure… Cela tourbillonnait dans son rêve en mascarade houleuse, tandis qu’au loin il croyait entendre encore le rythme sautillant de la chanson :
Entends-tu le coucou, Marinette,
Entends-tu le coucou ?
II
Toute la vie d’Auradou avait tenu jusque-là dans le cadre obscur du hameau de Gascogne, où, vingt ans auparavant, il était venu au monde.
Bien des villages de l’Agenais ressemblent à celui-là. À cheval sur la route d’Aiguillon à Tonneins, – pris entre les coteaux et le talus du chemin de fer, – Nicole se voit à peine des hauteurs, semant ses toits rouges dans le vert des arbres. Seule, l’église, avec son bas clocher, émerge au-dessus de l’amas confus des maisons… Mais, à deux pas de là, le paysage s’ouvre radieusement. Le Lot et la Garonne se rejoignent, découpant à leur confluent, entre deux vallées admirables, une île étroite, toute en peupliers, – qui d’en haut semble un croissant de verdure sur fond d’argent.
La maison où Jules Auradou vint au monde est la seconde qu’on rencontre en venant de Tonneins. Depuis trois ans, elle est redevenue ce qu’elle était quand il y naquit, – l’auberge de l’endroit. Les marchands de bestiaux y descendent, allant et venant entre les gros bourgs voisins, les veilles et les lendemains de foire… Au milieu d’une nuée de mouches, on y sert le tourin aux tomates, – et le jambon de Tonneins, cuit dans son jus.
En 58, le pays était prospère – autrement riche qu’à présent. Toutes les plaies d’Égypte se sont abattues sur ce Lot-et-Garonne, et le ruinent peu à peu : le phylloxéra qui ronge les ceps, la gelée qui tue les pruniers, la grêle qui met en morceaux les pieds de tabac ; puis de temps en temps, la Garonne, qui sort de son lit, emporte les arbres avec l’humus, et démolit les villages… Mais, au temps de la naissance du petit Auradou, – les terres rapportaient, les ventes marchaient ferme, les foires et les frairies étaient nombreuses et fréquentées… Dans la salle basse de l’auberge, la mère Auradou – la Martine, comme on l’appelait, suffisait à peine avec sa petite servante Estelle, à servir le monde, et, les jours de marché, il fallait mettre des tables devant la porte, pour que chacun pût manger.
La Martine, au milieu de ce tumulte, des appels sonores en patois local, du choc des verres et des bouteilles, promenait gaillardement sa belle carrure et sa grosse gaîté d’ancienne jolie femme, maintenant veuve et voisine du retour. Le village et le pays l’estimaient : on la savait bonne et très honnête, un peu trop dans les curés, par exemple, disaient quelques-uns ; mais on l’excusait ; n’avait-elle pas un grand fils de vingt-cinq ans prêtre à Agen, professeur de mathématiques au petit séminaire de Saint-Caprais ! Il venait de temps en temps la voir à Nicole. Alors, la Martine débordait d’orgueil. Très fière, elle se promenait le soir sur la route, le long du village, au bras de ce grand garçon à la figure d’ascète, qu’on disait si savant et que les paysans saluaient respectueusement en l’appelant Moussu Pierre !…
Or, le 2 février 1858, Pierre Auradou reçut à Agen une lettre de sa mère – une lettre écrite de cette grosse écriture incorrecte qu’il connaissait bien. Elle lui demandait de venir tout de suite à Nicole. Non pas qu’elle fût malade, au moins ! Mais elle avait quelque chose d’important à lui dire : il fallait qu’il vînt et même qu’il se hâtât…
Pierre demanda un congé à ses supérieurs et partit tout anxieux. Que pouvait lui vouloir sa mère ?… C’était la première fois qu’elle le mandait ainsi en plein milieu de l’année… L’inquiétude le mordait au cœur, tandis que le train l’emportait à travers la vallée de l’Agenais, toute dévêtue par l’hiver. Il avait peur, malgré l’assurance que lui donnait la lettre, de trouver la Martine au lit, malade à mourir. Vaillante comme il la savait, elle aurait été bien capable de travailler jusqu’au bout et de ne se coucher que pour tout à fait.
À Port-Sainte-Marie, comme le train s’était arrêté, ronflant devant la gare où tremblait la sonnerie d’un timbre, – il vit sur le quai des métayers de Clairac qu’il connaissait, – causant entre eux à grand renfort de gestes et de jurons… De la portière il leur dit bonjour ; les gens se retournèrent, cessèrent brusquement de se parler, l’air gêné. Un seul répondit :
— Eh ! adieu, moussu Pierre !
Ils s’éloignèrent vers la gare, sans plus rien dire, balançant gauchement leurs bras en paysans inhabiles à dissimuler leur embarras.
Pierre n’y comprenait rien.
La machine siffla et repartit ; le prêtre était tout songeur… Avant d’atteindre la gare de Nicole, qui est assez éloignée du village, – on passe devant celui-ci, – quelques maisons fuyant le long de la route. Pierre jeta un coup d’œil anxieux à l’auberge. Il redoutait vaguement de voir devant la porte un drap noir et des cierges… Mais non. Rien n’était changé ; la petite maison fila, vision d’un instant, avec sa porte grande ouverte et ses contrevents clos, comme d’habitude.
Pierre respira plus à l’aise. Si la Martine n’était que malade, on la sauverait.
Il descendit en hâte de la gare, et, quelques minutes plus tard, il entrait dans la salle basse de l’auberge. Il était deux heures après midi : la pièce était vide, cela le surprit.
Il appela. Ce fut Estelle qui vint.
— Eh bien, petite, où est ma mère ? s’écria-t-il. Comment va-t-elle ?… Est-elle malade ?…
— Eh, mon Dieu ! moussu Pierre, fit l’enfant, Mme Martine est là-haut, qui vous attend. Elle est au lit.
— Au lit ? mais elle est malade, alors ?
— Eh non, moussu Pierre… Seulement, vous comprenez, il fallait bien qu’elle se mette au lit…
Pierre, impatienté, écarta la petite, et monta dans la chambre de sa mère. Il la trouva couchée dans le grand lit à baldaquin. Sa figure, toute pâlie, avait perdu l’apparence florissante des mois passés… Près d’elle, une cuvette était posée sur la table de nuit, pleine de vomissements.
Le prêtre enlaça de ses bras la tête de sa mère, et la baisant passionnément :
— Mère, qu’as-tu, murmura-t-il. Tu es malade ?…
Elle ne répondait pas, enfonçant sa figure dans la poitrine de son fils, comme si elle eût eu peur de quelque chose d’invisible. Seulement Pierre l’entendait sangloter à présent, – de gros sanglots qui la secouaient toute entière sous les draps.
— Tu es malade, dis, répéta le jeune homme… Pourquoi ne m’avoir pas appelé plus tôt ?… Mais parle-moi, au moins, je ne sais rien !
Il serrait contre lui cette pauvre tête défigurée par les larmes… Il aimait sa mère avec adoration, – lui, dont le cœur était à vingt ans fermé à toutes les tendresses humaines. Parfois, il se reprochait celle-là même, s’accusant de trop chérir une simple créature.
Enfin, Martine dit :
— Mon garçon, je t’en prie, ne te fâche pas trop… Si tu savais !… Ils me laissent tous, maintenant, ils me disent des horreurs… Ne te fâche pas ; reste avec moi.
Le prêtre s’écarta et regarda sa mère, croyant à un accès de délire. La figure de la pauvre femme était bouleversée ; mais les yeux n’avaient pas d’égarement. Pierre, d’un coup, comprit que quelque chose de grave s’était passé dans cette maison, quelque chose de plus terrible encore que ce qu’il avait craint.
Son front se plissa ; son regard reprit l’expression dure qui lui était familière. Et de sa voix blanche de prêtre, il demanda :
— Qu’est-ce que vous dites donc ?… Je ne comprends plus… si vous voulez que je serve à quelque chose ici, il faut me mettre au courant…
Il avait pris, dans les dernières années, cette habitude volontaire de ne plus tutoyer sa mère, pour éviter les épanchements trop tendres, qu’il redoutait. Seulement tout à l’heure, la voyant malade et pleurante, il avait eu un instant d’oubli.
Mais la Martine, toujours en larmes, répétait :
— Pierrou, mon garçon, ne te fâche pas… Sur l’Évangile du bon Dieu, je ne sais pas comment ça s’est fait… Si tu te fâches, je n’oserai jamais te dire…
Elle se tut de nouveau, se couvrant la figure. Pierre maintenant avait peur de deviner… En lui-même, il eut un instant de lutte, tenté de mettre la main sur la bouche de sa mère, d’arrêter l’aveu qui l’épouvantait… Tout d’un coup, une idée étrange lui traversa l’esprit.
Il prit une chaise, d’un geste brusque, vint s’asseoir au chevet de la malade, et, sans qu’un muscle bougeât sur son masque :
— Ma sœur, fit-il, je vous écoute. Confessez-vous.
Un peu de sang revint aux joues de la pauvre femme. Elle aimait mieux cela, elle aussi. À un prêtre, on pouvait tout dire… Elle approcha sa bouche de l’oreille de son fils, qui avait pris sa posture habituelle de confesseur, les genoux croisés soutenant le coude droit, sa main en abat-jour sur les yeux.
— Mon père, murmura-t-elle, bénissez-moi parce que j’ai beaucoup péché… Confiteor.
Le prêtre répondit par une longue bénédiction latine, – récitée à demi-voix – en traînant sur les finales comme il avait coutume ; il coupa l’air d’un signe de croix, et reprit son immobilité.
Alors, la mère commença… Elle hésitait, elle s’embrouillait dans des phrases, elle s’interrompait par à-coups, n’osant continuer, envahie de hontes… Elle murmurait des excuses. Ce jour-là, bien sûr, elle n’avait pas sa tête à elle ; on avait fait du bruit dans l’auberge… L’homme l’avait suivie dans la grange au foin ; elle l’avait senti derrière elle, tout subitement… Si ce n’était pas une horreur, à une femme de son âge !… La petite Estelle, encore, elle l’aurait compris… Enfin elle ne savait pas comment cela s’était fait. – c’était affreux… Et maintenant après deux mois passés, comme elle commençait à oublier, – voilà qu’elle découvrait sa honte. Il n’y avait pas de doute à garder ; des vomissements l’avaient prise, – des faiblesses longtemps à l’avance, – et d’autres signes qui ne trompent point, – tout comme quand elle avait eu son premier enfant…
Elle s’arrêta, épuisée. Pierre ne disait rien. Pas une émotion n’avait paru sur sa figure : il était vraiment prêtre à cette heure.
Pourtant le coup avait été rude, et la nuit s’était abattue un instant sur sa pensée… À présent, une idée nette se faisait jour dans cette ombre, – non pas celle que sa mère eût devinée…
Il dit, très lentement, accentuant les syllabes :
— Ma sœur, vous êtes-vous déjà confessée de cela ?…
— Non, murmura la Martine, prise de peur devant son fils.
— Alors, vous êtes restée deux mois avec ce crime sur la conscience, sans parler à un prêtre ?
— Oui… deux mois… Je n’aurais pas osé… jamais…
— C’est un grand mépris de la clémence de Dieu… S’il vous eût rappelée à lui pendant ces deux mois, où serait votre âme, à présent ?…
La malade ne pleurait plus, épouvantée subitement à cette idée… Pierre l’avait toujours fait un peu trembler. Cette fois, il la terrifiait.
Elle dit, la voix haletante :
— Pierrou, je te jure, je n’osais pas, je n’aurais pas pu… Penses-tu, une femme de mon âge !… Mais tu vois bien que je t’ai tout dit, à toi… Tu peux me donner l’absolution, toi ; tu es prêtre… Pierrou, je t’en prie, fais cela… J’ai peur…
Pierre réfléchit un moment. Puis il reprit :
— Oui, – au lit d’un malade, je peux absoudre… Seulement, ma sœur, la confession n’a pas été complète. Il y a une chose grave que vous ne m’avez pas dite clairement. Le jour où vous avez eu ce malheur, oui ou non, avez-vous consenti ?
La pauvre femme se cacha le front dans ses mains. L’aveu qu’on lui demandait était trop affreux : La pitié du fils disparaissait sous l’âpre curiosité du confesseur.
— Mon Dieu, mon Dieu, fit-elle, je ne peux pas, pourtant… Je ne… je ne sais pas…
— Souvenez-vous, ma sœur, dit encore le prêtre, que je ne puis vous absoudre que si je connais votre faute, et que la faute réside précisément dans le consentement.
Martine hésita encore, baissant les yeux sous le regard fixe du jeune homme. Puis, tout d’un coup, elle prit son parti.
— Eh bien oui, j’ai consenti, comme tu dis… Oui, j’ai eu du plaisir… Crois-tu donc qu’on puisse avoir une femme quand elle ne veut pas ?… C’est inouï, – vous qui confessez, qu’on ne vous dise pas ces choses-là… J’ai consenti… Mais sais-tu combien d’années j’avais résisté, avant ?… C’est terrible, pour les femmes, l’âge que j’ai… Elles y passent toutes, je te dis, – les plus honnêtes… Je ne sais même pas le nom de l’homme… Un voyageur… Un petit brun qui est reparti le soir…
— Assez ! fit sévèrement le prêtre, que cet aveu brutal écœurait… Voyons. Vous repentez-vous de la faute commise, et avez-vous le ferme propos de ne pas retomber ?
La malade, rappelée à elle, joignit les mains, et, la voix étranglée de sanglots :
— Si je me repens ! fit-elle. Ah ! peux-tu le demander… Je voudrais être morte avant, plutôt que d’avoir fait cela.
— Eh bien, reprit Pierre, faites de tout votre cœur votre acte de contrition. Je vais vous absoudre…
Il murmura les paroles de l’absolution. Quelques mots seulement s’entendaient à travers le bredouillement familier des syllabes latines :
— … quidquid mali feceris et boni sustuleris… In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
Alors épuisé à son tour, il tomba à genoux au pied du lit, le front dans ses mains. Toute sa volonté, maintenue par l’effort de son énergie, se détendait dans une crise de déchirement intime… Sa mère !… Sa mère déshonorée comme une fille, avec un passant. Sa mère, publiquement enceinte… La honte de cette grossesse déjà devinée sans doute : il se rappelait les métayers parlant bas devant la gare de Port-Sainte-Marie… Et sa robe de prêtre éclaboussée par cette ordure ; lui, consacré très pur par l’onction pontificale, subir cet opprobre !…
Comme le Christ au jardin des olives, il demanda passionnément, dans sa prière, que l’amertume de ce calice fût éloignée de lui, – que tout cela, d’une façon quelconque, n’arrivât pas, ne fut pas vrai… Puis, comme à son Maître aussi, à force de prier, la résignation lui revint :
— Non pas comme je veux, pourtant, murmura-t-il, Seigneur, mais comme vous voulez !…
Et il se releva, une lueur au front, acceptant la honte. Son regard rencontra celui de sa mère. Il y lut tant d’humiliation et de désespoir qu’il s’émut de pitié. Il attira contre sa poitrine cette tête défigurée par l’angoisse et la baisa avidement.
— Pierrou, murmura la pauvre femme, – Pierrou, mon fils, – tu ne m’as pas dit que tu me pardonnais !
Le jeune homme lui mit la main sur la bouche.
— Chut ! fit-il… Je n’ai rien à vous pardonner, mère… Souvenez-vous que je ne sais rien, que vous ne m’avez rien dit. Vous êtes ma mère bien aimée… Je vous chéris, – je vous respecte, – je vous défendrai !
Il eut bientôt à la défendre.
Dans le voisinage, la nouvelle de cette grossesse laborieuse, qui obligeait la pauvre femme à s’aliter par intervalles, lui donnant à l’avance les affres mille fois répétées de la maternité, se répandit très vite :
— Sabès pas ?… La Martino, Martino de Nicolo !… Es grosso… As bis aquet bente ?…
Et ce petit village pervers où des mères vendaient leurs filles, vers la seizième année, aux messieurs de Bordeaux et de Toulouse, en quête d’aventures, ce petit village s’ameuta contre la malheureuse, envahissant d’abord l’auberge de sa curiosité hostile, puis la laissant déserte, jetant l’injure du dehors, en mots obscènes et en dessins orduriers charbonnés sur les murs de la maison.
Pierre Auradou, en face de ce déchaînement, tint bon contre tout le monde et prêta vaillamment à sa mère l’appui de sa dignité de prêtre et de son caractère irréprochable. Cette figure pâle, ridée à vingt ans, creusée de plis douloureux aux yeux et au nez, avait je ne sais quoi d’inviolable et de saint qui arrêtait l’audace des plus malveillants. Il ne voulut pas céder devant l’iniquité de ses compatriotes et fit rester jusqu’au bout, dans la même maison, sa mère qui le suppliait de l’emmener n’importe où. Seulement, il fit fermer l’auberge et demeura là, près de la Martine épuisée et malade, jusqu’au jour où celle-ci, après un long et douloureux accouchement, mit au monde un fils qui parut bien vivant et robuste, malgré les mortelles épreuves pendant lesquelles il avait été conçu et porté.
On l’appela Jules, et comme sa mère restait depuis qu’il était né percluse dans son lit, subitement envahie de rhumatismes, on le mit en nourrice à Tonneins.
Pierre, ayant réglé toutes ces choses, fit venir un médecin d’Aiguillon et causa longuement avec lui, après lui avoir fait soigneusement examiner sa mère. Quand le docteur repartit, la résolution du prêtre était prise. Il se voyait inutile à Nicole ; peu à peu le calme s’était fait. La haine au village n’osait plus élever la voix près de cette maison close, où l’on devinait qu’il se mourait quelqu’un. Une religieuse, – sœur Fabrice, – remplaça dans la maison la petite Estelle, et Pierre, l’œil sec, embrassa sa mère et repartit pour Agen, où sa place lui avait été gardée.
On le vit reprendre son enseignement, comme d’habitude… À Saint-Caprais, ses confrères l’avaient en haute estime, le raillant un peu, pour la forme, l’appelant le « Janséniste » par allusion à sa morale rigoureuse et désolante, à sa répugnance pour la pratique trop fréquente des sacrements… Personne, heureusement, ne connaissait exactement le motif de l’absence qu’il venait de faire, et il évita d’en parler.
Huit mois se passèrent ainsi, apportant des semaines uniformes et des jours tout pareils. Pierre allait voir l’enfant à Tonneins, le dimanche, et, en revenant, s’arrêtait à Nicole… Maintenant la Martine ne souffrait plus, mais la tête se prenait par moments ; elle délirait un peu… Son fils restait une heure auprès d’elle, et cette courte visite était consacrée aux exhortations, à la patience, aux préparations à l’autre vie.
Un soir de septembre, Pierre Auradou, en sortant de la chapelle du collège, où il avait fait sa méditation quotidienne, reçut un pli télégraphique de la sœur Fabrice.
Le rhumatisme avait gagné le cœur, et la Martine était morte.
III
Pierre, une fois sa mère morte, resta peu de temps à Saint-Caprais. Dès que son petit frère fut retiré de nourrice, il revint à Nicole, habiter l’ancienne auberge avec l’enfant. Une seule personne étrangère vivait avec eux, la vieille Maria, une fille de soixante ans, qui avait passé sa vie à servir des prêtres, et qui, les jours de procession, arborait encore fièrement le voile de tulle sur sa robe blanche de vierge.
Entre ce prêtre et cette vieille, l’enfant poussa vivace comme une plante de hasard. Pourtant la lumière et l’air manquaient dans cet intérieur étrange que l’aîné assombrissait à plaisir, poursuivi de cette idée qu’ils vivaient là, tous tant qu’ils étaient, pour expier le crime de la mère… Le petit Jules était toujours habillé de noir : c’était le deuil de sa naissance qu’il portait. Sa vie se partageait entre les lectures pieuses, les prières en commun, faites dans l’ancienne chambre de la Martine, transformée en chapelle, – et quelques promenades silencieuses en compagnie de son frère dans le merveilleux pays environnant… L’aîné avait commencé pour lui, de bonne heure, les leçons de latin et de sciences… Ce fut une véritable éducation d’enfant de lin, dont Pierre resserrait jalousement le cadre, ayant peur des germes qui pouvaient dormir au fond de cette âme d’enfant, dont il s’était juré de faire un prêtre. Il fallait que le fruit du crime rachetât le crime même… Dès le ventre de sa mère, comme Samuel, ce petit être avait été consacré.
La seule distraction que l’enfant aimât, c’était le service de la messe, le matin, à l’église. Il y courait dès six heures, hiver comme été, heureux de se sentir libre un instant de la tutelle de l’aîné.
L’hiver, la route était déserte, toute durcie ; les arbres tendaient leurs bras nus par-dessus, dans l’obscurité vaguement lumineuse des nuits froides. Pas bien loin, dans l’ombre, une petite lueur brillait, – la chandelle de l’abbé Galup, dans la sacristie où il s’habillait. L’air glacé piquait l’enfant au visage ; parfois, une neige fine tombait sur sa tête rase, et bien qu’il courût, il arrivait tout blanc à l’église… L’été, c’était l’heure de l’animation des campagnes, où les travaux étaient menés vaillamment pendant les courts instants de fraîcheur, où, des rivières voisines, s’évaporait lentement une buée laiteuse, chargée des âcres parfums du rouissage.
Puis, c’étaient l’entrée à la sacristie, le salut bref de la tête au curé qui attendait, la génuflexion devant le tabernacle, les roulements de clochette, les répons latins… Elle se disait pour les murs nus et pour les bancs vides, cette messe hâtive de six heures. Les yeux de l’enfant, dans cette solitude, se reposaient sur le grand tableau du chœur, un martyr de saint Symphorien donné par un peintre des environs… Pendant les moments inoccupés du canon et de la communion, il le contemplait longuement… Le saint, tout en blanc, comme en longue chemise, avec une tête de Christ roux, tenait les bras étendus en arrière, semblant offrir sa poitrine aux coups… Debout, derrière lui, sa mère l’exhortait. Imaginatif comme tous ceux de son pays, Jules se reconnaissait sous les traits du saint, et trouvait dans ceux de la mère la ressemblance de son aîné. Alors, ému devant sa personnalité, il se mettait à prier passionnément des prières d’un mysticisme naïf et débordant, qui lui venaient spontanément, très différentes de celles que Pierre lui avait apprises.