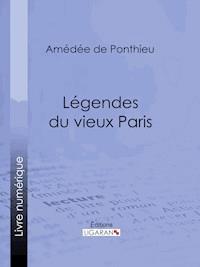
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Encore un livre sur Paris ? Oui, amis lecteurs. Au moment où le Paris de nos pères se métamorphose ou disparaît, il m'a paru utile de recueillir les petites légendes qui peuplaient ses ruelles, carrefours et monuments, épaves curieuses qui, ramassées dans la poussière des siècles passés, sont dignes de respect, et que je me suis empressé d'étiqueter sur les tablettes de ce petit musée au frontispice duquel vous lisez : Légendes du vieux Paris."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
● Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
● Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La vie est une légende qui commence dans le ciel, continue sur la terre dans une vallée de larmes et se termine ?… Dieu le sait…
AM… DE P…
Encore un livre sur Paris. – Quelle ville a plus de légendes ? – Ruines et rêverie. – Le De profundis du souvenir. – Les petites vignettes de la grande histoire. – Ne les dédaignons pas. – La petite étoile des pastoureaux. – Plaidoyer pour mon musée. – La morale dans les légendes. – L’histoire dans la rue.
Encore un livre sur Paris ?
Oui, amis lecteurs.
Au moment où le Paris de nos pères se métamorphose ou disparaît, il m’a paru utile de recueillir les petites légendes qui peuplaient ses ruelles, carrefours et monuments, épaves curieuses qui, ramassées dans la poussière des siècles passés, sont dignes de respect, et que je me suis empressé d’étiqueter sur les tablettes de ce petit musée au frontispice duquel vous lisez : Légendes du vieux Paris.
Dans l’introduction de mon dernier ouvrage : Les Fêtes légendaires, j’ai rapidement crayonné les différentes branches de ce rosier toujours fleuri qui se dresse au seuil du temple de l’Histoire, et se nomme la légende. « Les unes, ai-je dit, se rattachent aux villes », et quelle ville en a plus que Paris ? quelle ville dans le monde, excepté Rome, laisse dans l’âme de celui qui l’a vue plus de souvenirs historiques et artistiques empreints d’une grandeur et d’une majesté qui ne s’oublient jamais, parce qu’ils se rattachent à la vie du peuple qui a le plus fait progresser l’humanité ?
Que de fois, en parcourant les vieux quartiers, je me suis surpris à rêver devant ces antiques demeures féodales silencieuses et recueillies, les unes au portail majestueux flanqué de tourelles élégantes, les autres abritées derrière de hautes murailles couronnées de créneaux, fortes et solides comme des bastions !
Sur leurs façades mélancoliques enveloppées dans le souvenir comme dans un crêpe funèbre, le temps a buriné en lézardes bizarres des caractères hiéroglyphiques qui racontent leur histoire. Sur tous ces débris plane mystérieusement l’âme du passé, et, dans une vision à demi fantastique voilée de brumes, la pensée ressuscite les acteurs du temps jadis.
Derrière ces murailles crénelées, les hommes d’armes poussèrent le cri de guerre dont l’écho sinistre était l’effroi du laboureur et du paisible marchand. Dans cette cour d’honneur entourée d’écussons mutilés se convoquaient le ban et l’arrière-ban des vassaux du vaillant sire chevalier ; au portail flottaient pennons et bannières fleurdelisés. C’est là que fut poussé par des poitrines vaillantes et convaincues le cri enthousiaste des croisades : « Dieu le veut ! » Sous les voûtes massives de cette large galerie lambrissée de panoplies d’armes conquises, enguirlandées de devises orgueilleuses, les ménestrels ont chanté la ballade du preux chevalier sans peur. Cachées derrière l’ogive fleurie de cette mignonnette tourelle, de nobles dames au corps gent, au clair visage, et de fières damoiselles au regard azurin, au cœur, tendrelet, qui servirent de modèles aux enlumineurs du temps, ont soupiré en entendant le lait d’amour que chantait la lyre du troubadour au gai savoir, etc…
Preux, vassaux, bannières, soudards bardés de fer, troubadours, pages et châtelaines, où tout cela est-il allé ?
Où vont les neiges d’autan.
Poète, artiste, philosophe, légendiste, tout homme enfin qui comprend la poésie et l’enseignement de toute chose que le temps a frappée de son aile meurtrière, s’arrête malgré soi devant ces antiques demeures où la noblesse menait une existence fière et opulente, aujourd’hui froides, mornes et lugubres comme une tombe vide ; et l’on devient tout pensif. On s’agenouillerait même, comme au milieu d’un cimetière, prêt à murmurer le De profundis du souvenir sur ces grandes races disparues. Des fantômes voltigent autour de vous, votre extase sympathique vous laisse toujours, avec le désir de soulever le voile, une respectueuse mélancolie. Ces murs abandonnés sont des nids de légendes.
Mainte et mainte fois j’ai remarqué que l’on négligeait trop les petits faits, menue monnaie de l’histoire. Les grands auteurs les dédaignent et ne s’arrêtent que sur les sommités. Ainsi les vieux échevins de Paris tenaient registre des faits et gestes de leurs édiles « pour transmettre à la cognoissance de leurs enfants, vrais et légitimes héritiers, leurs dons, droits, privilèges et immunités, à eux faits par la munificence de leurs princes naturels et légitimes. »
Un clerc du Parloir-aux-Bourgeois compilait chaque année les faits de cet inventaire qui composait « un ample et très beau patrimoine », et il terminait par un anathème contre « le sacrilège qui causerait confusion et désordre à ce qui a coûté si cher, et fait veiller maintes nuits, et les mains légères et larronnesses qui voudraient y faire larcin. »
Ces documents habilement fouillés fournissent les matériaux des histoires de Paris qui paraissent successivement : mine féconde, inépuisable, champ banal où tous les auteurs vont glaner avec plus ou moins d’intelligence et de goût ; car les uns s’embourbent dans les ornières déjà tracées, et d’autres s’égarent dans des routes nouvelles. – Et les légendes, vignettes charmantes des grandes chroniques parisiennes, tantôt gracieuses, tantôt terribles, sont abandonnées dans les orties. Je viens après eux ramasser pieusement ces bleuets oubliés dans le chaume, fleurettes précieuses que le vent emporte une à une comme les feuilles de rose tombées de la tige.
Il n’y a pas de petits faits pour l’histoire ; et ces menus récits, ces grains de poussière, sont d’un grand prix. Ce sont les faits divers d’un temps qui n’est plus, et, parmi ces faits divers que chaque siècle enregistrait au jour le jour dans sa chronique, il y en a qui sont remplis d’un grand enseignement. Ces modestes traditions servent à caractériser d’une manière pittoresque, naïve, et surtout plus intime, la situation morale d’une époque. Je les préfère aux faits racontés par le grand chroniqueur ; car il sait qu’il parle pour l’avenir et écrit presque toujours sous l’influence de son impression personnelle souvent peu réfléchie, et à laquelle il lui est très difficile de se soustraire, tandis que la légende est le récit de tout le populaire, moins facile à tromper que le moine, qui, du fond de sa cellule, subit la pression de son ordre, ou le clerc scribe, dévoué au prince qui garnit son escarcelle.
Ne rejetons donc pas nos légendes. Si, selon le vieux proverbe : – « Petit vent allume grand feu, » – petite légendette éclaire grand siècle.
Nos savants zoologistes recomposent les races perdues avec un fragment d’os retrouvé sous un bloc calcaire antédiluvien : avec une légende nous pouvons recomposer toute une époque ; elle se reflète vivante et pittoresque avec sa grâce comme avec sa laideur, dans ce petit miroir au cadre gothique oublié dans un coin, aux parois disloquées de la hutte la plus humble du vieux paysan de France, ou dans la ruine orgueilleuse de quelque antique castel dont la silhouette robuste se dresse encore sur la crête de la lande déserte.
Une simple médaille trouvée au fond d’une fouille renverse souvent l’échafaudage savamment chevillé d’hypothèses, – laborieuses puérilités, – de nos plus grands historiens.
Je le redis encore : ne dédaignons pas les petites choses.
L’étoile qui vint briller au-dessus de la chaumine des pastoureaux était bien petite ; cependant c’est cette petite étoile qui les conduisit à la crèche où vagissait le divin poupon apportant la parole de vie qui régénéra le monde entier. S’ils eussent dédaigné cette petite médaille lumineuse que leur œil inquiet, en fouillant dans le ciel, vit marcher vers l’Orient, tandis que d’un autre côté les rois Mages, inspirés comme eux, suivaient la même route que leur traçait aussi cette petite messagère céleste, ils n’auraient pas découvert le fils d’un Dieu dans l’humble étable d’un petit hameau de Judée.
Pardon, chers lecteurs, de ce plaidoyer pour mon reliquaire. Mais, quoique les légendes, dans notre siècle fureteur où l’on vit si vite, où l’on est si curieux, semblent être revenues en faveur, il est encore un grand nombre d’esprits prosaïques complètement gâtés par l’anarchie morale de nos jours, qui les dénigrent parce qu’ils ne peuvent en comprendre la poésie, le charme et l’utilité. Ces fleurs qui ne se fanent jamais sont choses trop délicates pour leur esprit blasé ; ils les regardent comme des puérilités bonnes tout au plus pour les faibles d’esprit et les enfants.
Les légendes, ainsi que l’a dit un grand poète, sont filles de la religion et mères de la poésie. On y trouve toujours une leçon contrôlée par l’expérience populaire, elles instruisent, intéressent et moralisent, trio sacré qui inspire les bons écrits. De plus, un grand nombre nous donnent la clef d’une foule de proverbes, dictons et coutumes qui vivent encore.
Les vieilles traditions, comme les vieux monuments, qui ne sont pour moi que des légendes pétrifiées sur lesquelles le temps a jeté son manteau de lierre et de mousse, sont plus faciles à déchiffrer et nous racontent comme eux l’histoire des générations disparues. Elles servent à élargir le cercle de nos connaissances modernes, en ajoutant aux lumières du présent celles du passé. Ce sont nos guides pour l’avenir. Soldat de mon opinion, je jette le blâme à la face de cette petite coterie moderne qui, parce qu’elle a gravé sur son drapeau le mot : Avenir, se croit le droit de briser la chaîne de fer et de sang qui nous lie au passé, et de repousser dédaigneusement du pied dans l’abîme les vieilles croyances, légendes, traditions et chroniques qui s’y rattachent.
On retrouve encore dans les légendes du vieux Paris, si curieuses au point de vue historique, les changements successifs intervenus dans la physionomie des rues, dans les idées et les mœurs. On suit pas à pas la marche pénible du progrès dans les tableaux changeants de notre grande cité qui deviendra la ville éternelle, titre que l’orgueil romain décerna jadis à la Rome païenne, et, au milieu de cette galerie de tableaux, on voit passer, drapée dans la majestueuse simplicité de son manteau fleurdelisé, l’histoire de notre vieille capitale.
J’ai donc l’espoir, en la faisant connaître davantage dans son passé, de la faire admirer encore plus dans son avenir.
Paris, 1er janvier 1867.
AMÉDÉE DE PONTHIEU.
La chasse aux légendes. – La formation d’une ville. – Le baptême historique et légendaire de ses rues. – La malice de nos aïeux. – Un vieux rébus municipal. – Les vieilles rues de la Cité. – Ce qu’on voit par la fenêtre gothique de la tourelle du coin. – C’est l’histoire de France qui passe. – La rue de la Licorne. – Son ancien nom. – La demeure de Jean Pitard. – La confrérie des chirurgiens. – Le puits de sa maison. – Les oubliers et leurs statuts. – Origine du jeu de macarons. – Origine du pain bénit. – La Licorne et sa légende. – La rue Saint-Landry. – L’échelle patibulaire des évêques de Paris. – La chapelle de Saint-Landry. – Le premier asile des enfants trouvés. – Grandeur et décadence d’Isabeau de Bavière.
Quelle joie pour l’antiquaire lorsque, l’œil fixé sur les horizons lointains de notre histoire, il découvre l’empreinte d’une tradition primitive ! Avec quelle ardeur il suit le fil qui le conduit dans ce labyrinthe de débris glorieux, ramassant çà et là, miette à miette, les épaves des siècles passés, dispersées par la main du temps et des révolutions ! Qu’il est heureux quand, sortant de nos catacombes historiques, où il a fait la chasse aux légendes, il peut s’écrier, comme Archimède ; J’ai trouvé !
Dans ce corset de pierre qui formait jadis la limite d’une ville, des générations successives se sont posées l’une sur l’autre, en laissant chacune quelques traces gravées par leur génie et souvent cimentées avec leur sang. Chacune a eu ses grands évènements, ses jours de joie et de deuil racontés par les monuments, les églises, les places publiques, les palais, les rues, les ponts, les statues, les fontaines, etc. Ici, un guerrier fameux a repoussé l’ennemi et sauvé la ville du pillage ; la reconnaissance publique donne son nom au quartier illustré par son héroïsme. Là, un traître a vendu ses frères ; l’indignation de la cité se venge en appliquant son nom ridiculisé à un quartier qui sert de dépôt aux immondices, afin d’exprimer son mépris. Ailleurs, c’est un miracle, un crime ou un acte de dévouement, dont la mémoire se transmet par une inscription ou le simple nom de son auteur. C’est ainsi que se fait le baptême historique ou légendaire d’une ville ; chaque génération y laisse sa marque avant de descendre dans la tombe.
Toutes les villes ont donc leur bagage de chroniques, Paris, la grande ville, l’antique capitale du royaume de Clovis, est, plus que les autres, riche en souvenirs.
Longtemps pauvre et chétive, tenant pour ainsi dire dans la barque d’un nautonier, elle s’est souvenue, lorsque brilla pour elle son jour de splendeur, de son humble origine, et prit pour écusson la nacelle primitive qui, voguant sur la rivière de Seine, portait Lutèce et sa fortune.
Peu à peu, elle s’agrandit ; elle est chez elle ; comme une bonne ménagère, elle organise sa maison. Il lui faut des moulins pour moudre son blé : elle crée la rue des Moulins ; un four pour cuire son pain, elle a la rue du Four ; la rue des Poules et du Vieux-Colombier pour sa basse-cour ; la rue des Noyers pour faire de l’huile ; la rue du Bon-Puits pour l’eau de sa table ; la rue des Vignes conduisant au clos qui remplit ses celliers ; la rue des Rosiers et du Jardinet pour sa promenade. Viennent ensuite les denrées et les industries nécessaires à sa vie matérielle : de là les quartiers de la Boucherie, de la Poissonnerie, de la Panneterie, de la Tannerie, Saulnerie, Mercerie, Coutellerie, Mégisserie, Ferronnerie, etc.
Les hommes célèbres s’y succèdent. Alors le baptême légendaire continue : rue de Clovis, de Childebert, Clotaire, Dagobert, Saint-Eloi, Saint-Landry, etc. Les couvents se forment et enfantent de nouveaux noms : Saint-Denis, Saint-Martin, Saint-Benoit, Saint-Germain, Saint-Magloire, Saint-Marcel, Saint-Christophe, Sainte-Geneviève, etc.
Le vieil esprit gaulois s’en mêle, et alors nous voyons grimacer, au milieu de toutes ces dénominations, une foule de noms singuliers et d’inscriptions joviales ; la liste en serait trop longue, en voici seulement quelques exemples : rues Vide-Gousset et Maudétour, ainsi nommées à cause de nombreux larcins qui s’y commettaient ; rue des Orties et rue des Chiens, parce qu’elles étaient solitaires et malpropres ; rue de la Muette, parce qu’elle conduisait à un cimetière, et que les personnes mortes ne parlent plus ; rue du Demi-Saint, parce qu’à son entrée il y avait une grande statue de saint à moitié brisée, placée de manière à interdire le passage aux chevaux ; la célèbre cour des Miracles, si bien exploitée par nos romanciers modernes depuis le réveil du romantisme ; la vallée de Misère ; la rue Tirechappe, ainsi nommée des nombreux fripiers qui y tenaient boutique et harcelaient les passants à droite et à gauche, en les tirant par leur chappe afin de les engager à entrer pour vendre ou pour acheter ; ils criaient quand les clercs passaient : cote et surcot raféteroi (je raccommode), et comme les écoliers avaient plus de trous aux genoux et aux coudes que de blancs d’angelots ou de sols parisis dans leurs surcots, ils s’esquivaient au plus vite.
D’autres fois, ce sont des enseignes célèbres qui donnent leurs noms aux rues ; telles les rues du Croissant, de la Licorne, du Pélican, des Trois-Canettes, de la Femme-sans-tête. La rue du Bout-du-Monde tire son nom d’une enseigne qui pendait à la cinquième maison à droite, entrant par la rue Montmartre ; elle portait le rébus suivant : un os, un bouc, un duc (oiseau) et un globe, figure du monde, avec l’inscription : Os, Bouc, Duc, Monde (au bout du monde). Il y en avait bien d’autres rédigées dans le même esprit que nous retrouverons plus loin.
Beaucoup de noms nous sont parvenus tronqués ou défigurés ; ainsi qui reconnaîtrait la rue Jeux-Neufs, dans la rue des Jeûneurs, et la rue Sainte-Marie l’Égyptienne, dans le mot de la Jussienne ?
Enfin un grand nombre tirent leurs noms d’une tradition populaire, ce sont celles-là qui nous occuperont tout particulièrement.
L’Hôtel-Dieu doit prendre dans notre vieille Cité la place de rues anciennes qui, en disparaissant, vont entraîner avec elles dans l’oubli les souvenirs, les légendes et les traditions qu’elles rappellent. C’est donc un pieux devoir de remonter à leur origine et, avant de leur dire un dernier adieu, de raconter leur chronique.
Dans toutes les villes, chaque nom de rue a sa signification, sa chronique locale et légendaire ; mais pour Paris, la glorieuse capitale, ces souvenirs se rattachent souvent à l’histoire nationale ; dans la Cité surtout, berceau de la monarchie, qui renferme à ses deux extrémités les deux grandes colonnes de la civilisation, la religion et la justice, autour desquelles s’agitèrent d’abord, petits et faibles, les ancêtres de ceux qui plus tard parcoururent l’Europe en vainqueurs.
Si, montant par l’escalier à vis tout vermoulu de la tourelle du coin, nous mettons la tête à la fenêtre gothique, et que, accoudé au balcon branlant, nous prêtions l’oreille aux chuchotements des bons bourgeois qui vont besogner, nous connaîtrons leurs mœurs et leurs usages ; nous saisirons au passage les croyances, les joies et les douleurs qui les animaient. Écoutons bien, car c’est dans la Cité que s’agitèrent, pendant huit siècles, les destinées de la vieille France.
Notre histoire nationale a commencé dans ces rues étroites et sombres. Là, un roi a passé, suivi de son brillant cortège, et le bon peuple a crié : Noël ! Une reine a fait largesse ; dans une grande famine, un évêque a vendu les vases sacrés pour secourir les malheureux décimés par le fléau ; un martyr a été torturé ; un saint a fait un miracle. Ailleurs, c’est le logis d’un guerrier fameux ; on pouvait jadis pénétrer dans sa vie intime, toucher les armes et les meubles qui lui avaient servi ; ces reliques historiques ont été dispersées par les révolutions : on n’en trouve plus que des débris pieusement recueillis dans nos musées.
On entend encore, en passant, comme un écho lointain répétant les grandes querelles des vieilles factions civiles qui se disputaient, aux époques malheureuses, les morceaux d’un trône mal gardé.
Voyez-vous ce porche sombre, cette encoignure d’un aspect sinistre : c’est là que catholiques et huguenots s’égorgèrent. Regardez bien, vous verrez encore, sur le bord du ruisseau, des taches de sang… Sur cette borne usée, un moine a monté pour appeler la colère de Dieu sur la tête de celui qu’il nommait l’Hérode de France, et prêcher l’assassinat politique. Voyez-vous, le long des contreforts de ce couvent, cette longue procession d’ombres brunes et noires, les têtes cachées sous des cagoules, des cierges en mains, chantant les gloires de Dieu ? Ce sont les moines de Sainte-Geneviève qui se rendent au parvis de Notre-Dame ; une châsse rayonne au milieu d’eux, c’est celle de la sainte pastoure de Nanterre.
Mais quels sont ces cris ? où court cette foule bigarrée, moutonnière et hurlante ? Elle pousse des cris de mort. Où va-t-elle ? Au parvis Notre-Dame. Qu’y a-t-il ? Là, se dresse, sombre et terrible, un immense bûcher. Ce sont les Templiers qu’on mène à la mort, héroïques victimes du fanatisme et de la cupidité. Frémissez d’horreur et levez les yeux, vous verrez, sur un ciel noir comme un immense drap mortuaire, une grande croix rouge semblable à celle que portaient ces héroïques chevaliers empreinte sur le disque argenté de la lune entourée de trois cercles, le plus grand, de couleur blanche ; le second, de couleur rouge ; le plus petit de couleur noire, pronostics sinistres, mystérieux et lamentables de la colère divine qui pour venger les victimes va bientôt frapper les bourreaux, Philippe-le-Bel et Clément V.
Chut ! une ombre silencieuse glisse sous les auvents de cette ruelle déserte : c’est Abailard qui va rue des Chantres, chez le chanoine Fulbert, et, si nous prêtons l’oreille, nous entendrons craquer sous les pas furtifs de cet illustre amoureux les marches de l’escalier en spirale qui conduit à la chambrette de la gente Héloïse.
Dans un autre coin, c’est la peste qui ravage le quartier : on jette les morts sur des tas d’ordures, au pied d’une Notre-Dame de Pitié, et les pourceaux de l’abbaye voisine viennent les flairer librement, la sonnette au cou, au milieu des rues désolées. Ailleurs, entendez-vous ces cris de joie, ces jurons avinés de soudards en goguette ? C’est la taverne de la Licorne, et au travers des vitraux crasseux losangés de plomb, vous voyez la silhouette des lansquenets lutinant des ribaudes.
C’est ainsi que l’imagination, aidée des vieux récits, peut reconstruire le Paris pittoresque de nos pères, photographier sa physionomie à chaque époque, dans la longue et douloureuse série des métamorphoses qui le conduisent aux splendeurs de nos jours.
Repassons donc dans ces rues anciennes. Le couvre-feu est sonné, les bons bourgeois dorment ; profitons-en pour examiner ce qui se passe dans les plus curieuses :
LA RUE DE LA LICORNE, en 1269, était connue sous le nom de la rue près le chevet de la Madeleine, parce qu’elle longeait le chevet de la chapelle dédiée à sainte Madeleine.
C’est dans cette rue que demeurait, en 1278, Jean Pitard, le chirurgien de saint Louis qu’il suivit en terre sainte. Son buste décore le grand amphithéâtre de l’École de Médecine. C’est lui qui obtint du roi l’acte de fondation de la célèbre confrérie des chirurgiens. Comme c’était l’usage alors de mettre toute corporation, confrérie ou corps de métiers, sous le patronage d’un saint qui devait veiller tout spécialement sur l’association et figurer sur sa bannière, la confrérie des chirurgiens fut placée sous l’invocation de Saint-Côme et Saint-Damien, dont l’église était située au coin de la rue de la Harpe et de celle des Cordeliers, aujourd’hui de l’École de Médecine. Cette église avait un cimetière et un charnier. Tous les premiers lundis de chaque mois, les confrères devaient visiter les pauvres malades qui se présentaient à cette église. C’est là qu’ils se réunissaient et s’engageaient, sous la foi du serment, à observer les règles de leurs statuts.
Ceux qui ne voulaient pas s’y soumettre quittaient Paris pour aller exercer leurs talents dans d’autres villes ; et Dieu sait si la besogne manquait, dans ces siècles de fer où tout le monde devait être soldat, sous peine de devenir serf ou mendiant.
Jean Pitard, malgré sa fondation, fut presque oublié par l’histoire, qui ne raconte que peu de choses sur ce bienfaiteur de l’humanité.
Dans sa maison de la Licorne, il avait fait creuser à ses frais un puits qu’il livra au public, pour prévenir les maladies engendrées par l’eau de la Seine qui, dans certaines saisons de l’année, était boueuse et fort malsaine. Cette maison, rebâtie en 1611, portait encore à cette époque une vieille inscription, gravée par la reconnaissance des Parisiens, et qui était ainsi conçue :
La confrérie des chirurgiens est à peu près la seule fondation utile qui date du règne de Philippe III.
Vers 1300, la rue de la Licorne prit le nom de Rue a Oublayers, c’est-à-dire des pâtissiers faiseurs d’oubliés. On a écrit ce nom de diverses manières : Oublayers, Oblayers, Oublieurs. Ce nom vient du latin obelia, parce que ces sortes de gâteaux secs et très minces n’étaient vendus qu’une obole. Il y avait plusieurs sortes d’oubliés. On nommait nieules et supplications celles qui étaient d’une dimension plus petite.
Le nom de nieules, nebulœ, vient probablement de ce que la pâte en était transparente comme un brouillard.
C’était surtout les jours de pardons, indulgences ou pèlerinages de saints et processions de jubilé que ces oublayers débitaient une prodigieuse quantité de pâtisseries au sucre et aux épices, enjolivées d’images et sentences pieuses appelées gauffres à pardon ; ils établissaient leurs petits fourneaux autour du portail des églises.
La corporation des oublieurs, dont les chefs demeuraient dans cette rue, avaient des statuts qui dataient de l’an 1406. Ils portaient que « personne ne pourra exercer ce mestier à Paris, s’il ne sait faire par chascun jour, cinq cents de grandes oblies, trois cents de supplications et deux cents de nieules ou estérets. »
À cause des hosties qu’ils fabriquaient sous la surveillance des sociétaires, ils devaient être de bonnes mœurs, ne jamais jouer aux dez à argent ; de bonne vie et renommée, sans avoir été repris de vilains blâmes ni jamais employer aucune femme pour faire pain à célébrer en église, se servir de bons et loyaux œufs, ne devant jamais aller en hôtel de juif ou juive pour mestier vendre. Ils avaient le privilège de travailler le dimanche, excepté les quatre grandes fêtes.
L’ordonnance de 1400 permet aux oublayers de jouer seulement aux oublies en portant leur métier.
Tel est l’origine des loteries de macarons.
C’est de cette rue que partaient, dès le matin, de grosses et joyeuses commères, portant devant elles tout l’attirail de leur métier ; elles parcouraient les carrefours et accostaient les passants en débitant cette petite chanson :
Ou bien les suivants annonçant deux gaufres pour un denier.
Elles se croisaient dans les rues avec d’autres commères du Marché-Palu, qui allaient par la ville criant de leur côté, à pleins poumons :
Comme les bourgeois soupaient de bonne heure, les oublieurs se répandaient également le soir dans les rues et entraient dans les maisons offrir leurs oublies pour dessert. Les familles se réunissaient, et l’on tirait au sort les oublies, ce qui ouvrit la porte à de grands abus, car, dans quelques-unes, on se livrait aux jeux de hasard, où les filous trouvaient une mine féconde. Cela donna l’éveil au lieutenant criminel. Plusieurs fois, il fut obligé de sévir ; mais il ne voyait pas tout, et certaines maisons devinrent le repaire de débauchés qui s’y rencontraient la nuit.
Les voleurs, également, profitaient de cette coutume : déguisés en marchands d’oublies, ils pénétraient dans les maisons pour les dévaliser ou enlever quelque jolie fille qu’attendait, au détour d’une rue, la litière d’un riche ravisseur.
Les crustules miellées étaient faites avec de la farine de froment, du miel de Languedoc, du safran et des épices fines, le tout bénit d’avance par la main de monseigneur l’évêque. C’étaient ces sortes d’oublies qu’on jetait en largesse au populaire dans les églises, à certaines grandes fêtes de l’année. Comme la manne du ciel, elles tombaient des voûtes, et la foule se jetait dessus en se bousculant et poussant des cris de joie.
C’est pendant que ces gâteaux miellés tombaient que quatre sacristains, tenant chacun un grand corbillon garni de blanches toiles, présentaient des oublies et des gâteaux aux principaux assistants placés dans le chœur, prêtres, moines, marguilliers, chantres, nobles, etc. C’est de cette coutume charmante que vient l’origine du pain bénit que l’on distribue encore le dimanche dans toutes les paroisses de France, et ce petit fragment de pain avec lequel on fait pieusement le signe de la croix avant de le porter à sa bouche, remplace l’oublie du Moyen Âge.
Il y avait aussi autrefois une redevance de fiefs connue sous le nom de droit d’oubliage ; elle se transforma en gâteaux nommés oubliaux, puis en argent monnayé.
Les marchandes de plaisirs qui parcourent les rues et les jardins publics avec leur contrefaçon de crécelle et leur cri de soprano sont les derniers représentants de la confrérie sucrée des marchands d’oublies de la rue de la Licorne, et la grande fabrique de la rue de Ponthieu remplace à elle seule toute la rue de la Licorne des quatorzième et quinzième siècles.
Vers la fin du quinzième siècle, on montra dans cette rue une licorne ou unicorne venue d’Afrique. Bourgeois et manants de Paris la regardaient comme un animal fabuleux. Toute la cité fut en émoi.
À l’une des extrémités de la rue, une taverne fameuse profitant de la vogue arbora pour enseigne une licorne, dont la corne unique était dorée. Elle était fréquentée par les filles de joie de la rue du Val d’Amour et les soudards ; elle donna le nom de son enseigne à la rue.
La licorne est un animal que le Moyen Âge a orné d’une foule de curieuses légendes. La licorne aime la chasteté à un tel point, qu’on ne peut s’en emparer qu’en l’attirant par une jeune vierge. Dès qu’elle en aperçoit une, elle penche sa tête sur ses genoux et s’endort d’un sommeil si calme, qu’il est facile aux chasseurs de s’en rendre maîtres. Quelques-uns prétendent que sa corne, quand elle est jeune, est faite en forme de croix, mais qu’en grandissant et en changeant de forme, elle ne perd rien de sa merveilleuse vertu ; car, pour transformer en antidote toutes les eaux d’une source, il suffit que cet animal, en se désaltérant, y ait trempé la pointe de cet appendice enchanteur.
Dans l’art héraldique, elle est le symbole de la force et de la chasteté. Le pape Clément VII et Paul III l’avaient adoptée comme emblème ; nous la retrouvons encore dans les armes d’Angleterre.
LA RUE SAINT-LANDRY. Cette rue était anciennement nommée rue du Port-Notre-Dame ou Port-Saint-Landry. À son extrémité qui donnait sur la berge, les bateliers et poissonniers parisiens débarquaient les vivres et marchandises, qui étaient ensuite vendue au Marché-Palu (ainsi nommé à cause de son emplacement marécageux). Ce marché fut la première halle parisienne.
Il y avait jadis à Paris plusieurs endroits de sinistre réputation, où s’élevaient les échelles patibulaires. Ainsi, la rue des Vieilles-Haudriettes se nomma aussi la rue de l’Échelle du Temple, à cause de l’échelle patibulaire que le grand prieur de France y avait fait élever. Ces constructions étaient une espèce de pilori qui servait de marque de haute justice. L’évêque de Paris en avait plusieurs au parvis Notre-Dame, au port Saint-Landry, rue de l’Échelle, etc.
L’abbé de Saint-Germain avait un pilori. Aux Halles était celui du Roi. Les corps des suppliciés étaient ensuite transportés aux fourches de Montfaucon.
Saint-Landry, qui vivait au septième siècle sous Clovis II, fut un des évêques de Paris les plus populaires par son renom de piété et de charité. C’est le fondateur de l’hôpital Saint-Christophe devenu l’Hôtel-Dieu. Plein de zèle et d’humanité, dans une grande famine, il vendit aux juifs sa vaisselle, ses meubles, même les vases sacrés et les ornements de son église pour sauver la vie à une foule de malheureux qui, sans lui, seraient morts de faim.
Il y avait dans cette rue une chapelle où l’on prétend que ce saint évêque allait souvent faire ses prières. Il a même demeuré dans la maison qui s’élevait à l’endroit où, plus tard, les poissonniers et bateliers parisiens érigèrent cette chapelle en son nom.
Les évêques de Paris y possédaient, en 1265, une maison appelée la Lavanderie, parce qu’on y lavait le linge du chapitre et des autels de Notre-Dame. C’est dans cette maison que plus tard ils firent soigner, à la charge des seigneurs hauts justiciers, les enfants exposés dans une crèche, placée dans une des chapelles de Notre-Dame. Au dix-septième siècle, une dame charitable ouvrait dans la même rue un asile pour ces pauvres orphelins, sous le nom de Maison de Couche. Saint Vincent de Paul l’ayant visitée fut touché du dénuement de ces pauvres enfants, et, à l’aide d’aumônes, fonda à la porte Saint-Victor un refuge qu’il nomma l’Asile des enfants trouvés.
Le pieux évêque fut enterré à Saint-Germain-l’Auxerrois. Son tombeau fit des miracles. On mit ses reliques dans une belle châsse dorée qui fut placée sur une colonne dressée derrière le maître-autel. Un grand nombre de peintures murales, tracées par la main de nos artistes dans les églises parisiennes, reproduisent les principaux traits de la vie de ce grand prélat qui fut la gloire de son temps, et dont la mémoire est encore entourée de bénédictions.
Vers le neuvième siècle, lorsque les Normands vinrent mettre le siège devant Paris, les abbés de Saint-Germain-le-Rond, pour préserver les reliques de Saint-Landry des insultes de ces fiers pirates qui chantaient la messe des lances sur toutes les abbayes détruites, les cachèrent en la Cité dans la chapelle de Saint-Nicolas, dont la gloire s’effaça devant ce grand saint parisien, qui donna son nom à la modeste chapelle ; on l’érigea en paroisse en son honneur. Elle fut reconstruite au quinzième siècle et démolie en 1826.
Dans une chambre de l’Hôtel de Saint-Paul, mourait en grande indigence et pauvreté, dans la nuit du dernier septembre 1435, assistée d’une seule suivante, une reine maudite, dont le corps fut déposé clandestinement dans la chapelle de Saint Landry. Cette reine, détestée de tous les Français et méprisée des Anglais, était la femme de Charles VI, Isabeau de Bavière ; et la nuit suivante, pour épargner les frais de ses funérailles, le duc d’York, régent de France pour le jeune Henri de Lancastre, roi de France et d’Angleterre, fit porter son corps dans un petit bateau, accompagné de quatre moines portant chacun un cierge allumé.
À peine avaient-ils psalmodié le dernier verset des prières des trépassés, que le batelier s’arrêta. On était en face de Saint-Denis. Deux autres moines embusqués sur la rive portèrent modestement sur leurs robustes épaules le cercueil de la mégère royale, et le déposèrent sans cérémonie dans les caveaux de leur abbaye.
Quel contraste avec les fêtes populaires si joyeuses et si splendides qui célébrèrent son entrée solennelle dans Paris ! Et quel dénouement lugubre aux prédictions de ces anges descendus du ciel, qui lui posèrent moult doucettement sur la tête une couronne d’or fin enrichie de pierres précieuses, et lui souhaitèrent la bienvenue en chantant ces vers :
Isabeau fut inhumée piteusement dans le tombeau de Charles VI, et, fait bien remarquable, comme si la fatalité se fût acharnée après sa dépouille mortelle, son mausolée fut payé avec le prix de la bibliothèque recueillie par Charles V, et vendue 1 200 livres au duc de Bedfort.
La rue Glatigny. – Le Val d’Amour. – Les rendez-vous galants sur le pont aux Meuniers. – Pourquoi il était choisi. – Origine du dicton : Jeter son bonnet par-dessus les moulins. – Les ribaudes. – Les maisons de refuge. – Rue Cocatrix. – L’échanson de Phlippe-le-Bel. – La légende de Saint-Pierre aux Bœufs. – La rue Saint-Christophe. – La légende de sainte Marine. – L’anneau de paille. – Le tombeau de François Myron. – Souvenirs historiques sur le grand édile et son neveu Robert Myron. – Le premier pavé de Paris. – La rue des Marmousets. – Sa légende sinistre. – La rue du Haut-Moulin. – Saint-Denis la Châtre. – La rue Perpignan et son jeu de paume. – Une légende lugubre. – Les rues Haute, Basse et du Milieu des Ursins. – Une page d’histoire.
LA RUE GLATIGNY. La famille puissante des Robert et Guillaume de Glatigny possédait, dans cette rue, en 1241, un hôtel qui lui donna son nom.
Le populaire la nomma aussi du sobriquet pittoresque de Val d’Amour, parce qu’elle était habitée par des filles de joie.
C’est dans les tavernes fumeuses de cette rue que les ribaudes donnaient leurs rendez-vous et que la prostitution s’étalait dans toute sa hideuse effronterie.
Il y avait ainsi, dans la Cité, plusieurs endroits de mauvais renom. Non loin de là, le pont aux Meuniers, qui va de la Vallée de Misère au quai des Morfondus, avait aussi le privilège des rendez-vous des amants. Ce pont, construit en planches, était bordé par les dix moulins du chapitre, formant deux rangées de pignons qui surplombaient au-dessus de l’eau.
Les jours de fêtes carillonnées et les dimanches, c’était l’endroit le plus silencieux de Paris, car les dix moulins du chapitre se trouvaient, durant ces saintes journées, dans l’obligation de chômer, ainsi que le portait textuellement le contrat de louage. D’un autre côté, dans les jours de la semaine, le bruit des moulins forçait les passants à se parler très fort, et il était difficile de distinguer, au milieu du tic-tac, le baiser donné ou rendu, les mots d’amour et les rendez-vous soufflés à l’oreille. Aussi ce lieu était-il fort recherché des galants.
Son malencontreux renom était tellement notoire, que, pour donner à entendre qu’une jeune fille avait perdu le droit de coiffer le symbolique « chapel de fleurs d’oranger, » il suffisait de dire qu’elle avait passé par le pont aux Meuniers. C’est sur ce pont que naquit le vieux dicton populaire qui, pour indiquer qu’une fille ou une femme a perdu toute pudeur, dit qu’elle a jeté sa cornette par-dessus les moulins.
Voici la scandaleuse aventure qui avait donné naissance à ce mot narquois :
Un jour, une gente bourgeoise aux coquets atours, en batifolant avec un écolier qui fréquentait plus souvent le Préaux Clercs que les cours de l’Université, s’était approchée trop près d’un moulin ; la roue, dans sa course rapide, avait accroché un ruban de sa cornette qui, violemment arrachée de la tête de la volage, avait été lancée par-dessus les moulins et emportée par le vent au milieu de la Seine, à la grande hilarité des badauds.
La rue Glatigny était tortueuse et aventureuse ; les soudards seuls et les gens de sac et de corde y allaient chercher des ribaudes, avec lesquelles ils s’enivraient dans des tavernes sombres qui ne justifiaient guère le nom poétique de Val d’Amour.
Charlemagne avait essayé de bannir tout à fait de Paris les ribaudes ; il avait ordonné qu’elles seraient condamnées au fouet en place publique, et que ceux qui les auraient logées ou chez qui on les aurait trouvées les porteraient sur leur dos jusqu’au lieu de l’exécution ; mais, reconnaissant ce mal nécessaire, il fut obligé de le tolérer.
Ces femmes formèrent sous le titre bizarre de femmes amoureuses, une corporation, ayant des statuts. Tous les ans elles faisaient une procession solennelle le jour de Sainte-Madeleine. On leur désigna quelques rues, dont l’une des principales fut la rue Glatigny. Celles qui suivaient la cour devaient, pendant tout le mois de mai, faire le lit du roi des Ribauds, seigneur suzerain de six mille belles filles, dont la charge était d’un grand revenu.
Cette curieuse corporation attira aussi l’attention de la mine Blanche de Castille et de son pieux fils Louis IX, qui fit un règlement sévère pour mettre un frein aux scandaleuses saturnales des filles de joie de la rue Glatigny.
Elles ne pouvaient se rendre à leurs clapiers qu’à des heures fixées et avec un costume tout particulier, qu’elles ne devaient quitter, sous peines sévères. C’est sous saint Louis que cette rue fut dotée d’un val d’amour de dames au corps gent. Des gobelets d’argent pendaient à leur ceinture de laine, et menant de compagnie Bacchus et Vénus, elles proposaient aux passants de venir boire avec elles. Les dimanches et fêtes, assises sur les bornes de la rue Glatigny, elles récitaient leurs offices dans un livre de prières à fermoir de cuivre doré, attendant clers et soudards.
Autre trait caractéristique de l’époque : saint Louis faisait suivre sa cour en voyage d’un escadron volant et volage de ribaudes inscrites sur le rôle tenu par la dame des amours publics.
Il leur était interdit de porter des ceintures dorées ; cette ceinture de vierge que le mari dénouait en rougissant le soir de ses noces, avait sa signification morale : elle symbolisait la pudeur, c’était la cuirasse de la chasteté, et l’on disait des nonnes qui avaient conservé intact l’antique nœud d’Hercule : elles ont un nœud gordien que le diable lui-même ne pourrait dénouer. Au Moyen Âge, les honnêtes bourgeoises de Paris firent des ceintures dorées une écharpe de vertu, et les orfèvres, un objet d’art. Nous ne croyons pas nous tromper en disant que ce large ruban, orné d’emblèmes dorés, que l’on passe encore aujourd’hui au cou des rosières, lors de leur couronnement, vient de ce sage usage. Il remplace la ceinture dorée de nos chastes aïeules.
Quand le Parlement les eut interdites aux filles de joie, cette défense fut considérée comme une marque d’ignominie. Peu à peu elle tomba en désuétude, et les filles folles en ornèrent leur corsage comme les honnêtes femmes. C’est alors que s’établit le proverbe : Mieux vaut bonne renommée que ceinture dorée, c’est-à-dire une bonne réputation vaut mieux que ce signe souvent menteur de la vertu.
À cette interdiction se rattache l’anecdote suivante : C’était coutume de se donner mutuellement à l’église le baiser de paix, quand le prêtre qui disait la messe avait prononcé ces paroles : Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous ! La reine Blanche, épouse de Louis VIII, ayant reçu ce baiser de paix, le rendit à une fille publique dont l’habillement était celui d’une femme mariée et d’une condition honnête. La reine, offensée de la méprisé, obtint une ordonnance qui défendait aux coureuses d’aiguillettes de porter des robes à queue, à collets renversés, et une ceinture dorée.
Plus tard, on fut plus sévère : les sentences en matière d’amour à l’encan, s’exécutaient au carrefour du Petit-Carreau. La fille convaincue de débauche était conduite dans certaines rues et notamment au carrefour du Petit-Carreau, montée sur un âne, le visage tourné vers la queue, ayant sur la tête un chapeau de paille, avec un écriteau devant et derrière portant ces mots M… publique ; elle était battue et fustigée nue par la main de l’exécuteur des hautes œuvres, et flétrie d’un fer chaud en forme de fleur de lys sur l’épaule droite, puis bannie pour neuf ans de la ville de Paris :
Le populaire du Moyen Âge appelait encore naïvement les rues affectées à la prostitution : Les rues Chaudes.
Un jour un moine, monté sur un âne, en traversant la rue Glatigny quelques heures avant le couvre-feu, prêcha avec tant d’éloquence, qu’il convertit d’un seul coup vingt-cinq ribaudes qui le suivirent et furent enfermées au couvent des Filles-Dieu.
Quand ces filles du diable devenaient filles repenties, elles avaient des refuges. Guillaume III, évêque de Paris, ayant converti plusieurs de ces filles, leur avait fait construire le couvent des Filles-Dieu, dans lequel elles étaient recueillies et rendues à une vie meilleure. Il y avait encore le couvent des Filles pénitentes.
Au quatorzième siècle, cette rue, si célèbre dans l’histoire de la prostitution, était aussi désignée sous le nom de la rue du Chevet de Saint-Denis de la Châtre, à cause de sa position le long du chevet de cette église, bâtie sur le lieu où saint Denis avait été emprisonné et torturé. Le nom de Glatigny lui est resté.
LA RUE COCATRIX. Elle tirait son nom du fief de Cocatrix, situé entre les rues Saint-Pierre-aux-Bœufs et des Deux-Hermites. Cocatrix était l’échanson de Philippe-le-Bel. Cette charge était en grand honneur au Moyen Âge. L’échanson versait à boire au roi, achetait le vin de sa table, et devait veiller à la distribution du vin dans l’intérieur du palais. Il y avait avant lui le bouteillier, qu’il ne faut pas confondre avec l’échanson. La juridiction du bouteillier s’étendait sur tous les marchands de vins de Paris. Charlemagne en avait un.
Suivant un compte de 1285, il y avait quatre échansons au palais du roi : un pour le roi, à quatre sous quatre deniers de gages par jour, et trois pour le commun, à trois sous trois deniers, outre leurs autres droits.
Le jour du couronnement des reines ou des grandes fêtes, le roi donnait une gratification à l’échanson pour son droit de coupe (hanap).
À Passy, en 1305, il y avait un quartier de terre désigné sous le nom de l’Echansonnerie ; c’est là que se dressait le fier manoir de Geoffroi Cocatrix.
La rue Saint-Pierre-aux-Bœufs, qui était voisine, tirait la première partie de son nom d’une église consacrée à saint Pierre, et la seconde partie de deux énormes têtes de bœufs sculptées au portail de cette église. Une vieille légende en raconte l’origine :
Un écolier du nom d’Hémon de Fosse entra dans la Sainte-Chapelle au moment de l’élévation, il arracha l’hostie des mains du prêtre. Pour expier ce sacrilège, le curé ordonna une procession solennelle. Au moment où le cortège passait, deux bœufs que l’on conduisait à la boucherie s’agenouillèrent devant le Saint-Sacrement. C’est en souvenir de ce miracle que l’on sculpta la figure de ces deux ruminants religieux au portail.
La famille des Cocatrix avait sa chapelle à l’église Saint-Gervais.
LA RUE SAINT-CHRISTOPHE.– Cette rue était au treizième siècle désignée sous le nom de Regratterie, probablement à cause des petits marchands qui s’y trouvaient. Elle prit ensuite le nom du grand Saint-Christophe, à cause de son église, qui fut érigée en paroisse en 1300 ; elle datait du septième siècle.
Tout à côté, oh voyait le porche de l’église. Sainte-Marine, dans laquelle était la statué d’un moine assis, tenant dans ses bras un enfant emmailloté. Voici la légende qui explique cette singulière sculpture :
Sainte Marine était la fille unique d’un Grec qui, converti, entra dans un monastère. Ne voulant pas quitter son père, elle se vêtit des habits d’homme, et se présenta à l’abbé, qui la reçut sous le nom de frère Marin. Son père étant mort, elle continua sa vie religieuse au milieu des moines.
Les frères du monastère avaient coutume d’aller en ville avec un chariot traîné par des bœufs, pour apporter les provisions nécessaires au couvent. Quand ils devaient rester absents plusieurs jours, ils étaient hébergés chez un certain gentilhomme nommé Pandoche. Sa fille, ayant été séduite par un soldat, mit au monde un enfant. Pressée de questions par son père, elle accusa frère Marin de l’avoir violée. Plainte est portée à l’abbé, qui, après l’avoir fait frapper de verges, chassa ignominieusement le coupable du couvent.
Frère Marin resta pendant trois ans à la porte du monastère, subissant patiemment toutes les injures, et ne vivant que des morceaux de pain qu’on lui jetait chaque jour. L’enfant sevré fut envoyé à l’abbé, qui le bailla à frère Marin. Touché de son repentir et de son humilité, cédant aux prières des autres religieux, il lui rouvrit les portes du couvent, dans lequel il rentra avec l’enfant, ayant pour pénitence de faire les travaux les plus durs et les plus grossiers de la maison.
Frère Marin mourut, et comme il n’avait pas fait une pénitence suffisante, l’abbé ordonna de l’enterrer loin du couvent. Or, comme les frères lavaient le corps du défunt, ils reconnurent que c’était une femme. Alors ils se prosternèrent humblement, et, repentants de ce qu’ils avaient été injustes, ils demandèrent pardon à Dieu, et le firent inhumer solennellement dans le monastère. Plusieurs miracles eurent lieu sur son tombeau.
La fille du gentilhomme qui l’avait si indignement calomnié devint possédée du diable. Elle ne guérit que longtemps après, en venant tous les jours prier, pleurer et gémir sur la tombe de sa victime.
Les Parisiens, émerveillés par cette touchante légende et par les vertus miraculeuses de cette sainte, bâtirent vers le onzième siècle une église qui fut dédiée en son honneur. Comme elle avait très peu de paroissiens, et par conséquent un très mince revenu, les jours de grande fête on portait devant son porche, au milieu de la rue Saint-Christophe, un tronc dans lequel les passants mettaient leurs aumônes. Un religieux de Notre-Dame, agenouillé à côté, récitait un Ave en faveur de celui qui déposait une offrande.
C’est dans cette vieille chapelle que, pendant près de trois siècles, il fut d’usage de conduire l’homme et la femme qui avaient failli à l’honneur, pour les marier souvent contre leur gré. Trait curieux qui peint bien les mœurs du Moyen Âge, quelquefois ils étaient amenés par deux sergents en présence du curé. C’est là seulement, et pas ailleurs, que pouvaient se marier les filles-mères, car la bénédiction nuptiale leur était refusée partout. Ce triste privilège se rattache à la légende de sainte Marine si injustement calomniée par une fille qui avait failli. Pour les humilier, l’église n’avait pour elles que des escabeaux de bois grossiers, et le curé leur passait au doigt un anneau de paille (symbole de la fragilité de leurs amours illicites), et faisait ensuite aux nouveaux époux un sermon dans lequel il les engageait à vivre en paix et amitié, pour réparer la faute qu’ils avaient faite, racheter l’honneur de leurs familles et sauver leurs âmes de la damnation éternelle.
Cet usage dura jusqu’au dix-septième siècle. Des magistrats, des prélats obtinrent en 1627, que l’anneau de paille serait remplacé par un anneau d’argent, et les mariages des fines-mères se continuèrent à l’église Sainte-Marine avec cette modification jusqu’en 1760 ou 1765. Dans les soties et farces représentées par les clercs de la bazoche, les confrères de la Passion ou les Enfants sans souci, comédiens d’alors, il était parlé plusieurs fois, eu termes dérisoires, de l’anneau de paille de Sainte-Marine.
Par une coïncidence singulière et comme pour continuer cette comédie ridicule, un montreur de marionnettes s’était établi au moment de la révolution dans la nef morcelée et défigurée de cette curieuse chapelle.
C’est sous les dalles armoriées de l’une des chapelles du côté droit de Sainte-Marine que fut couché, après, trépas, le célèbre lieutenant civil d’Henri IV, l’éminent édile de 1604 qui édifia une façade de l’hôtel de ville – le parloir aux bourgeois, abandonné par les officiers municipaux, avait été démoli en 1589 ; – vous l’avez nommé, François Myron. Lui, aussi il bouleversa le vieux Paris de Philippe-Auguste pour l’embellir et le rendre prospère. Il jouissait d’une grande popularité ; parce que, tout en étant lieutenant civil et prévôt des marchands ; il était en même temps le type le plus remarquable du bourgeois de Paris dans la plus large acception du mot.
François Myron rendit célèbre dans l’histoire de Paris un nom qu’illustra encore après lui son neveu, prévôt des Marchands sous Louis XIII ; c’est Robert Myron, qui fit paver les ruelles de la bonne ville de Paris. De son temps il n’y avait encore de dallées que les quatre grandes voies aboutissant aux principales entrées de la ville. Ces entrées étaient les portes Saint-Honoré, Saint-Denis, Saint-Antoine et Saint-Jacques. On appelait ces voies la croisée de Paris, parce qu’elles formaient une croix en se rencontrant. Elles avaient été dallées sous Philippe-Auguste en 1184 ; c’est Girard de Poissy, un financier de l’époque, qui contribua volontairement pour 11 000 marcs d’argent à cette dépense qui s’éleva à 22 000 marcs. Ces dalles avaient de 13 à 14 pouces de longueur, 3 pouces d’épaisseur ; on empierra une cinquantaine de rues avoisinantes, et dans les autres ruelles le sol fut battu.
Les nobles et les hauts bourgeois hantèrent les voies dallées ; le commerce habita les rues empierrées et le populaire s’entassa dans les ruelles boueuses et infectes qui occasionnaient régulièrement des épidémies sévissant avec une telle rage qu’il fallait repeupler certains quartiers, notamment sous Louis XI. Et de quelles menues gens se composait ce recrutement municipal ? de mendiants, de truands, de voleurs de province. C’est là, faisons-le remarquer en passant, l’origine du mauvais renom de certains quartiers parisiens, mauvaise réputation qui existe encore aujourd’hui, quoique habités par de tout aussi honnêtes gens que les quartiers aristocratiques, qui ne jouissent de leur belle réputation qu’à cause de l’injuste préférence qu’eurent pour eux les édiles du vieux Paris.
Cette défaveur injuste révolta le bon Myron.
« De par Dieu ! dit-il un jour, les pauvres habitants des rues de l’Orberie, du Marché-Palu, des Calendreurs et des Morteliers sont nos enfants comme les beaux seigneurs de la place Royale et de la rue Saint-Antoine. Dieu leur a donné pour étoffe semblable une même peau. Ores, il ne faut pas que les uns restent plus longtemps étouffés dans la fange de leurs ruelles, tandis que les autres se promènent sur de belles et de bonnes dalles ; cecy seroit déshonorant pour la prévosté. Messieurs de la ville, baillez-moi de l’argent, et j’aviseray. »
On lui bailla 200 900 livres et il fit payer les quartiers populeux déshérités. Le nouveau pavé qu’employa l’entrepreneur Marie était à peu près de la dimension du pavé actuel. Certaines rues ont encore des pavés de cette époque.
Les Parisiens toujours fidèles à leurs habitudes gouailleuses et frondeuses chansonnèrent le prévoyant magistrat :
Mais, ce ne fut pas tout ; le vent tournait à la sédition. Ils étaient prêts déjà à faire des barricades avec les pavés, avant même qu’ils ne fussent enchaussés dans le sol. Il fallut que le capitaine des gardes plaçât des archers au coin des rues pour protéger les ouvriers contre les mutins.
Lors des démolitions de la maison portant le n° 13 de la rue d’Areole, élevée sur les fondations de l’église Sainte-Marine, on a trouvé le sarcophage de François Myron. La bière en plomb a la forme d’une ellipse étranglée à l’une de ses extrémités, comme les boîtes mortuaires dans lesquelles sont emprisonnées les momies égyptiennes. L’épitaphe était effacée. Quand on souleva le couvercle du cercueil, on ne trouva qu’un squelette entouré d’une suie noirâtre mélangée de poussière et de plantes aromatiques ayant servi à l’embaumement. Chose singulière, on ne retrouva ni les insignes de sa charge, ni son épée ni son anneau, etc., ni même des traces de ses armoiries : de gueules, au miroir rond (Myron, miroir rond, armes parlantes) d’argent garni et pommelé d’or. La commission des beaux-arts, par la bouche de ses experts, déclara que c’était bien le grand édile parisien, et ses reliques illustres furent descendues dans les caveaux de Notre-Dame.
LA RUE DES MARMOUSETS. Cette rue doit son nom à une maison qui s’appelait dans les anciens titres : Domus Marmosetorum, à cause de sa sculpture représentant des marmousets (enfants en bas âge).
Sous Charles VI, le peuple avait stigmatisé les conseillers de ce roi, renommé par sa faiblesse, du sobriquet dédaigneux de Marmousets.
D’après un acte qui date de 1206 les clercs de matines payaient dix livres à chaque mutation de doyen, au prieur de Saint-Éloi, pour amortissement de quelques maisons sises dans cette rue.
Louis, fils du roi Philippe Ier, avait fait abattre, de son autorité privée, partie d’une maison de cette rue, près de la porte du cloître, qui appartenait au chanoine Duranci. Elle saillait trop à son gré et rendait le passage incommode. Le chapitre de Notre-Dame réclama ses privilèges et ses immunités. Louis reconnut son tort, promit de ne plus faire d’attentat semblable, et consentit à payer un denier d’or d’amende. Afin que cette réparation fût plus éclatante, on choisit le jour où Louis, qui était monté sur le trône, Épousa Adelaïde de Savoie. Il la fit avant de recevoir la bénédiction nuptiale, qui ne lui aurait pas été octroyée sans cela, et consentit à ce qu’il en fût fait mention dans les registres du chapitre.
La maison des Marmousets fut rasée par un arrêté du parlement, pour un crime célèbre dans les annales parisiennes.
À cette maison qui faisait le coin de la rue des Marmousets, et de celle des Deux-Hermites, pendait l’enseigne d’un barbier juif. Son voisin était un pâtissier.





























