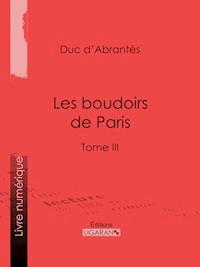
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Si on ne l'avait déjà dit et répété à satiété, je m'écrierais en tête de ce chapitre : – A quoi tiennent les destinées des empires ! Jamais, cependant, cette banale exclamation n'eût été mieux placée; Si Bonaparte n'eût pas épousé madame de Beauharnais, il est permis de douter qu'il eût eu le commandement de l'armée d'Italie ; s'il n'eût pas fait cette belle campagne d'Italie, comment les choses auraient-elles tourné pour la France ?"
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SOMMAIRE. – Ce qui est écrit là-haut. – Le boudoir de ma grand-mère. – La manie de l’antique. – Une loge à Feydeau. – Triple proposition de mariage. – Bonaparte refusé. – Madame de Beauharnais. – Les galions. – Les Frères Provençaux. – Le rendez-vous. – Un amour de deux ans de date. – Lady Maria C… – Le général remplacé par le capitaine. – Intelligence d’un domestique de place. – Les apparences trompeuses.
Si on ne l’avait déjà dit et répété à satiété, je m’écrierais en tête de ce chapitre :
– À quoi tiennent les destinées des empires !
Jamais, cependant, cette banale exclamation n’eût été mieux placée. Si Bonaparte n’eut pas épousé madame de Beauharnais, il est permis de douter qu’il eût eu le commandement de l’armée d’Italie ; s’il n’eût pas fait cette belle campagne d’Italie, comment les choses auraient-elles tourné pour la France ? Jamais aurait-on vu le 18 brumaire ? La France n’eût-elle pas été peut-être rayée de la liste des nations ? qui le sait ? comme dit Jacques le fataliste.
Toujours est-il que le mariage de Bonaparte avec madame de Beauharnais influa d’une manière notable sur sa destinée, et que si une certaine personne eût voulu, ce mariage ne se fût pas fait. D’où il résulte, comme je le disais tout à l’heure, que la destinée des empires dépend quelquefois de choses tout à fait en dehors de ce qui semble devoir déterminer les évènements, et que Jacques n’avait peut-être pas si tort de dire que tout était écrit là-haut.
La personne de qui il a dépendu que Bonaparte ne fût pas le mari de Joséphine est ma grand-mère, madame de Permon. Ma mère, dans ses Mémoires, ne pouvait passer sous silence cette curieuse anecdote ; mais elle rentre dans mon cadre non moins que dans celui de mémoires purement historiques, et j’espère qu’on me pardonnera de reproduire cet intéressant épisode qui m’appartient
Mon grand-père était mort le 8 octobre 1795 ; c’est-à-dire le 17 vendémiaire an III, quatre jours après la fameuse journée du 13 vendémiaire, où Bonaparte joua un rôle si actif, et où le pouvoir passa de la convention nationale aux mains du directoire exécutif. Le deuil de veuve et, plus encore, la douleur qu’elle éprouvait de la mort de son mari, faisaient que ma grand-mère vivait dans une solitude profonde, où elle n’admettait que quelques amis très intimes.
Le général Bonaparte qui, comme on le sait, était chez ma grand-mère comme un enfant de la maison, et qui, quelques jours avant la mort de mon grand-père, avait contribué d’une manière efficace à obtenir que les agents des sections ne vinssent pas troubler ses derniers ; moments pour l’accomplissement de quelques formalités, était l’homme que madame de Permon voyait le plus fréquemment. Il était rare qu’il laissât passer un jour sans faire le voyage de la rue Neuve-des-Capucines à la rue Sainte-Croix, où était située la maison qu’habitait ma grand-mère.
Cette maison, soit dit en passant, avait été arrangée par madame de Permon avec un goût et une élégance rares. Ce ne sera point un hors-d’œuvre dans l’histoire des Boudoirs de Paris, que de signaler le boudoir de ma grand-mère comme étant un des premiers ressuscites. Elle avait toutes les traditions des règnes précédents, et malgré le sang des Comnènes qui coulait dans ses veines, faisait assez peu de cas des modes grecques qui commençaient alors à s’impatroniser, et préférait avec raison les bons meubles de Boule, aux meubles de forme prétendue antique, qui étaient le superlatif de l’incommode et du sévère. Ce fut un des ridicules de ce temps-là, de parodier l’antiquité sous toutes ses faces ; on pardonne aux grandes figures de la convention des prétentions à une ressemblance avec les Brutus, les Léonidas, les Caton : ces hommes, largement taillés, avaient en effet le droit de se croire de la famille des héros de l’ancienne Grèce et de l’ancienne Rome, et il n’y a rien d’étonnant que la forme se soit ressentie du fond ; mais, eux disparus de la scène, l’affectation des modes grecques et romaines était une véritable parodie. Ma grand-mère, qui aimait ses aises au suprême degré, trouva fort ridicule la manie de cette résurrection, et s’en tint, pour son usage, à ce qu’elle avait appris depuis son arrivée en France à regarder comme le véritable confortable.
Sa maison était donc d’une grande élégance. Bonaparte, devenu après le 13 vendémiaire l’homme indispensable, continua, comme je l’ai dit, à venir assidûment chez elle. Il lui rendit même de grands services. C’était le temps de la famine ; on recevait toujours chez ma grand-mère avec une grande joie quelques pains de munition que le général y envoyait deux ou trois fois par semaine.
La solitude dans laquelle ma grand-mère passait sa vie menaçait d’avoir de funestes conséquences ; accoutumée au monde, elle prenait insensiblement dans la retraite une mélancolie dont sa santé se ressentit d’une manière inquiétante. Son médecin, le docteur Duchannois, homme aussi spirituel que praticien habile, lui ordonna des distractions. Il avait péril en la demeure, et ma grand-mère, à qui son deuil ne permettait pas d’aller dans le monde, loua à Feydeau une loge par ordonnance du médecin.
Cette loge était aux baignoires : ma grand-mère pouvait donc assister au spectacle sans être vue ; chaque soir elle s’y rendait suivant l’ordonnance, et pour ne pas s’éloigner des quelques amis qu’elle recevait ordinairement le soir, elle leur avait fait promettre que sa loge serait regardée comme une succursale de son salon. Jamais elle était seule ; mais tous les soirs, sans exception, le général Bonaparte venait s’y installer. Il était peu probable que ce fut le charme de la musique française qui l’attirât avec autant d’assiduité. Il l’a toujours eue en horreur, et l’on sait qu’il eut toutes les peines du monde à pardonner à Méhul de l’avoir amusé pendant une heure avec son charmant opéra de l’Irato, qu’il avait écouté de confiance, comme étant de la musique Italienne.
Un soir que, par hasard, il se trouva seul à Feydeau avec ma grand-mère, à qui il avait donné le bras pour aller au spectacle, au lieu de faire ses récriminations habituelles contre la musique de Grétry et de Monsigny, et les médiocres chanteurs chargés alors d’être les interprètes de cette musique, il garda le silence pendant plus d’une heure, regardant ma grand-mère comme un homme que ce qu’il a à dire embarrasse beaucoup, et qui ne sais par où commencer.
– Qu’avez-vous donc, Napoléon ? lui dit ma grand-mère qui avait conservé avec lui le ton de familiarité dont elle avait pris l’habitude, ayant vu tout enfant celui qui commençait à peser si puissamment dans la balance de nos destinées. – Vous ne dites rien est-ce que vous trouvez que madame Scio chante bien ce soir, ou bien la musique française a-t-elle trouvé grâce à vos oreilles ? Vous n’avez pas encore dit une seule fois votre éternel : quelle miaulerie !
– C’est que, dit Bonaparte, je pense à tout autre chose qu’à la musique, madame Permon.
– Est-ce que vous ne pourriez pas garder vos méditations politiques pour la rue des Capucines ? dit ma grand-mère qui était entière et absolue comme une reine : vous avez un air maussade qui est tout à fait ridicule.
– Je ne pense pas plus en ce moment à la politique qu’à la musique, madame Permon, et si je vous parais maussade et ridicule j’en suis au désespoir, car j’ai quelque chose à vous demander.
– Voyons, dit ma grand-mère, dites-moi cela.
– Est-ce que vous ne pensez pas à marier Permon ? dit le général ; il me semble qu’il est d’âge à cela.
– Permon a vingt-cinq ans, dit ma grand-mère ; il en a quarante pour la tête ; quand il voudra se marier, il fera ce que bon lui semblera.
– C’est que, dit Bonaparte, qui ne devait pas facilement s’intimider une fois que l’attaque était commencée, j’ai un projet de mariage pour lui, et c’est de cela que je voulais vous parler.
– Dites toujours, dit ma grand-mère.
– Permon, continua Bonaparte, sans être riche est à son aise ; c’est un homme aimable, d’un esprit supérieur ; il a des talents solides et des talents d’agrément qui en font un homme vraiment hors ligne : je l’aime beaucoup ; il est votre fils ; j’ai pensé à le marier à une fille de seize ans, jolie comme un ange, que j’aime aussi de toute mon âme, que vous aimez aussi, qui est la fille d’une de vos amies, qui n’a rien, mais pour qui je pourrai tout faire un jour. Devinez-vous ?
– Si ce n’est pas Paulette, dit ma grand-mère en souriant, je ne sais de qui vous parlez.
– Vous l’avez dit : c’est ma sœur Pauline que je veux donner à votre fils ; dites oui, madame Permon, je serais heureux de ce mariage.
– Je vous l’ai dit, mon cher Napoléon ; mon fils ne fera, en se mariant, que ce qui lui conviendra. Jamais je ne l’influencerai pour refuser ou accepter tel ou tel parti. Depuis la mort de son père, il est chef de famille. Je n’ai pas, personnellement, de répugnance pour ce mariage ; il me conviendrait même assez ; j’en parlerai à Permon ; mais, je vous le répète, il n’en sera que ce qu’il décidera lui-même.
La conférence en demeura là : mais le lendemain Bonaparte revint à la charge et vint savoir ce que mon oncle avait répondu. Ma grand-mère ne lui en avait pas encore parlé.
Bonaparte se fit répéter par ma grand-mère qu’elle ne s’opposait pas personnellement au mariage de M. de Permon et de Pauline, puis, croisant ses bras, et souriant de ce charmant sourire qui lui était particulier :
– Alors, madame Permon, je puis vous adresser une autre requête dont le succès dépend de vous seule : que diriez-vous du mariage de mademoiselle Loulou et de mon petit-frère ?
– Jérôme ? s’écria ma grand-mère en riant.
– Oui, dit Bonaparte, pourquoi riez-vous ?
– Vous n’y pensez pas, mon cher enfant ; Laurette à onze ans et Jérôme ne les a pas encore !
– Je ne parle pas de faire ce mariage tout à l’heure, dit Bonaparte, mais ce pourrait être une chose arrangée.
– En vérité, Napoléon, dit ma grand-mère, quelle mouche vous pique depuis deux jours ? Vous mariez tout le monde, même les enfants.
Elle se mit à rire comme une folle de la nouvelle idée matrimoniale qui avait poussé à Bonaparte. Il fit chorus avec elle ; mais il ne riait pas franchement. Enfin, il se promena pendant quelques minutes sans rien dire, puis, s’arrêtant tout à coup d’un air sérieux :
– Oui, dit-il à ma grand-mère, oui, madame Permon, un vent de mariage a soufflé sur moi ; je vous ai parlé d’abord de vos enfants, de ma sœur et de mon frère ; ce n’est pas par eux que j’aurais dû commencer. C’est pour moi que j’aurais dû vous demander votre bienveillance, continua-t-il en lui baisant la main ; cette union entre les deux familles, que ce soit moi qui la commence ; après l’expiration de votre deuil voulez-vous consentir à devenir ma femme ?
Ma grand-mère regarda Bonaparte pendant une ou deux minutes, aussi stupéfaite que s’il lui eût proposé de devenir la femme du pape : puis à ce silence d’étonnement succéda un éclat de rire homérique. Il lui fut impossible de se contraindre, et pendant près d’un quart-d’heure elle rit aux larmes sans pouvoir réprimer son hilarité.
Il n’est personne qui aime à se voir rire au nez : une pareille réponse est surtout choquante quand on n’a rien dit que de très raisonnable et de très naturel ; c’était le cas du général Bonaparte ; sa demande n’avait rien d’extraordinaire. En outre, si l’on songe quel était l’homme à qui ma grand-mère répondait par un éclat de rire, on comprend que cet homme, qui devait avoir la conscience de ce qu’il valait, dût être plus choqué que n’eût pu l’être un autre de voir sa demande accueillie d’une manière aussi leste. Sa physionomie exprima sans doute ce qui se passait au-dedans de lui, car ma grand-mère s’arrêta tout à coup, et s’approchant de lui d’un air sérieux :
– Ne vous fâchez pas, Napoléon, lut dit-elle ; votre proposition m’a fait rire ; mais c’est de moi et non de vous que j’ai ri ; le rôle ridicule, dans cette occasion, c’est moi qui le joue. Vous croyez savoir mon âge, vous ne le savez pas. Je ne vous le dirai pas, mais je serais votre mère ; je serais même celle de Joseph ; laissons cette plaisanterie, elle m’afflige venant de vous.
– C’est vous, madame Permon, reprit Bonaparte d’un air assez chagrin, c’est vous qui m’affligez. Ce que je vous dis est sérieux ; le mariage est une chose sérieuse ; je ne plaisante pas avec ce qui est grave ; je ne sais pas votre âge, dites-vous ? Que m’importe ? Une femme n’a que l’âge qu’elle paraît, et vous avez l’air d’avoir trente ans ; ce n’est pas d’aujourd’hui que je pense à vous faire ma demande. J’y ai mûrement réfléchi. Je veux me marier.
– À la bonne heure, dit ma grand-mère ; mais vous trouverez une femme de votre âge qui vous conviendra sous tous les rapports.
– Ah ! reprit Bonaparte, on veut me marier. On veut me donner une femme qui est charmante, bonne, agréable et qui tient au faubourg Saint Germain ; mes amis de Paris veulent ce mariage ; mes anciens amis m’en éloignent ; moi, je veux me marier, et ce que je vous propose me convient mieux de toutes manières. Pour Dieu, madame Permon, réfléchissez-y !
– Mes réflexions sont faites, dit ma grand-mère. Ne pensez plus à cette folie ; ne pensez pas davantage au mariage de Laurette et de Jérôme, ce sont deux enfants ; quant à celui de Permon et de Paulette, c’est une autre affaire. J’en parlerai à mon fils. Dans quelques jours je vous rendrai réponse. Pour ce qui est de nous, continua-t-elle en lui donnant la main, notre bonne amitié ne doit point être troublée de tout ceci ; je vous aime comme un fils ; n’ayez pas de moi trop mauvaise opinion ; j’ai beau avoir des prétentions, elles ne vont pas jusqu’à vouloir conquérir un cœur de vingt-six ans.
– Oh ! dit Bonaparte, vous plaisantez toujours ; réfléchissez au moins, madame Permon !
– Eh bien, dit-elle en riant, j’y réfléchirai.
Le résultat de ses réflexions fut de ne plus songer à ce qu’elle appelait la folie du petit Napoléon. Mon oncle, à qui l’on fit part de la démarche qui le concernait refusa tout net l’honneur d’être le mari de la belle Pauline.
Peu de temps après cette conversation, ma grand-mère eut une querelle assez vive avec le général Bonaparte à la suite de laquelle il cessa de venir chez elle. Ce ne fut que lorsque ma mère se maria, c’est-à-dire lorsque Bonaparte, premier consul depuis un an, était déjà sur la première marche de ce trône où il s’assit l’égal et le vainqueur des rois de l’Europe, qu’il retourna pour la première fois chez ma grand-mère.
M. de Caulaincourt arriva un jour chez elle, un mois ou six semaines après cette petite scène ; quand il se fut établi bien commodément dans une excellente bergère, il dit d’un air satisfait :
– Savez-vous qu’il a bon goût, votre général Bonaparte.
– Cela dépend, dit ma grand-mère qui avait gardé pour elle l’histoire de la demande en mariage.
– Je veux dire, continua le bon M. de Caulaincourt, qu’il ne ressemble pas aux jeunes gens qui, quand il s’agit de s’établir, préfèrent en général une jolie petite fille à une femme, belle encore, et qui connaît le monde.
– Que voulez-vous dire ? s’écria ma grand-mère à qui on pouvait pardonner de croire que cette observation était à son adresse, et qui, bien sûre de la discrétion de son fils à qui elle avait seule conté la chose, ne comprenait pas comment son vieil ami pouvait en être instruit.
– Parbleu ! reprit monsieur de Caulaincourt, je veux dire que le général Bonaparte a donné une preuve de son bon goût en faisant le choix qu’il a fait, car madame de Beau harnais est une femme charmante sous tous les rapports.
M. de Caulaincourt était l’ami de madame de Beauharnais.
– Bonaparte épouse madame de Beauharnais ? s’écria ma grand-mère.
– La semaine prochaine, dit M. de Caulaincourt.
Ma grand-mère se mit à rire d’aussi bon cœur que le jour où Napoléon lui avait proposé de l’épouser elle-même. Son vieil ami, qui ne comprenait rien à cet excès de gaîté, ou qui craignait qu’il n’eût une cause qui ne fût pas très obligeante pour une personne à laquelle il portait un vif intérêt, fit une grimace à laquelle ma grand-mère devina ce qui se passait dans son esprit. Comme elle était bonne par excellence, elle reprit son sérieux, et dit à M. de Caulaincourt :
– Je ris de quelque chose que vous ne sauriez deviner, mon ami ; croyez bien que je n’ai pas voulu vous être désagréable en quoi que ce soit.
Mon oncle, qui entrait en ce moment fut mis au courant de la nouvelle qu’apportait M. de Caulaincourt, et le spirituel vieillard put, quoiqu’on ait dit ma grand-mère, deviner ce qui avait provoqué son hilarité, en l’entendant dire à mon oncle :
– Lui qui parle toujours de la destinée, il paraît que la sienne était d’épouser une femme qui eût pu être sa mère.
Ce mariage avait été négocié par ceux des amis de Bonaparte qui se trouvaient être en même temps dans l’intimité de Barras. Porté au pouvoir par les évènements du 13 vendémiaire, Barras affecta dans cette occasion une grande reconnaissance pour le général Bonaparte, à qui était dû tout le succès de cette journée. Intimement lié avec madame de Beauharnais, il lui sembla très commode de trancher du souverain et de faire la fortune de l’homme à qui il devait tout en casant convenablement une femme à laquelle il portait de l’intérêt. Madame de Beauharnais était alors parfaitement belle, quoique déjà d’un âge respectable. Elle était d’une bonne famille, quoiqu’elle n’ait jamais été présentée sous l’ancien régime. La faveur de Barras ne pouvait manquer à l’homme qui donnerait son nom à une personne si avant dans l’intimité du directeur. Bonaparte, qui, ainsi qu’il le disait, voulait se marier, et qui, d’accord peut-être avec sa destinée, aimait mieux épouser une femme déjà posée qu’une jeune fille sans expérience, ne se refusa pas à contracter une alliance convenable de tous points. Le mariage se fit, et il ne tarda pas à aimer sincèrement Joséphine, mais il n’est guère possible d’admettre qu’il l’ait épousée par amour.
Le crédit de madame Bonaparte ne contribua pas peu à faire donner à son mari le commandement en chef de l’armée d’Italie. Il est permis de douter que le gouvernement directorial, qui a donné tant de preuves d’ineptie et d’incapacité, eût fait choix de Napoléon, uniquement parce qu’il était le plus digne. On est même autorisé à croire que ce qui aurait eu lieu, eût été précisément tout le contraire. Tout est donc pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles.
C’est ici la place d’une petite anecdote assez curieuse, parce que le nom du général Bonaparte s’y trouve mêlé, et qui se passa quelque temps avant l’histoire de la triple demande en mariage adressée à ma grand-mère, et même avant le 13 vendémiaire.
Tout le monde sait que jusqu’à cette époque, Bonaparte, disgracié, n’était pas dans une brillante position de fortune. Il vivait modestement à Paris, faisant bourse commune avec Bourrienne, son ami et son ancien condisciple, plus tard son secrétaire et son détracteur, et Junot, son aide-de-camp, qui avait mieux aimé rester avec le général disgracié, que près de tel autre en faveur.
Le trio avait donné à l’argent que mon père recevait ordinairement ou extraordinairement de sa famille, le nom pompeux de galions. Quand l’envoi se faisait attendre, on disait philosophiquement :
– Les galions ne sont pas arrivés.
Mais quand les galions, sous la forme de la diligence, avaient fait leur entrée triomphante dans le port de la rue du Bouloy, on les accueillait avec reconnaissance, et on se permettait le petit dîner aux Trois frères Provençaux.
Les galions étaient sans doute arrivés le matin ou la veille, car les trois amis se trouvaient attablés dans un bon cabinet bien chaud lorsque l’on frappa à la porte. Un domestique entra, et après avoir examiné chacun des convives avec attention, il s’avança vers mon père et lui remit un billet dont il attendait la réponse.
Mon père regarda la lettre ; il n’y avait pas d’adresse ; il le fit remarquer au domestique.
– C’est bien pour vous, dit celui-ci.
– J’irai, dit mon père, après avoir lu.
Le domestique parti, mon père tendit la lettre à son général, qui lut tout haut ce qui suit :
Vous ne me connaissez pas ; je suis donc obligée de vous dire que je suis jeune, jolie, d’une bonne famille, bien placée dans le monde, et que je vous aime à la folie. Dans deux heures je vous attends chez moi, rue du Mont-Blanc, n°… Vous demanderez madame Georges, et vous rapporterez la lettre.
– C’est quelque aventurière, dit Bonaparte.
– Elle aura senti les galions, dit Bourrienne.
– Gardez-les, général, dit mon père ; Bourrienne pourrait bien avoir raison ; quant à ma peau, je ne crains rien ; je crois que je serai bien plus le fait de cette honnête personne, vivant que mort. Je vais y aller.
On parla du rendez-vous mystérieux encore un instant, puis il n’en fut plus question, et à l’heure dite, mon père se rendit rue du Mont-Blanc, au numéro indiqué, demanda madame Georges, et fut introduit dans un appartement très élégant, où il fut reçu par une charmante personne d’une trentaine d’années, qui avait les plus beaux cheveux blonds du monde, les yeux les plus doux, la démarche la plus suave, et que l’on eût prise pour la vierge Marie en personne, si elle eût voulu se donner la peine de cacher son jeu.
Mon père tira la lettre de sa poche et la lui présenta respectueusement comme pour lui dire :
– C’est bien moi !
La femme Monde prit la lettre en souriant, la jeta négligemment sur un meuble, et tendant une petite main blanche à mon père, le fit asseoir à côté d’elle sur un sofa bien doux et bien parfumé, avec un sourire qui n’avait rien d’inquiétant.
– Je suis Anglaise, dit-elle, rompant la première le silence. Vous n’aimez pas sans doute les gens de ma nation.
– Je fais une différence entre ceux et celles de votre pays, madame, dit gaîment mon père ; je me bats volontiers contre les uns, et je crois que l’honneur me permet de rendre les armes aux autres.
– Il y a longtemps que j’ai envie de vous voir, dit l’Anglaise avec un accent assez peu prononcé, et s’expliquant avec une grande pureté ; depuis Toulon je suis amoureuse de vous. Ne me prenez pas pour une folle ; je suis la sœur de sir Georges C… qui commandait une partie des forces anglaises à Toulon. J’aime les braves ; votre nom est là, continua-t-elle en montrant son cœur ; depuis cette époque, je n’ai pu venir en France qu’à présent. Arrivée hier, je me suis informée de vous, et j’ai su, il y a deux heures, que vous dîniez dans un endroit public. Je vous ai écrit ; j’ai bien craint que vous ne vinssiez pas ; vous voilà, si ma franchise ne vous déplaît pas, je suis heureuse.
Mon père avait vingt-quatre ans à peine, il était très bel homme ; que l’amour de l’Anglaise, auquel elle donnait deux ans de date, fut sincère ou non, elle était charmante ; il venait de faire un bon dîner, il était dans un boudoir qui semblait appeler le plaisir. Comme on le pense bien, il ne se montra pas trop pointilleux ni cruel, et la belle insulaire n’eut pas à se repentir de ses avances, peut-être un peu exagérées.
Il y avait plus de deux heures que mon père était chez l’Anglaise, et ils n’avaient pas encore beaucoup parlé, lorsque celle-ci, dans une phrase qu’elle lui adressa, l’appela général.
Mon père, qui n’était pas homme à se donner les gants d’un grade qu’il n’avait pas, lui dit en lui faisant un grand salut :
– Capitaine, milady, s’il vous plaît.
L’Anglaise resta stupéfaite.
– Je ne comprends pas, dit-elle.
– Je serais heureux, dit mon père, de recevoir les épaulettes de général d’aussi belles mains que les vôtres, mais j’ai une bien grande vénération aussi pour celles qui m’ont donné l’épaulette de capitaine. Je la tiens du général Bonaparte ; et vous qui aimez la gloire…
– Que dites-vous ? s’écria l’Anglaise hors d’elle-même.
Mon père crut que l’Anglaise était prise d’un accès de patriotisme, et il s’approcha d’elle pour lui prendre la main et essayer de parler d’autre chose, mais elle fit un bond comme une lionne blessée par un chasseur, et s’enfuit à l’autre bout de la chambre.
– Ne m’approchez pas, lui cria-t-elle. Vous n’êtes donc pas le général Bonaparte ?
– Hélas, non, dit mon père : qui a pu vous abuser à ce point… ?
– Ah ! dit l’Anglaise, avec l’accent d’une profonde douleur ! ce n’est pas lui ! – et moi qui depuis deux ans !…
Elle exprima ce regret d’une manière si comiquement tragique que mon père ne put s’empêcher de sourire.
– Monsieur, dit l’Anglaise, rappelée à sa fureur par ce sourire qu’elle trouva sans doute passablement impertinent ; voulez-vous m’apprendre comment vous vous trouvez possesseur d’une lettre qui ne vous était point adressée ?
Mon père lui raconta avec sa franchise habituelle ce qui s’était passé, et lut donna sa parole d’honneur qu’il lui disait la vérité.
Il y avait dans l’accent de sa voix quelque chose qui sans doute persuada lady Maria C…, car elle s’apaisa en l’écoutant. Mais elle ne comprenait pas plus que lui comment il se trouvait nanti de la lettre destinée à son général. Elle sonna et ordonna au domestique de place qui la servait, de lui rendre compte de la manière dont il s’était acquitté de sa commission.





























