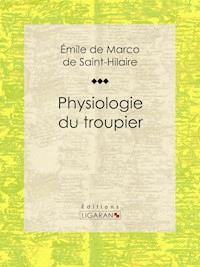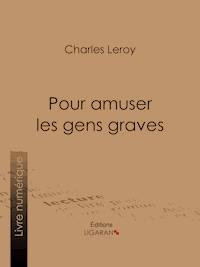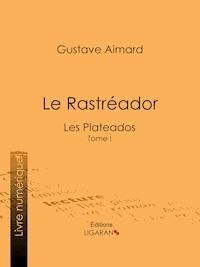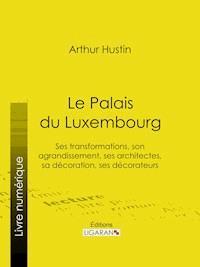Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Extrait : "Nicolas-Edme Restif naquit le 23 octobre 1734 à Sacy près Vermenton, dans le département de l'Yonne, ancienne province de Bourgogne. Son père, qu'il a peint sous les couleurs les plus avantageuses dans un livre qui tranche beaucoup sur le ton ordinaire de ses productions, était cultivateur après avoir abandonné par obéissance filiale un beau parti à Paris."À PROPOS DES ÉDITIONS Ligaran : Les éditions Ligaran proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants : • Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin. • Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 483
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
En réimprimant quelques-unes des Nouvelles qui composent le volumineux recueil intitulé les Contemporaines ou les aventures des plus jolies femmes de l’âge présent, nous n’avons point pour but de donner au lecteur de notre siècle des modèles de goût, de sentiment ou de style. Nous voulons lui présenter seulement un chapitre d’histoire littéraire d’une part et de l’autre un tableau des mœurs de nos grands-pères au moment où allait crouler la vieille monarchie française à bout de forces devant les premières revendications de l’esprit nouveau. Le tableau passa pour exact au moment où il parut pour la première fois. Quant au phénomène littéraire que présente l’auteur, il n’a pas cessé d’être curieusement examiné par tous ceux qui, lorsqu’ils assistent à une représentation théâtrale, n’ont pas seulement des oreilles pour les premiers sujets, mais s’intéressent également à tous les acteurs, sachant bien que tous les rôles ont leur raison d’être et leur utilité. En venant après bien d’autres présenter le résultat de notre étude, nous promettons de rester dans les limites de l’observation scientifique et d’écarter tout parti pris, toute exagération, toute hypocrisie. Nous sommes de ceux qui croient que les œuvres de Restif méritent d’être lues pour elles-mêmes et non pas uniquement recherchées pour les gravures qui les décorent, et que payer aussi cher qu’on le fait cette superfluité, c’est trop ravaler l’écrivain.
Pour le bien faire connaître, ce qu’il aurait fallu pouvoir publier, ç’aurait été ce livre étonnant : Monsieur Nicolas ou le cœur humain dévoilé. Cela est impossible à l’heure qu’il est, mais nous puiserons à cette source le plus que nous pourrons pour la Vie de Restif qui ouvrira ce premier volume.
Notre choix en comportera trois, d’après la division primitive, en Contemporaines mêlées, c’est-à-dire sans distinction d’état, en Contemporaines du commun et en Contemporaines graduées.
En ajoutant à ces textes une Vie de Restif, une Appréciation de son œuvre et une Bibliographie de ses ouvrages, nous espérons donner satisfaction à cette classe nombreuse de lecteurs qui, ne pouvant se procurer les 200 volumes de l’infatigable écrivain, veulent cependant savoir les causes du bruit qui s’est fait il y a cent ans, et se fait de nouveau aujourd’hui autour de son nom.
Nicolas-Edme Restif naquit le 23 octobre 1734 à Sacy près Vermenton, dans le département de l’Yonne, ancienne province de Bourgogne. Son père, qu’il a peint sous les couleurs les plus avantageuses dans un livre qui tranche beaucoup sur le ton ordinaire de ses productions, était cultivateur après avoir abandonné par obéissance filiale un beau parti à Paris. Il s’était marié deux fois ; il avait eu sept enfants d’un premier lit ; Nicolas-Edme fut le premier des sept qu’il devait avoir également du second. En se rappelant les vertus de son père et la douceur par laquelle sa mère, Barbe Ferlet de Bertro, savait corriger ce que son caractère avait de trop pétulant, M. Nicolas s’étonna plus tard de si peu ressembler à ses parents. Devançant une théorie de l’hérédité mise en avant dans ces dernières années, « je fus, dit-il, sans doute conçu dans un embrassement chaud, qui me donna la base de mon caractère : s’il eût été accompagné de dispositions vicieuses, j’étais un monstre ; la preuve de la pureté du cœur de mes parents, c’est ma candeur native. » Nicolas-Edme Restif ne fut pas un monstre, mais il fut un tempérament quelque peu exceptionnel. Dominé toute sa vie par l’érotisme, l’histoire de sa vie est, avant tout, comme l’a bien compris M. Monselet, l’histoire de ses amours.
Dès l’âge de quatre ans il se peint comme poussé par l’instinct « vers les filles dont la couleur ressemblait à la rose. » À onze ans il n’avait plus rien à apprendre, il était père, sans le savoir, il est vrai. Il devait aller loin sur cette pente et les listes successives qu’il donne de ses enfants naturels, si elles ne sont pas imaginairement grossies par cette sorte de manie de paternité qu’on voit s’accentuer davantage à mesure qu’il avance en âge pour éclater finalement avec une violence exagérée dans les Posthumes, son dernier livre, atteignent un chiffre invraisemblable, presque tout entier composé de filles, retrouvées successivement, la plupart sous les galeries du Palais-Royal.
Et c’est au village que commence cette odyssée galante ! Rien n’est plus gracieux, mais rien n’est moins déguisé, que ces premiers souvenirs de jeunesse où le jeune berger timide, et que les innocents baisers des petites paysannes font d’abord rougir, parce qu’on lui dit qu’il a « une fille à la joue », se montre à nous, s’enhardissant peu à peu, et se vengeant des premiers cris « V’qui M. Nicolas ! v’qui l’Sauvège ! » en devenant le plus téméraire – toujours naïvement et, comme il le dit, instinctivement – des joueurs aux jeux dramatiques du Loup, de la Belle-mère, de la Pucelle. Aussi combien plus tard il a raison, jetant un regard sur ce passé, de s’écrier : « Eh ! l’on parle de l’innocence des campagnes ! Il n’y a de mœurs que chez les gens instruits de la Ville et des champs ! »
Il n’y en avait pas à Sacy, à Nitry, à Courgis, à Vermenton, et comme par une fatalité qui tenait peut-être à l’homme lui-même plus qu’au temps et aux lieux où il vécut, il n’y en eut nulle part autour de Restif, pas plus à la campagne qu’à la ville, pas plus au collège que dans le monde, pas plus dans son enfance que dans son âge mûr ou dans sa vieillesse.
Son père n’était cependant pas un paysan tout à fait grossier, ni tout à fait pauvre. Il était, avons-nous dit déjà, venu à Paris dans sa jeunesse, il avait été sur le point d’y devenir quelque chose comme notaire ou procureur ; il était dans son village chef de la juridiction, soit à peu près ce que nous appelons maintenant juge de paix, et petit notaire ; il possédait plusieurs métairies parmi lesquelles celle de La Bretonne, dont son fils prit le nom plus tard ; il était allié à de bonnes familles, entre autres aux Cœurderoi, « dont il y a encore des présidents au Parlement de Bourgogne » fait remarquer le fils avec un certain orgueil, mais quatorze enfants ! Cette charge pesa dès l’enfance sur le petit Nicolas et comme tant d’autres de nos jeunes campagnards, encore aujourd’hui, il n’eut de première instruction que celle qu’il put acquérir en fréquentant l’hiver l’école de maître Jacques, à Vermenton.
Quoiqu’il fît parfois l’école buissonnière, ce pourquoi ses deux frères aînés, l’un déjà curé de Courgis, l’autre encore séminariste, ne lui ménageaient pas le fouet « pour effacer le péché originel par la douleur », il ne perdit pas tout à fait son temps, et s’il ne sut bien lire qu’à onze ans, il lut dès lors avec une sorte de fièvre qui le poussait à aller réciter ses lectures aux ouvriers de la ferme, aux batteurs en grange, aux bonnes femmes du village. Tous s’extasiaient sur son savoir et le vantaient à tel point, que le père se décida à le mettre en pension à Joux.
Il n’y resta pas longtemps ; il y gagna la petite vérole ; la convalescence fut longue, et quand la santé lui revint il fut prévenu qu’il allait recevoir une visite qui déciderait définitivement de son sort : celle du cousin Jean Restif, avocat à Noyers. « Je l’ai supplié de venir, lui dit son père, pour te juger à l’égard de l’avenir comme il a jugé ton frère aîné, aujourd’hui curé de Courgis. Et tout ainsi que j’ai fait la règle de ma conduite de ce qu’il m’a dit pour mon fils aîné, de même ferai-je pour toi, t’exhortant, mon enfant, à graver dans ta tête ce qu’il dira à ton sujet pour ne l’oublier jamais. »
Jean Restif, « cet homme respectable et d’une vertu rigide, » arriva pour la fête de Sacy, « mis plus que simplement, un vieil habit de drap gris, ses souliers coupés à cause des cors aux pieds » et l’interrogatoire commença immédiatement : « Mon petit cousin, que lisez-vous ? – La Bible, monsieur l’avocat, et mon père nous la lit tous les soirs. – Qu’y avez-vous remarqué ? » Restif répond, d’abord mal, puis un peu mieux, puis bien, mais il se montre tout entier, et quand le père demande enfin au juge sévère : « Quelle est votre opinion ? En ferai-je un laboureur ? » Ce juge répond « Non ! » Quant à en faire un prêtre comme son aîné, moins encore, « il aime les femmes ; ce n’est pas vice, mais c’est un penchant qui est toujours prêt à le devenir : comme la pauvreté, qui n’est pas vice, tient les pauvres toujours à la veille d’être fripons. » La conclusion fut qu’on ferait instruire l’enfant « dont le fond était propre à l’étude » et qu’on verrait après ce qu’il serait à propos d’en faire.
En conséquence, les vendanges terminées, son père le conduisit à Paris, chez l’abbé Thomas, le second de ses fils, alors sous-maître des enfants de chœur de Bicêtre. Le jeune Restif, sous la férule de ce frère janséniste et dont il s’est toujours plaint, ne fut pas des plus heureux. Il aurait même été très malheureux et presque abandonné s’il n’y avait eu dans l’établissement quelques jeunes servantes et deux Mères qui n’avaient rien des maximes rigides du jansénisme, cause cependant des efforts suivis de succès de l’archevêque Christophe de Beaumont pour disperser les prêtres de cette maison ; dispersion à la suite de laquelle notre jeune « confesseur de J.-C. » dut retourner à Courgis.
Il avait alors quatorze ans. Ce fut à ce moment que, dans une cérémonie religieuse, il se sentit pris d’un violent amour pour Jeannette Rousseau, la seule des femmes qu’il ait aimées qu’il n’ait pas possédée et la seule, par conséquent, dont le souvenir le poursuivit jusqu’au tombeau, à tel point qu’à soixante ans passés, se trouvant libre, il pensait à la demander en mariage, après une séparation de 46 ans. Nous devions signaler cette singularité de son existence. Peut-être n’a-t-il toute sa vie, comme on l’a dit de Don Juan, que cherché partout les fragments de cet idéal impollu et inaccessible qu’il crut avoir atteint un autre jour dans madame Parangon et qui lui échappa, par cela même qu’il l’avait atteint.
L’abbé Thomas lui continuait ses leçons de latin. Il en profitait pour écrire dans cette langue toutes ses impressions, toutes ses rêveries. Il achevait ainsi vers quinze ans un poème en l’honneur de ses « douze premières maîtresses, » poème que l’abbé saisit un jour et conserva longtemps, d’abord pour s’en faire une arme, ensuite pour s’humilier lui-même et qu’il brûla enfin. Mais il avait commencé par le communiquer au père. Il y eut à ce propos une belle scène.
« Quoi, à peine né, dit ce père respectable », vous ne respirez qu’après la lubricité la plus raffinée !… Il ne vous suffit pas d’une fille, d’une femme, il vous en faudrait douze !… Ô ciel ! qui l’aurait pensé, à voir l’hypocrite modestie que vous avez toujours eue sur le visage ! Quel sera l’étonnement et le chagrin de votre mère. – Cette pauvre mère qui comptait vous voir atteindre par votre mérite encore plus que par la science les garçons du premier lit, va bien rabattre de ses espérances !… Jamais m’a-t-on mandé à Auxerre quand mes deux aînés y étudiaient, pour m’exposer de pareilles turpitudes ? Moi, leur père, j’ai rougi devant eux d’être le vôtre. Il me semblait que je partageais votre infamie !… Je voyais leurs regards et leur surprise me reprocher un second mariage que de premiers enfants blâment toujours et qu’ils peuvent aujourd’hui blâmer puisqu’il a produit des fruits tels que vous… Vous venez, par vos écrits et par vos actions, de faire rougir votre père. »
Pendant cette véhémente apostrophe, le jeune poète pensait en lui-même : « Hô, si mon père savait tout ! » et se promettait de ne plus retomber dans la même faute. Serment d’ivrogne ! De ce jour, jusqu’au dernier, ce péché sera le sien. Même en moralisant, il côtoie l’immoralité (un néologisme son contemporain, qu’il n’avait pas trouvé et qui lui déplaisait), quand il n’y tombe pas, sans s’en douter, tout à plat.
On voit par ce qui précède que, quoique Restif n’ait commencé à être homme de lettres, dans le vrai sens du mot, qu’assez tard, il écrivait depuis sa plus tendre jeunesse. Il avait la vocation, il devait à son jour entrer dans le cercle et prendre sa part de cette ronde turbulente où se mêlèrent tant de grands penseurs et tant de petits esprits dont le rapprochement fortuit donne à la fin du XVIIIe siècle un caractère si original et si contrasté.
Après la scène que nous avons rapportée, il y eut difficulté pour les frères de vivre ensemble. Restif resta quelque temps cependant encore sous la tutelle de l’abbé Thomas. Pour y échapper il voulait à toute force se marier, mais son père lui persuada que de pareils désirs, avant dix-sept ans, étant encore trop prématurés, il fallait songer à choisir un état. On se rencontra un jour à Vermenton chez un parent éloigné avec un maître imprimeur d’Auxerre et sa femme, qui devait devenir pour M. Nicolas la céleste Colette ; à la suite de cette entrevue, il fut décidé que le jeune homme entrerait comme apprenti dans l’atelier de M. Parangon au mois de juillet 1751.
Le départ, les conseils, l’arrivée, les gaucheries, les naïvetés du nouvel apprenti, les mystifications des ouvriers, tout cela prend dans le récit de Restif, qu’on lise ce récit dans Monsieur Nicolas ou dans le Paysan perverti, l’aspect d’une photographie dont l’exactitude ne saurait être trop louée. Quoique nous devions plus tard nous étendre davantage sur cette particulière qualité du talent de notre auteur, nous ne pouvons ne pas dire dès ce moment que cet écrivain si fécond, qu’on a présenté comme si inventif et si varié, n’a jamais rien inventé et n’a jamais pris la plume que pour raconter des faits généralement vrais dans leur ensemble et toujours copiés d’après le modèle vivant, dans les détails.
Sa passion pour sa maîtresse qui s’était déclarée dès la première entrevue fut exaspérée par les fréquents rapports que son bon caractère et ses complaisances établirent entre elle et lui, mais Mme Parangon était vertueuse ; si elle était flattée de deviner cet amour qui n’osait se déclarer, elle savait en éloigner toujours l’expression catégorique. Pendant ce temps, le jeune Nicolas, employé à porter les lettres des ouvriers à leurs maîtresses, mis de moitié dans certaines parties et sachant déjà trop de l’amour pour en sacrifier le « physique » au « moral » se laissait aller à son penchant ; toutes les grisettes d’Auxerre y passèrent à leur tour. « C’est, dit-il, que j’étais moins amant d’une femme que des femmes et plus épris du sexe que de l’individu, quelque charmant qu’il fût. »
Un jour cependant, un jour, toutes les précautions de Mme Parangon, toutes les timidités de Nicolas furent inutiles. Un cordelier débauché et défroqué, qui tient dans le roman du Paysan perverti une place trop considérable, mais qui, en réalité, eut une grande influence démoralisatrice sur Restif, lui avait fait perdre à peu près tout respect humain. Excité sinon directement au moins par une sorte de raillerie à consoler « cette belle veuve » (M. Parangon était en voyage) l’apprenti ne put résister à une pareille tentation. D’après ses aveux mêmes il y eut quelque chose comme un viol, et ce qui tend à le faire croire, c’est qu’il ne s’est jamais vanté d’avoir obtenu plus tard de bonne grâce ce qu’il avait obtenu un jour par la force ou le hasard, et que, depuis ce moment, il a joint dans ses souvenirs respectueux Colette et Jeannette Rousseau, dont il a fait les grandes figures de ce Calendrier fameux rédigé dans sa vieillesse, où chaque jour commémore une femme, chaque dimanche deux, et chaque fête, trois.
Il obtint du reste un pardon qu’il sollicitait avec larmes. Bien plus, Mme Parangon sut trouver un moyen de le tenir en respect en flattant sa passion même. Elle lui fit croire qu’elle lui donnerait sa sœur en mariage. Il la crut, et lorsqu’elle fut morte, ce qui arriva peu de temps après, alors qu’étant passé maître il travaillait à Paris, il attribua le refus de M. Parangon de consentir à ce mariage à la haine que celui-ci lui avait vouée après avoir découvert son « crime », ce qui ne l’empêcha pas d’accepter des mains de ce même homme une autre femme avec laquelle il passa la vie la plus malheureuse et la plus troublée.
Cette période de la vie de Restif est celle sur laquelle, quoiqu’il s’y étende longuement, il a accumulé le plus de nuages. Je ne crois pas qu’il ait menti sciemment en faisant de M. Parangon un débauché de la pire espèce, ni d’Agnès Lebègue, une fille aussi perdue qu’il nous la dépeint. Il a bien certainement jugé les choses ainsi, après coup, sans quoi on ne s’expliquerait pas son mariage. Il a dû y avoir là une de ces surprises des sens dont il s’est repenti plus tard et alors que trouvant des torts chez les autres il n’a plus voulu en voir chez lui-même. Son séjour à Paris pendant son compagnonnage, n’avait pas contribué à réformer ses mœurs, il y avait vécu misérable. Il s’y était associé avec deux autres ouvriers, comme lui, de l’Imprimerie Royale. « Les charges du ménage, raconte-t-il, étaient partagées entre nous. Boudard, comme le plus entendu, allait à la boucherie : je portais le rôti au four et j’allais avertir de nous le rapporter, j’achetais en outre les racines, les légumes, le charbon, le bois. Chambon mettait le pot-au-feu, le soignait : nous lavions notre vaisselle tous les huit jours le dimanche après dîner. Cet accord subsista jusqu’à ce que deux femmes… »
Toujours les femmes ! Et quelles femmes ! L’une des plus honnêtes d’entre elles qu’il obtient par surprise, dans l’obscurité, lui conte, le prenant pour « l’abbé » qu’elle attendait, que sa tante avec laquelle elle vit, « mange… les rats… de l’Oratoire !… qu’elle paie un sou pièce les gros, deux liards les petits, au garçon portier… » Les autres sont des maîtresses d’hôtel garni qui croient se devoir à tous leurs locataires. Les autres… mais n’allons pas plus loin. Quoique Restif ait fait de Zéfire l’un des épisodes les plus dithyrambiques de ses souvenirs, cette peinture passionnée se termine à la mort de cette fille par une révélation assez révoltante pour que nous nous croyions obligés de la taire.
La rage du mariage persiste toujours malgré cette débauche permanente ; il veut épouser tout le monde. Après Zéfire, Suadèle ; après Suadèle, une anglaise, Henriette Kircher. Avec celle-ci la chose va même assez loin, il y a un simulacre de cérémonie religieuse et il se croit aussi bien marié que « s’il avait été à Gretna-Green, » jusqu’au moment où il trouve sa chambre vide et une lettre où on lui dit :
MONSIEUR,
Notre mariage est rompu, je ne saurais donc plus demeurer avec vous. Je m’en retourne dans mon pays avec ma chère tante qui veut bien encore me servir de mère. Adieu, monsieur ; oubliez-moi, comme je vous oublie et tranquillisez monsieur votre père.
HENRIETTE KIRCHER.
Dégoûté par ce dernier déboire, car la fille s’était fait passer pour une riche héritière, poursuivant un procès qu’un mariage seul pouvait lui faire gagner, Restif se décide à quitter Paris. Il retourne à Auxerre, à Courgis, va à Dijon où il travaille quelque temps, tout en s’apercevant, suivant une de ses réflexions d’alors, que « les mœurs sont un collier de perles : ôtez le nœud, tout défile » ; revient à Paris, n’y reste pas et repart le 7 novembre 1759 pour Auxerre où il rentre chez M. Parangon, par les conseils duquel il prend pension chez la mère d’Agnès Lebègue. Celle-ci devient sa femme, pour de bon, le 22 avril 1760.
J’étais beau, ce jour-là, s’écrie-t-il, en se rappelant ce grave passage de son existence ; j’étais beau, ce jour de ma mort morale ; on loua ma figure en disant qu’Agnès ne me méritait pas. Arrivés à l’église, le fatal serment de mariage fut prononcé. Un mot frappa mon oreille, au moment où jetant les yeux sur ma cousine Edmée, je la voyais en prière à l’écart : Enfin, la voilà donc mariée !… Et moi je pensais tristement : « Infortuné ! te voilà donc lié !… Je revins de l’église avec le sentiment pénible que j’étais perdu ! Et je l’étais… »
Il avoue cependant un peu plus tard qu’il avait bien ce que sa conduite méritait. S’il s’en était toujours souvenu il n’aurait pas sans doute écrit son roman : la Femme infidèle, où il ne ménage plus aucune attaque contre son épouse.
Celle-ci, qui très probablement eut aussi quelque chose à se reprocher, a eu au moins la sagesse de ne point répondre à ces attaques violentes par des attaques semblables. Lorsque Restif mourut, quoique le divorce eût été prononcé entre eux, pendant la révolution, elle crut devoir ne point souiller sa mémoire. Nous demandons pardon d’anticiper ainsi sur les évènements, mais comme nous ne reparlerons plus de Mme Restif, nous placerons ici la lettre qu’elle écrivit en 1806 à Cubières, qui lui avait demandé quelques renseignements biographiques pour mettre à la tête d’une édition de l’Histoire des compagnes de Maria :
Paris, 18 octobre 1806.
« Je suis trop charmée, monsieur, de l’honneur que vous m’avez fait, par la demande de quelques traits qui puissent être insérés dans l’éloge de mon mari, pour ne pas y répondre avec empressement ; mais des malheurs, que toute la prudence humaine ne pouvait prévoir, m’ayant séparée de cet homme de mérite dès 1784, je ne puis me livrer au plaisir que j’aurais à chanter ses louanges, si le démon de la discorde n’avait pas empoisonné l’esprit de cet homme naturellement bon. Cela fut cause que, durant vingt années, je n’eus aucune connaissance ni de ses affaires ni de sa conduite : en vain je lui écrivais, on interceptait mes lettres. Ainsi tout ce que je puis dire, c’est que durant tout le temps que j’ai passé avec lui, j’ai eu la satisfaction de voir dans mon mari un homme fort utile au public, de plusieurs manières. J’ai vu avec admiration plus de vingt pères de famille ne subsister un nombre d’années considérable que sur le travail que leur procurait cet auteur si laborieux. Il donnait toujours la préférence aux pères et mères chargés de nombreuse famille, car il était fort charitable. Si un vieillard, homme ou femme, lui demandait l’aumône, il le conduisait dans une petite auberge pour lui faire donner un ordinaire et une chopine de vin. Pour refuser un homme âgé, il aurait fallu qu’il n’eût rien eu sur lui ; etc.
Veuve RESTIF, née LEBÈGUE. »
Le « démon de la discorde » dont parle sa femme n’avait pas pour Restif le même nom. Il eût été heureux probablement si sa femme l’avait laissé vivre à sa fantaisie, sans lui faire aucun reproche, se bornant à le recevoir, lorsque, fatigué de ses maîtresses de passage, il serait revenu au logis. Il l’eût été davantage s’il n’avait pas craint les représailles et, avec son œil toujours éveillé sur ces points délicats, cru voir qu’après les avoir provoquées elles répondaient à son appel. Il était heureux de rencontrer des femmes « ayant dans le cœur une disposition adorable à la générosité. » Il ne pouvait se faire à l’idée que la sienne pût être ainsi pour d’autres que pour lui. La jalousie avec tous ses accessoires de colères, de ruptures s’ensuivit presque aussitôt, et ce fut lui qui s’en plaignit le plus, tout en donnant à sa femme les plus justes sujets de plainte.
Deux enfants, deux filles, vinrent au monde dans les intervalles de tranquillité. La mère les mit en nourrice en Bourgogne. Pendant un voyage qu’elle y fit pour les voir, tout changeait comme par un coup de théâtre dans la vie de Restif. Elle avait laissé à Paris un pauvre ouvrier de l’imprimerie du Louvre, elle allait retrouver à son retour un homme décidé à devenir littérateur.
Voici ce qui s’était passé :
Le directeur de l’imprimerie, « l’arabe Anisson Duperron, » n’était pas très aimé des ouvriers. Il les payait mal et s’enrichissait, croyaient-ils, à leurs dépens. Quand « cet ours » surprenait Restif en train de lire, quoique ce fût l’un de ses meilleurs compositeurs, il lui rabattait la demi-journée de 25 sous. Le pauvre diable n’osait se plaindre ; il enviait ceux de ses camarades qui trouvaient dans des relations féminines intéressées qu’il méprisa toujours une vie plus douce. « La probité de mon père, dit-il, sauva la mienne, je me rappelais en pleurant ce titre de l’honnête homme que lui avait donné le canton, et je me disais : – Mourons plutôt que d’y porter atteinte. » Il accueillit donc avec enthousiasme la proposition qui lui fut faite d’entrer comme prote chez Quillau où il devait gagner 18 livres par semaine, outre une copie de tous les ouvrages, ce qui pouvait valoir 300 livres. Ce nouveau poste ne le fit pas cependant négliger les aventures amoureuses qui lui arrivaient si facilement quand il ne les cherchait pas et qu’il cherchait quand elles tardaient trop à venir.
Ce fut une de ces chasses aux aventures qui décida de son sort. Il y avait rue Saint-Honoré un marchand de soieries qui avait deux filles. L’une d’elles, l’aînée, avait « le genre de figure de Mme Parangon. » La voir, l’aimer, le lui écrire, ce fut l’affaire du premier jour. Restif avait pris cette habitude de porter, dans ses habits de travail, qui ressemblaient un peu à ceux des commissionnaires, les lettres qu’il adressait à toutes les jolies femmes qu’il rencontrait et qu’il suivait, ou qu’il voyait dans leur comptoir. Mais Rose Bourgeois était tenue de près, on ne pouvait l’aborder. L’amant veut jouer le rôle de Sylphe. Il réussit à déposer ses missives sans être aperçu. Son agilité corporelle et la promptitude de son coup d’œil lui permettent de se dérober aux recherches pendant plusieurs semaines. Mais le père averti fait faire bonne garde, un beau matin, trois garçons de magasin saisissent le sylphe, et après avoir voulu le mener chez le commissaire, se contentent de le remettre aux mains de M. Rousseau.
Protestations d’amour épuré, délicat, honnête. Père sensible et sans doute amateur de littérature, qui se prend de tendresse pour l’épistolier, et qui finalement lui dit, comme les coquettes de théâtre disent je ne vous défends pas d’espérer : « Mon cher ami, je sens ce que vous valez par vos lettres et par vos réponses. Faites-vous connaître ; tirez parti de vos talents ; vous en avez et venez me voir dès que vous aurez quelque chose d’avantageux à m’apprendre. L’amour peut faire en vous des miracles, je l’ai vu à vos expressions. Ma fille est belle ; elle a plus de qualités que de beautés ; si vous la méritez un jour pourquoi ne l’auriez-vous pas ? »
Restif part sans dire, sans se rappeler peut-être, qu’il est marié, mais il ne revient pas, si ce n’est plus tard, pour saluer la maison vide de ses hôtes par ces paroles : « Salve, ô Domus, quæ me fecisti scriptorem ! »
Il l’était déjà – en vers – quoiqu’il ait dit un jour en signant la préface de la Confidence nécessaire,
Pour moi Phœbus est sourd et Pégase est
RESTIF,
il avait écrit des volumes de poésies aux filles d’Auxerre et à celles de Paris, il va le devenir en prose, c’est-à-dire de la manière qui convient le mieux à l’expression non plus de ses sentiments passionnés mais de ses investigations dans le domaine du réel. Il va s’adresser au public. Il est en droit de terminer l’histoire de cette première partie de son existence, en la qualifiant de honteuse, parce que c’est celle « de sa nullité, de sa misère, de son avilissement. » Nous l’allons voir maintenant aux prises avec un autre genre d’occupation où le travail de la pensée modérera quelque peu, sans l’éteindre tout à fait, sa fougue sensuelle.
Nous sommes en 1765. Restif vient de dépasser la trentaine. Il a beaucoup vu, beaucoup lu. Il sait assez de latin, un peu de grec, un peu d’anglais. Il se trouve tous les jours en présence de nouveaux ouvrages dont les auteurs l’éblouissent parfois, « surtout ce grand nigaud de Voltaire, que Royou traite en petit garçon ; et que je trouvais, dit-il, inimitable et si élevé au-dessus de ma sphère, qu’il étouffait en moi jusqu’à la velléité d’écrire. » Il finit cependant par en rencontrer qui lui semblent moins difficiles à égaler. Mme Riccoboni est encore d’une élégance trop soutenue, mais Mme Benoît, de Lyon !… C’est devant l’Élisabeth de cette muse de province qu’il se frappe le front et se dit : « Mais j’écrirais bien aussi un roman ! » Qu’il y a de modestie dans cet aveu ! Notre romancier qui va faire tant de tapage n’entre pas dans la carrière avec la haute ambition d’égaler les plus grands, il se fait humble, il descend jusqu’à Mme Benoît ! Il n’a point eu de peine à valoir mieux que son modèle. C’est que s’il n’avait pas l’habileté de main et de facture, il avait au moins quelque chose à dire.
Mais quoi ? Il se figure d’abord que le roman est œuvre d’invention. Il cherche, il veut créer, il se perd. C’est alors qu’il s’examine, qu’il regarde autour de lui et qu’il fait cette nouvelle découverte : le roman doit sortir de la vie réelle ; il a besoin d’avoir pour bases des faits vrais. Sur le vrai seul l’auteur peut échauffer sa verve. Et il prend ces faits dans sa propre vie, dans celle de ses amis, de ses voisins, partout où il les trouve. Et il écrit quatre volumes, pour débuter, sous ce titre : La Famille vertueuse.
Nous entrerons, lors de notre prochain volume, dans l’examen des progrès de l’idée et du talent chez Restif. Dans celui-ci nous devons nous borner à l’exposé des faits de sa vie et nous ne nous attarderons pas aux réflexions. Pour son premier livre, Restif avait cru avoir besoin d’un conseil. Cet « Aristarq » fut Nougaret, tout jeune alors, débutant aussi, et que son élève finit bientôt par mépriser, non seulement à cause de sa médiocrité, mais surtout à cause de ses mœurs ! Restif, si peu retenu qu’il fût, ne comprenait pas le dévergondage à froid et il s’est toujours excusé de ses plus grands écarts sur la passion, la fièvre qui les lui faisait commettre quand sa raison les condamnait. Les relations littéraires durèrent donc peu, mais il y eut des relations personnelles à la suite desquelles Restif se crut autorisé à placer, partout où il en trouvait l’occasion, dans les notes de ses livres, dans les appendices aux Contemporaines, les plus virulentes injures contre ce Mamonet, ce Gronavet, ce Regret, ce Negret, ce Progrès, qu’il accusait de toutes les bassesses et de tous les vices.
Le censeur de la Famille vertueuse fut un certain M. Albaret qui n’aimait pas la métaphysique. Par dégoût des romans philosophiques de l’époque il trouva que celui de Restif avait « le double mérite d’intéresser et de remplir son titre. » « Cette approbation, dit Restif, m’éleva l’âme. » Il voulut alors dédier son œuvre à Mlle Rose Bourgeois, mais le père, qui était décidément un homme sage, lui écrivit de n’en rien faire. La veuve Duchesne paya cet essai 15 livres la feuille ; Restif en dirigea l’impression comme prote et correcteur chez Quillau, et il profita de l’occasion pour essayer sa réforme orthographique qui ne fut point appréciée et repoussa même, à ce qu’il crut, les chalands.
Après ce premier demi-succès, Restif quitta sa proterie chez Quillau et s’en fut faire un tour à Sacy pour se montrer dans son nouvel éclat d’auteur imprimé. Il n’y resta que le temps de voir sa famille et n’en rapporta qu’un sujet de roman fourni par son frère l’abbé Thomas : Lucile, qu’il écrivit à son retour en cinq jours et qu’il vendit trois louis. La Confidence nécessaire, d’abord refusée par un premier censeur, puis par un second, fut enfin acceptée par un troisième « qui était fou le matin, et ivre l’après-midi » et auquel Restif ne reproche ce trait de caractère que parce qu’il pense pouvoir l’accuser justement d’avoir empêché Mlle Hus d’accepter la dédicace qu’il lui voulait offrir « en reconnaissance du plaisir que sa beauté lui avait donné sur le théâtre. »
Tout cela ne soutenait guère une maison que le petit commerce de mousseline de la femme n’enrichissait pas. D’ailleurs les époux étaient plus souvent séparés qu’unis. Le libraire Rapenot logeait Restif au collège de Presles et lui donnait six livres par semaine. Sur ces six livres il y avait 4 livres 10 sous pour la pension, il restait 30 sous. « Je payais une bouteille à 10 à notre dîner le dimanche, il me restait 20 sous : 3 sous pour une chemise, 1 sou pour un col, il me restait 16 sous ; j’en dépensais encore 4 et j’en épargnais 12 par semaine, pour le besoin, ou pour aller quelquefois au spectacle. » On voit que les maîtresses qui lui prenaient encore des « demi-journées, » ne l’aimaient pas du moins par intérêt.
Mais vient la Fille naturelle, mais vient le Pornographe. Les difficultés avec la censure sont toujours vives, mais toujours surmontées. M. de Sartines lui-même lève l’interdit mis sur le dernier ouvrage, les censeurs Crébillon fils et Collé approuvent le Pied de Fanchette et le Ménage parisien, et suggèrent même quelques corrections à l’auteur. Crébillon en dit du bien à ses amis. Les presses gémissent sans relâche sous cette production emportée jusqu’au moment où paraît le Paysan perverti.
Pour le coup ce fut un éclat. Un magistrat, M. d’Eprémesnil alla jusqu’à croire que le Paysan était de Diderot. Restif ne se vante pas assez de cette méprise. S’il avait pu comprendre la distance qui le sépare du philosophe et combien les déclamations de son matérialiste Gaudet d’Arras sont éloignées des déductions serrées et logiques de l’Encyclopédie où il puisait une partie de son savoir, il ne se serait pas borné à mentionner ce fait sèchement et comme en l’air. Peut-être d’ailleurs se croyait-il supérieur à celui avec lequel on le confondait et s’est-il dit : Est-ce que Diderot aurait pu faire le Paysan ?
Ce succès indéniable, puisque le roman tiré à 3, 000 exemplaires eut plusieurs éditions, fut souvent contrefait, fut traduit en allemand, où il eut quatre éditions, et en anglais où il en eut quarante-deux, mit Restif en lumière. Cet autre esprit vigoureux et chercheur, qu’on oublie trop, Mercier, s’enthousiasma pour le nouveau venu : la liaison avec M. Bultel Dumont, trésorier de France, devint plus intime ; les Contemporaines augmentèrent encore la renommée et les relations de l’auteur qui en vint à posséder une petite fortune. S’il rencontrait toujours de bonnes filles, ou d’éveillées marchandes ; si les actrices de l’Opéra-Comique ou d’habiles intrigantes, comme Sara Debée, qu’il crut être la Dernière aventure d’un homme de quarante-cinq ans, lui donnaient sans cesse des distractions, il reconnaît cependant qu’il en était arrivé à « l’âge où on ne se soucie plus tant d’être aimé, » et il se contentait d’aimer pour le seul plaisir de suivre sa vocation. Ce fut à ce moment qu’il eut quelques grandes dames, mais avec elles il est gêné, il est platonique et le plus souvent il ne les désigne que sous des noms supposés dont nous ne devons pas chercher à soulever le voile.
La haute société devenue curieuse, mais sentant bien qu’il y avait entre l’ouvrier parvenu et elle des obstacles difficiles à détruire, s’entendait à les tourner.
Un jour de novembre 1789, dit M. Monselet, il reçut une invitation à dîner de M. Senac de Meilhan, intendant à Valenciennes, avec lequel il avait eu quelques relations d’affaires dans le temps. C’était un homme fort aimable, occupé lui-même de littérature et de poésie légère. Restif, cédant sans doute à ces considérations, se rendit chez lui, rue Bergère, à l’issue de l’Assemblée nationale. Il pouvait être trois heures. On attendait encore deux dames et plusieurs messieurs. À quatre heures et demie, tout le monde étant arrivé, on se mit à table. Restif fut placé entre une sorte d’amazone aux mouvements mâles, à la voix haute au regard assuré, qu’on lui dit être une madame Denis, marchande de mousseline rayée, et une autre dame plus timide ou plus fière, à qui l’on ne donna point de qualité. Les autres convives étaient un petit homme, propret, en surtout de laine blanche, un beau garçon de vingt à vingt-cinq ans, à physionomie ouverte, un quatrième un peu boiteux et deux autres qu’il ne remarqua pas. On causa politique. La marchande de mousseline rayée demanda à plusieurs reprises : Que dit le peuple ? Elle fit beaucoup d’amitiés à Restif et lui demanda la permission d’aller le voir, ce qu’il n’eut garde de refuser. Bref, le repas fut des plus animés. Restif, d’ordinaire renfrogné et taciturne, devint fort éloquent dès qu’on le mit sur le chapitre de ses ouvrages. Il charma tout le monde par le feu et l’abondance de son élocution, surtout madame Denis, surtout l’homme à la physionomie ouverte.
Le lendemain voici le billet qui lui fut remis de la part de M. de Meilhan : « Madame Denis, marchande de mousseline rayée, est la duchesse de Luynes ; l’autre dame, la comtesse de Laval ; le beau-fils qui se faisait nommer Nicodème, Mathieu de Montmorency ; l’homme un peu âcre, un peu boiteux, l’évêque d’Autun ; l’homme au surtout blanc, Sieyès. C’est pour vous que cette compagnie est venue. On m’avait chargé de vous inviter ».
Cette aventure se répéta plusieurs fois, entre autres chez le duc de Mailly, chez le comte de Gémonville. Restif était d’ailleurs un habitué des dîners que donnait Grimod de la Reynière, où il se rencontrait avec Pons, Duchosal, Viguier, Chénier, les frères Trudaine, Fortia de Piles, Larive, Saint-Prix, et Monsieur Nicolas contient le récit de l’un de ces dîners qui ne fut pas le moins excentrique. Il comptait ou avait compté en 1789 parmi ses amis, outre Mercier qui l’avait en grande estime, Crébillon fils, Collé, le docteur Guillebert de Préval, Pidansat de Mairobert, Beaumarchais qui avait voulu le mettre à la tête de son imprimerie de Kehl, le vicomte de Toustain-Richebourg, Lepelletier de Mortfontaine, intendant de Soissons, chez lequel il s’était rencontré avec la « belle marquise de Montalembert, » Speranzac, Fontanes, avec lequel il eut quelques démêlés, mais qui fut un de ceux qui l’accompagnèrent au cimetière Sainte-Catherine (Montparnasse). La comtesse Fanny de Beauharnais fut une de ses dernières inspiratrices en même temps que sa plus constante bienfaitrice. Il y a place dans cet autre livre étrange : les Nuits de Paris, pour mesdames de Marigny, de Valimbert, pour le comte de Clermont-Tonnerre. Il avait donc fini par se désencanailler, et lorsqu’arriva la Révolution, après trente ans d’une vie un peu décousue, mais qui, en somme, ressemble à celle de beaucoup de jeunes gens, après trente autres années d’un travail acharné, il avait amassé assez d’argent pour rappeler fièrement aux libraires ce qu’ils lui devaient, et assez de considération pour ne se croire pas indigne d’entrer à l’Institut lorsque la Convention l’organisa en 1795.
Pendant ces mêmes années de travail, il avait marié ses deux filles. La première fut malheureuse, et il a peint d’une façon trop crue les détails de ses malheurs et les torts de son gendre, qu’il désigne souvent sous le nom de l’Échiné, dans Ingénue Saxancour. La seconde devint promptement veuve. Il vivait séparé de sa femme en attendant que le rétablissement du divorce permît à celle-ci de le réclamer en sa faveur, il n’avait plus, comme il dit, que quelques « aventurettes » lorsque les évènements politiques vinrent le surprendre et que deux banqueroutes successives lui enlevèrent le peu qu’il possédait.
Ce fut un coup terrible, mais qui ne l’abattit pas. Il reprit le composteur, en même temps qu’il reprenait la plume. À ce moment, il n’a plus le temps, qu’il n’a jamais beaucoup pris, du reste, de réfléchir, et souvent il compose à la casse, sans copie, pour aller plus vite. Il publie son Théâtre (3 volumes, 17 pièces) la Semaine nocturne, supplément aux Nuits de Paris, le Palais-Royal (2 volumes), l’Année des Dames nationales, douze volumes, où il jette pêle-mêle ses propres aventures et des renseignements souvent précieux sur la Révolution. Cet ouvrage le conduit jusqu’en 1794, moment cruel, où sentant la fin venir, l’inspiration manquer, il se replie sur lui-même et, comme un grand poète, notre contemporain, essaie de battre monnaie avec ses sentiments intimes, avec les secrets qu’il avait bien déjà fait pressentir, mais qu’il avait toujours déguisés, avec sa vie et celle des autres écrites, comme il dit, « cyniquement, pour dépolitiquer un peu la nation, comme d’autres l’ont dépantinée et déballonnée. »
Restif qui soignait tant l’illustration de ses livres ne put donner que le sujet des planches qui devaient accompagner ses seize nouveaux volumes. Est-ce à cause de cela que l’effet de Monsieur Nicolas fut nul, en France ? Il n’en fut pas tout à fait ainsi à l’étranger. Il nous en est revenu un écho, et si la qualité des lecteurs peut suppléer quelquefois à la quantité, c’est dans ce cas ou jamais qu’il est permis de le croire.
Voici, en effet, ce que Schiller écrivait à Goethe, le 2 janvier 1798 :
« Avez-vous lu par hasard le singulier ouvrage de Restif : le Cœur humain dévoilé ? En avez-vous du moins entendu parler ? Je viens de lire tout ce qui en a paru, et, malgré les platitudes et les choses révoltantes que contient ce livre, il m’a beaucoup amusé. Je n’ai jamais rencontré une nature aussi violemment sensuelle ; il est impossible de ne pas s’intéresser à la quantité de personnages, de femmes surtout, qu’on voit passer sous ses yeux et à ces nombreux tableaux caractéristiques qui peignent d’une manière si vivante les mœurs et les allures des Français. J’ai si rarement l’occasion de penser quelque chose en dehors de moi et d’étudier les hommes dans la vie réelle, qu’un pareil livre me paraît inappréciable. »
On voit par là que le « citoyen Gille, » comme l’appelait la Convention, jugeait Restif comme nous désirerions qu’il fût jugé par tout le monde. Il trouvait chez lui deux choses essentielles et qui éclipsent toutes les autres : une individualité nette, tranchée ; un peintre exact et coloré.
Restif traversa la Révolution sans s’y mêler autrement que comme spectateur. Il nous a conservé une longue et curieuse conversation de Mirabeau, il nous a dépeint dans la Semaine nocturne les effrois des rues de Paris pendant cette période agitée. Il a vu passer, et il les a croquées au passage, les figures de presque toutes les femmes qui ont joué un rôle ; « Mariannecharlotte-Cordai, la Vierge Renaud, la Genlis, la Teroueigne, la Rivarole, la Momoro, la femme Danton, la femme Hebert, la jeune Duplessis, femme de Camille Desmoulins, etc. » Il continuait ses promenades nocturnes qui furent parfois dangereuses et qui le firent arrêter dans une ou deux occasions. La seule fois où il courut quelque danger, ce fut quand, sur la dénonciation de son gendre, Augé, on l’accusa d’être l’auteur de trois libelles : Moyens sûrs à employer par les deux ordres pour dompter et subjuguer le tiers état. – Domine salvum fac regem. – Dom B… aux États-Généraux. Arrêté le 28 octobre 1789 à 10 h. 1/2 du soir, il fut traduit devant la commission du district de Saint Louis la Culture. Il nia, il n’était d’ailleurs pas coupable et au sujet de Dom B…, il répondit :
« Nous ne sommes pas l’auteur de cette production dont nous n’avons lu qu’un passage où nous sommes cités comme auteur du Pornographe ; nous savons qu’on en connaît l’auteur, l’éditeur et le libraire. Il est bien gauche autant qu’atroce d’accuser son beau-père de ce qui n’existe pas ou de ce qui est connu pour être d’un autre, mais cette scélératesse a été commise à deux, par un colporteur, ancien domestique infidèle, chassé de chez un auteur et de chez un libraire, lequel l’a soufflée à Augé et à son partenaire. »
La dénonciation attribuait l’impression de cette dernière brochure à Maradan ; Restif fit observer que Maradan était en effet son libraire ordinaire, mais qu’il n’était pas imprimeur. Il déclara en outre qu’on pouvait faire des recherches chez lui et qu’il était prêt à montrer tous ses papiers. L’affaire en resta là.
Quant à ce que disent les Biographies, générales ou autres, pour lesquelles Restif est un homme capable de tous les crimes et digne de tous les mépris, sur les avanies que lui fit la foule, sur l’assassinat de sa femme par son gendre, sur ses relations avec la police qui autorisait ses ouvrages – on ne voit pas trop dans quel intérêt – il faut considérer tout cela comme fables. Si Restif avait voulu demander du pain à quelque métier déshonorant, il n’eût pas sans doute été obligé de travailler manuellement, malgré les infirmités que l’âge avait amenées avec lui ; il n’eût pas obtenu en 1795 un secours de 2, 000 francs sur la somme allouée par le Gouvernement aux hommes de lettres dans le besoin ; il n’eût pas été obligé de tenter une dernière partie, en publiant ce livre à peu près insensé, qui s’appelle les Posthumes, et à la fin duquel il dépeint ainsi sa triste situation :
« Que le lecteur sensible se représente un vieillard de 68 ans commencés, qui a tant travaillé pour l’utilité publique : utilité plus grande que celle de beaucoup d’autres ouvrages dont les auteurs se croient de grands hommes, pour avoir établi la distinction d’une ligne droite à une ligne courbe… Pour moi, je ne me suis jamais occupé qu’à indiquer à mes semblables, différentes routes de bonheur, surtout dans l’état du mariage qui est le plus ordinaire et celui de tous les hommes. Dans les Contemporaines j’ai tracé 272 de ces routes, 34 dans les Françaises, 45 dans les Parisiennes, 610 dans les Provinciales, plus de 60 dans le Palais royal, plus de 80 dans l’Enclos et les oiseaux. Voilà des productions véritablement utiles. Je ne parle pas de la Vie de mon père, du Paysan et de sa sœur pervertis, du Nouvel Abeilard et de tant d’autres ouvrages. Ils m’avaient procuré un avoir de 74 mille francs qui ont été engloutis par les assignats. Ainsi ont disparu l’espoir et la dernière ressource de ma vieillesse : Car que ferais-je, à 68 ans ?
L’homme qui vient de s’épuiser pour imprimer cet ouvrage n’a que son prompt débit pour tout moyen de subsister, avec 3 orfelins en bas âge. Miseremini mei, miseremini mei, saltem vos, amici mei, (vous dirait Job). Aidez-moi du moins à imprimer 4 ou 5 ouvrages mss, dont j’hypothéquerais sur la première rentrée pour les frais. Ô Corbeau !… Suisse respectable, viens à mon secours, s’il est possible ! Jamais on en eût autant de besoin. »
Cet appel désespéré joint à quelques mots dans la Préface en l’honneur du « magnanime général Buonaparte, ce sauveur de la nation française » et à l’entremise de Fontanes et de M. Le Comte, lui valurent au moment même où les Posthumes étaient saisies, une place au ministère de la police générale. Cette place est la cause probable des accusations portées contre lui, mais il ne put la remplir, il donna presque immédiatement sa démission, et en 1806 il mourait dans sa maison de la rue de la Bucherie, près de ses deux filles Anne et Marion Restif, laissant à celles-ci des ballots de papiers imprimés et manuscrits, dont elles ne purent tirer qu’un médiocre parti, et en même temps le soin de le défendre contre les attaques auxquelles il s’attendait de la part de ses ennemis littéraires, car il n’en eut pas d’autres.
M. Monselet a retrouvé et publié une lettre que les deux sœurs écrivirent quelques jours après cette mort en réponse aux rédacteurs du Journal de Paris où avait paru un article malveillant et anonyme.
« Messieurs,
La lecture de votre article sur notre père, M. Restif de la Bretonne, nous fait sortir de l’état d’accablement où nous a jetées le sentiment de sa perte pour rétablir quelques vérités.
Plus instruites que vous, à cet égard, nous ne devons pas souffrir que le public qui fut toujours le confident de notre père, que ce public impartial qui a tant de fois daigné l’accueillir, soit abusé sur le compte de l’ami de la vérité.
Notre respectable père a terminé sa vie à 72 ans, le 8 février, à midi, entouré de sa maison, composée de ses enfants, de sa domestique et de sa garde, sans souffrances, sans crainte. En le disant mort à 68 ans, vous avez sans doute daté de l’époque où il est devenu infirme.
Jamais il n’a manqué d’un honnête nécessaire : ses enfants et petits-enfants, ses sœurs, ses amis et même ses voisins ne l’auraient pas souffert. Son infortune venait de malheurs et non d’un manque de conduite ; quel homme fut plus que lui laborieux et infatigable ? Certes, il ne pouvait être dans l’aisance, après avoir essuyé des banqueroutes et des remboursements en mandats ; mais sa position, pour avoir été difficile, n’a point été humiliante. Le gouvernement d’un Empereur aussi humain que grand pourvoit à tout avec dignité.
Si cet hommage public, que nous devons à la mémoire du plus digne des pères, est accueilli de vous, messieurs, notre reconnaissance égalera la considération distinguée avec laquelle nous avons l’honneur d’être vos très humbles servantes.
A. RESTIF, femme VIGNON.
M. Vve RESTIF D’ANNAY. »
Une telle lettre prouve au moins que les causes des dissentiments de Restif avec sa femme, n’avaient pas été toutes mises à son compte par sa famille. Nous avons retrouvé de notre côté une autre lettre de Marion Restif seule à l’occasion de la publication par Dorat-Cubières-Palmezeaux de l’Histoire des compagnes de Maria ou Épisodes d’une jolie femme, œuvre posthume de Restif accompagnée d’une notice de la façon de l’éditeur. C’est dans cette notice que se trouve la lettre d’Anne Lebègue que nous avons reproduite plus haut et qui est datée de 1806. Anne Lebègue était morte peu de temps après, et Cubières, dans son travail biographique, l’avait un peu trop louée aux dépens de son mari. Marion Restif écrivit alors au Journal de l’Empire qui avait donné, le 1er février 1811, un article sur le livre de Restif et sur Cubières, article où l’on s’égayait beaucoup sur le compte de ce dernier, la lettre suivante :
« Quelque peine que j’éprouve à rappeler les malheurs de Restif de la Bretonne, mon père, je ne puis m’empêcher d’adresser hautement de vifs reproches à M. Cubières de Palmezeaux dont le ridicule ouvrage a été l’occasion d’articles affligeants pour une famille infortunée.
J’ai d’autant plus à me plaindre de M. de Palmezeaux que l’ayant fait prier par M. Mercier de ne rien publier sur mon père, il n’a eu aucun égard à ma juste demande. Il n’a pas voulu non plus se rendre aux sollicitations que je lui ai fait faire par M. Guillaume de supprimer un écrit qu’il a mis en tête de sa notice et dans lequel, à travers des louanges outrées qu’il prodigue à mon père, il ose se servir de mon nom pour donner crédit à de scandaleuses injures dont tout le monde est révolté. Ma mère du fond de son tombeau rejette avec indignation un éloge tel que celui de M. Cubières de Palmezeaux et lui dit par la voix de la plus faible des mortelles qu’il sera toujours le maître de faire de l’esprit tant qu’il voudra, pourvu que ce ne soit pas aux dépens de la tranquillité et du bonheur des familles.
M. RESTIF de la Bretonne. »
C’est dans la notice dont il est ici question que Cubières donne ce portrait physique de Restif :
« La taille de Restif de la Bretonne était moyenne, c’est-à-dire d’environ cinq pieds deux pouces ; il avait le front large et découvert, de grands yeux noirs qui lançaient le feu du génie, le nez aquilin, la bouche petite, les sourcils très noirs, qui, dans sa vieillesse descendant sur ses paupières, formaient un mélange singulier qui rappelait à la fois l’aigle et le hibou. Je l’ai vu, dans les jours d’été, travaillant à une imprimerie avec l’habit d’ouvrier et par conséquent la poitrine découverte, velue comme celle d’un ours. Il n’y avait pas dans sa jeunesse un homme plus robuste que lui l’ensemble de sa figure était admirable. Une dame fort honnête le voyant pour la première fois dans sa vieillesse s’écria : – Oh ! la belle tête ! et lui demanda la permission de l’embrasser. Restif ne se fit pas demander cette permission une seconde fois. »
Ce portrait peut passer pour exact. Il se rapporte à celui qu’a fait de Restif son dessinateur habituel, Binet ; il est surtout des plus ressemblants quand on le lit en regard de la petite figure en pied drapée dans un manteau et coiffée d’un chapeau à larges bords surmonté d’un hibou, qui est placée en tête des Nuits de Paris. Cette figure a été dessinée par Gaucher et se trouve au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque nationale dans l’œuvre de cet artiste. On la retrouve sous différents costumes dans toutes les gravures de cet ouvrage et dans plusieurs de celles qui illustrent les autres livres de l’auteur.
Telle fut la vie de cet écrivain qui inaugura chez nous une époque littéraire toute nouvelle. Cette vie, telle que nous l’avons esquissée à grands traits, est instructive. L’homme était né avec des passions vives. Il a pu, pendant une assez longue jeunesse, – longue parce qu’elle avait été précoce, – se laisser entraîner à des excès de libertinage condamnables. Mais son plus grand tort a été surtout de n’avoir rien oublié de cette exubérante floraison de ses passions et d’avoir voulu en montrer la gerbe à tout le monde. Bien différent en cela de J.-J. Rousseau, dans lequel on ne peut avoir aucune confiance, il n’a pas paré sa marchandise. Il l’a étalée sur le marché avec la plus naïve bonne foi. Ç’a été une raison pour les critiques majestueux et prud’hommes, de se voiler la face et de se frapper la poitrine. Mais dussions-nous passer pour trop faible et trop complaisant, nous croyons qu’on aurait mauvaise grâce à se plaindre de l’occasion que Restif nous a fournie de voir comme il le dit un « homme tout entier », un « cœur mis à nu ». À côté des gentillesses souvent scélérates des Mémoires de Casanova, à côté des amplifications rhétoriciennes de Desforges dans le Poète, et tout en abordant les mêmes sujets délicats, il doit être mis à part, en ce qu’il ne nous donne pas l’idée d’un homme vicieux. C’est comme Schiller l’a bien compris une nature violemment sensuelle, mais ses peintures ne sont pas licencieuses. Il ne s’y complaît pas, ne les excuse pas, et le plus souvent il se borne à relater les faits en latin ou en style de procès-verbal. Il est le seul de ceux qui se sont offerts à la curiosité du physiologiste, chez lequel on soit assuré de trouver l’homme intime, peint sans apprêt comme sans déguisement.
Celui-ci aurait pu finir érotomane dans une maison de fous, comme son contemporain le marquis de Sade, dont l’ouvrage l’avait tant bouleversé, qu’il avait essayé de le combattre avec ses propres armes. Il a été sauvé de cette extrémité par son perpétuel et exalté désir de servir l’humanité. S’il s’est trompé sur la voie réformatrice qu’il devait suivre, il n’en a pas moins été de bonne foi en s’y engageant. Cette bonne foi nous permet de n’être pas trop sévère sur les moyens qu’il a cru devoir employer. Un de ses triomphes, c’est l’essai que fit de son projet de règlement pour les prostituées, indiqué dans le Pornographe, l’empereur d’Autriche Joseph II. Un autre, comme nous le dirons prochainement, c’est d’avoir éveillé l’esprit d’amélioration sociale chez Fourier, chez Saint-Simon et chez plusieurs des utopistes du commencement du XIXe siècle. Que les puristes et les « préjugistes, » comme il les appelait, se plaignent de cette introduction de la fougue et des exagérations populaires dans la littérature, la philosophie et la politique françaises ; ce n’est pas à nous fils du dix-huitième siècle à nous en offenser. Quoique Restif n’ait pas eu personnellement à se louer de la Révolution, il avait contribué à la préparer au moyen de ses écrits destinés aux classes les plus inférieures, surtout aux femmes dont l’influence est si grande dans ces moments de trouble et de rénovation sociale, et au début du mouvement, il avait raison de réclamer la part qu’il y avait prise.
Mais nous nous laissons entraîner et c’est l’écrivain, plus que l’homme, que nous jugeons en ce moment. Cette tâche est réservée à la seconde partie de notre étude. Nous nous arrêterons donc ici.
Le seul tableau par lequel nous voulions terminer cette courte esquisse, c’est celui du pauvre vieillard, ayant conservé jusqu’à ses derniers jours le culte de ses premières et pures amours ; se promenant sur les berges de la Seine, relisant les inscriptions qu’il avait tracées à diverses reprises sur le parapet des quais pour se rappeler certains moments fortunés de son existence ; suivant des yeux l’inconstante Sara venant effacer celles de ces dates qui la concernaient ; remontant par ses souvenirs vers ses belles années ; choisissant parmi les noms de son Calendrier ceux qui lui semblaient les plus dignes ; bâtissant avec eux sur de nouvelles bases ces édifices de bonheur possible qu’il appelle ses Revies ; pleurant madame Parangon, désirant toujours revoir la bonne Jeannette Rousseau, et, pensant parfois à cette Colombe d’Auxerre qu’il avait failli épouser, pour dire aux flots passants : « Ô fleuve qui viens de baigner le pied de la maison de celle que j’ai tant aimée, dis-moi si elle est heureuse ! »
Ce tableau, c’est l’homme, tel qu’il fut toujours, enthousiaste de la femme. Il lui faut pardonner beaucoup parce qu’il a beaucoup aimé. Ne sait-on pas que les grands amoureux sont les grandes dupes et par suite les vrais malheureux ?
J. ASSÉZAT
1er janvier