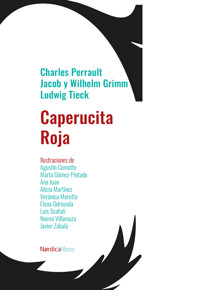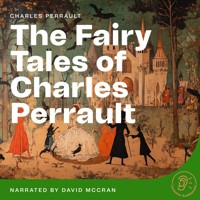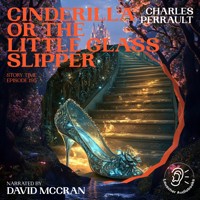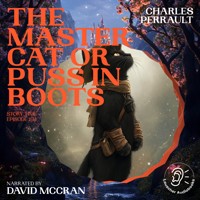Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
RÉSUMÉ : "Les Contes" de Charles Perrault est une collection intemporelle de récits qui ont façonné l'imaginaire collectif depuis des siècles. Ce recueil regroupe des histoires célèbres telles que "Cendrillon", "Le Petit Chaperon rouge", "La Belle au bois dormant" et "Le Petit Poucet". Chacune de ces fables, à la fois captivante et éducative, distille des leçons de morale tout en transportant le lecteur dans un univers enchanté. Les contes de Perrault sont empreints de magie, de mystère et de sagesse populaire, et ils continuent d'inspirer des générations de lecteurs. L'auteur utilise un langage simple mais poétique, rendant ses histoires accessibles à tous, tout en offrant une profondeur d'interprétation pour les lecteurs plus avertis. Les personnages, souvent confrontés à des épreuves, incarnent des valeurs universelles telles que la bonté, le courage et la ruse. En revisitant ces contes, on découvre des nuances et des symboles qui révèlent la richesse culturelle et historique de l'époque de Perrault, tout en restant d'une étonnante modernité. "Les Contes" est une oeuvre incontournable qui invite à la rêverie et à la réflexion, tout en célébrant le pouvoir intemporel de la narration. L'AUTEUR : Charles Perrault, né le 12 janvier 1628 à Paris, est une figure emblématique de la littérature française du XVIIe siècle. Issu d'une famille bourgeoise, il étudie le droit avant de se tourner vers la poésie et les lettres. Sa carrière prend un tournant décisif lorsqu'il rejoint l'Académie française en 1671, contribuant activement aux débats littéraires de l'époque. Perrault est surtout connu pour avoir popularisé le genre du conte de fées, bien qu'il ait également écrit des oeuvres poétiques et des essais. En 1697, il publie "Histoires ou contes du temps passé", une collection de récits qui immortalise son nom. Ces contes, inspirés par les traditions orales et les récits populaires, sont rédigés dans un style élégant et accessible. Ils sont souvent accompagnés de morales explicites, reflétant les valeurs et les préoccupations de son temps. Bien que Perrault ait d'abord publié ses contes sous le nom de son fils, Pierre, il finit par être reconnu comme leur véritable auteur. Son oeuvre a eu une influence durable sur la littérature mondiale, inspirant de nombreux écrivains et artistes. Charles Perrault décède le 16 mai 1703, laissant derrière lui un héritage littéraire qui continue de fasciner et d'inspirer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 140
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
Sur les contes de fées
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Le petit Chaperon rouge
Le petit Poucet
La belle au bois dormant
Cendrillon ou la petite pantoufle de vair
Le maître Chat ou le Chat botté
Riquet à la houppe
Peau-d’Âne
Les fées
La Barbe-Bleue
Sur les contes de fées
I
Qu’on me permette, à propos de contes, de raconter ici une petite histoire.
Mon ami Jacques entra un jour chez un boulanger pour y acheter un tout petit pain qui lui avait fait envie en passant. Il destinait ce pain à un enfant qui avait perdu l’appétit et qu’on ne parvenait à faire manger un peu qu’en l’amusant. Il lui avait paru qu’un pain si joli devait tenter même un malade.
Pendant qu’il attendait sa monnaie, un petit garçon de six ou huit ans, pauvrement, mais proprement vêtu, entra dans la boutique du boulanger.
« Madame, dit-il à la boulangère, maman m’envoie chercher un pain… »
La boulangère monta sur son comptoir (ceci se passait dans une ville de province), tira de la case aux miches de quatre livres le plus beau pain qu’elle y put trouver, et le mit dans les bras du petit garçon.
Mon ami Jacques remarqua alors la figure amaigrie et comme pensive du petit acheteur. Elle faisait contraste avec la mine ouverte et rebondie du gros pain dont il semblait avoir toute sa charge.
« As-tu de l’argent ? » dit la boulangère à l’enfant.
Les yeux du petit garçon s’attristèrent.
« Non, madame, répondit-il en serrant plus fort sa miche contre sa blouse, mais maman m’a dit qu’elle viendrait vous parler demain.
– Allons, dit la bonne boulangère, emporte ton pain, mon enfant.
– Merci, madame, » dit le pauvret.
Mon ami Jacques venait de recevoir sa monnaie. Il avait mis son emplette dans sa poche et s’apprêtait à sortir, quand il retrouva immobile derrière lui l’enfant au gros pain qu’il croyait déjà bien loin.
« Qu’est-ce que tu fais donc là ? dit la boulangère au petit garçon qu’elle aussi avait cru parti. Est-ce que tu n’es pas content de ton pain ?
– Oh ! si, madame, dit le petit.
– Eh bien ! alors, va le porter à ta maman, mon ami. Si tu tardes, elle croira que tu t’es amusé en route, et tu seras grondé. »
L’enfant ne parut pas avoir entendu. Quelque chose semblait attirer ailleurs toute son attention. La boulangère s’approcha de lui, et lui donnant amicalement une tape sur la joue :
« À quoi penses-tu, au lieu de te dépêcher ? lui dit-elle.
– Madame, dit le petit garçon, qu’est-ce qui chante donc ici ?
– On ne chante pas, répondit la boulangère.
– Si, dit le petit. Entendez-vous : « Cuic, cuic, cuic, cuic ? »
La boulangère et mon ami Jacques prêtèrent l’oreille, et ils n’entendirent rien, si ce n’est le refrain de quelques grillons, hôtes ordinaires des maisons où il y a des boulangers.
« C’est-il un petit oiseau, dit le petit bonhomme, ou bien le pain qui chante en cuisant, comme les pommes ?
– Mais non, petit nigaud, lui dit la boulangère, ce sont les grillons. Ils chantent dans le fournil, parce qu’on vient d’allumer le four et que la vue de la flamme les réjouit.
– Les grillons ! dit le petit garçon ; c’est-il ça qu’on appelle aussi des cricris ?
– Oui, » lui répondit complaisamment la boulangère.
Le visage du petit garçon s’anima.
« Madame, dit-il en rougissant de la hardiesse de sa demande, je serais bien content si vous vouliez me donner un cri-cri…
– Un cri-cri ! dit la boulangère en riant ; qu’est-ce que tu veux faire d’un cri-cri, mon cher petit ? Va, si je pouvais te donner tous ceux qui courent dans la maison, ce serait bientôt fait.
– Oh ! madame, donnez-m’en un, rien qu’un seul, si vous voulez ! dit l’enfant en joignant ses petites mains pâles par-dessus son gros pain. On m’a dit que les cri-cris, ça portait bonheur aux maisons ; et peut-être que s’il y en avait un chez nous, maman, qui a tant de chagrin, ne pleurerait plus jamais. »
Mon ami Jacques regarda la boulangère. C’était une belle femme, aux joues fraîches. Elle s’essuyait les yeux avec le revers de son tablier. Si mon ami Jacques avait eu un tablier, il en aurait bien fait autant.
« Et pourquoi pleure-t-elle, ta pauvre maman ? dit mon ami Jacques, qui ne put se retenir davantage de se mêler à la conversation.
– À cause des notes, monsieur, dit le petit. Mon papa est mort, et maman a beau travailler, nous ne pouvons pas toutes les payer. »
Mon ami Jacques prit l’enfant, et avec l’enfant le pain, dans ses bras ; et je crois qu’il les embrassa tous les deux.
Cependant la boulangère, qui n’osait pas toucher elle-même les grillons, était descendue dans son fournil. Elle en fit attraper quatre par son mari, qui les mit dans une boîte avec des trous sur le couvercle, pour qu’ils pussent respirer ; puis elle donna la boîte au petit garçon, qui s’en alla tout joyeux.
Quand il fut parti, la boulangère et mon ami Jacques se donnèrent une bonne poignée de main.
« Pauvre bon petit ! » dirent-ils ensemble.
La boulangère prit alors son livre de compte ; elle l’ouvrit à la page où était celui de la maman du petit garçon, fit une grande barre sur cette page, parce que le compte était long, et écrivit au bas : payé.
Pendant ce temps-là mon ami Jacques, pour ne pas perdre son temps, avait mis dans un papier tout l’argent de ses poches, où heureusement il s’en trouvait beaucoup ce jour-là, et avait prié la boulangère de l’envoyer bien vite à la maman de l’enfant aux cri-cris, avec sa note acquittée et un billet où on lui disait qu’elle avait un enfant qui ferait un jour sa joie et sa consolation. On donna le tout à un garçon boulanger, qui avait de grandes jambes, en lui recommandant d’aller vite. L’enfant avec son gros pain, ses quatre grillons et ses petites jambes, n’alla pas si vite que le garçon boulanger ; de façon que quand il rentra, il trouva sa maman, les yeux, pour la première fois depuis bien longtemps, levés de dessus son ouvrage et un sourire de joie et de repos sur les lèvres.
Il crut que c’était l’arrivée de ses quatre petites bêtes noires qui avait fait ce miracle, et mon avis est qu’il n’eut pas tort. Est-ce que sans les cri-cris et son bon cœur cet heureux changement serait survenu dans l’humble fortune de sa mère ?
Pourquoi cette historiette en tête d’une préface aux contes de Perrault, me dira-t-on ? à quoi peut-elle servir ?
À répondre par un fait, si menu qu’il soit, à cette catégorie d’esprits trop positifs, qui prétendent aujourd’hui, au nom de la raison, bannir le merveilleux du répertoire de l’enfance.
Dans cette histoire, il n’y a pas ombre de fée ni d’enchanteur ; c’est une histoire vraie jusque dans ses détails, et si, dans sa vérité, elle a réussi à prouver que pour l’enfance l’illusion, grâce à Dieu, est partout et que pour elle le merveilleux se trouve jusque dans les réalités de la vie commune, elle est ici à sa place.
Cette innocente superstition aux êtres et aux choses qui portent bonheur, aux insectes, aux animaux, aux oiseaux de bon présage, cri-cris, hirondelles et autres, vous la trouverez en tous lieux et en tous pays. Vingt chefsd’œuvre, écrits dans toutes les langues, l’ont consacrée. Niera-t-on que ce ne soit de la féerie dans son genre ? Non sans doute. Le grillon de ma boulangère, le grillon du foyer, ce cri-cri protecteur et mystérieux, ce cricri Génie, je le tiens pour Fée. Faut-il pour cela le détruire, faut-il le tuer, faut-il l’écraser dans le cœur des simples et des enfants ? Mais quand cet aimable mensonge, l’ami de leur maison, n’y sera plus, qu’y aura gagné la maison, je vous prie ? Si le grillon est de trop, que d’illusions enfantines ou populaires, c’est tout un, il faudrait bannir de ce monde, depuis la foi au bonhomme Noël, descendant obligeamment tous les hivers, et à la même heure, par les tuyaux de toutes les cheminées, pour remplir de jouets les souliers et les sabots des enfants endormis, jusqu’à l’échange pieux ou naïf des gages de tendresse !
Vous êtes positif : pourquoi avez-vous une bague au doigt ? Pourquoi cachez-vous dans votre poitrine ce médaillon qui renferme… quoi ? un chiffre, une initiale, une date, une mèche de cheveux, une fleur, un brin d’herbe, un symbole, une relique, un talisman, une superstition aussi ? Si vous voulez être conséquent avec vous-même, laissez cela à d’autres.
Mais où s’arrêter alors ? En vérité, les gens qui ont peur du merveilleux doivent être dans un grand embarras ; car, enfin, du merveilleux la vie et les choses en sont pleines. Est-ce que tout ce qui est bon en ce monde ne tient pas du miracle par un côté, et de la superstition par un autre ? Est-ce qu’il faut les cacher aussi les prodiges de l’amour, de tous les beaux et nobles amours, qui tous ont leurs héros, leurs martyrs, et par suite leurs légendes, légendes vraies, et pourtant par leur héroïsme même fabuleuses ?
Vous voulez supprimer les Fées, cette première poésie du premier âge. Ce n’est pas assez : supprimez la poésie tout entière, supprimez la philosophie, supprimez jusqu’à la religion, jusqu’à l’histoire, jusqu’à la science ; car en vérité le merveilleux est autour, sinon au fond de tout cela. Perrault est de trop ! Mais alors Homère est de trop aussi ! Virgile, Dante, l’Arioste, le Tasse, Milton, Gœthe et cent autres, les livres profanes et les livres saints eux-mêmes, sont de trop ! Avec quoi, s’il vous plaît, les élèverez-vous donc, vos malheureux enfants ? Vous ne leur apprendrez ni le grec, ni le latin, ni l’allemand, ni l’anglais ; vous leur interdirez aussi les fables, car enfin dans Ésope, dans Phèdre, dans La Fontaine, dans Lessing, dans Florian, cet autre classique du jeune âge, on voit que les bêtes parlent ; et cela aussi peut paraître contre nature à des gens qui cependant ne devraient guère s’en étonner.
Rien, vous ne pourrez rien découvrir aux enfants, si vous prétendez leur cacher le merveilleux, l’inexpliqué, l’inexplicable, l’impossible qui se trouvent dans le vrai tout aussi bien que dans l’imaginaire. L’histoire est pleine d’invraisemblances ; la science, de prodiges ; la réalité abonde en miracles et ses miracles ne sont pas tous de choix, hélas ! Le réel est un abîme tout rempli d’inconnu ; demandez-le aux vrais savants. La science explique l’horloge ; elle n’est pas parvenue encore à expliquer l’horloger. L’échec de la raison est au bout, au sommet de tous les savoirs, et vous-même, homme positif, vous êtes un mystère.
Ah ! revenez, revenons aux contes des Fées pour les enfants, si, plus difficiles que La Fontaine, nous ne sommes pas assez bons pour y revenir pour nous-mêmes.
Si ces contes-là ne font pas de bien, ils ne font de mal à personne, du moins. Or c’est une qualité jusqu’à présent incontestée que l’innocence.
Une jeune mère de mes amies, imprudemment sermonnée par son mari, qui croyait, lui, aux féeries de la Bourse, à la pire des fées, la fée Hasard, la fée du Jeu, et qui cependant s’estimait un esprit fort, cette jeune mère, dis-je, avait résolu de donner à ses enfants ce que son mari appelait une éducation exclusivement sérieuse.
Dans une visite du jour de l’an que je lui fis, elle me montra les cadeaux que les grands-parents et les amis de la maison avaient envoyés à l’adresse de son petit garçon. Dans le nombre, il y avait un exemplaire des Contes des Fées de Perrault.
« Pour ceci, me dit-elle avec une certaine fatuité, je le mettrai dans mon armoire, et cela n’en sortira pas. »
J’allais plaider la cause de Perrault, quand survint un incident qui la plaida mieux que je n’aurais pu le faire, car il la gagna.
On entendit tout à coup un bruit sourd comme celui d’une chute que quelqu’un aurait faite dans la chambre voisine, puis des cris. La mère, attentive, avait reconnu tout de suite la voix de son enfant. Elle pâlit et se précipita vers la porte. L’enfant se débattait en criant : « Maman ! maman ! » dans les bras de sa bonne, qui déjà l’avait relevé et le ramenait avec une bosse au front et tout en pleurs, naturellement.
Le mal était petit, la bosse n’était pas grosse.
La mère, un peu rassurée, prit son fils sur ses genoux, baisa et rebaisa son front endolori, et lui dit :
« C’est fini ; le petit Jules n’a plus de bobo. »
Les larmes de l’enfant se séchèrent, et le sourire reparut sur sa bouche rose.
La bosse n’avait pas disparu, cependant il était guéri. Cette compresse merveilleuse de baisers maternels, ce remède féerique avait opéré subitement ; et quand il s’agit de compresses véritables et d’eau fraîche, le petit bonhomme ne voulut pas en entendre parler.
« Jujules est guéri, répétait-il dans sa foi ingénue, maman a ôté son bobo.
– Eh bien ! dis-je à la mère, enlevez donc la foi aux miracles de cette mignonne tête-là, et vous verrez si vous guérirez ses bosses en l’embrassant ? »
La confiance robuste de l’enfant dans la vertu souveraine des caresses maternelles, ce n’est pas du positif à coup sûr, c’est de l’illusion s’il en fut jamais, c’est la foi au baume des enchanteurs. Ah ! laissons à nos chers petits leur croyance en ces douces sorcelleries ! Est-il mauvais pour l’enfant, est-il mauvais pour l’homme lui-même de croire qu’un baiser guérit de tout, et est-ce faux d’ailleurs ? N’est-ce pas surtout ce qui console de la douleur qui guérit du mal ? La puissance de l’amour ne vaut-elle pas celle du médecin ou du philosophe à tous les âges de la vie ? Quand a-t-on plus besoin de se sentir aimé que lorsque l’âme et le corps sont en souffrance ?
On donna les Contes de Perrault au petit Jules ; il regarda les images ; il voulut savoir l’histoire de ces images ; on lui lut deux ou trois contes : il n’avait plus de bosse.
« Aimes-tu mieux ce livre-là qu’un cataplasme, lui dis-je ?
– Oui, » me répondit-il de son plus grand sérieux.
En vérité, n’est-il pas bien juste que pour l’enfant comme pour l’homme l’illusion précède de quelques moments la déception ?
Que si vous voulez être rassurés sur les prétendus ravages que peuvent faire dans l’imagination des enfants les féeries de Perrault, soyez tranquilles. L’enfant ne prend, n’absorbe dans ce genre que ce qui lui convient. Les petits hommes sont comme les grands : ils ne voient de chaque chose que tout juste ce qui leur en plaît, et se soucient peu du reste.
Je citerai, à l’appui de cette affirmation, une anecdote que j’ai racontée ailleurs, et que j’aurais dû n’écrire qu’aujourd’hui et pour cette préface seulement.
La galette du petit Chaperon rouge
J’avais en 184.. (ce n’est pas hier) accepté la mission épineuse d’amuser pendant une demi-heure une petite personne qui dès lors était assez difficile à fixer ; il s’agissait de détourner son attention, pendant cette longue suite de minutes, d’un événement important qui s’accomplissait dans la maison de ses parents et qu’on prétendait lui cacher.
Cette petite personne, âgée de quatre ans déjà, n’était pas de celles auxquelles on fait accroire aisément que des vessies sont des lanternes, et sa mine sérieuse et réfléchie disait assez que, toute fille d’Ève qu’elle était, les balivernes n’étaient pas de son goût.
Je résolus donc, pour accomplir mon mandat à la satisfaction de la famille qui m’avait fait l’honneur de me le confier, de raconter quelque chose de grave à ma petite amie, et, craignant non sans raison de ne rien pouvoir tirer de moi-même qui fût digne d’un auditoire aussi raffiné, je pris, dans la bibliothèque du grand-père de mademoiselle Thècle, c’est le nom de la demoiselle avec laquelle j’avais accepté ce délicat tête-à-tête, je pris, dis-je, les Contes de Perrault et les ouvris à l’endroit du plus tragique de tous, à la page où commençait l’histoire émouvante du Petit Chaperon rouge.
À tous ses mérites le conte de Perrault joignait, par grande fortune pour Thècle, celui de la nouveauté. Cette terrible histoire ne lui avait point encore été racontée. La meilleure éducation d’une fille de quatre ans ne saurait être complète.
Sûr de mon effet, je commençai donc :
« Il était une fois une belle petite fille de village…, etc., etc. »
Je dois rendre justice à mon auditoire : tant que dura ma lecture, et j’eus soin de la faire de la voix lente et pénétrée qui convenait à un si grave sujet, il me prêta la plus bienveillante attention. Les coudes appuyés sur sa chaise à bras, le cou tendu vers moi, les yeux fixes, mademoiselle Thècle témoigna, par son immobilité, du profond intérêt qu’excitait en elle ce palpitant récit. Ses regards, ses beaux grands regards d’enfant ne quittèrent pas mes lèvres, et, quand je fus arrivé au dénouement, je ne pus douter que toutes les péripéties du drame terrible qui venait de se dérouler devant elle n’eussent frappé ses esprits attentifs.