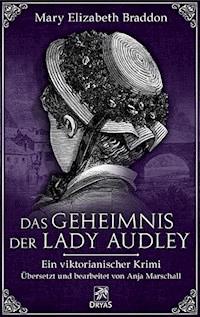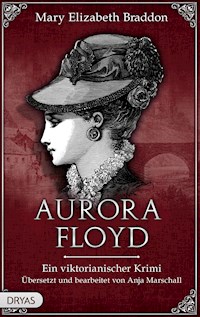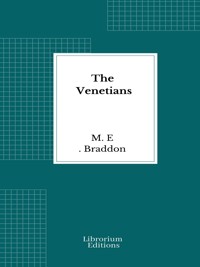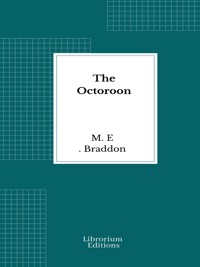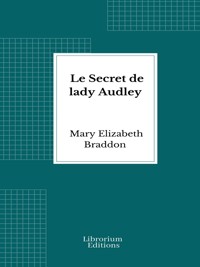1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Il y a des maisons qui, ni plus ni moins que des personnes, ont un air respectable… elles rendent confiants les fournisseurs les plus sceptiques ; les caisses de marchandises franchissent leur seuil d’un bond… et même les gamins qui vagabondent par la ville s’en éloignent, discrets et respectueux, faisant sans doute réflexion qu’il ne serait point décent de prendre ses ébats en des lieux si honnêtes.
Une de ces maisons-là s’élevait, il y a quelques années, dans une toute petite rue de l’ouest de Londres, entre Holborn et l’église de Saint-Pancrace. Il est peut-être dans l’ordre que la distinction excessive s’impose, de telle sorte qu’elle en devienne désagréable. La splendeur immaculée du No 14 de Fitzgeorge Street semblait une sorte d’insolence permanente adressée aux autres maisons, ses humbles voisines. Le No 14 faisait un contraste pénible avec l’entourage pauvre, presque sale. Les rideaux de mousseline du parloir du No 15 étaient jaunis, fanés par la fumée, et l’éclatante blancheur des rideaux du No 14 soulignait cruellement leur misère. Mme Magson, la logeuse du No 13, se donnait un mal d’enfer, frottait, époussetait du matin au soir ; mais la pauvre femme perdait sa peine, et elle se désespérait en pensant qu’elle aurait beau faire elle ne parviendrait jamais à rendre les dalles de ses marches et le bouton de sa porte aussi luisants, aussi nets que ceux du No 14.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Les Oiseaux de proie
Mary Elizabeth Braddon
© 2024 Librorium Editions
ISBN : 9782385746322
CHAPITRE I UNE MAISON DE BLOOMSBURY
CHAPITRE II VIEUX JOURNAUX
CHAPITRE III MONSIEUR ET MADAME HALLIDAY
CHAPITRE IV MALADIE INQUIÉTANTE
CHAPITRE V UNE LETTRE DE L’ALLIANCE
CHAPITRE VI LES INCERTITUDES DE M. BURKHAM
LIVRE DEUXIÈME LES DEUX MACAIRES
CHAPITRE I LE TEMPLE DE L’OR
CHAPITRE II LA PENTE RAPIDE
CHAPITRE III PEINES ET ASPIRATIONS DU CŒUR
CHAPITRE I UN BON MARIAGE
CHAPITRE III PERSPECTIVES D’AVENIR DE GEORGE SHELDON
CHAPITRE IV NOUVELLE EXISTENCE
CHAPITRE V À LA PELOUSE
CHAPITRE VI LE PACTE DE GRAY’S INN
CHAPITRE VII LA TANTE SARAH
CHAPITRE VIII CHARLOTTE PRÉDIT QU’IL PLEUVRA
CHAPITRE IX SHELDON AUX AGUETS
LIVRE QUATRIÈME JOURNAL DE VALENTIN
CHAPITRE I LE PLUS VIEIL HABITANT
CHAPITRE II LA RÉSIDENCE DE MATTHIEU HAYGARTH
CHAPITRE III LA PRUDENCE DE M. GOODGE
LIVRE CINQUIÈME LES RELIQUES DU MORT
CHAPITRE I TRAHISON D’UN PAPIER BUVARD
CHAPITRE II VALENTIN INVOQUE LE FANTÔME DU PASSÉ
CHAPITRE III LA CHASSE AUX JUDSON
CHAPITRE IV UN COUP D’ŒIL SUR LE PASSÉ
LIVRE SIXIÈME L’HÉRITIÈRE DES HAYGARTH
CHAPITRE I DÉSAPPOINTEMENT
CHAPITRE II SUITE DU JOURNAL DE VALENTIN
CHAPITRE IV DANS LE PARADIS
CHAPITRE V TROP BEAU POUR DURER
CHAPITRE VI TROUVÉ DANS LA BIBLE
LIVRE SEPTIÈME L’ENGAGEMENT DE CHARLOTTE
CHAPITRE I LA PATIENCE FAIT LA FORCE
CHAPITRE II FAIBLESSE DE MADAME SHELDON
CHAPITRE III AVEU DE VALENTIN À GEORGE SHELDON
CHAPITRE IV AFFABILITÉ DE PHILIPPE SHELDON
CHAPITRE V BIENVEILLANCE DE SHELDON
CHAPITRE VI LE GRAND CHEVAL DE VALENTIN
CHAPITRE VII PRUDENCE DE SHELDON
CHAPITRE VIII LA PAIX DE NOËL
LIVRE PREMIERAMITIÉ FATALE
CHAPITRE IUNE MAISON DE BLOOMSBURY
Il y a des maisons qui, ni plus ni moins que des personnes, ont un air respectable… elles rendent confiants les fournisseurs les plus sceptiques ; les caisses de marchandises franchissent leur seuil d’un bond… et même les gamins qui vagabondent par la ville s’en éloignent, discrets et respectueux, faisant sans doute réflexion qu’il ne serait point décent de prendre ses ébats en des lieux si honnêtes.
Une de ces maisons-là s’élevait, il y a quelques années, dans une toute petite rue de l’ouest de Londres, entre Holborn et l’église de Saint-Pancrace. Il est peut-être dans l’ordre que la distinction excessive s’impose, de telle sorte qu’elle en devienne désagréable. La splendeur immaculée du No 14 de Fitzgeorge Street semblait une sorte d’insolence permanente adressée aux autres maisons, ses humbles voisines. Le No 14 faisait un contraste pénible avec l’entourage pauvre, presque sale. Les rideaux de mousseline du parloir du No 15 étaient jaunis, fanés par la fumée, et l’éclatante blancheur des rideaux du No 14 soulignait cruellement leur misère. Mme Magson, la logeuse du No 13, se donnait un mal d’enfer, frottait, époussetait du matin au soir ; mais la pauvre femme perdait sa peine, et elle se désespérait en pensant qu’elle aurait beau faire elle ne parviendrait jamais à rendre les dalles de ses marches et le bouton de sa porte aussi luisants, aussi nets que ceux du No 14.
Non contente d’être un véritable modèle de respectabilité, l’impertinente maison affichait même parfois je ne sais quelles prétentions à l’élégance. Elle s’était fait une mine aussi élégante que possible pour les environs d’Holborn. Sur les fenêtres l’on voyait de gais géraniums très-bien portants, ce qui, comme chacun sait, est chose rare pour le géranium, lequel jouit généralement d’une santé déplorable. Des cages d’oiseaux se dessinaient dans l’ombre douce des rideaux de mousseline et les reflets des briques nouvellement repiquées se fondaient dans la teinte verte des stores vénitiens. Sur la porte de la rue, fraîchement vernie, étincelait une large plaque de cuivre. Et tout cela, les marches blanches, les géraniums écarlates, les stores verts, le rayonnement métallique de la plaque de cuivre, vous avait un air opulent qui, tout compte fait, n’était pas trop déplaisant.
Les privilégiés admis à visiter l’intérieur de la maison en sortaient avec un sentiment d’envie et d’admiration et n’en finissaient pas quand ils commençaient le récit des splendeurs, tant du dehors que du dedans. Le prestige de l’habitation rejaillissait, comme il arrive, sur l’habitant, et on se demandait de temps en temps si ce dernier n’était pas une personne tout à fait supérieure aux autres personnes. Du reste, l’inscription gravée sur la plaque de cuivre informait le voisinage que le No 14 était occupé par M. Philippe Sheldon, chirurgien-dentiste, et aux heures de loisir les habitants de Fitzgeorge Street faisaient des commentaires à perte de vue sur la vie, les habitudes, les affaires de ce gentleman.
Il était, cela va de soi, éminemment respectable ; les voisins ne se posaient même pas cette question. Un bourgeois qui avait une devanture de porte aussi soignée et de pareils rideaux de mousseline était nécessairement le plus correct des humains. Il est évident qu’il n’y a qu’un citoyen de mœurs dissolues et d’esprit déréglé qui puisse avoir à ses fenêtres des rideaux de mousseline chiffonnés et malpropres. Les yeux sont le miroir de l’âme, dit le poète ; or, si on ne voit pas toujours les yeux d’un homme, rien de plus logique que de contempler les fenêtres de sa maison pour savoir au juste ce qu’il vaut. C’était du moins l’opinion des habitants de Fitzgeorge Street, Russell Square.
La personne et les habitudes de Sheldon étaient, du reste, en parfaite harmonie avec l’aspect de sa maison : ses devants de chemise étaient aussi blancs que les marches de son perron ; l’éclat de sa plaque de cuivre se retrouvait dans l’éclat de ses boutons de manchettes ; le lustre de ses gilets de satin noir n’était pas moins brillant que le vernis de sa porte ; et le poli parfait de ses ongles bien taillés, extrêmement nets, sa chevelure, ses favoris irréprochables, faisaient involontairement songer à la construction régulière de la maison, à sa façade de briques, à ses fleurs, à sa plaque de cuivre orthodoxe.
Aucun dentiste, aucun autre médecin n’avait habité la maison avant la venue de Sheldon : elle était restée inoccupée pendant plus d’une année et se trouvait dans un complet état de dégradation, lorsqu’un beau jour les affiches disparurent des fenêtres, et, immédiatement après, les briquetiers et les peintres plantèrent leurs échelles contre les murs décrépits. Sheldon ayant pris la maison pour un long bail, dépensa deux ou trois cents livres pour l’embellir. Lorsque les réparations et les décorations furent terminées, deux grands wagons chargés de meubles massifs, de mode ancienne, arrivèrent de la gare du Nord et s’arrêtèrent devant la maison. Au même moment on pouvait voir un jeune homme à la figure méditative qui allait, venait, entrait dans une chambre, puis dans une autre, se mettait à genoux, se relevait, mesurait, toisait avec une règle de trois pieds, prenant rapidement des notes sur un petit carnet qu’il tenait à la main. C’était un envoyé du tapissier, et avant la nuit tombante, plus d’un voisin savait que l’étranger venait pour poser des tapis neufs. Le nouveau locataire était évidemment d’un tempérament actif et énergique, car trois jours après son arrivée, la plaque de cuivre de la porte annonçait sa profession, en même temps qu’un cadre recouvert d’un verre et placé au niveau des yeux des passants, révélait par de nombreux témoignages l’habileté et la science du dentiste. Ce cadre instruisit et divertit à la fois les gamins du voisinage, qui ne revenaient pas de la blancheur des dents et du rouge vif des gencives ; ils firent même, à ce propos, les critiques les plus irrévérencieuses. Mais ce cadre en verre et cette plaque de cuivre étaient des moyens de publicité insuffisants. Tout de suite un joli jeune homme en habit râpé se mit à courir le quartier, frappant aux portes à la manière des facteurs, deux coups aussi secs, aussi tranchants qu’il savait, et distribuant des circulaires imprimées qui apprenaient au monde que Sheldon, chirurgien-dentiste, était inventeur d’une nouvelle méthode pour poser les fausses dents, incomparablement supérieure à toutes celles déjà connues ; et que, de plus, il était breveté pour un perfectionnement merveilleux de la nature, en corail. Le nom du perfectionnement avait été fabriqué avec du grec, du latin, ce qui, en général, inspire soudain, aux braves gens qui ne comprennent pas, une confiance démesurée.
Les voisins secouèrent la tête avec une prophétique solennité en lisant ces circulaires. De tous temps les pauvres gens, ceux qui passent leur vie à lutter contre la misère, se sont laissé aller aux tentations malsaines de l’envie ; en aucun temps ils n’ont pu se défendre d’une sorte de satisfaction cruelle en voyant se préparer et s’accomplir la ruine de ceux que le sort avait d’abord le plus favorisés. Cela n’est pas à l’honneur de l’humanité, mais cela est. Fitzgeorge Street et son entourage s’étaient jusqu’alors passés des services d’un dentiste ; mais il paraissait très-douteux qu’on pût, en exerçant cette profession, vivre avec le seul secours de la clientèle du quartier. Sheldon avait peut-être dressé sa tente, dans cette pensée que partout où il y a des hommes il y a des maux de dents, et que le guérisseur d’un mal si commun ne peut manquer de faire fortune en quelque lieu du monde qu’il lui convienne d’établir son petit arsenal d’horreurs. Pendant quelque temps après son arrivée, il fut l’objet de la préoccupation des voisins. On le regardait d’un air quelque peu défiant, en dépit de la belle et solide apparence de ses meubles et de la blancheur éblouissante de ses fenêtres ; on se demandait ce que deviendrait cette prospérité toute neuve qui s’étalait si gaillardement au soleil, et si tout ce luxe ne disparaîtrait pas un beau matin en une flambée, comme un feu de paille.
Les voisins furent un peu surpris et même un peu désappointés lorsqu’ils virent que le dentiste nouvellement établi semblait faire ses affaires et trouvait le moyen de rester là où il était venu. Les rideaux de mousseline étaient changés souvent, très-souvent ; la pierre à frotter, l’huile, la flanelle pour les nettoyages étaient prodiguées ; on en abusait ; quant au linge de Sheldon, il continuait à être d’une pureté resplendissante. La surprise et la défiance firent alors place à un sentiment d’envie mitigé par le respect. Le dentiste avait-il beaucoup de clients ? C’est ce que personne n’aurait pu dire. Il n’est pas d’état et de profession dans lesquels un homme persévérant ne rencontre quelque léger encouragement. Une moitié des voisins déclarait que Sheldon s’était fait une petite clientèle, et mettait de l’argent de côté, tandis que l’autre moitié doutait encore et affirmait qu’il avait des ressources particulières et vivait aux dépens de son petit capital. Puis, peu à peu, les jours et les mois s’écoulant, des bruits transpirèrent. Sheldon avait quitté sa ville natale de Barlingford, dans le comté d’York, où son père et son grand’père avaient été chirurgiens-dentistes avant lui, pour venir s’établir à Londres ; il avait cédé avantageusement une excellente clientèle et avait transporté à la Métropole ses meubles : pesantes chaises et lourdes tables dont le bois avait été usé et poli par les mains de son aïeule ; comptant bien que sa bonne mine, son adresse, son goût du travail, l’aideraient très-vite à faire fortune. On sut ensuite qu’il avait un frère avocat qui venait le voir souvent. Il avait, d’ailleurs, fort peu d’amis. On cita sa régularité, sa conduite, sa sobriété. Il avait trente ans environ, était célibataire et bel homme. Sa maison se composait d’une vieille femme laide et active, importée de Barlingford ; d’une fille chargée des commissions, et d’un jeune garçon qui ouvrait la porte, introduisait les clients dans le cabinet des consultations, et de plus, entre temps, faisait une besogne plus mystérieuse. On l’apercevait alors dans un petit cabinet sur la cour, limant, tripotant de la cire, du plâtre venu de Paris, des os, paraissant très-absorbé. Les habitants de Fitzgeorge Street avaient appris tout cela dans le cours des quatre années qui s’étaient écoulées depuis l’établissement du dentiste ; mais c’était tout ; ils n’avaient rien pu découvrir de plus. Sheldon n’avait fait aucune connaissance dans le quartier et n’avait même pas cherché à en faire. Ceux de ses voisins qui avaient vu l’intérieur de sa maison y étaient entrés comme patients : ils en étaient sortis aussi satisfaits de Sheldon qu’on peut l’être d’un homme qui vous a fait beaucoup de mal pour vous faire du bien. On avait toutefois vanté les bonnes manières du dentiste et son mouchoir parfumé. Du reste, Sheldon vivait très-retiré ; les voisins d’en face qui le guettaient d’un œil curieux dans les soirées d’été, pendant qu’il fumait son cigare, assis dans un fauteuil près d’une fenêtre ouverte, n’étaient pas plus renseignés sur sa pensée intime que s’il se fût agi d’un Tartare Calmouck ou d’un chef Abyssinien.
CHAPITRE IIVIEUX JOURNAUX
L’aspect de Fitzgeorge Street était froid et sombre, sous un ciel gris du mois de mars, lorsque Sheldon revint à Londres, après une absence de huit jours. Il avait été à Barlingford et avait employé ces quelques jours de congé à revoir ses anciennes connaissances. Le temps avait été déplorable pour les promenades en dog-cart, les grandes courses à cheval où les hommes et les bêtes s’animent, veulent se dépasser : une bourrasque avait failli renverser Sheldon dans les rues de sa ville natale, et un bon quart d’heure durant l’avait secoué, lui barrant le passage et l’empêchant de frapper à la porte de ses parents. Ce mois de mars avait été particulièrement rude. Il n’était donc pas surprenant, à son retour en ville, que ce voyage n’eût fait aucun bien à Sheldon.
« Cette semaine vous a changé, » lui disait la vieille femme du comté d’York, en posant sur la table une côtelette et la tasse de thé avec la théière, le sucre, le lait.
Sheldon mangea très-vite. Il semblait qu’il eût hâte de se débarrasser de la présence de sa vieille ménagère et qu’il fût gêné de la voir le questionner. Elle avait été sa nourrice, et, se souvenant des petites tendresses familières de l’enfant nerveux qu’elle avait nourri, elle se laissait souvent aller avec son maître à des façons plus libres que celles des serviteurs, même les plus estimés et les plus anciens. Elle le regardait furtivement, pendant qu’il était assis dans un large fauteuil au dossier élevé, fixant d’un air rêveur la flamme du foyer, et elle aurait voulu l’interroger sur son voyage.
Mais Sheldon n’était pas un homme à faire ce qu’il avait résolu de ne pas faire, même pour être agréable à sa nourrice. Il était bon maître, payait les gages de ses domestiques très-ponctuellement et ne leur donnait pas grand mal ; mais avec lui, il était de notoriété publique que les bavardes perdaient leur temps. Nancy Woolper, soyons poli, Mme Woolper le savait bien, et elle en avait fait la remarque à sa voisine, Mme Magson, le soir, en faisant un bout de causette après dîner. On peut vivre des années entières dans un quartier sans savoir ce que sont ses voisins ; mais dans les offices seigneuriaux du West End, aussi bien que dans les plus modestes cuisines des faubourgs, les domestiques des maisons les moins mondaines auront beau faire, à un jour donné, ils ne pourront se soustraire à l’offre de quelque autre politesse faite par les domestiques voisins.
« Vous pouvez ôter le couvert, Nancy, dit à ce moment Sheldon, sortant tout à coup de la rêverie dans laquelle il avait paru absorbé pendant les dix dernières minutes ; j’ai beaucoup à travailler et j’attends George dans le courant de la soirée. Rappelez-vous que je n’y suis que pour lui seul. »
La vieille rangea sur le plateau la théière et le reste, mais elle ne cessa de regarder son maître. Il était assis, la tête un peu inclinée, et ses yeux noirs, obstinément fixés sur le foyer, avaient cette lueur intense, particulière que l’on remarque dans le regard de ceux dont la vue, dépassant l’objet sur lequel elle semble s’attacher, s’en va loin par delà les choses de la réalité. Nancy observait ainsi son maître très-souvent ; elle ne pouvait s’habituer à considérer l’enfant qu’elle avait fait sauter sur ses genoux comme un homme. C’était pourtant un homme presque impénétrable, et l’abîme qui s’ouvrait entre Nancy et la pensée de cet homme déconcertait la pauvre femme. Ce soir-là, elle l’examinait plus attentivement qu’à l’ordinaire, si c’est possible, car il y avait dans sa physionomie un changement qu’elle cherchait vainement à s’expliquer.
Sheldon leva brusquement la tête et vit le regard qui le fixait. Cela l’impatienta, sans doute, car il dit nerveusement :
« Qu’est-ce que vous regardez, Nancy ? »
Ce n’était pas la première fois qu’il avait surpris cette curiosité de sa servante et en avait été importuné ; mais Nancy, en femme du Nord qu’elle était, ne se laissait pas décontenancer, et avait toujours sur les lèvres une réponse plausible : elle démontrait à son maître que sa curiosité n’était que l’effet de l’intérêt qu’elle lui portait.
« Je pensais justement, monsieur, dit-elle sans baisser ses petits yeux gris, à ce que vous avez dit que vous n’y seriez pour personne, excepté pour George. Dites-moi, monsieur, que faudrait-il faire si un client nous arrivait ? Il n’y a rien comme ces méchants vents de mars pour faire pousser les maux de dents. Dites donc, monsieur, un client en voiture ?…
— Les vents de mars pas plus que les pluies d’avril ne m’amèneront probablement de clients ni à pied, ni en voiture, vous devez bien le savoir, Nancy. S’il en venait un, faites-le entrer et donnez-lui à lire le Times de la semaine dernière pendant que je ferai la toilette de mes instruments… voilà ! maintenant, allez… non… attendez, j’ai quelques nouvelles à vous donner. »
Il se leva et se tint le dos tourné au feu, fixant le tapis pendant que Nancy restait près de la table avec son plateau chargé entre les mains. Son maître ne lui dit rien pendant quelques minutes, puis se retourna à moitié, se regardant vaguement dans la glace pendant qu’il parlait.
« Vous vous rappelez Mme Halliday ? lui dit-il.
— Certainement, monsieur. C’était autrefois Mlle Georgina Cradock, Mlle Georgy, comme on l’appelait… vos premiers amours… Je n’ai jamais compris comment elle a pu se décider à épouser ce gros lourdaud de Halliday… à moins qu’elle ne fût éprise de ses grands yeux ronds et de ses favoris rouges.
— C’est son père et sa mère qui se sont épris de sa ferme, de ses récoltes, et de ses bestiaux, Nancy, répondit Sheldon en continuant à s’observer dans la glace. Georgy y a été pour peu de chose. C’est une de ces femmes qui laissent aux autres le soin de penser pour, elles. Tom est néanmoins un excellent garçon, et Georgy a eu de la chance de rencontrer un pareil mari. Si je lui ai quelque peu fait la cour autrefois, il y avait longtemps que cela était fini lorsqu’elle a épousé Tom. Cela n’a jamais été qu’une amourette et j’en ai eu dans mon temps avec bien d’autres filles de Barlingford. Vous le savez bien, Nancy. »
Sheldon était rarement aussi communicatif avec sa femme de ménage ; la bonne femme, satisfaite de la rare condescendance de son maître, eut un gros rire qu’elle accompagna d’un signe de tête.
« Je suis allé jusqu’à Hiley, pendant que j’étais à la maison, » continua Sheldon.
Sheldon disait encore la maison en parlant de Barlingford, bien qu’il eût rompu presque tous les liens qui l’y rattachaient.
« Et j’ai dîné avec les Halliday… Georgy est aussi jolie que jamais, et tous vont très-bien.
— Ont-ils des enfants, monsieur ?
— Une fille, répondit Sheldon avec indifférence ; elle est en pension à Scarborough, et je ne l’ai pas vue. J’ai passé une très-agréable journée avec les Halliday. Tom a vendu sa ferme. Cette partie du monde ne lui convient pas, à ce qu’il paraît ; elle est trop froide et trop humide pour lui. C’est un de ces hommes gros et gras qui sembleraient pouvoir vous renverser avec leur petit doigt et qui tremblent au premier zéphyr. Je ne pense pas qu’il fasse de vieux os, Nancy ; mais on ne peut là-dessus rien affirmer. Je pense qu’il ira bien encore une dizaine d’années ; je dirai même que je l’espère, dans l’intérêt de Georgy.
— Je ne sais cependant s’il a eu raison de vendre la ferme de Hiley, observa Nancy. J’ai entendu dire qu’elle avait les meilleures terres à quarante milles autour de Barlingford ; mais il l’a sans doute vendue très-cher.
— Oh ! oui, il l’a parfaitement bien vendue, à ce qu’il m’a dit. Vous savez que lorsqu’un campagnard du Nord trouve l’occasion de gagner de l’argent, il ne la laisse jamais passer. »
Nancy reçut ce compliment décoché à ses concitoyens avec un sourire approbatif et Shelton continua. Il ne cessait de se regarder dans la glace et arrangeait ses favoris, de l’air d’un homme très-absorbé.
« Maintenant, comme Tom est né pour être fermier et rien que fermier, il faut qu’il trouve une autre terre sous un ciel qui lui sera plus clément. Ses amis lui ont conseillé le Devon ou les Cornouailles. Dans ces régions fortunées il pourrait faire pousser des myrtes et des roses jusque sur son toit et envoyer des petits pois au marché de Londres jusqu’à la fin de novembre. Il peut trouver cela sans se presser. Il viendra la semaine prochaine à Londres et s’en occupera. Georgy et lui sont deux enfants qui ne sauraient jamais se tirer d’affaire tout seuls, à Londres, du moins. Je les ai engagés à descendre ici ; leur logement ne leur coûtera rien et nous ferons les autres dépenses en commun, à la mode du comté d’York ; car, je ne puis malheureusement pas prendre à ma charge deux pensionnaires pendant un mois. Pensez-vous que vous serez capable de faire le service pour nous tous, Nancy ?
— Oh ! oui, je m’en tirerai très-bien ; je ne suis pas une paresseuse comme les filles de Londres, qui mettent une demi-heure pour essuyer une tasse à thé. Soyez tranquille, je m’en tirerai !… M. et Mme Halliday occuperont votre chambre, bien sûr ?
— Oui, il faut leur donner la meilleure chambre ; moi, je dors n’importe où… Maintenant, descendez, Nancy, et pensez à tout cela… Il faut que je travaille, j’ai des lettres pressées à écrire ce soir. »
Nancy se retira avec son plateau, flattée, heureuse de la familiarité que lui avait montrée son maître et, de plus, enchantée à la pensée que la maison allait être pleine de monde. Ce serait certainement un grand embarras ; mais la nature remuante de Nancy souffrait de la vie monotone qui lui était quotidiennement imposée ; elle aspirait de toutes ses forces, à la chose qui la sortirait de son train-train ordinaire. Il y aurait aussi le plaisir de secouer un peu la paresse de la fille de Londres, il faudrait bien se mouvoir, monter, descendre. Et enfin, la question des petits profits n’était pas à dédaigner ; Nancy n’était point sotte, et elle savait que dans une maison où l’on boit et où l’on mange beaucoup, rien n’est plus facile à une ménagère intelligente que de faire son affaire, comme on dit. Pendant ces quatre dernières années, Sheldon avait vécu très-simplement, pauvrement presque. Nancy, qui aimait toujours en son maître l’enfant aux yeux noirs qu’elle avait bercé, il y avait vingt-neuf ans de cela, l’avait soutenu dans cette voie de privation par son ordre, son économie. Elle s’était montrée honnête, délicate même, allant jusqu’à refuser de petits bénéfices que l’usage l’autorisait à accepter sans scrupule. Mais, ce que Nancy avait fait pour son maître, elle n’était pas disposée à le recommencer pour d’autres, pour des gens riches, qu’elle n’avait point bercés. Ici son intégrité cessait d’être excessive. Elle se mit en tête de faire supporter à Thomas Halliday, pendant son mois de séjour au logis, toutes les dépenses du ménage. Elle trouva cela juste, toujours à la mode du comté d’York.
Pendant que Nancy méditait sur ses devoirs domestiques, le maître de la maison, lui aussi, méditait et sur des sujets qui devaient être infiniment plus graves. Il avait pris dans un tiroir un portefeuille de cuir et en avait tiré une liasse de papiers. Il ne fit mine d’écrire aucune espèce de lettres, quoiqu’il eût prétexté qu’il avait à le faire en congédiant sa servante, mais les coudes appuyés sur la table, il mordillait le bout d’un porte-plume en bois qu’il maniait nerveusement entre ses doigts en regardant le mur avec une fixité stupide. Sous la clarté du gaz son visage semblait fatigué ; ses yeux étaient tout brillants de fièvre.
Sheldon était ce qu’on appelle un bel homme ; il avait la régularité fade des têtes en cire qui se voient à la porte des coiffeurs. Oui ! ses traits étaient réguliers, son nez d’une belle coupe aquiline, sa bouche ferme et très-fendue, son menton et sa mâchoire un peu plus carrés cependant que ne le sont en général les mentons et les mâchoires des têtes que nous venons de dire. Son front, où se dessinait assez nettement la bosse de la clairvoyance, ne révélait en somme rien de très-supérieur. Le phrénologue qui aurait voulu savoir l’homme qu’était Sheldon, ne l’aurait pu en se bornant à l’examiner du regard : il lui aurait fallu le secours de ses doigts ; car une des choses qui frappait le plus chez le dentiste, c’était sa chevelure ; elle était abondante, très-soignée, très-noire, comme ses favoris. Les favoris, bien taillés, attiraient aussi l’attention. Et après les cheveux et les favoris, les dents de Sheldon apparaissaient entre ses lèvres blanches, massives, caractéristiques : c’était une réclame parlante du plus bel effet. Un artiste aurait peut-être jugé les dents trop larges, trop carrées. Étaient-elles donc vraiment belles ? On ne savait. Généralement on disait qu’elles semblaient mieux faites pour la mâchoire d’un des grands félins, qui broient si bien dans les jungles de l’Inde les os des imprudents, que pour celles d’un homme. Néanmoins, comme elles étaient d’une blancheur magnifique et que le teint de Sheldon était très-foncé, cela faisait contraste et ce n’était pas laid.
Sheldon était un homme laborieux, actif, et patient. L’oisiveté du rêve lui répugnait ; sa pensée toute entière était au travail ; elle se concentrait sur l’objet qu’elle voulait atteindre avec une force et une souplesse d’une précision extraordinaire, comme mathématique. Les cases de ce cerveau avaient été rangées symétriquement comme le grand-livre d’un commerçant. Ses idées y étaient enregistrées avec tant d’art et de méthode, que sur un signe de sa volonté, Sheldon faisait sortir à son heure celle dont il avait besoin. Ce soir-là, il resta plongé dans ses réflexions jusqu’au moment où il fut interrompu par le bruit d’un double coup de marteau frappé à sa porte. Cette façon de frapper était évidemment familière à son oreille, car il murmura : « George ! » mit de côté son pupitre, et se leva sur le tapis du foyer pour recevoir le visiteur attendu.
Une voix d’homme se fit entendre en bas ; une voix qui ressemblait à celle de Sheldon lui-même. Puis, un pas vif et ferme résonna dans l’escalier, la porte s’ouvrit, et un homme, qui lui-même ressemblait beaucoup à Sheldon, entra dans la chambre. C’était George Sheldon, le frère de Philippe Sheldon de deux ans plus jeune que lui. On n’eût, certes, pas pris les deux hommes l’un pour l’autre ; mais ils se ressemblaient beaucoup, et l’on voyait tout de suite qu’ils étaient frères. Leurs façons surtout étaient les mêmes. Ils étaient de la même taille, grands et bien conformés. Ils avaient tous deux les yeux noirs et brillants, les favoris et les cheveux noirs, les mains nerveuses, le bout des doigts carré, et le poignet osseux. Quelque chose d’âpre les distinguait, mais ce quelque chose avait été assoupli par les frottements de la vie moderne. À la première vue, ils pouvaient plaire ou déplaire ; mais quelle qu’eût été la première impression, on ne pouvait s’empêcher en les examinant de penser vaguement à ces hommes du Nouveau-Monde, solides et agiles, au regard clair, aux manières gracieuses et cassantes, qui conservent en eux je ne sais quoi de menaçant.
Ils s’accueillirent par un signe de tête amical ; ils étaient trop pratiques pour se livrer à aucune démonstration d’amitié fraternelle ; ils s’aimaient pourtant, se rendaient à l’occasion de mutuels services, et prenaient de temps à autre, rarement, leurs plaisirs ensemble. C’était tout. Leur amitié allait jusque là, mais pas au delà.
« Eh bien ! Philippe, dit George, je suis bien aise de vous voir de retour. Vous avez l’air fatigué cependant. Vous avez sans doute fait beaucoup de visites là-bas ?
— J’ai bien employé mon temps. J’ai passé une journée chez Halliday. Il s’en va passablement vite.
— Hum ! murmura George, il est regrettable qu’il ne s’en aille pas plus vite. Il devrait avaler sa gaffe, afin que vous puissiez épouser Georgy.
— Bah ! si Georgy devenait veuve, voudrait-elle de moi ? dit Philippe de l’air d’un homme qui doute.
— Oh ! elle ne serait pas longue à se décider. Avant son mariage, elle était très-aimable avec vous, et l’eût-elle oublié, elle n’oserait pas vous refuser si vous la demandiez en mariage. Vous savez bien, Philippe, qu’elle a toujours eu un peu peur de vous.
— Je ne sais rien de cela. C’était une assez gentille personne ; mais malgré sa simplicité, elle savait très-bien se défendre contre un amoureux pauvre et donner la préférence à un riche.
— C’était le fait de ses vieux parents. Georgy se serait jetée dans l’huile bouillante si son père et sa mère lui avaient dit de le faire. Ne vous souvenez-vous pas, lorsque nous étions enfants, à quel point elle avait peur de salir sa robe ? Je ne crois pas qu’elle ait épousé Tom de meilleur cœur qu’elle allait en pénitence pour avoir taché ses vêtements. Vous souvenez-vous ?… Elle s’en allait dans un coin, parce que ses parents le lui ordonnaient, et elle a épousé Tom par la même raison. Je ne crois pas non plus qu’elle ait été bien heureuse avec lui.
— Il n’y a qu’elle qui puisse le savoir, répondit tristement Philippe ; ce que je sais, moi, c’est que j’ai grand besoin d’une femme riche, car mes affaires vont aussi mal que possible.
— La pêche n’a pas été bonne, hein ?… La vieille douairière n’est pas revenue ?… Pas beaucoup de commandes de râteliers à dix guinées ?
— J’ai reçu l’année dernière à peu près soixante-dix livres, dit le dentiste, et mes dépenses sont d’environ cinq livres par semaine. J’ai couvert la différence avec l’argent que j’avais pour m’établir, espérant que je pourrais me soutenir et me faire une clientèle ; mais la clientèle diminue tous les ans. Je crois que dans le commencement on est venu à moi à cause de la nouveauté ; car, pendant les premiers douze mois, cela n’a pas été trop mal ; mais maintenant, autant vaudrait jeter son argent par la fenêtre, que de l’employer en circulaires et en annonces.
— Ainsi, une femme jeune, avec vingt mille livres et une mâchoire à mettre en état, ne s’est pas encore présentée ?
— Non ; ni une vieille non plus. Je ne regarderais pas à l’âge, si elle avait de l’argent, » répondit Philippe avec amertume.
George leva les épaules et plongea ses mains dans les poches de son pantalon, avec un geste de désespoir tout à fait cocasse. Il était le plus jeune des deux, et affectait dans son costume, ses manières, et son langage, un certain air de maquignon fort différent de la tenue et de la mise étudiées de son frère. Ses vêtements étaient amples et empestaient toujours le tabac. Il portait des bijoux, des breloques, des boutons de chemise, des épingles, des chaînes pendantes, et des trousseaux de clefs de montre. Ses favoris étaient plus épais que ceux de son frère, et il portait des moustaches, une belle paire de moustaches touffues, crânement retroussées, qui auraient mieux fait sous le nez d’un capitaine de guérillas que sous celui d’un paisible citadin. Sa situation comme avocat n’était guère meilleure que celle de son frère comme dentiste ; mais il avait ses plans pour arriver à la fortune et il espérait en faire une beaucoup plus belle que celle qu’opèrent ordinairement les membres du barreau. Il s’était mis à la poursuite des généalogies, à la recherche des faits oubliés, des moyens de renouer des anneaux rompus ; c’était une sorte de résurrectionniste légal, un piocheur dans les cendres et la poussière du passé ; il se disait qu’avec le temps il découvrirait un trésor qui le dédommagerait du travail et de la patience qu’il aurait déployés la moitié de sa vie.
« Je puis me résigner à attendre ma bonne chance jusqu’à l’âge de quarante ans, disait-il quelquefois à son frère dans ses moments d’expansion. Il me restera encore dix ans pour en jouir, et vingt de plus pour faire de bons dîners, boire de bon vin, et déblatérer à la manière des vieux contre la décadence de toutes choses.
Ils se tenaient debout aux deux côtés de la cheminée. George regardait son frère, pendant que Philippe fixait sur le foyer ses yeux couverts par ses lourds sourcils. Le feu était presque éteint, George se baissa et se mit à l’activer nerveusement.
« S’il est quelque chose que je haïsse par-dessus tout, et je hais beaucoup de choses, dit-il, c’est un feu qui s’éteint… Comment va-t-on à Barlingford ?… On y est aussi gai que par le passé, je suppose ?
— Pas plus gai que lorsque nous l’avons quitté. Les choses ont mal tourné pour moi, à Londres, et au milieu de mes tracas j’ai été plus d’une fois tenté d’en finir avec un coup de rasoir ou avec quelques gouttes d’acide prussique ; et lorsque j’ai revu ces rues froides et tristes, ces noires maisons, la place du marché déserte, l’église Saint-Jean-Baptiste, avec ses pierres massives, et entendu le monotone ding-dong des cloches sonnant pour les prières du soir, je me suis demandé comment j’avais jamais pu vivre une semaine dans un pareil lieu. J’aimerais mieux balayer les rues à Londres que d’habiter la plus riche maison de Barlingford, ainsi que je l’ai dit à Halliday.
— Et Tom va venir à Londres, si j’ai bien compris votre lettre ?
— Oui ; il a vendu Hiley, il désire trouver un autre domaine dans l’ouest de l’Angleterre. Lui et Georgy vont venir passer quelques semaines à Londres, et je les ai engagés à loger ici. Je ferai aussi bien d’utiliser la maison de cette façon, car vraiment elle ne vaut pas cher au point de vue professionnel.
— Hum ! je ne comprends pas votre but.
— Je n’ai aucun but particulier. Tom est un bon garçon et sa société vaudra mieux que la solitude d’une maison vide. La visite ne me coûtera rien ; Halliday supportera sa part de la dépense.
— À la bonne heure, cela pourra avoir au moins un résultat, répliqua George, qui considérait que toute action de la vie humaine doit être calculée de manière à produire un résultat productif ; mais je crains que vous ne soyez bientôt fatigué de cet arrangement. Tom est un très-bon garçon, à sa manière, et très-fort de mes amis, mais ce n’est, en somme, qu’un cerveau vide. »
La conversation changea de sujet, et les deux frères se mirent à parler de Barlingford et de ses habitants ; de quelques parents qui leur restaient et les rattachaient encore à leur ville natale ; ils parlèrent aussi de leurs anciens camarades d’enfance. Le dentiste prit dans le buffet une bouteille entamée de whisky pour son frère et pour lui ; mais la conversation n’en continua pas moins. Philippe était triste et distrait et répondait seulement de temps à autre ; il finit même par déclarer qu’il était harassé.
« Ce n’est pas une plaisanterie que de venir de Barlingford par un train de petite vitesse, et je ne pourrais me permettre l’express, dit-il, en manière d’explication, en réponse à son frère qui lui reprochait sa distraction.
— Alors, je pense que vous ferez bien de vous mettre au lit, reprit George qui avait fumé deux cigares et bu la bouteille de whisky, avec de l’eau chaude et du sucre. Je m’en vais… Je vous ai dit en arrivant combien vous me paraissiez fatigué. Quand attendez-vous Tom et sa femme ?
— Au commencement de la semaine prochaine.
— Si tôt que cela… Allons, bonsoir, je vous reverrai certainement, avant qu’ils arrivent. Vous feriez bien de venir jusque chez moi, demain soir. J’ai une affaire en train, qui m’occupe beaucoup en ce moment.
— Toujours vos mêmes travaux ?
— Toujours. Il ne m’en vient pas beaucoup d’autres.
— J’ai bien peur que vous ne tiriez jamais grand profit de celui-là.
— Je ne sais pas. Un joueur de whist a souvent bien des mauvaises cartes avant qu’il tombe sur une série d’atouts ; mais les atouts finissent toujours par venir s’il a la patience de les attendre. Tout homme a sa chance, Philippe ; il ne faut que savoir la saisir ; mais il y en a beaucoup qui se découragent, et s’endorment avant que leur chance arrive. J’ai déjà dépensé bien du temps et du travail en pure perte ; mais les atouts sont dans le jeu, et il faudra bien qu’ils en sortent un peu plus tôt, un peu plus tard… »
George fit un signe d’adieu et se retira, et, tout en s’en allant, il sifflait gaiement. Philippe l’entendit et tourna sa chaise vers le feu avec un geste d’impatience.
« Vous pouvez être très-savant, mon cher George, se dit le dentiste à lui-même, mais vous ne ferez jamais fortune à lire des testaments et à feuilleter des registres de paroisses pour rechercher les héritiers légitimes ; il n’est nullement probable qu’une somme un peu ronde attende qu’on vienne la chercher, quand tous ceux qui peuvent alléguer le plus léger prétexte pour s’en emparer sont encore au monde. Non, non, mon garçon, croyez-moi, il faudra que vous trouviez un meilleur moyen pour vous enrichir. »
Le feu avait baissé de nouveau, et Sheldon demeurait mélancoliquement assis devant les charbons noircis. L’état de ses affaires était fort mauvais… plus mauvais qu’il n’avait osé le confesser à son frère. Les voisins et les passants qui enviaient la brillante demeure de Sheldon ne soupçonnaient pas que le maître de la maison était entre les mains des usuriers et que la pierre à frotter qui servait à blanchir les marches de sa porte était payée par les trésors d’Israël. La philosophie de Philippe était toute mondaine. Il savait que le soldat de fortune qui veut remporter la victoire dans la grande bataille de la vie doit tenir son harnais en bon état et cacher les blessures qu’il peut recevoir sous l’éclat de sa cuirasse, de ses armes, et de ses galons.
Sa tentative pour se créer une clientèle ayant échoué, l’habile Sheldon ne voyait pas d’autres chances de salut que de laisser les restes de cette mésaventure à un confrère qui les paierait plus qu’ils ne valaient. C’est dans ce but qu’il conservait intacte la blancheur de ses rideaux de mousseline, bien que le savon et l’empois fussent payés avec de l’argent emprunté à soixante pour cent. C’est également dans ce but qu’il entretenait une sorte de pratique et cette apparence d’honorabilité qui est par elle-même une sorte de capital, C’était certainement une rude besogne que de défendre la forteresse contre les assauts de la misère, mais le dentiste se comportait vaillamment, et luttait avec opiniâtreté, attendant d’un jour à l’autre la victime que le sort lui devait. Il faisait réflexion qu’il serait excellent de pouvoir dire un jour : J’ai été pendant quatre ans un des notables habitants de Bloomsbury ; et cela lui donnait du courage. Il avait tendu des filets en divers endroits pour attraper l’innocent poisson et son petit capital. Plusieurs fois, il avait cru réussir ; mais capital et poisson s’étaient contentés de rôder autour du filet sans y entrer. Du reste, il n’avait jamais parlé de céder son fonds : il attendait les propositions, les provoquait sournoisement, mais ne les faisait pas.
Chaque jour, dans les derniers temps, l’état des choses empirait ; toutes les vingt-quatre heures l’échéance des billets déjà renouvelés apparaissait terrible, implacable. Philippe se sentait tomber graduellement dans les profondeurs douloureuses, compliquées, où le démon de l’Insolvabilité tient sa cour et rend ses arrêts. Tant qu’il avait eu son petit capital il n’avait point fait de dettes ; mais ce capital épuisé et les affaires de son état allant de mal en pis, il fut bien obligé d’emprunter. Ses prêteurs se lassèrent vite et refusèrent de lui faire la moindre avance. La chaise sur laquelle il était assis, le tisonnier avec lequel il arrangeait le feu ne lui appartenaient pas. Un jugement obtenu par un des juifs, ses créanciers, autorisait celui-ci à faire vendre ses meubles ; et, en rentrant chez lui, il pouvait trouver placardée sur son mur l’affiche du commissaire-priseur et son commis occupé à dresser l’inventaire de son mobilier. Si à ce moment la victime tant attendue qui devait acheter sa clientèle s’était présentée il eût été trop tard ; ses créanciers seuls auraient bénéficié du marché.
Il est rare qu’un homme se trouve acculé par une plus sombre fatalité que celle qui accablait Sheldon. Cependant ce soir-là il ne paraissait à vrai dire ni découragé, ni désespéré, mais simplement préoccupé par la préparation, l’exécution possible de quelque grand projet.
« Ce serait une bonne affaire pour moi, murmura-t-il, si j’étais de taille à la faire réussir. »
Le feu s’éteignit tout à fait ; les horloges sonnèrent minuit. Philippe réfléchissait à l’avenir devant les cendres encore tièdes de la cheminée. Les domestiques s’étaient retirés à onze heures, après avoir poussé les lourds verrous de la porte d’entrée, ce qui était bien inutile. Un mortel silence emplit la maison. Sheldon, toujours assis, entendait avec une netteté qui l’irritait les voix des passants attardés et les miaulements des chats du voisinage. Un meuble en acajou qui était dans un coin fit entendre un craquement étrange, long et triste. Il n’y prit pas garde. Il n’était point superstitieux. Son esprit froid ne se laissait pas distraire par les choses surnaturelles. Il était de ceux qui pensent qu’avec un crayon et un bout de papier on peut mettre en formules très-nettes les problèmes les moins accessibles à l’homme.
« Je ferai mieux de lire l’exposé de cette affaire avant qu’ils arrivent, dit-il, ayant probablement épuisé le sujet de ses réflexions. Il n’y a pas de meilleur moment que celui-ci pour le faire librement, à ma guise. Dans le jour, on ne sait jamais si l’on n’est pas épié, espionné. »
Il regarda à sa montre, puis alla à une armoire où il prit de petits fagots, des allumettes, et de vieux journaux. Parfois il allumait son feu lui-même et notamment lorsqu’il voulait, la nuit, travailler plus fort que de coutume ou le matin de bonne heure. Il le ralluma aussi habilement que la ménagère la plus entendue et resta à le surveiller jusqu’à ce qu’il fût pris par tous les bouts. Puis il prit son bougeoir et descendit l’escalier qui conduisait à la pièce où il arrachait avec des pinces les dents de ses semblables. La grande chaise garnie de crin, éclairée par la pâle lumière du bougeoir, avait comme une apparence fantastique ; l’imagination d’une personne plus impressionnable eût pu la croire occupée par le fantôme d’un patient, expiré sous les tenailles de Sheldon. Il alluma le gaz d’un bec mobile qu’il avait l’habitude de faire arriver presque dans la bouche des clients qui venaient le soir. De chaque côté de la cheminée se trouvaient des armoires qui servaient de bibliothèque ; les livres n’avaient pas une grande valeur, et, néanmoins, les armoires étaient constamment fermées.
Sheldon prit une clef dans la poche de son gilet, puis ayant ouvert la bibliothèque, il en tira une pile de livres très-pesants. C’étaient des volumes reliés du journal la Lancette. C’était un véritable fardeau, et je ne crois pas que le dentiste aurait pu supporter un poids plus considérable. Il s’y prit très-adroitement, disposa de son mieux, entre ses bras, les lourds volumes, et remonta dans sa chambre. Il s’assit, jeta autour de lui un regard rapide, ouvrit un des livres, un autre, un troisième, se mit à le parcourir… il s’arrêtait, lisait un article d’un bout à l’autre, avec un redoublement d’attention, ou bien très-vite quelques lignes : il prenait des notes sur un petit carnet oblong et semblait se dire :
« Bien… bien… tout cela est bon… parfait… et ceci donc !… et encore ceci ! n’omettons rien… »
Il était encore là, écrivassant, courbé sur sa table, quand les horloges voisines jetèrent une à une, à la file, sans ordre, trois coups distincts, qui tombèrent dans la nuit.
CHAPITRE IIIMONSIEUR ET MADAME HALLIDAY
Les invités de Sheldon arrivèrent le jour annoncé. C’étaient des bourgeois de province, extrêmement considérés dans leur pays, jugés tout à fait comme il faut par leurs compatriotes, mais qui ne ressemblaient pas le moins du monde à des bourgeois de Londres.
Thomas Halliday était du comté d’York. C’était un homme gros, parlant haut, d’un caractère facile, jovial. Il avait hérité d’un petit domaine acquis par le travail et l’économie de son père. Sa vie avait toujours été des plus simples, il réalisait le type du fermier et rien de plus. Pour lui une exposition de bestiaux ou une foire aux chevaux étaient les joies suprêmes de l’existence. La ferme où il était né, et où il avait été élevé, était située à environ six milles de Barlingford ; ce qui fait que les meilleurs souvenirs de son enfance et de son adolescence étaient dans cette petite ville et surtout sur la place de son marché. Lui et les deux Sheldon avaient été camarades d’école et ils étaient restés bons amis ; ils s’amusaient ensemble comme on peut s’amuser à Barlingford ; ils faisaient la cour aux mêmes beautés provinciales dans les thés cérémonieux, en hiver, et pendant l’été, organisaient des pique-niques entre hommes, pique-niques dans lesquels plus on mangeait, plus on buvait, plus l’on était heureux. Halliday avait toujours respecté George et Philippe, se sentant moins fort, plus humble qu’eux ; ce qui ne l’empêchait pas de sentir la supériorité factice que lui donnait sa richesse sur ses amis. Il n’eût pas échangé les champs fertiles de Hiley pour la science et l’esprit des deux frères. Il était déjà propriétaire de sa maison bien meublée et de sa ferme fort bien garnie, lorsque lui et Philippe devinrent amoureux de Georgina Cradock, la plus jeune fille d’un avoué de Barlingford, voisin du père des deux Sheldon. Philippe et la jeune fille tout enfants avaient joué ensemble dans les grands jardins murés qui se trouvaient derrière les deux maisons et une intimité toute fraternelle les avait longtemps unis ; mais, lorsque plus tard ils se rencontraient en soirée, M. Cradock commença à surveiller les libertés de leur jeune affection. Georgina n’avait point de dot, et le digne avoué, son père, pensait qu’on trouvait le bonheur domestique bien plutôt dans la boîte à argenterie et l’armoire au linge, que dans les avantages physiques de son fiancé. Les dents blanches et les favoris noirs de Philippe ne le convertirent pas ; de sorte que le pauvre Sheldon fut jeté par-dessus le pont, comme il disait lui-même, et un beau, jour Georgy épousa Halliday, avec tout le cérémonial et la solennité usités dans la bourgeoisie de Barlingford.
Cette union s’accomplit sans crise, sans déchirement. Philippe lui-même ne montra aucun désespoir extravagant. Son père était quelque peu médecin en même temps que dentiste, et si Philippe avait nourri quelque sombre dessein, il n’aurait pas eu besoin de s’adresser aux complaisances ou à l’amitié d’un pharmacien ; car sur les planches du laboratoire de son père, il eût pu trouver une douzaine de petites fioles noires dont le contenu, en trois ou quatre secondes, l’aurait prestement débarrassé du fardeau de la vie. Mais Philippe était plus philosophe ; il s’éloigna fièrement de M. et Mme Halliday, pendant quelque temps après leur mariage, ce qui fit penser qu’il se considérait comme assez malheureux. Mais la prudence qui avait toujours été la conseillère de Philippe fut également sa consolatrice dans cette légère crise : elle l’amena à juger assez vite que la réussite de sa tentative amoureuse eût peut-être été, en somme, la plus mauvaise opération qu’il eût pu faire au début de sa carrière.
Georgina n’avait pas de fortune ; cela dit tout. L’expérience aidant sa philosophie naturelle, le jeune dentiste ne tarda pas à découvrir que la vie des habitants les plus fortunés de Barlingford ressemblait tout à fait à celle des canaris. Ils étaient enfermés dans une jolie cage, avec abondance de grains et d’eau. La cage est propre, le vieux oiseau s’y trouve bien et n’est pas tourmenté du désir de voir des horizons nouveaux ; mais de temps en temps surgit une couvée de jeunes descendants qui battent de l’aile, sont plus impatients, et ne demandent qu’à prendre leur volée au plus tôt et à courir le monde librement. Avant qu’une année se fût écoulée depuis le mariage de Georgy, son premier amoureux s’était complètement résigné et était dans les meilleurs termes avec son ami Tom. Il dînait avec le jeune ménage et du meilleur appétit. La façon dont Philippe envisageait les conditions de sa vie avait, en effet, creusé entre lui et Georgina un abîme bien plus profond que ne l’avait fait la cérémonie de la paroisse d’Hiley. Philippe était arrivé à penser que l’existence de sa ville natale n’était qu’une sorte de végétation animale, pareille à celle des crabes, des huîtres, et autres pauvres bêtes inférieures. Il comprenait alors que par delà les dernières maisons de son petit bourg, il y avait un monde immense, où un homme comme lui pourrait faire quelque figure. Ce monde l’attirait, ce qui est simple.
Une fois certain qu’il ne ferait rien de digne de lui à Barlingford, Sheldon pensa tout de suite à Londres. À ce moment même son père mourut très à propos. Philippe céda sa clientèle à un jeune praticien plus modeste et accourut dans la grande ville, où il fit l’infructueux essai d’établissement que nous avons dit.
Sheldon avait perdu quatre ans à Londres et il s’en était écoulé neuf depuis le mariage de Georgy. Pour la première fois il allait se trouver en face du sort heureux ou malheureux qu’il avait un instant convoité ; de la femme qui l’avait dédaigné pour un autre. Il résolut de juger la situation avec la froideur d’un anatomiste ; cette résolution, du reste, ne lui coûta pas beaucoup ; elle lui fut même facilitée par les circonstances. Les jeunes époux demeuraient chez lui ; dînaient à sa table ; c’étaient deux natures expansives et bavardes ; ils étaient de ces gens qui, à tout bout de champ, devant les étrangers, parlent de leurs affaires, se chamaillent, laissent voir au premier venu le fond de leur intimité.
Sheldon avait la sagesse d’observer une stricte neutralité ; il prenait un journal lorsque la petite discussion commençait et le quittait lorsqu’elle était finie, avec la plus parfaite apparence d’indifférence. Mais il est probable que le mari et la femme n’appréciaient qu’à demi cette réserve ; ils eussent probablement préféré qu’il jugeât en dernier ressort ; cela eût passionné le débat, c’est-à-dire l’eût fait plus intéressant. Pendant ce temps, Philippe les observait silencieusement par-dessus son journal et faisait à son aise ses remarques sur chacun. Qu’il fût satisfait de voir que les amours passées n’avaient pas toujours raison ou qu’il vît avec quel plaisir son rival avait le dessous, rien, dans sa figure, ni dans ses façons, ne le faisait deviner.
La naïve, mais bourgeoise gentillesse de Georgina s’était transformée. C’était alors une très-avenante jeune femme. Son teint et ses joues roses n’avaient rien perdu de leur ancienne fraîcheur ; ses longs cheveux châtain clair étaient aussi doux, aussi brillants que lorsque, toute jeune fille, elle les tressait pour aller au théâtre de Barlingford. Mignonne et frêle, Georgina avait eu une éducation ordinaire ; elle s’imaginait avoir acquis toute la science humaine en apprenant l’abrégé historique de Goldsmidt et les éléments de la Grammaire française. De plus, elle considérait comme le dernier mot de la perfection de la toilette une robe de moire antique et une grosse chaîne d’or ; et à ses yeux une maison lourdement meublée, un cheval et un gig, étaient l’expression la plus élevée de la splendeur terrestre et de la prospérité.
Telle était la frivole créature que Sheldon avait autrefois admirée et à laquelle il avait été sur le point d’offrir des vœux éternels, En l’étudiant maintenant, il se demandait comment il avait pu avoir d’elle une si haute opinion, mais il n’avait pas beaucoup de temps à donner à cette étude abstraite et fastidieuse ; il avait mieux à faire : notamment à s’occuper de ses propres affaires et de l’état dans lequel elles se trouvaient.
De leur côté M. et Mme Halliday étaient tout entiers ou à leurs affaires ou à leurs plaisirs, comme cela se trouvait ; ils aimaient beaucoup à s’amuser. Dans le jour ils allaient aux expositions et le soir aux théâtres, puis revenaient à la maison faire de petits soupers, après lesquels les deux camarades causaient amicalement avec grand renfort d’eau-de-vie et d’eau chaude.
Malheureusement pour la pauvre Georgy, ces heureux jours étaient souvent troublés par des nuages orageux. Cette pauvre petite femme était affligée de cette terrible fièvre intermittente : la jalousie, et le gros Thomas était un de ces hommes qui ne peuvent pas rencontrer une femme sans lui faire hic et nunc, un bout de cour. De plus, n’ayant par lui-même aucune ressource intellectuelle, il recherchait la compagnie. Cette disposition avait assez vite fait de lui un habitué des parloirs de tavernes et des petites réunions de sportsmen toujours à l’affût d’une partie de plaisir. Il en résultait qu’il laissait souvent en tête à tête son agréable maison et sa jeune femme. La pauvre Georgy trouvait ainsi de nombreuses occasions de nourrir ses craintes et ses soupçons jaloux ; elle se demandait sans cesse où pouvait être un homme aussi souvent absent de chez lui. Elle n’avait jamais été très-éprise de son mari, mais ce n’était pas une raison pour qu’elle ne fût pas très-jalouse. Cette jalousie se manifestait d’une façon maussade et fatigante, plus terrible à supporter que la fougue vengeresse de Clytemnestre. C’était vainement que Halliday et ses gais compagnons, ses amis, lui certifiaient l’innocence arcadienne des courses de chevaux et la pureté exquise de l’atmosphère fumeuse des parloirs de tavernes. Les soupçons de Georgy étaient trop vagues pour être réfutés, mais cependant assez fondés pour être l’occasion de bouderies, de reproches, toutes choses qui sont, par essence, les plus féminines et les plus ennuyeuses du monde.
Cependant l’honnête et bruyant Tom faisait tout ce qu’il pouvait pour lui prouver sa bonne foi et son attachement : il achetait à sa femme autant de robes de soie et de chapeaux qu’elle pouvait en porter. Il fit un testament par lequel il l’instituait sa seule légataire, et poussa même la sollicitude jusqu’à faire assurer sa propre vie, à différentes compagnies, pour un capital de cinq mille livres.
« Je suis d’une nature à pouvoir être enlevé subitement, disait-il à Georgy, et votre pauvre père désire que je mette en bon ordre tout ce qui vous concerne. Je ne suppose pas que vous vous remarierez, ma chère ; par conséquent, je n’ai pas de précautions à prendre pour la petite fortune de Charlotte. Si je dois la confier à quelqu’un, il vaut mieux que ce soit à ma petite femme qu’à un beau parleur de tuteur qui spéculera à la Bourse avec l’argent de ma fille et prendra la route de l’Australie lorsque tout sera mangé. Si vous voulez avoir confiance en moi, ajouta-t-il d’un ton de reproche, je vous prouverai que j’ai confiance en vous. »
Sur quoi, la pauvre petite Mme Halliday murmurait d’un air plaintif que ce n’était pas sa fortune et les assurances sur la vie dont elle avait tant besoin, mais d’un mari qui restât chez lui, heureux de la tranquillité de son foyer. Le pauvre Tom promettait de s’amender et tenait facilement sa promesse jusqu’à la prochaine occasion. À dire vrai, ce n’est pas commode à un homme jeune et généreux, solidement établi, qui fait valoir sa propre terre, qui a trois ou quatre bons chevaux dans son écurie, et une cave bien garnie, de rester froid devant les avances d’une camaraderie cordiale et sincère, j’en appelle aux bons compagnons ? qu’ils répondent.
À Londres, Halliday retrouva un de ses préférés. George était celui des deux frères qu’il aimait le mieux. George l’entraînait souvent hors de son tranquille séjour pour le conduire dans quelque mystérieux repaire, d’où il ne sortait qu’après minuit, sentant le vin, la démarche peu assurée, et les vêtements empestant la pipe.
Il était cependant toujours de bonne humeur, même après ces escapades et ne cessait de protester dans son langage campagnard qu’il n’y avait pas le moindre mal.
« Sur ma parole, vous savez, ma chère, George et moi avons pris une demi-douzaine d’huîtres, un cigare, une bouteille de pale ale, et nous sommes rentrés de suite après. »
La pauvre Georgy ne se sentait nullement rassurée par ces protestations d’huîtres et de cigares, dites d’une bouche empâtée par un mari qui avait peine à se soutenir. Ce séjour à Londres, si charmant à son début, menaçait de devenir plus difficile, plus fâcheux. George et ses amis avaient fini par faire du jeune fermier à peu près ce qu’ils voulaient. Il n’était jamais au logis, et Georgy n’avait d’autre distraction, durant les longues et humides soirées de mars, que ses travaux de couture à la lumière du gaz dans le salon de Sheldon, pendant que celui-ci, qui prenait rarement part aux plaisirs de son frère et de ses amis, travaillait en bas, dans son cabinet de torture, à quelque appareil de dentition mécanique.
Fitzgeorge Street, quoique particulièrement enclin à découvrir chez ses voisins les indices d’embarras pécuniaires ou des histoires où la morale fait piteuse figure, ne trouva aucun scandale à signaler à l’occasion de la visite de M. et Mme Halliday à leur compatriote et ami. Le bruit s’était répandu au dehors, grâce à l’éloquence de Mme Woolper, que Sheldon avait autrefois prétendu à la main de la dame et avait été éconduit ; les voisins s’étaient en conséquence mis en campagne, ne demandant qu’à pouvoir découvrir chez le dentiste quelque retour du passé. Il y aurait eu de joyeuses discussions dans les cuisines et arrière-boutiques si Sheldon eût montré des attentions particulières pour sa jolie hôtesse ; mais l’on arriva positivement à savoir, toujours par Nancy et par la servante, ce phénomène de paresse et d’iniquité, que non-seulement Sheldon n’était nullement aux petits soins auprès de la jeune femme, mais qu’il la laissait seule pendant des heures entières, en l’absence de son mari, nez à nez avec ses travaux à l’aiguille, tandis que lui préparait des onguents destinés à réparer les désastres que le temps inflige à la beauté.
La troisième semaine de la visite de M. et Mme Halliday approchait de sa fin et le jeune fermier n’avait encore pris aucune décision, quant aux choses qui l’avaient amené à Londres. La vente de la ferme d’Hiley