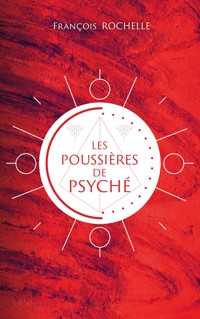
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Il arrive encore que de véritables petits trésors archéologiques soient découverts par pur hasard. C'est le cas de cette tombe pour le moins surprenante dénichée par des enfants dans les vestiges souterrains d'une nécropole antique à Alexandrie, celle d'un étrange philosophe de la période hellénistique du nom de Bolos de Mendès. L'astrophysicien Georges Rapiaud rejoint une équipe d'archéologues en plein tournage de documentaire afin d'en percer le mystère. La découverte est de taille : Bolos de Mendès aurait réussi à mettre à jour le principe le plus fondamental et le plus incroyable de la science et de la physique, celui de la création pure et simple de la matière. Le plus préoccupant est que son véritable héritage ne se résume pas à de simples théories gribouillées dans sa tombe. Georges Rapiaud et ses amis devront user de tous les moyens pour que ne se produise une véritable apocalypse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 434
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
On cherche le bien sans le trouver, et l’on trouve le mal sans le chercher.
Démocrite d’Abdère (460 - 370 av. J.-C.)
Sommaire
Prologue
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
ÉPILOGUE
Prologue
Neuvième jour du mois Appellaios
An 16 du règne de Ptolémée V (190 av. J.-C.)
D’un bleu pâle encore lumineux à l’ouest jusqu’au noir profond à l’est, le dégradé que formait le ciel était parfait ce soir-là. Pas un nuage pour en altérer sa pureté. Les pieds solidement ancrés dans le sable, cambré, le regard porté sur la nuit tombante, il scrutait l’insondable, pensif. Lui aussi, songea-t-il, se trouvait d’une certaine manière au centre de deux mondes que tout oppose, celui de la clarté de ses innombrables acquis et celui de l’abyssale immensité de l’inconnu. Demain, assurément, cette frontière invisible qui le séparait de l’ultime savoir serait franchie.
Un frisson le parcourut. La fraîcheur avait enveloppé le désert et chassé la chaleur étouffante de la journée. Le tribon qu’il portait n’était plus adapté à une heure si tardive. Sans y faire attention, il se drapa un peu plus dans la tunique grise de lin grossier que Socrate lui-même préconisait pour chaque philosophe, allant jusqu’à théoriser sur ce vêtement ample et la liberté de penser qu’il favorisait.
Malgré l’air glacé qui se faufilait dans la simple étoffe, l’homme resta à contempler le crépuscule sans bouger. De nouvelles étoiles, à chaque seconde, perçaient avec toujours plus de témérité l’obscurité. Ces yeux embrassèrent alors avec volupté l’essaim naissant de points lumineux scintillants, symbole évident d’une existence matérielle derrière le néant.
Une voix le héla timidement derrière lui, en bas de la dune. Il se retourna vers son élève et disciple. Plusieurs autres fidèles l’entouraient. Ils attendaient tous, impatients, le verdict de leur maître à penser. Ce dernier pointa un endroit précis de son doigt, là où une partie du sol paraissait plus ferme et rocailleuse, et clama avec aplomb :
« C’est l’emplacement que je choisis. Que tout y soit disposé dès les premières lueurs du soleil. »
Chacun resta figé, la respiration coupée, comme soufflé par ce que ces mots impliquaient : demain serait enfin le grand jour. Puis les sourires apparurent, les regards complices, les tapes dans le dos, les rires. C’était toute leur joie et leur excitation, jusque-là dûment contrôlées, qui jaillissaient d’un coup.
Le maître descendit calmement la dune pour les rejoindre et se diriger en leur compagnie vers le campement. Lui le savait bien, mais se gardait pourtant de le révéler : qu’impor-tait l’endroit précis. Le lieu choisi n’aurait en réalité aucune incidence sur le bon déroulé de l’expérience. Se retrouver éloigné de toutes civilisations alentour n’avait que pour unique but d’être à l’abri des regards indiscrets.
Tout en foulant le sable, il ne put refréner l’envie de contempler à nouveau la voûte céleste, avec cette fois un sentiment de puissance et de fierté, enivré par l’enjeu de sa tâche, persuadé de la réussite de ce qu’il avait mis si longtemps à élaborer et à finaliser, sans se douter un seul instant des véritables risques encourus, ni même préjuger de la colère imminente des dieux.
Chapitre I
Il n’avait vraiment pas la tête à ça ! Une émission de télévision pseudo-éducative d’une chaîne quelconque, tout aussi populaire qu’elle soit, il n’en avait rien à faire ! En tout cas, pas aujourd’hui, pas en ce moment. Il était bien trop occupé par son travail et ses recherches. Pourtant, il savait qu’il n’avait pas le choix. Sa hiérarchie avait été catégorique à ce sujet : l’institut de recherche avait besoin de fonds et devait absolument accepter ce genre d’exercice médiatique pour se faire connaître et exister un tant soit peu dans l’univers de la science. Refuser cet entretien impliquerait des heures de palabres à se justifier avec le directeur et une perte de temps d’autant plus importante. Le prix à payer pour éviter cet écueil était, somme toute, de prendre sur soi et de se soumettre à la corvée.
Madame Armond passa la tête par la porte.
« Georges, ils sont là. Ils vous attendent dans la salle de réunion. »
Le ton était ferme et direct. Cela faisait quatre ans qu’elle était la secrétaire de Georges Rapiaud, éminent chercheur en astrophysique, et elle le connaissait assez bien pour savoir à quel moment il était préférable de garder ses distances et de rester factuel afin d’esquiver son sale caractère.
Georges marmonna. À 62 ans, il fallait qu’il fasse le clown alors qu’il avait tant de choses à faire. Il avait cette hantise de vieillir sans arriver à boucler une seule théorie à la hauteur de ses ambitions. Ses recherches n’étaient d’ailleurs plus un travail, mais une véritable obsession.
« On est bien d’accord, Nicole, pas plus de trente minutes. Si ça traîne, vous volez à mon secours et vous venez me chercher sous n’importe quel prétexte ! Allez, c’est parti pour une interview débile ! »
Quand Georges débarqua, l’air maussade, dans la salle de réunion et qu’il découvrit l’équipe de tournage assise tranquillement sans que le matériel soit déjà installé, son sang se mit à bouillir. Un jeune homme en veste à carreaux, moustache raffinée sous le nez, bondit de sa chaise et s’avança tout souriant :
« Monsieur Rapiaud, ravi de vous rencontrer. Charles Ravel, journaliste en charge du sujet sur Newton pour l’émission “Ça y est ! J’ai tout compris” qui sera diffusée le mois prochain. »
Le cameraman et l’ingénieur du son, de leur côté, se levèrent pour serrer la main au chercheur.
« Avant tout, dit Georges sèchement, comme vous devez le savoir j’ai très peu de temps à vous consacrer, et je suis très inquiet en constatant que votre caméra ne soit pas déjà prête à tourner.
— Mais, je… nous… balbutia le journaliste, nous attachons de l’importance à la mise en images et cette salle de réunion, avec ses grands murs blancs, n’est vraiment pas propice à un joli cadre pour votre interview… Un autre endroit, comme votre bureau par exemple, serait peut-être… plus… intéressant ? »
Face à l’exaspération non dissimulée du chercheur, sa voix s’étrangla sur ses derniers mots. Il sentit que le prestigieux Georges Rapiaud était sur le point de lui claquer la porte au nez et qu’il allait rentrer bredouille à la rédaction.
« Bon, dit le journaliste précipitamment pour prendre de court son interlocuteur, pas de souci, ce sera très bien ici. »
Puis, s’adressant à son cameraman :
« Allez, Jeannot, tu te boostes un peu, tu me fais un joli éclairage et on tourne dans cinq minutes maxi, OK ? »
Le cameraman regarda le scientifique avec un léger sourire, puis, calmement, se tourna vers Charles Ravel pour lui répondre d’un simple « OK ».
L’attitude du technicien détendit Georges. Ça le rassurait de voir que, lui aussi, n’était pas dupe du petit air hautain du journaliste. Il l’observa en train de déballer tranquillement son matériel sans prêter attention au ton arrogant de son chef. Ce cameraman, qui ne devait pas encore avoir quarante ans, semblait même supporter ce surnom ridicule de “Jeannot” sans rechigner.
« Voilà un garçon qui sait prendre de la hauteur, pensa le scientifique. Je ferais bien de prendre exemple sur lui et de mettre de l’eau dans mon vin. Plus vite je me débarrasse de cette satanée interview, plus tôt je pourrai retourner à mon travail. De toute façon, je n’ai aucune envie d’avoir à me justifier devant le directeur de l’institut pour avoir jeté dehors, manu militari, une équipe télé. »
Jean, de son vrai prénom, prépara la caméra qu’il posa sur le trépied. Pierre, le preneur de son, s’occupa d’installer un microphone HF sur l’encolure de la veste du chercheur.
Pendant ce temps, Charles expliqua à ce dernier ce qu’il attendait de l’entretien filmé. Il souhaitait faire découvrir aux enfants, avec l’aide d’un scientifique de renom, la notion de gravité et les principes généraux de la théorie de Newton. Georges l’écoutait d’une oreille distraite tout en observant la mise en place technique. Jean avait fermé les rideaux pour faire l’obscurité la plus totale et éviter les contraintes de la lumière existante. Il disposa par la suite plusieurs petits éclairages aux faisceaux très focalisés dans le but de recréer l’ambiance désirée. Cela fit penser à Georges que lui aussi cherchait souvent à faire le vide de tout dans l’espoir de prendre le plus de recul possible… faire abstraction des éléments présents ; écarter chaque notion acquise qui pollue la démarche spirituelle et scientifique ; repartir de zéro pour rebâtir, brique par brique, une nouvelle manière de penser, un cheminement inédit vers de nouvelles théories. Sortir des sentiers battus et avoir un regard neuf étaient, depuis plusieurs mois, sa principale préoccupation. Voilà comment accéder à une vision différente du monde et espérer comprendre l’Univers : éteindre la lumière qui aveugle pour ensuite gérer à loisir sa propre émission de photons et refaçonner son propre éclairage.
Georges n’entendait plus ce que racontait le journaliste.
Son cerveau entier s’enlisait dans une avalanche de pensées tourbillonnantes où une réflexion en provoquait implacablement une autre. Il alla jusqu’à se dire que Dieu aussi, dans la Genèse, avait utilisé cette méthode. À partir de rien, il avait d’abord créé une terre informe et vide. Il avait ensuite décidé de faire apparaître la lumière. Sans elle, il lui aurait été impossible d’organiser le monde qu’il souhaitait. Et voilà que ce cameraman, juste sous ses yeux, sans s’en douter, prenait possession de cette salle de réunion, comme Dieu avait pris possession de l’Univers. Si ça pouvait être aussi simple pour lui… nombre de fois il avait tenté de faire table rase de toutes les notions scientifiques qui contaminent sans cesse sa pensée…
« … et tout ça, bien sûr, en des termes simples pour bien se faire comprendre aussi des plus jeunes. »
Les mots du journaliste extirpèrent le chercheur de ses rêvasseries et le firent revenir à la triste réalité.
« Allez, songea-t-il résigné. Jouons le jeu de cette interview, qu’on en finisse ! »
L’ingénieur du son, casque sur les oreilles, les yeux rivés sur les diodes de sa mixette, murmura entre ses dents un « c’est bon pour moi ». Le cameraman se glissa derrière l’appareil de prise de vues et, tout en faisant un dernier réglage, confirma que lui aussi était prêt.
Georges répondit alors au journaliste. Il fit l’effort de formuler ses propos le plus clairement possible :
« La gravité est une force que l’on connaît tous, bien sûr.
Nous avons sans cesse les pieds posés sur le sol et il est difficile de contrarier cet état de fait. On a beau sauter le plus haut que l’on peut, on retombe invariablement sur terre.
Notre constitution de bipède est entièrement conditionnée par cette force invisible : que ce soit notre musculature pour se déplacer malgré la pesanteur, ou notre solide squelette pour ne pas s’écrouler sur nous-même, ou bien encore notre système veineux capable de remonter le sang vers le cœur. La composition intrinsèque de notre corps prend en compte cette attraction constante vers le centre de la Terre.
« Pourtant, nous n’y apportons absolument aucune attention et nous ne nous préoccupons presque jamais de cette force que nous subissons à chaque moment de notre vie… excepté lorsque l’on regarde, certains matins, l’aiguille de la balance afin de se rassurer sur son propre embonpoint. »
Satisfait de son mot d’esprit qu’il fut le seul à trouver d’une grande finesse, il marqua un sourire en coin, puis continua plus sérieusement :
« La gravitation est un phénomène tellement évident dans notre vie de tous les jours qu’on en oublie son existence.
Cependant, ce formidable et étrange pouvoir d’attraction est là, en chaque chose.
— Pouvez-vous nous parler d’Isaac Newton et de l’épisode de la pomme ? demanda le journaliste désireux d’entrer un peu plus dans le vif du sujet.
— Isaac Newton est un savant anglais du 17e siècle.
Il n’était pas, bien sûr, le premier à avoir observé le phénomène de la gravitation ni même le premier à l’avoir étudié. La manière qu’il a eue d’appréhender cette force a néanmoins apporté au monde l’une des pierres fondatrices de notre physique moderne : la théorie de la gravitation universelle. On raconte qu’il en aurait eu l’idée en recevant une pomme sur la tête… et il semblerait que ce ne soit pas une légende. Pour partie en tout cas. Car si aucun fruit ne s’est écrasé sur son jeune crâne bouillonnant d’intelligence, on rapporte en effet que c’est en se promenant tranquillement dans un jardin et en observant la chute inopinée d’une pomme qu’auraient jailli de son esprit des évidences scientifiques jusque-là inexprimées. Il s’est demandé pourquoi les pommes tombaient toujours sous leur arbre et jamais à côté.
C’est à ce moment précis qu’il aurait pris conscience de cette chose capitale : il fallait bien qu’il y ait une force pour l’attirer vers le centre de la Terre. Il considéra la Lune et se dit que cette même force devait aussi s’exercer sur elle malgré la distance. Sans elle, le satellite naturel s’échapperait de son orbite pour poursuivre sa course au fin fond de l’Univers.
Cette force devenait une évidence : c’était la gravitation !
« Non content de ce constat, en regardant à nouveau le fruit à ses pieds, il comprit un autre fait scientifique marquant : si la Terre attire assurément la pomme, la pomme de son côté attire aussi la Terre. Ceci dans une moindre mesure, bien sûr.
« Ces concepts vont aboutir par la suite à une définition de l’attraction universelle. Vous devez la connaître, monsieur Ravel ?
— Heu, bien entendu, hésita le journaliste. Mais il serait bon pour les téléspectateurs que ce soit vous-même qui nous la donniez…
— Isaac Newton résume sa théorie comme cela : les corps s’attirent de façon proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Cela signifie qu’il est question d’une force qui se trouve en chaque chose et qui interagit avec son entourage direct plus ou moins intensément, mais d’une manière continue. L’amplitude de l’attraction dépend de sa masse, d’une part, et de la distance, d’autre part. Il est incroyable d’imaginer que l’inspiration géniale de ce savant a surgi alors qu’il ne faisait que flâner dans un verger. Et cela en ne pensant à rien ! »
Georges s’arrêta soudainement de parler, se laissant de nouveau envahir par le galop de ses réflexions.
« Voilà une bonne idée, se dit-il à lui-même en oubliant jusqu’à l’existence de l’équipe de télévision en face de lui, et pourquoi pas une petite balade dans un verger ? J’aurais peut-être moi aussi un éclair de génie, une nouvelle vision du monde ? Pas de problème pour la balade, je m’en sens capable… mais ne penser à rien en flânant, ce n’est pas trop mon style. C’est bien là le reproche des quelques femmes que j’ai rencontrées dans ma vie. Elles ont toutes bien compris qu’avec mes obsessions, il ne restait guère de place pour les moments simples tant désirés par les couples ordinaires, comme, par exemple, celui de se contempler dans les yeux, bêtement, et attendre que le temps passe. C’est pour cette raison qu’elles ont successivement abandonné l’espoir d’une vie commune et qu’elles ont préféré me laisser seul avec mes idées fixes.
« Idées fixes, oui, c’est bien ça ! J’ai si souvent l’impression de m’approcher du but… Tout près, jusqu’à ressentir cet Univers autour de moi qui gravite… je la touche presque du doigt, cette équation qui réunifie le “tout”… je l’entraperçois, cette formule fondatrice de l’existence... pratiquement nette dans un premier temps, puis, malheureusement, de plus en plus floue… et pour finir : plus rien ! Je me retrouve de nouveau bloqué, empêtré dans mes idées fixes. »
« Hum, hum… » osa le journaliste qui n’avait plus la patience d’attendre que le scientifique revienne de lui-même de ses très lointaines pensées.
« Oups, pardon ! réagit Georges Rapiaud qui chercha instantanément à rattraper le fil de son histoire comme un équilibriste. Je disais, ah oui... que cette théorie de la matière qui attire la matière, cette gravitation universelle, était le début d’une nouvelle aventure… mais qui, hélas, demeure une aventure tout à fait d’actualité, car il reste encore beaucoup à découvrir. Oh oui, beaucoup… soupira l’astrophysicien.
Vous semblez surpris, monsieur Ravel, mais je vous le demande : que sait-on, en définitive, de cette incroyable et paisible force ? On est capable de l’observer, de l’utiliser et de la quantifier, mais on est toujours incapable d’en connaître ses fondements élémentaires. Les scientifiques cherchent immuablement à mettre en place une théorie du tout qui expliquerait une bonne fois pour toutes l’ensemble des forces de l’Univers, dont fait partie notre fameuse “gravitation”.
Plus on avance dans les recherches, plus les équations sont complexes. On est passé, dans l’Histoire de la science, de la physique classique, qui inclut les théories de Newton, à la relativité d’Einstein. Maintenant arrivent sur le tapis les incroyables et foisonnantes théories des cordes. Les idées fusent, mais les certitudes sont fragiles. Comment expliquer de manière fiable et fondée cette puissance invisible qui existe entre deux objets ?
« Laissez-moi vous faire part des différentes solutions qui s’offrent à nous. Une des hypothèses est la déformation de ce que l’on appelle l’espace-temps. Elle ferait se rapprocher les objets, un peu comme deux balles qui flotteraient sur l’eau et qui se rapprocheraient au creux d’une vague. Une autre supposition met en scène une particule élémentaire de l’atome : le graviton. Chaque atome contiendrait cette particule qui permettrait l’attirance à distance avec d’autres atomes… Le graviton serait alors le chaînon manquant de la gravitation. Les travaux sur le sujet sont palpitants, mais, en tout état de cause, le mystère reste entier… Quelle est donc enfin cette force d’attraction ? Certains sont persuadés de le savoir… moi je doute. »
Le journaliste sentait que le chercheur s’enlisait dans des considérations confuses qui n’apportaient plus rien à son reportage.
« Je vous remercie, c’est une belle conclusion. Je crois que j’ai là tous les éléments pour construire mon sujet.
— Oh, mais il y a encore bien des choses à dire…
— Ce n’est pas nécessaire, je dois rester simple et clair. Le résultat final ne durera que trois minutes et il sera destiné à un très large public. »
Le journaliste s’adressa ensuite à l’équipe :
« C’est bon les gars, vous pouvez remballer ! »
Jean, tout en enlevant la caméra du trépied, prit la parole contre toute attente et demanda au scientifique :
« Excusez-moi, je peux me permettre une question bête ? »
Georges, qui avait les deux mains de l’ingénieur du son sous le menton afin d’extraire le microphone du col de la veste, risqua un léger mouvement de tête pour regarder le cameraman.
« Je vous en prie », lui répondit-il, puis, se disant à lui-même : « on n’en est plus à une question bête, ce matin. »
« Comment peut-on être scientifiquement sûr, enchaîna le technicien, que ce qu’on appelle “la gravité” consiste dans l’attirance des objets ? »
« Comprends rien à ce qu’il dit ! » pensa-t-il énervé, et de lui formuler gentiment :
« C’est-à-dire ?
— Je veux dire… Est-on sûr que les choses s’attirent réellement ?
— Ben, quoi d’autre ?
— Je ne sais pas… pourquoi pas “poussées” l’une vers l’autre ? Si on a du mal à définir ce qu’est la force de gravité et la raison pour laquelle deux corps se rapprochent, comment peut-on être certain qu’il s’agisse d’une attraction ? »
Le journaliste leva les yeux au ciel et l’interrompit :
« Bon, Jeannot, tu ferais mieux de ranger ton matos.
Monsieur a autre chose à faire que de t’expliquer que l’attraction, ça attire ! Allez, zou ! »
Georges, ignorant l’intervention du journaliste :
« De quelle force pourrait-il s’agir ? Vous voulez remettre au goût du jour la théorie de l’éther ? D’un fluide en lieu et place du vide ? »
Jean répondit, les genoux à terre, tout en rangeant sa lumière :
« Je n’en sais rien, c’est juste une question qui me trotte… pas l’éther, bien sûr… en fait, pas l’éther en tant que fluide mécanique tel qu’on l’a déjà imaginé. On parle toujours de la force d’attraction comme provenant de l’atome lui-même.
Mais cette force pourrait découler de l’environnement de la matière, plutôt que de cette dernière.
« Vous venez de nous expliquer que la “courbure de l’espace-temps” pouvait être la cause de ce qu’on appelle l’attraction. Cela signifie alors que le vide peut se modeler et, après tout, qu’il n’est pas si vide que ça, non ? Pourquoi ce vide, qui apparaît relatif, n’aurait pas lui-même une influence directe sur la matière ? »
Charles Ravel voulut mettre un terme aux divagations de son cameraman et s’écria, les mains sur la tête, prêt à exploser :
« Jeannot ! »
Pierre, lui, sentant la tempête gronder, finissait de ranger son propre matériel dans la plus grande discrétion. Jean ferma la dernière valise sans dire un mot tandis que Georges fixait, immobile, un endroit imaginaire dans un coin du plafond. Charles s’efforça de se calmer en regardant nerveusement s’il avait des messages sur son téléphone. Quand son équipe fut enfin prête à partir, il se retourna avec une telle énergie en direction du chercheur que ce dernier sortit de sa léthargie en sursautant.
« Merci infiniment pour cet entretien, monsieur Rapiaud.
— Hein, heu… oui, au revoir… c’était, comment dire… avec plaisir. »
Jean prit sa caméra en bandoulière, salua le scientifique puis suivit ses deux collègues dans le couloir. Georges resta seul dans la pièce. Il se rassit, doucement, les idées dans le vague, le regard vers la fenêtre. Au loin, un quart de lune pouvait se deviner entre deux nuages. Il la contempla de longues minutes sans bouger quand son assistante arriva.
« J’ai aperçu l’équipe télé qui s’en allait, mais vous, je ne vous voyais pas revenir. Je vous rappelle que vous avez une visioconférence dans cinq minutes. »
Georges Rapiaud se retourna vers elle, songeur, et, d’un calme olympien, lui demanda :
« Madame Armond, rendez-moi un petit service, trouvez-moi le numéro du cameraman qui était là il y a un instant, en toute discrétion. Pas celui du journaliste. Surtout pas lui. Juste celui du cameraman. Son prénom est Jean.
C’est tout ce que je sais. »
Chapitre II
Jean enfonça maladroitement une paire de bouchons antibruit dans le creux de ses oreilles. Les épaules qui le comprimaient de part et d’autre l’obligeaient à garder les coudes collés contre lui, ce qui compliquait la manœuvre. Il regrettait son enregistrement tardif au comptoir d’ Egyptair.
Les seules places encore libres étaient celles situées au centre des rangées alors qu’il aurait nettement préféré être assis près d’un hublot. Il était maintenant pris au piège entre deux solides Égyptiens qui réduisaient son espace vital à son minimum. Mieux valait s’isoler en se coupant du bruit entêtant des moteurs et tenter de trouver le sommeil. C’était sans compter sur ses deux voisins, qui, non contents d’empiéter sur ses accoudoirs, entamèrent une discussion de leur voix tonitruante comme si sa présence n’était en rien signifiante. Les quatre heures et demie de vol en direction du Caire n’allaient pas être une partie de plaisir.
Sur le point de se laisser démoraliser par tant d’inconfort, il se réfugia dans le souvenir du moment passé avec sa femme avant son départ. Quand leurs horaires respectifs le permettaient, ils ne perdaient jamais l’occasion de boire un café ensemble dans la cuisine afin de bien démarrer la journée. Ce matin, tasse à la main, sa femme s’était montrée plus anxieuse que d’habitude. Elle trouvait hasardeux de partir en Égypte durant cette période de tension que le pays traversait. La sécurité des touristes et des étrangers n’y apparaissait pas complètement garantie. Jean la rassura et lui expliqua que la situation était devenue beaucoup plus calme et qu’il ne fallait pas se laisser influencer par les dérives médiatiques de ces derniers temps. Le risque d’attentat n’était plus d’actualité dans la région et on lui avait certifié, de plus, qu’ils auraient une escorte militaire si cela se révélait nécessaire.
Le moment de la séparation était venu. Le taxi attendait en bas de chez eux. Elle se dépêcha de lui glisser à l’oreille des mots d’amour sans arriver à apaiser la douleur de ce nouveau départ. Un pincement au cœur assaillit le cameraman durant l’ultime embrassade. Il culpabilisait d’abandonner une fois de plus la personne avec qui il avait pourtant décidé de vivre. Il monta dans le taxi, l’estomac noué. Le chauffeur démarra et, sans aucun état d’âme, prit la direction de l’aéroport.
Le tournage auquel il se rendait était tout à fait imprévu.
Jean avait immédiatement accepté ce nouveau contrat dans la mesure où il n’avait pas de travail attendu dans les jours à venir. Son statut d’intermittent du spectacle ne lui garantissait pas d’emplois réguliers et il était dépendant des propositions de tournage pour le moins aléatoires. Il avait été contacté en urgence deux jours plus tôt par une société de production qu’il ne connaissait pas encore. Elle s’appelait “Vertige production” et cherchait désespérément à remplacer le cadreur qui avait débuté la mise en images d’un documentaire à Alexandrie. Le technicien avait dû être rapatrié en France au bout d’une semaine suite à une intoxication alimentaire sévère. Le tournage ne pouvait s’interrompre pour autant et c’est à Jean qu’il avait été demandé de prendre la relève au pied levé, ce qu’il avait consenti sans hésiter, même s’il redoutait toujours un peu de rencontrer une équipe avec laquelle il n’avait jamais travaillé. Il espérait qu’elle serait sympathique et qu’il y trouverait vite sa place.
Ce ne pouvait en tout cas pas être pire que le reportage qu’il avait fait, il y a de cela trois jours, sur Newton et la gravité.
Charles, le journaliste, avait décidément la grosse tête et ne l’avait pas lâché d’une semelle. Ce tournage n’avait pas été des plus agréables. Dommage, le sujet était intéressant et le chercheur lui plaisait bien. Il aurait aimé discuter plus longuement avec le scientifique, mais la relation difficile qu’il entretenait avec Charles ne lui permettait de toute évidence pas ce genre de liberté.
Jean s’amusait souvent à penser à différentes théories sur l’astrophysique et la matière. Il ne le faisait pas d’une manière très sérieuse, mais, en amateur, il éprouvait un véritable plaisir à échafauder ses propres hypothèses, par jeu intellectuel. Une sorte de jouissance le submergeait en tentant d’imaginer l’inimaginable aux frontières de l’infiniment grand et de l’infiniment petit.
L’avion poursuivait son vol et franchissait maintenant les Alpes. Les voix graves des deux Égyptiens continuaient de résonner dans ses oreilles malgré les protections auditives en mousse. La discussion cacophonique n’en finissait pas. Jean leur aurait bien demandé d’échanger leur place pour qu’ils soient côte à côte et que lui puisse trouver le sommeil, mais il n’eut pas le courage de les interrompre. Il mit un terme à son ambition de dormir durant le trajet et posa sur ses genoux le sac à dos qu’il avait gardé sous le siège. Encastré entre les deux colosses, il eut de la peine à en extraire son guide touristique. Puisqu’il allait se frotter à l’archéologie et à la période de l’Antiquité égyptienne, autant profiter de ce temps pour s’instruire un peu. Machinalement, il feuilleta à rebours les pages de l’ouvrage et s’arrêta au chapitre dédié au résumé historique. Les quelques informations qu’il pourrait glaner lui seraient d’une grande utilité une fois sur place pour comprendre le contexte de ce qu’il aurait à filmer.
Le paragraphe sur lequel il s’attarda en premier parlait de la vie d’Alexandre le Grand et de ses conquêtes d’une manière générale. Il apprit que cet illustre personnage historique était à l’origine roi de Macédoine, contrée située dans le nord de la Grèce antique. La période concernée était le quatrième siècle avant Jésus-Christ. Il n’eut de cesse de développer son empire durant toute sa courte existence. Il trouva en effet la mort très jeune, à l’âge de 32 ans. Il avait étendu son royaume vers l’est jusqu’aux portes de l’Inde, subtilisant avec acharnement de nombreux territoires qui appartenaient alors au peuple le plus puissant de l’époque :
le peuple perse. Ce gigantesque royaume qu’Alexandre le Grand constitua fut appelé plus tardivement “le monde hellénistique”. Il y fonda une quantité incroyable de cités auxquelles il donna à la plupart son propre nom. Le monde antique se vit ainsi enrichi de plus de soixante-dix cités baptisées Alexandrie. L’une d’elles fut même affublée du nom de son fidèle cheval mort sur le champ de bataille : Bucéphale.
Jean sourit à la lecture de cette anecdote, avant que le coude de son voisin ne le bouscule involontairement. Avec un soupir d’exaspération, il passa au paragraphe suivant qui concernait plus particulièrement l’Égypte et la ville majestueuse d’Alexandrie. Il découvrit avec intérêt que ce pays était aussi sous la domination perse lorsque Alexandre le Grand en fit la conquête en l’an 331 avant Jésus-Christ.
Le roi de Macédoine se désigna d’emblée comme étant le digne successeur des pharaons et choisit, inspiré par la visite impromptue d’Homère lors d’un songe, l’emplacement d’un nouveau port au nord-ouest du Caire. C’est ainsi qu’il créa cette cité qu’il appela, pour ne rien changer à son habitude : Alexandrie. Cette ville deviendra l’une des plus importantes de l’Antiquité et sera d’ailleurs surnommée par la suite “le comptoir du monde”. Jean apprit avec surprise que la culture grecque y fut alors importée de manière massive, comme cela l’avait été dans tout son empire, mais toujours avec le même souci de préserver également les coutumes locales.
Jean referma le guide touristique. Le chariot des hôtesses s’approchait à grands pas. Une boisson et un plateau-repas seraient les bienvenus pour briser la monotonie du voyage.
Encore trois longues heures avant d’être libéré de ses cerbères qui, même s’ils avaient cessé leur bavardage, le compressaient sans répit aussi cruellement qu’un carcan.
Dès la sortie de l’avion, en descendant l’escalier métallique, la moiteur et la chaleur se firent immédiatement ressentir. Le phénomène s’accentua durant la petite marche sur le tarmac. Le soleil était de plomb et l’air irrespirable. La sueur se mit à coller sous ses vêtements inappropriés pour ce genre de voyages. Jean savait pourtant que le climat en Égypte nécessitait des tenues plutôt amples pour permettre à la transpiration de s’évaporer et ainsi apaiser la sensation de chaleur. Il espéra que les quelques tee-shirts et chemisettes qu’il avait précipitamment empaquetés dans sa valise seraient suffisants pour supporter cette fournaise.
Il entra dans le hall de l’aéroport avec les autres passagers et se positionna devant le tapis d’arrivée des bagages.
Les ventilateurs du plafond dispersaient avec difficulté l’air pesant sans parvenir à le refroidir pour autant. Quelques militaires, mitraillette en bandoulière, rôdaient à proximité des portes d’accès, preuve des tensions que connaissait le pays. Son bagage apparut enfin sur le tapis roulant quand une voix l’interpella derrière lui :
« Jean Dussard ? »
Jean se retourna surpris et acquiesça. L’homme était un Égyptien d’une cinquantaine d’années, mal rasé et vêtu d’un costume gris usé jusqu’à la corde. Ce dernier pointa du doigt la valise qui continuait son chemin et lui demanda « c’est la vôtre ? », puis, d’un mouvement léger, tendit le bras et l’arracha à son périple.
« Bonjour, je me prénomme Amir, reprit-il dans un français teinté d’un fort accent local. Je suis l’assistant égyptien de l’équipe de tournage. Préparez votre passeport et suivez- moi, nous allons passer la douane ensemble, j’ai toutes les autorisations. Ensuite, nous partirons en voiture pour Alexandrie où le reste de l’équipe vous attend. »
Jean ne fut pas étonné d’être accueilli par un tel personnage. Lorsqu’un tournage se déroule à l’étranger, il est courant que les sociétés de production fassent appel à un assistant vivant dans le pays. Il s’occupe généralement de la logistique et facilite la réalisation du documentaire du fait de sa bonne connaissance des lieux et de la langue. En l’occurrence, sa présence était par ailleurs indispensable pour participer aux négociations concernant les autorisations de filmer. Il est épineux pour un Européen, quand cela est nécessaire, de manier l’art malicieux du bakchich.
Amir guida le cameraman jusqu’au parking où était garé un minibus bleu foncé. Il lui présenta le chauffeur qui resta confortablement installé derrière le volant, puis ouvrit la porte coulissante. Ils grimpèrent tous les deux et s’assirent côte à côte sur la première banquette. Amir lui expliqua que la route durerait deux heures et demie environ et qu’ils se rendraient directement à l’hôtel. Jean se dit qu’il profiterait de ce temps supplémentaire pour essayer à nouveau de dormir un peu. Amir ferma la porte et le minibus vibra de toute part au moment du démarrage. Première secousse, premier sursaut, le véhicule débuta sa course et laissa derrière lui l’aéroport international.
La tête calée contre le sac à dos qu’il avait accolé contre la vitre, Jean somnola par à-coups durant une grande partie du trajet. À l’approche d’Alexandrie, les bruits intempestifs des klaxons achevèrent de le réveiller complètement. Le concert cacophonique annonçait les premiers embouteillages et une entrée laborieuse dans la ville. Le chauffeur tenta à plusieurs reprises de changer de file pour gagner quelques mètres. En vain. L’arrivée à l’hôtel n’était de toute évidence pas pour tout de suite. L’air glacé de la climatisation réglée à son maximum se mélangeait avec difficulté au vent chaud qui s’infiltrait par la fenêtre que le conducteur avait paradoxalement laissée grande ouverte. Les bourrasques, alternativement chaudes et froides, fouettaient le visage de Jean et lui procuraient une sensation de nausée. Pour ne rien arranger, Amir, qui se faisait une joie de le voir réveillé, l’abreuvait de paroles sans discontinuer. Jean ne l’écoutait que d’une oreille et sortit machinalement son téléphone de la poche. L’écran affichait deux textos de bienvenue de l’opérateur téléphonique égyptien, ainsi qu’une alerte lui signifiant qu’un message vocal avait été laissé durant le vol.
Le numéro d’appel était français et lui était étranger. En prendre connaissance n’avait rien d’urgent. Il éteignit l’appareil et le rangea.
Sa tête était lourde et il avait hâte d’arriver. Il lui tardait de rencontrer l’équipe et de découvrir à quelles personnalités il allait avoir à faire. Son impatience était d’autant plus vive qu’Amir ne lui avait rien appris de plus sur le tournage que ce qu’on lui avait déjà raconté avant de partir. Il savait juste que le documentaire concernait des fouilles archéologiques dans une nécropole, des mots qui piquaient sa curiosité, mais qui manquaient sérieusement de précisions.
Ce genre d’intitulés pouvait correspondre à beaucoup de reportages de ce type : l’archéologie est tout de même un thème un peu courant et banal dans ce pays.
Bien loin de là, à Paris, Georges Rapiaud déboula dans le bureau de sa secrétaire :
« Alors, des nouvelles ? »
Madame Armond fit un bond sur sa chaise, se détourna de son écran en reprenant son souffle et réprimanda :
« Monsieur Rapiaud, vous me faites peur à entrer sans frapper ! À chaque fois vous me faites sursauter. Ménagez-moi un peu si vous ne voulez pas me voir finir sur une civière.
— Bon, d’accord, désolé… Mais alors ? Du nouveau ?
— Concernant vos cinq réunions à venir ? Ou, sinon, à propos des comptes rendus de vos différentes visioconférences avec vos collègues du monde entier que j’ai à traduire et à taper ? Ou parlez-vous peut-être de vos demandes précises de recherches d’articles ?
— Madame Armond, coupa Georges d’un ton las, cessez ce petit jeu. Vous savez bien de quoi il est question.
— Non, Monsieur, pas de nouvelles de votre cameraman.
J’ai enfin pu trouver son numéro et lui laisser un message.
Mais aucune réponse pour le moment. Votre insistance me surprend… »
Après un soupir de déception, Georges se détendit et lui sourit :
« C’est juste une intuition. Je ne cesse de tourner en rond dans mes recherches. Je m’épuise dans les calculs et les détails… Je m’embourbe dans toutes ces théories des cordes si prometteuses, et en même temps si artificielles. Je m’efforce de trouver autre chose, une inspiration… et si ce gars ne représente qu’une chance sur un billion de me fournir ne serait-ce qu’un début d’inspiration… je ne veux pas la rater !
Je cherche une lueur, juste une toute petite lueur. Ça vous convient comme explication, très chère Nicole ? » conclut-il d’un ton exagérément charmeur.
Madame Armond se retourna d’un coup devant son ordinateur et recommença à pianoter sur son clavier, laissant pantois le scientifique sur le pas de la porte, puis répondit, amusée :
« Ah bon ! Ce que vous voulez, en somme, c’est une muse !
Il en a de la chance ce cameraman… »
Chapitre III
Caméra sur l’épaule, main gauche sur l’objectif, les doigts prêts à contrôler la bague de mise au point et le diaphragme, Jean n’attendait plus que le feu vert de Baptiste, le journaliste, pour presser sur le bouton “REC”. Sébastien, l’ingénieur du son, mixette au cou et casque sur les oreilles, tendit sa perche à bout de bras afin de placer le microphone au-dessus de Michel de Pringent, le fameux archéologue français. Chapeau de paille sur la tête, ce dernier attendait patiemment que le tournage démarre et que lui soient posées les premières questions. Son col de chemise était ouvert de manière étudiée, ce qui lui conférait un air faussement décontracté. Il maintenait son visage droit et hésitait à croiser les bras ou à les laisser le long du corps, se cherchant l’attitude la plus conforme à sa haute fonction. Michel de Pringent était le tout nouveau responsable des fouilles archéologiques dirigées par la France à Alexandrie. Il avait intégré ce poste il y a tout juste un mois et s’apprêtait déjà, pour sa plus grande renommée, à être filmé par une importante chaîne de télévision nationale.
Il était à peine sept heures du matin et le soleil perçait timidement entre les pans de deux immeubles. Le choix de débuter le tournage à l’aube avait été une nécessité pour espérer échapper un tant soit peu à la canicule de la journée.
La chaleur, cependant, se faisait déjà sentir et la sueur commençait à perler sur les tempes de Jean.
La séquence se déroulait au cœur d’un quartier populaire, loin du centre d’Alexandrie, à l’ouest de la ville originelle où trônait jadis le phare majestueux, l’une des sept merveilles du monde antique. Les bâtiments qui cloisonnaient les rues au bitume éventré devaient dater des années cinquante pour certains et n’étaient en rien le miroir du faste et de la splendeur d’antan. Les rayons orangés du soleil nettoyaient péniblement la tristesse des façades délabrées. Intrigués, les habitants se penchaient aux fenêtres, tandis que les passants s’arrêtaient pour regarder de près ce singulier spectacle matinal. Les discussions allaient bon train. Chacun donnait son avis sur ce qui pouvait bien mériter d’être filmé dans ces rues d’ordinaire ignorées. Trois militaires chargés de la sécurité surveillaient avec sévérité les allées et venues de tous ces curieux. Ils prêtaient une attention particulière aux enfants qui, ils le savaient, seraient forcément tentés de trop s’approcher.
Jean sentit la sueur lui piquer l’œil posé sur l’œilleton du viseur. Il restait concentré sur le champ de vision que lui permettait l’optique de la caméra et ne cessait de rectifier le cadre. Il cherchait le meilleur angle pour bien distinguer la porte de l’immeuble derrière l’archéologue. Cette entrée avait son importance et il trouvait opportun qu’elle demeure présente à l’image. Le journaliste, sur le point de commencer l’interview, se souvint brusquement qu’il n’avait pas éteint son téléphone. Il le sortit de sa poche pour le mettre en mode “avion” et ainsi éviter d’interrompre la séquence. Baptiste espérait beaucoup de ce documentaire et il se devait d’être rigoureux à tout point de vue. Jean avait bien compris, en le rencontrant la veille, qu’il allait travailler avec un personnage exigeant dont l’expérience du tournage était avérée, et ce, malgré son jeune âge. Il lui donnait trente-deux ans tout au plus. La soirée qu’ils avaient passée ensemble en compagnie de l’ingénieur du son, Sébastien, avait été un moment agréable et chaleureux.
C’était en dégustant une dorade grillée accompagnée d’une bière locale qu’ils avaient fait connaissance. Jean avait découvert avec soulagement que Baptiste était une personne d’un grand calme, qu’il aimait les bonnes plaisanteries et, plus important encore, qu’il était dans ses habitudes de faire toute confiance au cameraman en ce qui concernait la mise en images. Les relations promettaient d’être cordiales et professionnelles. Sébastien, de son côté, avait aussi cherché à le mettre à l’aise en parlant des connaissances de travail qu’ils avaient en commun. Ce dernier avait une soixantaine d’années. Il portait une barbe irrégulière d’au moins trois jours et une paire de lunettes posée sur le bout du nez. Un sourire en coin ne le quittait jamais, quelles que soient les circonstances, ce qui lui donnait un petit air espiègle et attachant. Sébastien était aguerri aux tournages à l’étranger et connaissait Baptiste depuis plusieurs années. Le journaliste ne se priva d’ailleurs pas de le présenter comme un ami fidèle et comme un homme de contact qui aimait aller vers les gens et discuter avec eux. La soirée s’était terminée dans la bonne humeur et chacun avait regagné sa chambre pour tenter de dormir malgré le bruit de la climatisation et le vacarme omniprésent de la rue.
Le lendemain matin, à cinq heures, Jean avait retrouvé l’équipe au petit déjeuner. Le premier geste avait été de se ruer sur la machine à café. Passée la grimace de la première gorgée, ce sont deux tasses du breuvage noirâtre qui furent rapidement avalées. Un peu de caféine, quelle qu’en soit la mixture, était la bienvenue pour affronter la journée qui s’annonçait.
« Moteur ! » lança le journaliste. Le brouhaha des spectateurs improvisés s’étouffa, laissant la voix claire de Baptiste résonner au milieu de légers murmures récalcitrants :
« Monsieur de Pringent, pouvez-vous nous expliquer la présence de votre équipe archéologique dans ce quartier d’habitation, non loin du centre-ville ? Ici, rien ne ressemble de près ou de loin à un site antique. »
Michel de Pringent commença à parler en avançant dans la rue, précédé de Jean qui le filmait à reculons. Sébastien lui emboîtait le pas avec agilité, soucieux de garder le micro à bonne distance de l’orateur sans pour autant lui faire de l’ombre sur la tête. Baptiste marchait accolé à Jean afin que l’archéologue s’adresse à lui, proche de l’axe de la caméra. Sur le côté, suivaient le plus discrètement possible Amir, l’assistant de production, ainsi que les deux autres archéologues français qui devaient intervenir par la suite dans le reportage.
Michel de Pringent, la cinquantaine, avait l’habitude des médias, et ce fut dans un style théâtral qu’il expliqua :
« Rien, à Alexandrie, en effet, ne peut ressembler de près ou de loin à la ville antique. De cette époque, il ne subsiste rien et les vestiges sont d’une extrême pauvreté. Pour avoir la chance de découvrir quelques traces archéologiques, il faut faire l’effort de plonger dans l’eau peu ragoûtante de la baie pour y dénicher les restes du fameux phare qui fit la gloire de cette cité, ou bien encore, fouiner sous le sol qui sert de terrassement à tout ce quartier. En effet, ces immeubles que vous voyez ont été construits à l’endroit même où se trouvait un immense espace funéraire.
« Tout ce secteur se situait, à l’époque de l’Antiquité, juste à l’extérieur des remparts de la cité d’Alexandrie, à l’ouest.
Il faut bien considérer que l’expansion de la ville a été particulièrement foudroyante, ce qui a eu pour effet de voir sa population atteindre en un rien de temps jusqu’à cinq cent mille habitants. Il apparaît alors évident qu’une véritable organisation avait dû être nécessaire pour gérer les malheureux défunts d’une si grande agglomération et qu’il avait bien fallu dédier des domaines entiers pour les y enterrer.
« Et voilà. C’est ici, autour de nous, que fut fondée, il y a plus de deux mille ans, la plus importante nécropole de la cité. Elle était particulièrement étendue et démesurée, suffisamment, en tout cas, pour la considérer comme une ville à part entière. Sur une superficie d’environ trois kilomètres carrés, sa structure était composée d’innombrables rues pavées. Il y avait aussi des citernes, des maisons consacrées aux métiers du funéraire, notamment pour l’embaumement des morts, ainsi que bon nombre de temples. Bref, c’était une cité vouée dans sa totalité aux sépultures, une cité au nom des plus exaltants : Nécropolis, la cité des morts ! »
L’archéologue laissa en suspens ses derniers mots pour en savourer l’impact le temps d’un instant, puis reprit :
« Une grande partie de ce gigantesque cimetière se trouvait en sous-sol et était constituée d’un agglomérat de tombeaux et de caveaux creusés à même la roche. Le tout formait un véritable labyrinthe au réseau souterrain complexe. Il ne reste bien sûr plus grand-chose, aujourd’hui, de cette incroyable nécropole. Outre les nombreuses transformations qui se sont succédé au cours des siècles lors de son utilisation, les aménagements urbains modernes n’ont pas laissé beaucoup de chance aux vestiges les plus anciens.
« Il est arrivé cependant que l’on découvre, lors de chantiers de construction, des niches funéraires qui ont suscité suffisamment d’intérêt pour organiser des fouilles temporaires. Des salles mortuaires immenses ont pu ainsi être mises à jour ces dernières décennies par mes prédécesseurs ; des salles dont les parois accueillaient parfois sur toute leur surface plusieurs dizaines de loculi creusés à même la roche.
Les loculi sont, dans notre jargon, des petits espaces funéraires rectangulaires, des sortes de caveaux.
« Il faut, bien entendu, préciser que les tombes étudiées avaient été pour la plupart soigneusement vidées de leur contenu des siècles plus tôt par des pilleurs sans scrupules. »
L’archéologue marqua une pause et s’essuya le front. Il fit demi-tour à la demande du journaliste pour marcher en direction de l’immeuble d’où ils étaient partis. Le cortège redémarra et Michel de Pringent reprit, comme un comédien professionnel, l’attitude d’homme de science qu’il aimait afficher. Avec force et conviction, il poursuivit son récit :
« Il y a trois semaines, trois enfants d’une dizaine d’années ont joué en arpentant les souterrains situés sous les caves de leur immeuble. Ils y ont découvert un accès qui les a menés à ce qui pourrait ressembler à une série de tombes. N’ayant pas conscience de leur trouvaille déjà exceptionnelle, ils ont poussé plus loin leur investigation dans les méandres des cavités, puis sont tombés sur une entrée très particulière, une entrée composée d’une grille en métal, chose extrêmement rare, et ornée tout autour de peinture. Elle donnerait sur une autre salle qui, d’après leurs explications, ne leur était pas accessible.
« Il serait incroyable qu’un caveau de cette importance à l’intérieur de cette nécropole soit encore intact et n’ait pas été pillé ! Mais si ces enfants disent vrai, il y a peut-être sous ces immeubles un dernier joyau archéologique à découvrir qui nous permettrait d’en apprendre un peu plus sur les us et coutumes de l’Antiquité.
« Bien sûr, l’idée qu’il puisse s’agir de la tombe d’Alexandre le Grand nous a tous effleurés. Elle est encore de nos jours introuvable et fait l’objet de toutes les affabulations. Il nous faut malheureusement admettre comme improbable cette éventualité. Il est inimaginable que sa sépulture, qui était à l’époque un monument hautement vénéré, soit située à l’écart de la ville et si profondément enfouie.
« Bref, une fois revenus de leur périple, les trois enfants sont allés raconter à leurs parents la fabuleuse découverte.
L’information est rapidement arrivée jusqu’aux oreilles du ministère des Antiquités égyptiennes qui nous a sollicités pour étudier cet endroit afin d’en valider, ou non, l’intérêt et le potentiel archéologique… Et nous voilà : moi et mon équipe ! Équipe principalement composée, pour cette mission, de Jacques Fontier et d’Isabelle Montenier. Nous sommes venus dans ce quartier il y a une semaine pour prendre contact avec les enfants et avoir plus de détails.
« Il y a deux jours maintenant, mes deux archéologues ont fait un premier repérage avec un des garçons pour identifier le chemin à suivre et bien localiser leur découverte. Cette première expédition s’est très bien passée. Ils sont parvenus, sans l’avoir encore ouverte, jusqu’à la fameuse entrée. Jacques et Isabelle s’équipent en ce moment même et s’apprêtent à retourner dans les sous-sols. L’objectif est, aujourd’hui, de pénétrer dans le tombeau et de voir véritablement de quoi il s’agit. Dans quelques minutes, ils partiront lever le voile sur l’un des ultimes secrets de “Nécropolis”. »
Sur le dernier mot qui concluait sa prestation, Michel de Pringent adopta une posture et figea un large sourire comme si on le prenait en photo. Le directeur des opérations qu’il était prenait visiblement plaisir à jouer avec la caméra. Jean souffla et posa son engin à terre. Il lui fallait maintenant s’équiper pour suivre et filmer les archéologues durant leur expédition sous terre, dans l’antre de la nécropole, la mystérieuse et énigmatique “cité des morts”.
Le projet de documentaire auquel Jean venait d’être associé consistait à raconter le quotidien de l’équipe archéologique de Michel de Pringent. Un contrat d’exclusivité avait été signé avec la production qui devenait alors la seule habilitée à la filmer. La découverte inopinée par des enfants d’une nouvelle tombe dans la nécropole avait précipité la période du tournage. Ce genre d’aubaine était suffisamment rare pour ne pas la manquer. Baptiste contemplait l’entrée de l’immeuble qu’un rayon de soleil illuminait. Derrière la porte se trouvait un monde oublié que la caméra était sur le point de dévoiler. Excité à cette idée, il se mit à rêver à des scénarios fantaisistes et s’imaginait déjà la voix exaltée du commentateur apposée à des images au suspense insoutenable. Il se perdit à visualiser des scènes palpitantes, macabres et terrifiantes, se laissant aller à croire en la possibilité de la découverte improbable d’un trésor monumental appartenant à un pharaon jusque-là inconnu ! Le professionnalisme reprit soudain le pas sur l’euphorie prématurée.
Il reposa fermement les pieds sur terre et s’attacha à superviser d’un œil attentif les moindres détails des préparatifs.
Avant d’augurer d’une bande-annonce de choc, il fallait déjà que le tournage se passe sans aucun souci. Il ne restait plus qu’à croiser les doigts et, plus que tout, à faire confiance à son nouveau cameraman.
Jean était en effet le seul membre de l’équipe de Baptiste autorisé à accompagner Isabelle et Jacques dans la nécropole.
Bien que les deux jeunes archéologues aient une relative habitude de se déplacer dans des conditions aussi particulières, ils n’avaient aucunement le désir d’avoir à chaperonner plusieurs néophytes. Progresser dans ces sous-sols méconnus était loin d’être une chose aisée et demandait un effort hors du commun. Il fallait que chacun puisse être autonome et pouvoir se débrouiller tout seul. Ils en avaient longtemps averti le cameraman pour s’assurer qu’il pourrait les suivre sans être un poids ni une gêne. Par exemple, il était important, pour la sécurité de tous, qu’il n’ait pas peur du noir et qu’il ne soit pas sujet à la claustrophobie. Celui-ci les rassura sur ses aptitudes en prenant soin de ne pas révéler son manque d’expérience dans des conditions si extrêmes. Il était inutile de semer le doute alors qu’il se sentait parfaitement à la hauteur de la tâche. Les différentes mises en garde l’amenèrent toutefois à reconsidérer le type de matériel à emporter. Pour plus de facilité, il laissa de côté sa caméra d’épaule, trop lourde et imposante, et préféra se munir d’une caméra de plus petite taille, une caméra de poing, plus adaptée aux endroits exigus. Cette caméra fournissait des images haute définition de très bonne qualité et serait, dans ce cas précis, bien plus pratique. L’ingénieur du son, écarté malgré lui de l’expédition, équipa chacun des deux archéologues d’un micro HF et brancha les deux récepteurs correspondants sur la caméra. Tout ce qui pourrait se dire dorénavant se trouverait enregistré sans qu’aucun câble ne soit nécessaire et sans que Jean ait à s’en occuper.
La promenade ne serait pas une partie de plaisir, ça, le cameraman l’avait bien compris. Il lui faudrait parfois ramper, se faufiler dans de petits passages, avancer à la lumière de leur lampe frontale et respirer dans la poussière… le tout dans une chaleur écrasante. Il se prépara mentalement aux efforts qu’il aurait à fournir tout en enfilant une épaisse combinaison orange. Baptiste le rejoignit pour lui donner ses dernières recommandations :
« Surtout, n’hésite pas à leur poser des questions pour que l’on ait bien leurs réactions, leurs ressentis. Ne t’arrête jamais de filmer, même si les conditions sont difficiles. Il me faut de l’image, plein d’images. On fera le tri après, au montage. Allez, c’est à toi de jouer, éclate-toi bien ! Sébastien et moi, on va en terrasse boire une citronnade bien fraîche. »
Il afficha alors sur son visage un sourire complice :
« Je plaisante, bien sûr, on est avec toi de tout notre cœur.





























