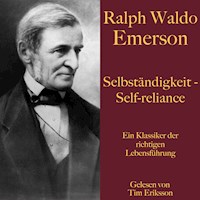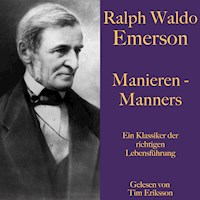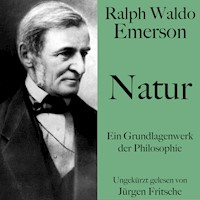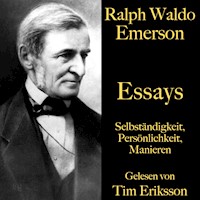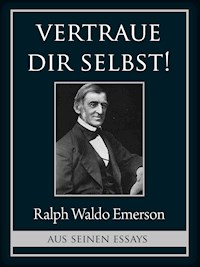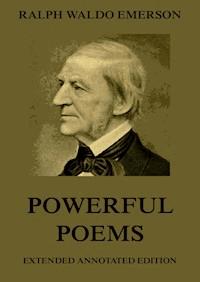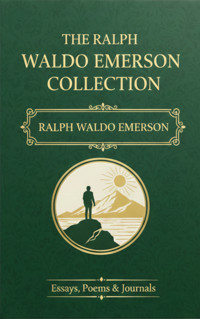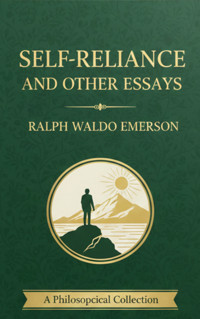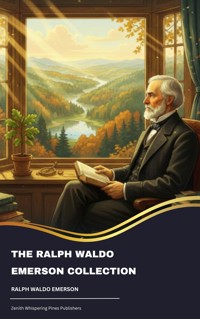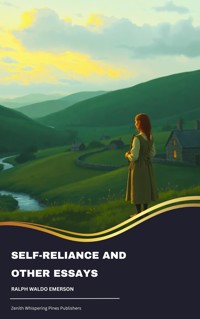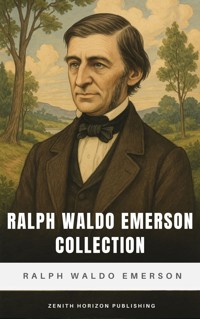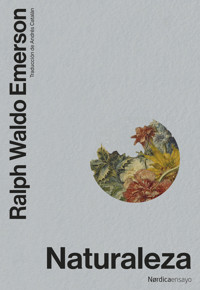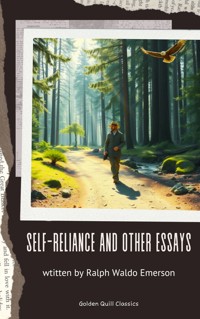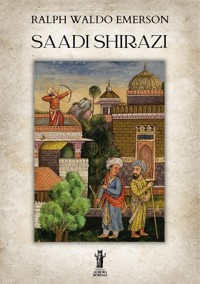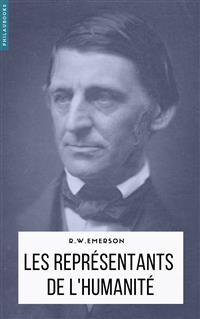
2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Philaubooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
La recherche du grand est le rêve de la jeunesse et la plus sérieuse occupation de la virilité. Nous voyageons en pays étrangers pour découvrir ses œuvres et, s’il est possible, pour entrevoir sa splendeur ; mais nous nous trouvons désappointés par la richesse, qui en occupe la place. Vous me dites que les Anglais sont un peuple pratique, que les Allemands sont hospitaliers, que le climat est délicieux à Valence, qu’il y a de l’or à récolter dans les montagnes du Sacramento. C’est vrai ; mais je ne voyage pas pour trouver des gens confortables, riches et hospitaliers, un ciel pur ou des lingots qui coûtent trop cher ; et s’il existait un aimant qui indiquât les contrées et les demeures habitées par les individus intrinsèquement riches et puissants, je vendrais tout pour l’acheter, et je me mettrais en route aujourd’hui même. Extrait.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Les représentants de l’humanité
Ralph Waldo Emerson
Traduction parPierre De Boulogne
philaubooks
Table des matières
A Ernest Christophe Sculpteur
Préface
1. Utilité des grands hommes
2. Platon ou le philosophe
- Platon : Dernières nouvelles
3. Swedenborg ou le Mystique
4. Montaigne ou le Sceptique
- Le message de l’âme
5. Shakespeare ou le Poète
6. Goethe ou l’Écrivain
7. Napoléon ou l’homme du siècle
À propos de l’auteur
A Ernest Christophe Sculpteur
A Ernest Christophe Sculpteur
Cher ami,
Acceptez, je vous prie, cette traduction des Représentants de l’Humanité d’Emerson, comme un témoignage sincère de ma profonde et inaltérable affection. Vous êtes un des rares artistes qui pensent, avec Michel Ange, que l’art ne doit être étranger à rien, et qu’il n’a qu’à gagner au contact de la philosophie, de la science et de la politique. C’est aussi l’avis d’Emerson, qui dit dans ses Essais (1° série) :
« Plus le caractère spirituel du siècle domine l’artiste et s’exprime dans son œuvre, et plus cette œuvre conservera une certaine grandeur, et représentera aux contemplateurs futurs, l’Inconnu, l’inévitable, le Divin. » — « L’art n’est pas arrivé à sa maturité, tant qu’il ne marche pas de front avec les plus puissantes influences du monde, tant qu’il n’est pas pratique et moral, et qu’il n’est pas étroitement uni à la conscience1. »
Cette pensée n’est pas votre seule affinité avec cet éminent esprit. Aussi ma traduction d’un de ses principaux ouvrages vous a-t-elle été destinée dès le principe, alors que j’entreprenais, soutenu par vos généreux encouragements, ce travail ardu, difficile, auquel je n’avais à consacrer qu’une conscience rigoureuse. Aujourd’hui qu’il est terminé, je vous l’offre, heureux et fier de le placer sous l’auspice du nom d’un ami dévoué et d’un véritable artiste.
P. de Boulogne.
Mars 1863.
1Essai XII. — Art.
Préface
Au moment où la Révolution, partie de Paris, parcourait l’Europe en soulevant Berlin et l’Italie, Vienne et la Hongrie ; où le monde civilisé prêtait l’oreille au moindre souffle arrivant de France et attendait avec anxiété l’issue des orages suscités par les journées de février 1848, un philosophe, un poète, un sage, Ralph Waldo Emerson, citoyen des États-Unis, arrivait à Londres et y ouvrait un cours public sur les grands hommes. Plein de confiance dans l’avenir de l’humanité qu’il sentait exister en lui, — Emerson est panthéiste, — calme et tranquille en face des bouleversements dont s’effrayaient ses contemporains, indifférent aux révolutions ou aux réactions impuissantes à ébranler sa foi robuste, Emerson consacra chacune de ses leçons à l’étude de l’une de ces grandes individualités qui s’appellent Platon, Montaigne, Swedenborg, Shakespeare, Napoléon et Goethe. Depuis lors, en 1850, il a réuni en volume ces leçons, ou plutôt ces essais critiques et philosophiques, et ce sont eux dont nous publions aujourd’hui une traduction.
Ce petit livre est l’œuvre du génie le plus saillant, du penseur le plus profond, que puissent revendiquer aujourd’hui les États-Unis. Il émane d’un écrivain, d’un homme original et véridique, éminemment digne d’entrer en relations avec les amis des esprits de cette trempe. — Que ceux à qui il s’adresse lui fassent donc bon accueil ! Ralph Waldo Emerson est né, en 1803, à Boston. Après avoir obtenu son diplôme de bachelier au collège Harvard, il étudia la théologie et devint ministre de la seconde église unitaire de sa ville natale. Plus tard, ayant adopté l’opinion des quakers sur la Cène, Emerson quitta la chaire et se retira à Concord, dans le Massachusetts, ou il a vécu depuis dans l’étude de la littérature et de la philosophie. Emerson a été collaborateur de la Revue de l’Amérique du Nord, de l’Examinateur chrétien et, pendant deux ans, éditeur du Cadran, magasin littéraire et philosophique, imprimé à Boston.
Chapitre 1
Utilité des grands hommes
Il est naturel de croire aux grands hommes. Si les compagnons de notre enfance arrivaient à être des héros, et si leur condition devenait royale, cela ne nous surprendrait pas. Toute mythologie s’ouvre par des demi-dieux placés dans des circonstances élevées et poétiques, car leur génie est souverain. Dans la légende de la Gautama, les premiers hommes mangeaient de la terre et la trouvaient délicieusement agréable.
La nature semble exister pour les êtres excellents ; le monde s’appuie sur leur véracité ; ils rendent la terre salubre, et ceux qui les ont pratiqués ont trouvé la vie joyeuse et nutritive. Notre foi en une telle société rend seule l’existence douce et tolérable, et, dans la réalité ou dans l’idéal, nous nous efforçons de vivre avec les hommes supérieurs. Nous donnons à nos enfants et à nos terres leurs noms, qui sont enchâssés dans les verbes du langage ; leurs œuvres et leurs effigies décorent nos demeures, et chaque circonstance du jour nous rappelle une de leurs anecdotes.
La recherche du grand est le rêve de la jeunesse et la plus sérieuse occupation de la virilité. Nous voyageons en pays étrangers pour découvrir ses œuvres et, s’il est possible, pour entrevoir sa splendeur ; mais nous nous trouvons désappointés par la richesse, qui en occupe la place. Vous me dites que les Anglais sont un peuple pratique, que les Allemands sont hospitaliers, que le climat est délicieux à Valence, qu’il y a de l’or à récolter dans les montagnes du Sacramento. C’est vrai ; mais je ne voyage pas pour trouver des gens confortables, riches et hospitaliers, un ciel pur ou des lingots qui coûtent trop cher ; et s’il existait un aimant qui indiquât les contrées et les demeures habitées par les individus intrinsèquement riches et puissants, je vendrais tout pour l’acheter, et je me mettrais en route aujourd’hui même.
L’espèce humaine a cours parmi nous en raison de son crédit. La connaissance du fait de la résidence de l’inventeur des chemins de fer dans une ville augmente la considération de tous les citoyens. Mais les populations énormes, composées de mendiants, sont aussi dégoûtantes qu’un fromage qui marche seul, qu’un amas de fourmis ou de puces, — plus le nombre en est grand, et pire est le mal.
Notre religion consiste à aimer et à chérir ces divins patrons. Les dieux de la Fable marquent les époques brillantes des grands hommes. Nous coulons tous nos vases dans un même moule. Nos colossales théologies, judaïque, chrétienne, bouddhiste, mahométane, sont l’acte nécessaire de la structure de l’esprit humain. L’historien ressemble à un homme qui entre dans un magasin pour y acheter des tentures ou des tapis ; il s’imagine posséder un article nouveau, mais s’il visite la fabrique, il reconnaît que sa nouvelle étoffe reproduit encore les volutes et les rosaces des murs intérieurs des pyramides de Thèbes. Notre théisme est la purification de l’esprit humain. L’homme ne peut peindre, créer ou penser que l’homme. Il croit que les grands éléments matériels ont eu leur origine dans sa pensée, et notre philosophie constate une seule Essence indivise ou en partage.
Si nous procédons maintenant à la recherche du genre de services que nous rendent les autres hommes, prenons garde au danger des études modernes, et partons de plus bas. Nous ne devons ni lutter contre l’amour, ni dénier l’existence substantielle de nos semblables. Sans eux, je ne sais trop ce qu’il adviendrait de nous. Nous avons des forces sociales. Notre affection pour les autres nous crée une sorte de profit ou d’acquêt que rien ne peut remplacer. Je peux, à l’aide d’un autre, exécuter ce que je ne puis faire seul. Je peux vous dire à vous ce que je ne puis me dire à moi — même. Nos semblables sont des lentilles à travers lesquelles nous déchiffrons nos propres esprits. Chaque homme recherche les individus d’une qualité différente de la sienne et qui ont une valeur générique, c’est-à-dire qu’entre les autres hommes il recherche les plus autres. Plus la nature est forte, plus elle est réactive. Recherchons la qualité pure ; négligeons un esprit médiocre. Un point capital différencie les hommes, à savoir, s’ils vaquent oui ou non à leurs propres affaires. L’homme est cette noble plante endogène qui croit, comme le palmier, de l’intérieur à l’extérieur. Il peut entamer avec célérité et en se jouant sa propre affaire, impossible aux autres. Il est facile au sucre d’être doux, et au nitre d’être salé. Nous nous donnons beaucoup de peine pour tendre des pièges et y surprendre ce qui tombera de soi-même entre nos mains. Je considère comme un grand homme celui qui habite une sphère supérieure de la pensée, à laquelle les autres hommes ne peuvent atteindre sans travail ni difficulté ; il n’a qu’à ouvrir les yeux pour apercevoir les choses dans leur vrai jour et pour saisir leurs grandes affinités, tandis qu’il leur faut exécuter de pénibles corrections et veiller d’un œil vigilant sur les nombreuses sources de l’erreur. Les services qu’il nous rend sont analogues. Il n’en coûte aucun effort à une belle personne pour refléter son image dans nos yeux ; et de quelle splendeur brille pourtant ce bienfait ! Il n’en coûte pas davantage à une âme sage pour transmettre sa qualité aux autres. Et chacun peut rendre plus communicable ce qu’il a de meilleur. « Peu de moyens, beaucoup d’effets. » Il est grand celui qui demeure ce que l’a fait la nature et qui ne nous rappelle jamais les autres.
Mais il doit nous appartenir à un titre quelconque, et notre vie doit en recevoir une promesse d’explications. Je ne puis dire ce que je voudrais connaître, mais j’ai remarqué qu’il existe des personnes qui, par leur caractère et leurs actes, répondent à des questions que je n’ai pas l’habileté de poser. Un homme répond à une question que nul de ses contemporains n’a posée, et il demeure isolé. Les religions et les philosophies passées et transitoires répondent à quelque autre question. Certains hommes nous touchent comme de riches possibilités, mais inutiles à eux-mêmes et à leur époque, jouets peut-être de quelque instinct qui règne dans l’air, ils ne parlent pas à nos besoins. Mais les grands hommes sont proches, et nous les reconnaissons à première vue. Ils satisfont une attente et tombent à plomb. Le bien est effectif, génératif, et se procure à lui-même demeure, nourriture et alliés. Une pomme simple produit de la graine, — une pomme hybride demeure stérile. Dès qu’un homme est à sa place, il devient inventif, fécond, magnétique ; il inonde des armées de ses desseins, qui s’exécutent ainsi. La rivière creuse ses propres rivages, et chaque idée légitime s’ouvre à elle-même ses canaux et s’assure un accueil favorable, des moissons pour se nourrir, des institutions pour s’exprimer, des armes pour combattre, et des disciples pour l’expliquer. Le véritable artiste a la planète pour piédestal ; mais l’aventurier, après bien des années de lutte, ne possède rien au delà de la semelle de ses souliers.
Nos entretiens habituels roulent sur deux genres d’utilité ou de service de la part des hommes supérieurs. Le don direct flatte la croyance primitive des hommes ; le don direct d’une assistance matérielle ou métaphysique, tel que celui de la santé, de l’éternelle jeunesse, du raffinement des sens, de l’art de guérir, de la puissance magique et de la prophétie. L’enfant croit à l’existence d’un maître qui peut lui vendre la sagesse ; les églises croient à l’imputation des mérites. Mais, en réalité, nous ne connaissons guère de services directs. L’homme est endogène, et l’éducation en est le développement. L’aide que nous recevons des autres est mécanique, si on la compare aux découvertes de notre nature. Ce qu’on apprend ainsi est délicieux à apprendre, et le résultat en demeure acquis. Les lois morales sont centrales et partent de lame pour rayonner à l’extérieur. Le don gratuit est contraire à la loi de l’univers. Servir les autres, c’est nous servir. Je dois m’acquitter envers moi-même. « Mêle-toi de tes affaires, dit l’Esprit, imbécile ! Voudrais-tu par hasard t’occuper de celles des cieux ou de celles des autres ? » Reste le service indirect. Les hommes ont une qualité pittoresque ou représentative et nous servent intellectuellement. Boehme et Swedenborg ont reconnu que les choses étaient représentatives. Les hommes sont également les représentants, d’abord des choses, et, en second lieu, des idées.
Les plantes transforment les minéraux en nourriture pour les animaux ; ainsi tout homme convertit les matières brutes de la nature à des usages humains. Les inventeurs du feu, de l’électricité, du magnétisme, du fer, du plomb, du verre, du lin, de la soie, du coton ; les fabricants d’outils ; l’inventeur du système décimal, le géomètre, l’ingénieur, le musicien, tracent individuellement une route facile pour tous à travers un chaos impossible et inconnu. Tout homme se trouve, par une secrète inclination, affilié à un district de la nature dont il devient l’agent et l’interprète, comme le furent : Linnée, des plantes ; Huber, des abeilles ; Fries, des lichens ; Van Mons, des poires ; Dalton, des formes atomiques ; Euclide, des lignes ; Newton, des fluxions.
L’homme est pour la nature un centre qui projette une filière de rapports à travers tout ce qui est fluide et solide, matériel et élémentaire. La terre tourne, et chaque motte ou chaque pierre passe sous le méridien ; c’est ainsi que chaque organe, chaque fonction, chaque acide, chaque cristal ou chaque grain de poussière entre en rapport avec le cerveau. Il attend longtemps, mais son tour arrive. Toute plante a sa parasite, et toute chose créée son amant et son poète. Justice a déjà été rendue à la vapeur, au fer, au bois, à la houille, à l’aimant, à l’iode, au blé, au coton ; mais qu’ils sont peu nombreux encore les matériaux utilisés par nos arts ! La masse des créatures et des qualités demeure encore cachée et expectante. Il semble que chacune d’elles attende, comme la princesse enchantée des contes de fées, un libérateur humain prédestiné. Chacune d’elles doit être désenchantée et paraître au jour sous une forme humaine. Dans l’histoire des découvertes, la vérité mûre et latente semble s’être préparé un cerveau à son usage. Il faut qu’un aimant s’incarne dans un Gilbert, un Swedenborg ou un Œrsted, avant que l’esprit général puisse en admettre la puissance.
Si nous nous bornons à ces premiers avantages, — le règne minéral et végétal possède une grâce sobre qui, dans les moments les plus sublimes de la vie, se manifeste par le charme de la nature, l’éclat de la marcassite, la certitude de l’affinité, la véracité des angles. La lumière et l’obscurité, la chaleur et le froid, la faim et l’alimentation, le doux et l’amer, les solides, les liquides et les gaz nous enlacent d’une guirlande de plaisirs, et par leurs agréables querelles trompent les jours de la vie. L’œil répète chaque jour ce premier éloge des choses : — « Il vit que cela était bon. » Nous savons où trouver ces charmants acteurs, et ils n’en sont que plus goûtés lorsque les races supérieures les ont expérimentés quelque peu. Nous avons droit aussi à des avantages plus élevés. La science demeure incomplète tant qu’elle ne s’est pas humanisée. La table des logarithmes est une chose, et son rôle vital dans la botanique, la musique, l’optique et l’architecture, en est une autre. Les mathématiques, l’anatomie, l’architecture, l’astronomie, accomplissent des progrès, imprévus d’abord, lorsque par l’union de l’intelligence et de la volonté elles s’élèvent dans la vie et reparaissent dans la conversation, l’écriture et la politique.
Mais ceci arrive plus tard. Nous ne parlons en ce moment que de nos rapports avec elles dans leur propre sphère, et de la manière dont elles semblent fasciner et attirer un de ces génies qui ne s’occupent toute leur vie que d’une chose. La possibilité de l’interprétation réside dans l’identité de l’observateur avec le sujet observé. Toute chose matérielle a son côté céleste, et possède dans la sphère spirituelle et nécessaire sa traduction qui y joue un rôle aussi indestructible que les autres. Et c’est vers ces Ans que toutes choses gravitent incessamment. Les gaz se condensent en firmament solide ; la masse chimique arrive à la plante et elle pousse, au quadrupède et elle marche, à l’homme et elle pense. Mais la nature du commettant détermine aussi le vote du représentant. Ce dernier n’est pas un simple mandataire, car il participe du principe représenté. Le semblable peut seul connaître le semblable. Si l’homme connaît les choses, c’est qu’il est un des leurs ; c’est qu’il vient de sortir de la nature ou de cesser d’en être une partie intégrante. Le chlore animé connaît le chlore, et le zinc incarné, le zinc. Leur qualité détermine sa carrière, et il peut diversement publier leurs vertus qui le composent lui-même. L’homme formé de la poussière du monde n’oublie pas son origine. Tout ce qui est encore inanimé parlera et raisonnera un jour. La nature inédite verra publier tous ses secrets. Oserais-je dire que les montagnes quartzeuses se pulvériseront en d’innombrables Werners, Van Buchs et Beaumonts, et que le laboratoire de l’atmosphère contient en dissolution, j’ignore combien de Berzélius et de Davys ?
C’est ainsi que du coin de notre feu nous embrassons les pôles de la terre. Cette quasi — omniprésence supplée à l’imbécillité de notre condition. Par une de ces journées célestes où le ciel et la terre se rencontrent et s’embellissent mutuellement, il nous semble misérable de ne pouvoir la dépenser qu’une fois ; nous nous souhaitons un millier de tête, un millier de corps, afin de célébrer son immense beauté de mille façons et en mille lieux. Est-ce une folie ? Non, car en réalité nous sommes multipliés par nos représentants. Avec quelle facilité nous nous approprions leurs travaux ! Tout navire qui arrive en Amérique a reçu sa carte de Colomb. Tout romancier est un débiteur d’Homère. Tout charpentier qui manie un rabot emprunte son génie à quelque inventeur oublié. La vie est ceinte de toutes parts d’un zodiaque de sciences, tribut d’hommes qui ont péri pour ajouter leur point radieux à notre ciel. L’ingénieur, le courtier, le juriste, le médecin, le moraliste, le théologien, tout homme enfin qui possède une science est un délimitateur et un ingénieur géographe des latitudes et des longitudes de notre condition. Ces constructeurs de routes dans toutes les directions nous enrichissent. Nous devons étendre l’aire de la vie et multiplier nos relations. Nous avons autant à gagner à la découverte d’une nouvelle propriété sur le vieux globe qu’à l’acquisition d’une nouvelle planète.
Nous recevons trop passivement ces secours matériels ou semi-matériels. Nous ne devons pas être des sacs et des estomacs. Pour gravir un degré, — nous sommes mieux servis par notre Sympathie. L’autorité est contagieuse. En regardant là où regardent les autres, en conversant avec les mêmes objets, nous subissons le charme qui les attiraient. Napoléon disait : « Ne combattez pas trop souvent contre le même ennemi, ou vous lui apprendrez tout votre art de guerre. » En causant souvent avec un homme d’un esprit vigoureux, nous acquérons promptement l’habitude de considérer les choses sous le même aspect, et en toute circonstance nous anticipons sa pensée.
Les hommes sont secourables par l’intelligence et l’affection. Je regarde comme un leurre toute autre assistance. Si vous affectez de me donner le pain et le feu, je m’aperçois que j’en paye le haut prix, et en définitive ce service me laisse tel qu’il m’a trouvé, ni meilleur ni pire ; toute force morale ou mentale est au contraire un bienfait positif. Elle vous échappe avec ou sans votre aveu, et me profite à moi à qui vous n’aviez jamais songé. Je ne puis entendre parler de vigueur personnelle ou d’une grande puissance d’exécution sans un surcroît de résolution. Nous sommes les émulateurs de toutes les actions de l’homme. Le mot de Cecil sur sir Walter Raleigh : « Je sais qu’il peut terriblement travailler, » est un trait électrique. Tels sont également les portraits tracés par Clarendon : — de Hampden, « qui possédait une habileté et une vigilance que les plus laborieux ne pouvaient lasser ni fatiguer, des facultés que les plus fins et les plus subtils ne pouvaient surprendre, et un courage personnel égal à ses plus belles qualités ; » — de Falkland, « ce sévère adorateur de la vérité qui se serait plutôt permis le vol que le mensonge. » Nous ne pouvons lire Plutarque sans une fermentation du sang ; et j’accepte le dire du Chinois Mencius : « Un sage est le précepteur de cent siècles. Au récit de la vie de Loo, l’idiot devient intelligent et l’irrésolu déterminé. »
Telle est la morale de la biographie ; et cependant il est difficile à des hommes morts de toucher au vif comme nos propres compagnons, dont les noms ne vivront peut-être pas aussi longtemps.
Que m’importe un individu auquel je ne pense jamais ? Tandis que dans chaque solitude se trouvent ceux qui secourent notre génie et nous stimulent d’une merveilleuse manière. L’amour a la puissance de mieux deviner la destinée d’un autre que cet autre lui-même et de l’attacher à son œuvre par d’héroïques encouragements. L’amitié possède-t-elle rien de plus insigne que la sublime attraction qu’elle exerce sur nos vertus ? À l’avenir nous ne ferons plus bon marché de nous-mêmes ou de la vie. Nous sommes fixés à un but, et le travail des terrassiers du chemin de fer ne nous fera plus honte désormais.
Sous ce chef rentre également cet hommage, très pur, je pense, que toutes les classes rendent au héros du jour, — depuis Coriolan et Gracchus jusqu’à Pitt, Lafayette, Wellington, Webster, Lamartine. Écoutez ces acclamations dans la rue ! Le peuple ne peut trop le regarder. Il se complaît dans cet homme. Voilà une tête et un corps ! Quel front ! quels yeux ! Des épaules atlantiques, un port héroïque et une force intérieure suffisante pour guider la grande machine ! Ce plaisir que procure l’expression complète de sentiments qui, dans les relations particulières, n’arrivent habituellement au jour que par des voies embarrassées et obstruées, existe également dans un ordre plus élevé et renferme le secret de la joie du lecteur en présence du génie littéraire. Ici rien de caché et un feu capable de fondre la montagne de bronze. Le principal mérite de Shakespeare peut se traduire en ces termes : C’est l’homme qui comprend le mieux la langue anglaise et qui exprime toujours ce qu’il veut dire. Le libre écoulement de la pensée n’est pour les hommes qui lui servent de canaux et d’écluses, qu’un indice de santé ou d’une heureuse constitution. Le nom de Shakespeare rappelle d’autres avantages purement intellectuels.
Les assemblées souveraines et les rois, avec leurs médailles, leurs épées et leurs habits armoriés, ne peuvent adresser à un être humain de compliment comparable à la communication de pensées d’une certaine élévation et qui présupposent son intelligence. Cet honneur qu’il est presque impossible, dans les relations personnelles, de rencontrer deux fois en sa vie, le génie le rend perpétuellement, et se trouve satisfait, si son hommage est accepté de temps à autre durant le cours d’un siècle. Les démonstrateurs des propriétés de la matière descendent, pour ainsi dire, au rang de cuisiniers et de confiseurs à l’apparition des révélateurs d’idées. Le génie est le naturaliste ou le géographe des régions supersensibles ; il en dresse la carte, et, en nous initiant à de nouveaux champs d’activité, il refroidit notre affection pour les anciens. Nous les acceptons aussitôt comme la réalité dont le monde que nous avons fréquenté n’était que l’ombre.
Nous allons au gymnase et à l’école de natation pour contempler la puissance et la beauté corporelles. Il y a plaisir égal et bénéfice supérieur à assister aux exercices intellectuels de toute espèce, tels que ceux de la mémoire, de la combinaison des nombres, d’une grande faculté d’abstraction ; tels que les variations de l’imagination, sa versatilité même ou sa concentration, attendu que ces actes exposent à la vue les organes invisibles et les membres de l’esprit qui correspondent, membre pour membre, aux différentes parties du corps. Nous pénétrons ainsi dans un nouveau gymnase où nous apprenons à élire les hommes d’après leurs signes les plus infaillibles, en suivant le conseil de Platon : « Elisez ceux qui, sans l’aide des yeux ou de tout autre sens, marchent à la vérité et à l’être. » Parmi ces activités se placent en première ligne les tressaillements, les incantations et les résurrections opérées par l’imagination. Quand cette faculté s’éveille chez l’homme, elle semble multiplier dix ou mille fois sa force. Elle fait surgir en lui le sentiment délicieux de l’étendue indéfinie, et inspire à l’esprit d’audacieuses habitudes. Nous sommes aussi élastiques que le gaz de la poudre à canon ; il suffit d’une sentence inscrite dans un livre ou d’un mot jeté dans la conversation, pour donner carrière à notre imagination, et à l’instant nos têtes vont plonger dans les galeries supérieures alors que nos pieds foulent encore le plancher du parterre. Et ce bienfait est réel, parce que nous avons droit à ces dilatations, et qu’une fois que nous avons passé les bornes, il ne nous est plus possible de redevenir jamais complètement les misérables pédants que nous étions.
Les hautes fonctions de l’intelligence sont tellement alliées entre elles, qu’une certaine puissance imaginative apparaît habituellement chez les esprits éminents ; chez les arithméticiens de premier ordre eux-mêmes, mais spécialement chez l’homme méditatif, aux habitudes de pensée contemplatives. Ces derniers nous servent en ce qu’ils possèdent la perception de l’identité et de la réaction. Les yeux de Platon, de Shakespeare, de Swedenborg, de Goethe n’ont jamais perdu de vue ces deux lois. Leur perception est une sorte de mètre de l’intelligence. Les petits esprits sont tels, faute de les apercevoir.
Mais ces fêtes elles-mêmes ont leurs excès. Notre amour pour la Raison dégénère en idolâtrie pour son héraut. Partout où un esprit d’une puissante méthode a enseigné les hommes, nous rencontrons des exemples d’oppression. La domination d’Aristote, l’astronomie de Ptolémée, l’autorité de Luther, de Bacon, de Locke ; en religion, l’histoire des hiérarchies, des saints et des sectes, prenant le nom de leurs fondateurs, en sont la preuve. Hélas chaque homme est une de ces victimes. L’imbécillité des hommes sollicite toujours l’impudence du pouvoir. C’est une volupté pour le talent vulgaire que d’éblouir et d’enchaîner le spectateur ; le vrai génie, au contraire, cherche à nous défendre de lui-même. Le vrai génie n’appauvrit pas, mais délivre et confère de nouveaux sens. S’il arrivait un sage dans notre village, il ferait naître chez ceux qui converseraient avec lui une notion nouvelle de la richesse, en leur ouvrant les yeux sur des avantages inaperçus ; il établirait un sentiment d’immuable égalité ; il nous tranquilliserait par la certitude que nous ne pouvons être trompés, et chacun comprendrait alors les écueils et les sauvegardes de sa condition.
Les riches reconnaîtraient leurs erreurs et leur pauvreté, les pauvres, leurs fautes et leurs ressources.
Mais la nature accomplit tout cela en temps opportun. La rotation est son remède. L’âme est impatiente des maîtres et avide du changement. Les maîtresses de maison disent d’une domestique qui s’est montrée précieuse : « Elle était restée trop longtemps chez moi. » Nous sommes des tendances ou plutôt des symptômes, et nul de nous n’est complet. Nous arrivons et nous partons, et nous buvons à petits traits l’écume de plusieurs existences. La rotation est la loi de la nature. Quand un grand homme disparaît, le peuple interroge l’horizon en quête de son successeur ; mais nul ne vient ni ne viendra. Sa classe s’est éteinte avec lui. C’est dans un champ tout autre, et complètement différent, qu’apparaîtra l’homme futur ; il ne sera ni Jefferson, ni Franklin, mais aujourd’hui un grand éleveur, demain un entrepreneur de roules ; puis un ichtyologiste ; puis un pionnier, chasseur de buffles, ou un général à demi sauvage de l’Ouest. Nous résistons ainsi à nos maîtres les plus grossiers ; mais nous possédons contre les meilleurs un remède plus exquis pouvoir qu’ils manifestent ne leur appartient pas. Lorsque nous sommes exaltés par des idées, nous ne le devons pas à Platon, mais à l’idée dont Platon lui-même était le débiteur.
Je ne dois pas oublier que nous sommes spécialement redevables à une classe d’hommes particulière. La vie est une échelle graduée. Entre les rangs de nos grands hommes, il existe de larges intervalles. Le genre humain, dans tous les siècles, s’est attaché à un petit nombre d’individus qui, soit par la qualité de l’idée qu’ils corporifiaient, ou par la grandeur de leur abord, avaient droit à la position de chefs et de législateurs. Ceux-là nous enseignent les qualités de la nature primordiale et nous initient à la constitution des choses. Nous nageons journellement dans un fleuve d’illusions, et nous nous amusons en réalité à bâtir dans l’air des maisons et des villes dont les hommes qui nous entourent sont dupes. Mais la vie est une vérité. Dans nos intervalles lucides, nous nous écrions : « Qu’une porte s’ouvre enfin pour moi dans le monde des réalités ; — j’ai porté trop longtemps la cape du fou ! » Nous voulons connaître l’esprit de notre économie et de notre politique. Donnez-nous-en la clef, et si les personnes et les choses sont les notes d’une musique céleste, déchiffrons-en les mélodies. Nous avons été frustrés de notre raison, et cependant il a existé des hommes sains d’esprit qui ont joui d’une riche et illustre existence. Ce qu’ils connaissaient, ils l’ont su pour nous. À travers chaque nouvel esprit transpire un nouveau secret de la nature dont le livre ne peut être fermé avant la naissance du dernier des grands hommes.
Les hommes supérieurs tempèrent le délire des esprits animaux, nous rendent prudents et nous convient à de nouveaux desseins et à de nouvelles facultés. La vénération du genre humain les choisit pour occuper les lieux les plus élevés. Voyez la multitude de statues, de portraits et de monuments qui rappellent leur génie dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque maison et dans chaque navire.
« Leurs fantômes se lèvent toujours devant nous ; ces êtres d’une nature supérieure, mais nos frères par le sang, nous dominent au lit et à table par d’admirables regards et de sublimes paroles. »
Comment spécialiserai-je les avantages distinctifs des idées, les services rendus par ceux qui introduisent les vérités morales dans l’esprit général ? Je suis tourmenté dans toutes mes actions par le perpétuel tarif de leur prix. Si je travaille dans mon jardin à la taille d’un pommier, je me distrais assez bien et je pourrais me livrer indéfiniment à cette occupation. Mais il me vient à l’esprit que j’ai passé une journée à expédier cette précieuse bagatelle. Je pars pour Boston ou New — York, et je cours çà et là à mes affaires ; quand elles sont terminées le jour l’est aussi. Je suis furieux en songeant que j’ai payé d’un tel prix un avantage insignifiant. Je me rappelle la peau d’âne sur laquelle il suffisait de s’asseoir pour voir se réaliser ses désirs, mais qui diminuait à chaque souhait. Je me rends, à une assemblée de philanthropes. J’ai beau faire, je ne puis quitter des yeux la pendule. Mais qu’il se présente dans celle société une âme noble, peu au courant des individus ou des partis, de la Caroline ou de Cuba, et quelle proclame une loi résolvant ces questions, m’attestant ainsi l’équité qui fait échec et mat tout tricheur et ruine tout égoïste, et m’avisant de mon indépendance, en toutes conditions de lieux, d’époques ou de constitution physique, — et cet homme m’affranchit ; j’oublie l’heure ; je sors des douloureuses relations personnelles ; je me trouve guéri de mes blessures ; je deviens immortel en comprenant que je possède un bien incorruptible. Il existe ici-bas un grand antagonisme entre les riches et les pauvres. Nous vivons dans un marché qui n’est pourvu que d’une certaine quantité de blé, de bois ou de terre ; or, plus j’en possède et moins il en reste pour les autres. Je ne puis être riche sans paraître manquer d’urbanité. Nul n’est heureux du bonheur des autres, et notre système est un plan de guerre et une prétention injurieuse à la supériorité. Tout rejeton de la race saxonne est élevé à vouloir primer. Tel est notre système, et l’homme en arrive à mesurer sa grandeur par les regrets, l’envie et la haine de ses rivaux. Mais dans les champs nouveaux il y a place pour tous ; l’amour — propre, l’exclusivisme n’y existent pas.