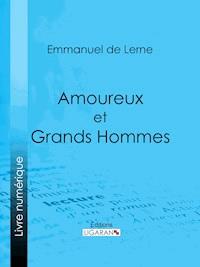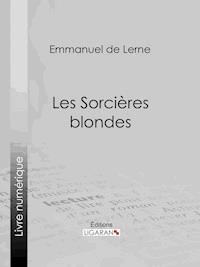
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "La nuit était belle. Le château, rempli de bruit et de mouvement, laissait échapper des flots de lumière et d'harmonie. Dans les salons, les danses tournoyaient en cercles capricieux, à la lueur pâlissante des bougies. De belles femmes et de jeunes hommes, la joie du plaisir sur les lèvres et clans le regard, évoquant du tombeau les siècles passés, promenaient à travers les lambris dorés leurs costumes de velours et de satin magnifiquement brodés."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335094855
©Ligaran 2015
La nuit était belle. Le château, rempli de bruit et de mouvement, laissait échapper des flots de lumière et d’harmonie. Dans les salons, les danses tournoyaient en cercles capricieux, à la lueur pâlissante des bougies. De belles femmes et de jeunes hommes, la joie du plaisir sur les lèvres et dans le regard, évoquant du tombeau les siècles passés, promenaient à travers les lambris dorés leurs costumes de velours et de satin magnifiquement brodés. Les fleurs mouraient dans cette chaude atmosphère. Une large galerie, couverte d’un tapis moelleux, ornée de statues de marbre, de vases du Japon garnis de camélias, éclairée par des lampes d’albâtre, conduisait aux jardins. Au-dehors, la façade et les abords du château resplendissaient de mille feux de couleur. Et puis, à mesure qu’on s’enfonçait dans le parc, une obscurité mystérieuse succédait graduellement aux clartés trop vives, protégeant ceux qui, las de la foule et du bruit, cherchaient dans les charmilles et sous les ombrages quelques instants de repos. Plus loin, un orchestre champêtre invitait les paysans à la danse, et le vin, coulant à pleins bords, ravivait leurs joies et désaltérait leurs vigoureuses ardeurs.
Le marquis Louis de Meillan célébrait, d’une façon princière, la fête du roi et sa propre fête en même temps dans son château d’Anjou. Seul peut-être au milieu de tous, Gaston, son fils, paraissait triste et préoccupé sous ses sombres habits espagnols du temps de Charles II ; et, dans un moment où l’animation du bal pouvait plus facilement dérober son absence, il s’éloigna, et, par mille détours, se dirigea vers l’étang.
Là, une femme l’attendait. Elle portait un costume du temps de Diane de Poitiers ; insouciante au reste de sa toilette et des regards qui, depuis le soir, s’étaient fixés sur elle. La blancheur mate de son visage, ses yeux noirs et voilés, son profil de camée antique, ses cheveux et ses sourcils épais, dénotaient en elle une nature grave, passionnée, rêveuse, douce et fière à la fois.
– Vous m’attendiez, Jeanne ? dit Gaston d’une voix attendrie.
Ils s’assirent sur un banc, près de l’étang.
– Oui, je suis venue, répondit la jeune femme, parce que je vous l’avais promis, mais c’est pour la dernière fois.
Gaston la regarda avec un douloureux étonnement.
– Mon honneur et mon repos me commandent de ne plus vous voir ; votre honneur à vous, Gaston, exige que vous cessiez de me poursuivre… Je sais ce que vous n’allez répondre, que vous m’aimez, n’est-ce pas ? Eh bien ! repousser la demande que je vous fais en ce moment, ce serait me prouver que vous prenez peu souci de mon bonheur : Non, Gaston, Jeanne Delaunay ne saurait être la femme du fils du marquis de Meillan. Vous appartenez à une noble famille ; moi, je suis la fille et la veuve d’un soldat ; vous êtes destiné à occuper dans le monde une position brillante ; votre père a placé en vous tout son orgueil de gentilhomme et toutes ses espérances ; je vous le dis encore, Gaston, je ne veux point me jeter comme un obstacle à travers votre vie briser d’un seul coup votre carrière et vous apporter malheur.
– Oh ! mais je vous aime plus que l’ambition, plus que la gloire, plus que l’avenir, plus que le monde entier !
– À votre âge, Gaston, on parle toujours ainsi. Aujourd’hui, vous oubliez l’avenir pour ne songer qu’au présent. Pensez aussi au monde au milieu duquel vous devez vivre, et dont le blâme est implacable et terrible.
– Jeanne, vous ne savez pas ce que je souffre ! Sans cela vous me prendriez en pitié. Ce n’est point un amour passager que cet amour enfoui deux années dans mon cœur. Ce n’est point non plus un amour enthousiaste, sans persévérance, que le mien ; je l’ai scruté et mûri de longs jours. Dites, que voulez-vous que je fasse ? qu’exigez-vous ? à quelles épreuves dois-je me soumettre pour que vous ayez foi en moi ? Parlez, j’obéirai. Me faut-il attendre des années ? j’attendrai. Faut-il m’éloigner et vous fuir ? Ordonnez, je suis prêt à tout. Mais, Jeanne, ma Jeanne bien-aimée, ne doutez plus de mon énergie, ne doutez plus de ma persévérance et de mon cœur.
Gaston était aux pieds de Jeanne ; sa voix était caressante, son regard convaincu. Il priait, il suppliait. Jeanne sentait son courage faiblir. Pourtant elle dit encore les conséquences funestes de ce qu’elle appela une mésalliance ; elle lutta longtemps, elle s’efforça d’ébranler la résolution de Gaston. Elle fut sévère pour lui, dure pour elle-même ; malgré sa souffrance, elle fut énergique, elle fut dévouée.
Lorsqu’elle eut terminé : – J’ai recueilli chacune de vos paroles, dit Gaston, et je vous remercie, Jeanne, d’avoir parlé ainsi. Mais si, maintenant encore, d’un cœur ferme, l’esprit éclairé, mais persévérant, je vous dis : Jeanne, consentez-vous à être ma femme ? Jeanne, que me répondrez-vous ?
– Mon Dieu ! murmura Jeanne, que puis-je faire, et suis-je coupable d’être vaincue ?
– Jeanne, croyez-vous à ma parole ? dites, croyez-vous à mon amour ?
– Oui, répondit-elle en tendant la main à Gaston, j’y crois comme je crois en moi et comme je crois en Dieu. Gaston, je vous aime.
Gaston ne saisit pas cette main pour la couvrir de baisers, il ne se jeta pas aux pieds de madame Delaunay ; il se leva, et la parole émue, mais non tremblante :
– Jeanne, dit-il, vous serez ma femme, et, puisque c’est pour mon bonheur que vous semblez craindre, j’en prends l’engagement devant vous, je serai heureux. Je serai heureux, Jeanne, et vous, vous serez heureuse par moi, et de mon bonheur.
Un bruit de pas se fit entendre. Gaston entraîna Jeanne dans la barque amarrée sur le bord de l’étang, et s’éloigna vers la rive opposée, emportant avec lui son bonheur. À moins de faire un long détour, il était impossible, sans le secours du canot, d’aborder à cette partie du parc.
Les rames frappaient en cadence les eaux silencieuses ; les rayons de la lune tremblaient dans le sillage de la barque, les étoiles étincelaient au firmament. Partout régnait le calme mystérieux de la nuit ; les lumières lointaines semblaient des fruits de feu jetés dans le feuillage, les sons affaiblis de l’orchestre arrivaient par intervalle, apportés par les bouffées des brises chargées de l’arôme des fleurs. – Jeanne et Gaston ne parlaient pas. L’âme de madame Delaunay était inondée d’une enivrante poésie. Un vent tiède et léger glissait dans ses cheveux et rafraîchissait son front. Gaston laissa flotter les rames près de lui, et la main de Jeanne dans la sienne :
– Quelle belle nuit ! dit-il ; voyez, pas un nuage dans ce ciel bleu suspendu sur nos têtes, pas une ride sur cette eau limpide ! Et voyez aussi les joies de cette âme que vous avez consolée et ravie, et dites, Jeanne, si le bonheur est à nous !
Jeanne laissa tomber sa tête sur l’épaule de Gaston.
– Mais, parlez-moi, reprenait-il ; dites que vous avez foi en moi et dans l’avenir !
Et Jeanne, le visage illuminé d’un rayon divin :
– Que vous dirais-je ? répondait-elle. Que je vous ai aimé bien vite ; qu’il y a de longues années que je vous aime ; que j’ai lutté avec effroi ; que j’aurais dû m’éloigner peut-être et vous résister ; que je n’en ai pas eu le courage ; que vous avez vaincu, Gaston, et qu’à cette heure je vous ai donné mon cœur pour la vie et tout entier.
Gaston ne pouvait rester longtemps loin du bal. Il fallut se quitter. Ils revinrent sur la rive ; ils se dirent adieu vingt fois et au revoir, et ils se séparèrent.
Et le marquis de Meillan, caché derrière eux dans le feuillage, murmura lentement et à voix basse : – Mon Dieu ! conservez-moi mon fils !
Gaston avait vingt-quatre ans. Il était grand, noble de visage et de manières. De sa mère, née dans le Midi, il tenait une nature ardente ; de son père, un caractère grave et opiniâtre, mélange singulier qu’on rencontre encore souvent aujourd’hui. Fils unique, héritier d’un grand nom, dernier rejeton d’une famille illustre, il avait reçu de son père une éducation solide. Un travail assidu avait rempli ses jeunes années, et, malgré l’avenir brillant naturellement ouvert devant son fils, et qui permettait à ce dernier de se laisser aller doucement au cours facile d’une destinée toute faite, le marquis s’était efforcé d’entraîner Gaston vers l’étude, comme s’il avait été obligé de se créer lui-même une carrière. Aussi dans ce siècle, où pour être quelque chose de grand il faut l’être par soi-même, Gaston semblait-il devoir porter dignement son nom. À vingt ans, il occupait déjà dans la diplomatie une position rare et enviée à cet âge. Une louable ambition, indispensable à qui veut parvenir, et qui n’est après tout que la conscience de sa propre valeur, avait trouvé place dans sa jeune tête ; et le marquis souriait avec complaisance en contemplant cet enfant sur lequel reposaient toutes les espérances d’une race puissante. Ce fils était la joie, la préoccupation constante, le but unique de son père.
M. de Meillan avait soixante ans. Nature de bronze, cœur intrépide, il avait fait avec honneur les guerres vendéennes. Lieutenant de Charette, sa taille élevée, son regard sévère, son imposante attitude, son courage et son coup d’œil prompt et sûr, l’avaient conduit rapidement à une position exceptionnelle dans l’armée. Près de son illustre chef, il avait livré vingt batailles ; il était resté deux fois parmi les morts, et n’avait dû la vie qu’à l’affection inquiète que lui portait son général. Charette retrouvait dans l’intelligente énergie du marquis plus d’un point de ressemblance avec son propre caractère. À l’issue de la guerre, la réputation de M. de Meillan resta intacte ; et, s’il était aimé en Vendée jusqu’à la vénération, lors du retour du roi, son influence devint grande dans le gouvernement, et, dans le noble faubourg, chacun s’inclinait avait respect et sympathie en sa présence. Vis-à-vis de Gaston, M. de Meillan, dévoué dans ses actes jusqu’aux soins maternels, s’était toujours montré grave, avare de paroles, maître et père de famille, à la façon de la vieille cité romaine. Si Gaston était son fils bien-aimé, il était en même temps le fils du marquis de Meillan. Noblesse l’avait toujours obligé, lui ; noblesse devait aussi obliger son enfant. Gaston était encore bien jeune lorsque son père, le prenant par la main, lui avait raconté le passé de sa famille. Il lui avait dit ses aïeux partant avec saint Louis pour la croisade, ses pères tombant près du roi sur tous les champs de bataille, et sous chaque règne payant largement la dette du sang. Il les lui avait montrés dans les conseils, dirigeant les destinées de la France, et ne se reposant jamais à la cour qu’après le travail. Il l’avait conduit au pied de l’échafaud de son grand-père, mort martyr de sa foi comme Louis XVI ; et, quand il en était arrivé à lui-même, sans orgueil, mais avec la fière satisfaction du devoir accompli, le marquis lui avait montré ses blessures, reçues en défendant la cause qu’avait depuis de longs siècles soutenue sa race. – Aujourd’hui, avait-il ajouté en terminant, c’est moins une épée qu’une intelligence et une pensée active que nous demanderont nos rois. Ils reviendront bientôt ; soyons donc prêts, mon fils.
Et Gaston, baisant la main du marquis :
– Mon père, avait-il répondu avec une émotion sérieuse, les Meillan n’auront point à rougir de leur dernier né.
Jusqu’à vingt ans, Gaston n’avait donc eu qu’une seule ambition : porter dignement le nom de son père, et il s’était juré de n’en avoir pas d’autre. Imprudent enfant, qui comptait sans l’amour.
Non loin du château, demeuraient madame Aubry et sa fille Jeanne. Madame Aubry était veuve d’un ancien officier de Charette, compagnon d’armes du marquis. Durant la guerre, Aubry avait fait ce que les Vendéens appelaient modestement leur devoir. M. de Meillan lui avait toujours témoigné un vif intérêt, et même un jour il lui avait sauvé la vie. Aussi, l’affection reconnaissante d’Aubry envers le marquis était un culte. Il tomba à son tour, comme ils tombaient tous alors, – Bonchamps aujourd’hui, demain Stofflet, Charette plus tard, – le visage tourné vers l’ennemi, le nom de Dieu et du roi sur les lèvres. Madame Aubry, qui, toujours et partout, avait suivi son mari d’aussi près qu’il lui avait été possible, revint avec Jeanne à son modeste castel. Une fortune honorable eût amplement suffi à des goûts moins simples que les siens. J’ai dit que Jeanne était belle, je dirai de plus qu’elle était noble de cœur et d’intelligence. La pureté de son langage, la dignité de son maintien, l’élévation de son esprit, dénotaient en elle une rare délicatesse et une exquise distinction. Son imagination était vive, mais son jugement sain. Elle consacrait à l’étude de la musique une partie de ses heures, et, malgré un penchant naturel et combattu vers des idées romanesques, elle ne lisait aucun ouvrage frivole. Dévouée à sa mère jusqu’à l’abnégation, elle épousa, pour lui complaire, un officier vendéen beaucoup plus âgé qu’elle, nommé Delaunay ; mais cette union fut courte, et Jeanne resta veuve près de sa mère, peu de temps après son mariage.
Dans son enfance, Gaston avait entendu le marquis faire de son ancien compagnon d’armes un éloge toujours laconique, mais profondément senti. Souvent il s’était trouvé près de Jeanne, et, chaque fois qu’il était revenu à Meillan, il l’avait revue avec bonheur. Après une longue absence à Paris, il fut un jour frappé de sa beauté et de sa grâce ; et, bien que madame Delaunay fût son aînée de trois ans, il comprit bientôt qu’il existait pour le cœur un autre sentiment que l’orgueil de race, qu’une ambition de famille et de blason. D’abord il aima sans se l’avouer à lui-même, prenant d’autant moins garde à cet amour, qu’il lui semblait plus impossible et sans issue honorable. Pouvait-il songer un seul instant à cette union, en présence de laquelle une longue suite d’aïeux, sortant du tombeau, seraient venus lui demander de quel droit il jetait, par une mésalliance, la flétrissure sur leur nom jusque-là sans tache.
Cette confiance en lui-même le perdit. Désarmé au jour de la lutte, il tomba victime de son imprudence et de sa présomption. Et, quand ses yeux s’ouvrirent, quand l’illusion ne fut plus possible, il voulut combattre ; il était trop tard, le mal avait poussé de profondes racines : Gaston aimait Jeanne avec ardeur. Il s’éloigna pourtant ; il voulut se raisonner, oublier ; il chercha à se distraire. Ce fut en vain. Il retourna à Meillan et trouva Jeanne abîmée dans une douleur profonde : elle avait perdu sa mère. Souvent, chez les âmes délicatement craintives, l’amour, pour se révéler, prend la forme et le prétexte des consolations et de la pitié. Gaston s’efforça d’adoucir les souffrances de Jeanne ; il la vit chaque jour ; il l’admira davantage. Il se demanda ce que son avenir pouvait redouter d’une semblable union. N’élevait-il pas madame Delaunay jusqu’à lui, en lui donnant son nom ? abdiquait-il pour cela les nobles traditions de ses ancêtres ? quel déshonneur jetait-il sur sa race ? Et, l’esprit rassuré ou plutôt vaincu, il tomba aux pieds de Jeanne et lui avoua son amour.
Jeanne repoussa cet amour comme une folie ou comme un crime. Elle s’estimait trop pour être sa maîtresse, elle n’était point d’assez grande maison pour devenir sa femme. – Ces Vendéens, sous leur simplicité native, portent au fond du cœur des instincts de gentilshommes. – Comme tout sentiment exalté, l’amour devait être pour Gaston inébranlable et terrible. La passion trouve dans l’obstacle surtout une excitation et une force puissante. Gaston aimait la lutte ; il l’accepta et se jura à lui-même que madame Delaunay serait sa femme. La résistance de Jeanne fut longue, franche, désintéressée, mais elle, aimait Gaston. L’amour l’emporta, et, nous l’avons vu, le 25 août 1819, elle lui jura de l’épouser.
Quant au marquis, sous l’empire de préoccupations bien différentes, il s’était mépris longtemps sur le motif réel de la tristesse de Gaston. Depuis peu de jours seulement de vagues soupçons pénétraient dans son esprit. Mais le hasard lui fit entendre, dans le parc, les serments échangés entre Jeanne et son fils. Mieux que personne M. de Meillan connaissait le caractère de Gaston. Il ne chercha point à s’abuser. Il plongea ses regards au fond de l’abîme entrouvert sous ses pas. Il sonda la gravité de la blessure déjà faite, il vit son bonheur anéanti. Alors, certain que toute intervention humaine était désormais impuissante à le secourir, il éleva sa pensée et ses yeux vers le ciel, et dans son désespoir il s’écria : « Mon Dieu ! conservez-moi mon fils ! »
La foule s’écoulait ; les lumières pâlissaient dans les premières lueurs du jour, les voitures roulaient sur la route, les paysans regagnaient, en chantant, leurs foyers. Le calme renaissait au château de Meillan. Enveloppé dans son manteau, Gaston errait au milieu du parc, respirant à pleins poumons l’air frais du matin et demandant à la brise de calmer son front brûlant des émotions de la nuit. Il ne songeait ni à son père, ni à la gloire, ni à l’avenir. Il marchait d’un pas rapide, la tête haute, tout enivré du bonheur présent. Insensiblement et sans y prendre garde, il se rapprocha de l’habitation de Jeanne et se trouva devant la porte de madame Delaunay avant même de s’être aperçu de la direction qu’il avait suivie.
À cette vue son cœur battit avec violence. L’heure n’est point avancée ; tout sommeille dans la campagne. S’il pouvait seulement, et de loin, l’entrevoir une fois encore. Et, sans réfléchir davantage, il franchit la haie et le fossé du jardin. Il s’approche de la maison ; au rez-de-chaussée la fenêtre de la chambre de Jeanne est entrouverte. Jeanne est assise la tête cachée dans ses mains ; son costume de la nuit est jeté sur un fauteuil ; elle semble plongée dans une rêverie profonde. Gaston la contemple dans un amour silencieux. Mais bientôt, emporté par son ardente jeunesse, il pousse la fenêtre, s’élance dans la chambre et tombe aux pieds de Jeanne.
– Vous ici, Gaston, s’écrie-t-elle avec effroi, seul, avec moi, à cette heure ! Ah ! fuyez, ou vous m’avez trompée, vous ne m’aimez pas !
Et madame Delaunay, tremblante, éperdue, le repousse sans vouloir l’entendre. Mais Gaston, d’une parole sincère et rapide, dit comment il est parvenu près d’elle, comment il n’a pu résister à son cœur ; il lui répète encore qu’il l’aime et qu’il la bénit.
– Je vous crois, Gaston, je vous croirai toujours, répond Jeanne. Mais, au nom du ciel, partez ! Mon honneur, qui est le vôtre, chaque seconde que vous restez peut lui faire une blessure mortelle. Au nom de votre bonheur et du mien, partez !
Ces paroles de madame Delaunay réveillèrent Gaston comme d’un rêve. Il comprit l’imprudence de sa conduite.
– Vous avez raison, Jeanne, dit-il, je pars. Mais, ajouta-t-il avec une douceur suppliante, pardonnez-moi. Mon bonheur m’écrase ; il me rendra fou, vous le voyez bien. Adieu ! adieu !
Gaston rentre au château et se jette sur son lit jusqu’au moment où il lui faut s’habiller à la hâte, monter à cheval et se rendre à un déjeuner de garçons donné par son voisin de campagne, le vicomte Maurice de Sars. La perspective d’une semblable réunion lui déplaît. Ces joies bruyantes l’effarouchent ; ces distractions vulgaires l’ennuient et l’épouvantent. Il eût voulu rester seul, loin du bruit, avec ses joies inconnues. Mais il a promis, il ne peut manquer à sa parole.
Le déjeuner fut gai. Gaston voulut se mettre à l’unisson et suivre l’exemple que lui donnaient ses amis. Malgré ses efforts, il ne put y réussir et resta froid, pensif et silencieux. À la fin du repas, bien des bouteilles se trouvaient vides, bien des têtes exaltées. À, ce moment, où l’expansion déborde de tous les cœurs, où les indiscrétions imprudentes se croisent à l’envi, alors que tout le monde veut parler à la fois, bien des santés furent portées selon les préférences ou la fantaisie des convives.
– À Gaston de Meillan et à ses amours ! dit Arthur de Gontaut.
– Oui, à tes amours, Gaston, à celle que tu aimes et qui t’aime aussi, nous le savons, répète Jules de Marsanges, à ton bonheur que nous envions tous.
– Les amours de Gaston ! dit Roger en souriant d’un air incrédule. Le farouche Hippolyte n’a pas d’amours.
– Roger a raison, continue l’amphitryon ; l’amour de Gaston, messieurs, c’est la gloire de sa race. Moi, je bois à la réalisation de tes nobles projets, mon ami, au succès de ta brillante carrière, mon futur ministre du roi. Je bois au beau nom que tu portes vaillamment, comme l’a porté ton père. Gaston, je bois à toi.
Au milieu de ce bruit, de ces voix qui se croisent, le front de Gaston s’assombrit. Mille impressions diverses s’entrechoquent tumultueusement dans son cœur.
– Non, messieurs, reprend Arthur de Gontaut, j’ai dit aux véritables et belles amours de notre ami, et je maintiens mon toast.
Gaston relève fièrement la tête ; il attache sur Arthur un regard scrutateur et brillant de colère.
– Tu es fou, Arthur, répond encore Maurice, devinant l’impression pénible que ces paroles causent à Gaston, tu es fou et Meillan est sage. Comme nous, il ne jette pas ses années de jeunesse au souffle des joies futiles et des inutiles passions. Sa vie est grave, fructueuse. Pour moi, je trouve qu’il a raison.
– Eh bien ! Gaston, reprend Arthur, mets-nous d’accord. Qui, de moi ou de Maurice, se trompe en ce moment ?
– Et toi-même, répond Gaston, que veux-tu dire ? Je devine mal les énigmes. Explique-toi.
– Que diable ! s’écrie Jules, il n’y a rien là pour te déplaire, et les plus rigides eux-mêmes t’excuseraient. On travaille, on marche vers un glorieux avenir, c’est bien. Mais, après tout, on a vingt ans ; pourquoi serait-il donc défendu d’aimer ?
– Je ne vous comprends pas, dit Gaston avec une froideur affectée.
– Allons, c’est un secret ! et, comme un secret ne m’a jamais paru plus inviolable que les secrets d’amour, n’en parlons plus, dit Arthur.
– Parle, au contraire, dit Gaston d’un ton bref, je le désire, parle.
– Eh bien ! si tu le veux, je dirai qu’elle est charmante, et, puisque tu es heureux, tu dois être bienheureux. Je bois donc à celle dont tu escaladais ce matin le balcon, au chant de l’alouette, lorsque je t’aperçus ainsi que Jules. Roméo, je bois à Juliette ; Gaston, je bois à la belle Jeanne Delaunay.
– Tu n’as rien vu et tu mens ! s’écria Gaston en se levant, le visage pâle, les yeux étincelants.
L’insulte était sanglante. Les convives s’efforcèrent vainement de l’atténuer. Arthur ne pouvait dévorer un affront, Meillan n’était pas homme à rétracter en ce moment ses paroles. D’ailleurs, qu’était-ce qu’un duel pour ces jeunes gens dont les pères ne marchaient jamais sans l’épée à la ceinture ? Et, qu’était-ce que la vie pour ces descendants des gentilshommes qui, sous Henri III et Louis XIII, interrompaient un joyeux festin pour un bon coup d’épée et revenaient ensuite, – l’un des deux seulement, bien entendu, – continuer le repas interrompu ?
Les témoins sont choisis. Dans deux heures, Arthur et Gaston doivent se battre dans la forêt. Gaston écrit une lettre pour son père, une seconde pour Jeanne, les place cachetées sous un même pli sans adresse, et les remettant à Maurice : « Mon ami, lui dit-il, si je meurs, tu feras parvenir ces lettres. Il y a peut-être là un secret ; je le confie à ta discrète amitié. »
Deux heures après, Gaston, blessé, était transporté au château de Meillan. Le visage du marquis ne trahit aucune émotion. Il ne questionna personne, il ne prononça pas un mot. Mais, lorsque, durant la nuit, délivré de toute contrainte, libre des regards étrangers, il se trouva seul au chevet du malade, il regarda longtemps son fils endormi, et sa pensée s’abîma dans d’incommensurables douleurs. Un nom, échappé des lèvres du blessé, eût suffi pour tout révéler à son père, si ce dernier eût eu besoin d’apprendre et n’avait, hélas ! tout compris. Pendant toute la maladie, M. de Meillan ne quitta pas Gaston. Il ne l’interrogea pas. Il demeura grave, silencieux, soutenant la tête de son fils dans ses moments de défaillance et lui présentant lui-même les remèdes qui devaient le sauver. La blessure était moins profonde qu’on ne l’avait craint d’abord. Au bout d’un mois, Gaston se leva ; il était presque guéri ; seulement, le médecin exigeait encore plusieurs semaines de repos.
Appuyé sur le bras de son père, attentif à modérer sa marche et à lui choisir les sentiers faciles et unis, Gaston fixe les yeux vers la demeure de Jeanne ; il brûle du désir d’aller vers elle, de la rassurer, de la consoler. Son sang bouillonne, son esprit et son cœur endurent une horrible torture. Que devient madame Delaunay ? que fait-elle ? que peut-elle croire ? Non, il n’a plus la force d’attendre ; et, dût-il mourir ensuite, il la verra.
La nouvelle de la maladie de Gaston et la cause de son duel étaient arrivées jusqu’à Jeanne. Depuis lors, renfermée dans sa demeure, instruite chaque jour de l’état du blessé, grâce aux informations discrètes que recueille Marthe, sa vieille gouvernante, elle succombe sous le poids de ses silencieuses souffrances. Elle aime Gaston et comprend que désormais leurs deux existences sont à jamais et étroitement unies. Compromise aux yeux du monde, son espoir réside tout entier en celui qui a juré de lui donner son nom. Ce sinistre début de leur amour l’épouvante ; l’avenir lui apparaît gros d’orages et de déboires ; ses heures, se passent dans l’anxiété, ses nuits s’écoulent sans sommeil.
Un jour que, plus inquiète encore, elle n’a pu recevoir de nouvelles de Gaston, on lui annonce tout à coup M. le marquis de Meillan. À ce nom, Jeanne se trouble ; elle se lève et s’appuie contre la cheminée pour ne pas tomber. Le marquis la salue avec douceur et avec tristesse, et s’assied vis-à-vis d’elle. Il semble, lui aussi, plus pâle que de coutume. Mais, bien que dévoré par le chagrin le plus poignant qui puisse torturer l’âme d’un père, bien que chacune des paroles qu’il va prononcer eût arraché à tout autre un cri de douleur, telle est l’énergique puissance de cet homme sur lui-même, qu’il lui a suffi de dire à son visage de sourire pour que son visage ait souri ; il a commandé à son cœur d’être calme, et son cœur a obéi.
– Jeanne, dit M. de Meillan rompant le premier le silence, Gaston est guéri.
Madame Delaunay leva vers le ciel un regard de reconnaissance.
– Et je viens réclamer de vous un service, continua-t-il.
– De moi ! répondit Jeanne avec surprise, parlez, monsieur le marquis. – Mais, reprit-elle avec tristesse, est-il donc possible que vous, vous ayez besoin de moi ?
– Je vous remercie déjà, Jeanne, car ces mots me prouvent que votre cœur se souvient.
– Oui, je me souviens, monsieur le marquis ; je me souviens que vous fûtes toujours le protecteur de notre famille, que vous avez sauvé la vie à mon père. Je n’ai point oublié que mon père mourut sans avoir pu acquitter sa dette envers vous et nous la légua. Vous le voyez, monsieur le marquis, je n’ai rien oublié.
– Votre père était un noble cœur, Jeanne ; c’était pour moi un ami. Ce que j’ai fait pour lui n’est rien ; j’étais prêt à en faire davantage. Mais aujourd’hui, Jeanne, d’un mot vous pouvez, et au-delà, acquitter sa dette, vous pouvez changer les rôles et rendre le marquis de Meillan votre obligé.
Madame Delaunay regarda le marquis avec étonnement et avec crainte.
– Écoutez-moi, poursuivit-il. Je vais vous confier mes plus chères pensées. Vous êtes digne de m’entendre et vous me comprendrez. J’ai un fils. Ce fils, je l’aime de tout mon amour, je ne possède que lui. Je suis prêt à sacrifier ma vie à son bonheur. Gaston est l’unique héritier, l’espérance d’une grande famille. Ses obligations sont terribles, sa responsabilité est immense. Intelligence active et que l’inaction et un bonheur trop calme tueraient, il avait jusqu’ici compris la mission qui lui était échue et dignement répondu à mes efforts. L’avenir s’ouvrait devant lui remplit de brillantes promesses, mais aujourd’hui tout est changé. Son front est pensif, son esprit malade ; une influence secrète pèse sur lui ; et ce n’est pas seulement son vieux père dont il va briser la vie, c’est son propre bonheur qu’il va détruire. Une personne, une seule, peut, par son dévouement, le rendre à son père, à sa famille, à ses devoirs et à lui-même. Maintenant, Jeanne, savez-vous ce que je réclame de vous ?
Madame Delaunay resta muette, les yeux fixés à terre, abîmée dans sa douleur.
– Si vous aimez Gaston, Jeanne, si vous l’aimez, il faut le sauver, reprit M. de Meillan.
– Et, pour le sauver, il faut renoncer à son amour, n’est-ce pas ? murmura-t-elle ; il faut rompre la parole que je lui ai donnée ; il faut m’éloigner, fuir loin de lui.
– Oui, Jeanne, vous l’avez dit, il faut partir. Gaston aime une femme d’une rare intelligence et d’un grand cœur ; il lui a fait une promesse solennelle, et une folle équipée lui défend de regarder en arrière. Il ne reculera pas, son malheur fût-il certain. C’est à l’amour dévoué et sublime de celle qui l’aime de faire ce qu’il ne saurait faire lui-même ; c’est à elle de partir, puisqu’il ne partirait pas.
– Oui, je comprends, dit Jeanne, pâle comme la mort, je suis un obstacle dans sa vie !
Et sa tête retomba sur sa poitrine.
– Oh ! je le sais, vous devez bien souffrir ! dit doucement le marquis ému en présence de cette véritable et poignante douleur.
Mais, dominé par son amour de père et voyant madame Delaunay ébranlée :
– Pourtant, si vous l’aimez, Jeanne, poursuivit-il, sauvez-le ! Il est dans la vie de chacun des obligations implacables ; et, quelque digne que vous soyez de l’affection de mon fils, croyez-moi, son bonheur ne peut être près de vous.
– Oh ! s’écria-t-elle, vous me brisez le cœur !
Et puis, après un long silence, durant lequel Jeanne lutta, cédant tour à tour à son amour ou à son dévouement :
– J’obéirai, dit-elle d’une voix éteinte, je partirai… mais lui ?
– Le mal est grand, répondit le marquis ; je l’espère, il n’est pas sans remède. Je veillerai sur lui, je soignerai sa blessure, et Dieu nous viendra en aide.
– Je partirai, répéta Jeanne étouffée par la douleur.
– Dieu compte au ciel votre sacrifice, Jeanne, votre père vous bénit, et moi je vous remercie de sauver mon fils.
Jeanne passa la main sur son front comme pour chasser toute égoïste pensée et raffermir son courage ; et, relevant la tête, sublime alors de résignation :
– Il faut que ce soit à l’instant même, reprit-elle, je le comprends. Demain, je partirai.
– Jeanne, dit M. de Meillan, je possède un château en Dauphiné, disposez-en si bon vous semble. Vous aviez mon affection ; vous l’avez plus entière encore. De loin, partout, je veillerai sur vous. Je vous brise le cœur, Jeanne, et pourtant je vous aime.
– Merci, monsieur le marquis. Mais le monde est grand ! et que m’importe où j’irai désormais, je trouverai bien une solitude pour cacher mes larmes.
– Il va vous falloir en ce moment bien du courage, mon enfant.
– Soyez sans crainte, monsieur le marquis, je vous ai promis que votre fils vous était rendu.
– Merci, Jeanne, c’est vous qui le sauvez.
M. de Meillan se leva.
– Monsieur le marquis, dit Jeanne en marchant vivement à lui, un jour, quand je ne serai plus, – et ce sera bientôt, – vous lui direz, n’est-ce pas, combien je l’ai aimé. Vous lui direz, à lui, qui m’accusera peut-être, que son bonheur me fut plus cher que mon bonheur, et qu’à mon départ vous m’avez vue, et que je souffrais bien.
M. de Meillan lui serra la main et s’éloigna. Et la pauvre désolée, dont les yeux étaient restés, secs jusque-là, tomba anéantie dans un fauteuil, et des larmes amères inondèrent son visage.
Le lendemain, au lever du soleil, Jeanne regardait à travers une fenêtre la berline qui allait l’emporter. Les malles étaient placées sur la voiture, le postillon faisait claquer, son fouet, tout était prêt.
– Allons, dit-elle en s’efforçant de ranimer son courage, le sacrifice est accompli. Ai-je longtemps encore à souffrir ? Je ne sais. Mais, puisque son bonheur l’exige, partons.
Et Jeanne descend lentement les marches de l’escalier ; elle va franchir la porte, monter en voiture, s’éloigner pour toujours ; mais, un homme lui barre le passage : c’est Gaston. À sa vue, Jeanne pousse un cri : – Mon Dieu, dit-elle, je ne suis pas coupable ! C’est vous qui le voulez ainsi.
– Vous partiez, Jeanne ? lui demande Gaston. Et pourquoi partiez-vous ?
Atterrée par cette question, à laquelle elle ne sait que répondre, madame Delaunay baisse les yeux ; elle balbutie comme un coupable surpris en faute.
– Oui, vous partiez, vous me fuyiez ! reprend Gaston, la saisissant par le bras et l’entraînant dans le salon en désordre, dont il ferme du pied la porte avec violence. Répondez-moi et n’essayez pas de me tromper. Quel est ce mystère, et n’est-il pas vrai que c’était à cause de moi que vous partiez ? Et pourtant, ai-je usé de contrariété pour arracher votre promesse, et vous ai-je, par ma conduite, autorisé à recourir à la ruse ? Vos sentiments sont de courte durée, madame ; vous avez peu de mémoire : car il n’y a pas un mois vous me juriez un éternel amour.
– Vous vous taisez, continua-t-il avec une exaltation croissante. Insensé que j’étais de croire à vos serments ! Eh bien ! aujourd’hui, votre liberté, je vous la rends ; vos promesses, je les brise ! Cependant, vous eussiez pu, ce me semble, choisir une occasion plus propice. Qu’avez-vous attendu, et que ne partiez-vous il y a quinze jours ? Atteint d’une blessure reçue en défendant votre honneur, je ne serais pas venu me jeter au travers de vos projets. Allez ; je pars moi-même, et soyez sans crainte, vous ne me reverrez plus.
Affaibli par sa maladie, Gaston tomba épuisé près de Jeanne.
– Non, je ne vous ai point trompé ! s’écria Jeanne penchée vers lui. Gaston, je vous aime ! oh ! vivez, je vous aime !
Et, d’une voix brisée, Gaston répétait comme en délire :
– Jeanne, Jeanne, que vous ai-je donc fait ?
– Gaston, continuait madame Delaunay, je vous le jure, je ne suis pas coupable ! vous ne pouvez me condamner ainsi sans m’entendre. Ayez pitié de moi, Gaston ; vous ne savez pas combien je vous aime.
– Vous m’aimez ! répéta-t-il en soulevant péniblement la tête. Mais oui, vous m’aimez ! que vous disais-je donc ? ne m’avez-vous pas juré d’être ma femme ? Oh ! non, vous ne partirez pas, Jeanne, restez près de moi, votre absence me tuerait.
Et Gaston pressait les mains de madame Delaunay à genoux devant lui ; et Jeanne répétait encore : – Gaston, je vous aime.
Appuyé sur le bras de Jeanne, Gaston se leva, s’approcha de la fenêtre, l’ouvrit et d’une voix ferme : – Reconduisez vos chevaux, dit-il au postillon, madame Delaunay ne part pas.
Tout à coup Jeanne pâlit : – Le marquis ! s’écria-t-elle.
Quelques secondes après, en effet, M. de Meillan entra, calme, grave, comme toujours. En présence de son père, Gaston prit une attitude respectueuse. M. de Meillan salua Jeanne avec un sourire qui semblait dire : Vous teniez votre promesse, ce n’est pas vous qu’il faut blâmer ! et s’adressant à son fils :
– Vous m’avez inquiété vivement, Gaston, dit-il. Faible encore, à peine guéri, vous avez été imprudent de monter à cheval malgré l’avis du médecin. En ce moment, vous souffrez, rentrons au château ; c’est de repos que vous avez besoin.
Gaston, immobile, semblait combattu par sa volonté d’obéir à son père et sa crainte de perdre Jeanne une seconde fois. Le marquis devina sa pensée.
– Je sais tout, Gaston ; mais rassurez-vous, madame Delaunay vous promet, – je le lui demande en mon nom, – de ne point s’absenter d’ici trois jours ; de votre côté, d’ici trois jours, vous ne chercherez pas à la rencontrer. Votre père vous le demande, au besoin il vous en prie.
Le marquis se retira. Gaston jeta sur Jeanne un regard suppliant et suivit son père en silence.
En quelques minutes, la voiture de M. de Meillan les ramenait au château. Durant le trajet, pas un mot ne fut échangé entre eux sur ce qui venait de se passer. Il en fut de même le jour suivant. Le second jour, au matin, le marquis entra dans l’appartement de son fils, et, lui tendant la main avec affection, il lui dit :
– Dieu m’est témoin, Gaston, que je vous ai bien aimé ! Je me suis complu sans cesse à diriger votre jeunesse vers le bien, à développer votre intelligence, à faire de vous un grand cœur ; car je n’ignorais pas que vous auriez un glorieux, mais lourd fardeau à soutenir. Si parfois j’ai tressailli de joie en voyant mon nom salué à l’égal des plus grands noms, c’est que je savais que vous le porteriez un jour. Si je me suis surpris souriant au souvenir d’un passé sans reproche, et peut-être non sans gloire, c’est que je devais vous léguer ce passé. Je vous ai aimé avec mon cœur de père, je vous ai aimé aussi avec ma fierté de gentilhomme. À votre tour, mon fils, de soutenir l’honneur de cette race à laquelle chacun de vos aïeux a voulu ajouter une illustration nouvelle. À eux aussi, et plus d’une fois, il a fallu comprimer les battements de leurs cœurs, briser leurs volontés, étouffer leurs larmes ; je ne parle pas du sang répandu, – le sang n’est rien. Ils ont eu à remplir souvent, ceux-là, – votre père vous le dit, Gaston, – un pénible et rude devoir. La Providence remet aujourd’hui en vos mains un dépôt sacré. Vous aurez à rendre des comptes sévères, votre responsabilité est grande ; mais votre présent répond de l’avenir.
Sentant son fils ému sous sa puissante parole, le marquis continua :
– Voici vos devoirs, mon fils. Et maintenant, si la France est en danger, si le service du roi réclame un dévouement, éprouvé, marchez au premier rang, c’est votre place ; nul ne peut vous la contester. Passez tête haute au milieu des plus puissants, sans fausse modestie comme sans orgueil, c’est votre droit. Droits et devoirs, les acceptez-vous sans réserve ? jurez-vous de les respecter et de les maintenir ?
– Mon père, nul de ces devoirs ne saurait me commander de manquer à l’honneur.
– Eh bien ! mon fils ?
– Mon père, j’aime madame Delaunay et lui ai donné ma parole. Une folle imprudence, un duel, l’ont à jamais compromise ; aujourd’hui l’honneur, aussi bien que mon amour, m’ordonnent de l’épouser.
– Malheureux enfant ! s’écria le marquis, emporté un instant par l’émotion qui lui brise le cœur, vous ignorez donc qu’un semblable mariage détruit votre avenir, flétrit votre nom, jette vivant mon fils au tombeau. – Gaston, continua-t-il en recouvrant bien vite le calme qu’il avait perdu un instant, quelles que soient les qualités de la fille de mon ancien capitaine, et je les reconnais le premier, le monde a des principes, préjugés ou non, sur lesquels il ne transige pas. Jeanne n’a ni nom ni fortune ; le monde exige de la fortune et un nom. Vous serez blâmé par ceux-là mêmes qui aujourd’hui applaudissent à vos succès. Vous rencontrerez sur les lèvres un dédain superbe, vous recueillerez à la dérobée des paroles vagues d’une compassion blessante. Vous saurez vous venger, n’est-ce-pas ? Non ; il est des mots qui blessent comme des coups de poignard, insaisissables et lâches, et contre lesquels la vengeance ne peut rien. Ceux qui vous resteront fidèles prendront en pitié votre imagination exaltée et votre intelligence sans énergie. Votre femme portera votre nom ! mais le monde scrute tout mystère, et vos envieux seront là pour rappeler votre mésalliance, basée non sur l’espoir d’une grande fortune, mais sur un caprice d’amour. Votre famille, elle vous reniera. Blessé dans votre orgueil, vous irez à l’écart cacher votre blessure et pleurer peut-être sur ceux auxquels vous aurez donné la vie. Et vous resterez seul, tout seul, Gaston, car votre amour lui-même vous l’aurez maudit.
– Mon père, vous calomniez votre fils.
– Cet amour, continua M. de Meillan, sera la cause de toutes vos douleurs. Eh bien ! si la pensée de votre avenir et de celui de votre famille ne vous touche pas, ne faites pas du moins le sacrifice de votre repos, de votre bonheur.
Et la sollicitude paternelle ouvrant au marquis les mystérieuses profondeurs de la passion :
– Ce n’est point un roman, c’est une grave histoire que la vie. L’amour de l’homme n’est point éternel. L’amour ne saurait remplir votre cœur tourmenté du besoin d’agir et d’une légitime ambition. Votre tristesse engendrera l’ennui. Vous verrez votre carrière brisée, vos travaux inutiles, vos efforts impuissants. Le mal sera sans remède. Las bientôt de cette existence d’exception, que vous-même vous vous serez faite par générosité et délicatesse, vous voudrez cacher votre désespoir, lutter jusqu’à la fin ; vous ne le pourrez pas, vous succomberez. Celle que vous aurez prise pour femme deviendra pour vous un fardeau, et votre souffrance lui sera aussi un reproche vivant et sanglant de toutes les heures. Mon expérience vous paraît cruelle et implacable ! À votre âge ; on croit tout possible ; on ne peut, ni calculer ni prévoir. Mais moi, je sais la vie pour vous, confiez-moi votre bonheur.
– Madame Delaunay a ma parole, mon père ; ce serait forfaire à l’honneur que d’y manquer.
– Mais, si madame Delaunay vous rendait votre parole ?
– Elle ne le fera pas mon père.
– Elle le fera, Gaston ; car, il y a deux jours, lorsque vous la surpreniez prête à partir, elle s’éloignait silencieuse et dévouée. Elle partait convaincue, elle aussi, que c’était là le seul moyen de vous sauver.
– Ô Jeanne ! murmura Gaston, plus digne encore de mon amour !
– Gaston, dit M. de Meillan, je vous ai prié de réfléchir durant trois jours ; demain soir ces trois jours expirent et vous serez libre. D’ici là, Gaston, sondez votre cœur ; vous savez si je vous aime, si vous êtes toute ma vie, tout l’espoir de votre famille ! mais vous ne savez pas, mon fils, ce que c’est que l’amour d’un père ! Repassez dans votre mémoire ce que je vous ai dit de votre bonheur à venir, et du bonheur de celle que vous voulez prendre pour femme. Choisissez entre un amour fatalement condamné, et la gloire de votre nom et l’affection de votre père à jamais perdue pour vous. Demain soir, Gaston, j’attendrai votre réponse. Avant de monter sur l’échafaud, votre aïeul m’embrassa, et ses adieux furent ceux-ci : « Je vous lègue un nom sans tache, mon fils ; vous le léguerez sans tache à vos enfants. Et n’oubliez pas que je préférerais vous voir étendu mort à mes pieds que de songer un seul instant que vous pouvez déshonorer mon nom. » Ces paroles d’un martyr, je vous les adresse, vous les méditerez mûrement. Toutes paroles dernières d’un père, Dieu le ? recueille et s’en souvient. Demain, Gaston, vous déciderez de votre sort, vous déciderez aussi du mien.
Gaston passa une nuit agitée ; combattu entre son affection pour son père et son amour pour-Jeanne, son esprit eut à soutenir une lutte longue et terrible. Tantôt, marchant à grands pas, il se rappelait chacune des paroles du marquis qu’il vénérait, et cette immense douleur ébranlait sa volonté. Tantôt il songeait à Jeanne. Il se rappelait la persévérance dont il avait eu besoin pour obtenir la promesse de madame Delaunay, et vaincre cette âme hésitante et désintéressée. Il se rappelait sa visite imprudente le lendemain du bal, son duel, dont la cause était connue de tout le pays, et la résolution de Jeanne qui consentait la veille à partir pour que lui-même fût heureux. Et l’amour triomphait à son tour.
Le jour suivant, le marquis et Gaston ne se virent pas. Seulement, à travers sa fenêtre, de loin et à la dérobée, M. de Meillan, apercevant son fils, resta immobile, les bras croisés, sa tête blanchie inclinée sur sa poitrine, repaissant ses yeux, pour la dernière fois peut-être, de cette image, source de tant de craintes et de tant d’espérances. Il le contemple comme, à l’heure suprême, on regarde encore, pour les graver dans sa mémoire, les traits adorés de celui qui va mourir. Et, sentant son courage faiblir, le fils des croisés courbe son front ; il s’agenouille dans la poussière, il prie, les mains jointes, le Dieu qu’il invoqua tant de fois avant la bataille, dans les champs sacrés de la Vendée.
Vers le soir, M. de Meillan reçut son fils dans le grand salon du château, entouré des portraits de ses aïeux.
– J’attends votre réponse, Gaston, lui dit-il. Mais votre attitude me fait assez comprendre que votre décision est irrévocable.
– Oui, mon père, répondit Gaston d’une voix éteinte.
– Ainsi, reprit M ; de Meillan, ni mes conseils, ni mon affection, ni votre bonheur, ni la pensée de vos devoirs n’ont pu fléchir votre résolution ?
Gaston garda le silence.
Alors le marquis ouvrit lentement une cassette, y prit des papiers, et, froid et inébranlable comme un principe, il les présenta à son fils.
– Voici les titres relatifs à la fortune de votre mère, dit-il. Elle n’était pas riche, mais c’était une noble femme. Cette croix d’or, votre grand-père la portait sur sa poitrine en montant à l’échafaud ; une clause de son testament m’ordonne de vous la donner à l’époque de votre mariage, pour que vous la transmettiez-vous même à l’aîné de vos enfants. J’accomplis donc la volonté dernière de mon père. Prenez cette croix. Et, maintenant, voici votre nom, marquis de Meillan ; moi aussi, je vous le remets sans tache comme je l’avais reçu sans tache. Il vous appartient par droit de naissance. Gardez-le donc, puisqu’il ne m’est pas permis de vous l’enlever. Allez ; j’ai rempli envers vous tous mes devoirs, je ne vous dois plus rien. Vous êtes libre, désormais je n’ai plus d’enfant. Je ne vous demanderai jamais compte de ce nom, que vous avez renié, et je prierai Dieu qu’il ne vous demande pas compte non plus du glorieux dépôt confié à votre garde, ni du bonheur de votre père, dont vous flétrissez et brisez la vie.