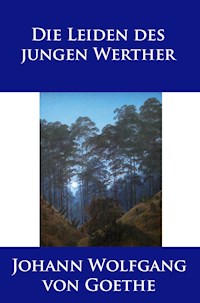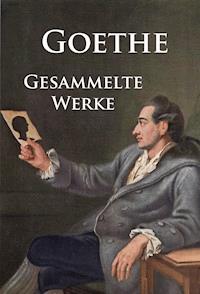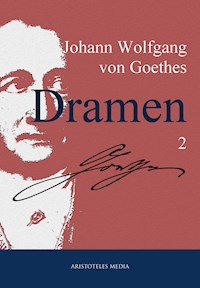Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SK Digital Classics
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Werther rencontre Lotte lors d’un bal. Elle danse. Elle rit. Elle incarne tout ce qu’il cherche. Il tombe amoureux instantanément, totalement, irrévocablement. Mais Lotte est fiancée à Albert. Un homme bon, stable, digne d’elle. Werther le sait. Cela ne change rien. Ses sentiments grandissent malgré l’impossibilité. Il reste proche d’eux. Visite leur maison. Parle avec Lotte. Se consume en silence. Chaque instant avec elle est joie et torture. Il ne peut pas partir. Il ne peut pas rester. Il ne peut pas oublier. Werther écrit des lettres à son ami. Y déverse son âme. La passion, la nature, le désespoir. L’intensité de ses sentiments brûle tout. La raison ne peut rien contre la force de ce qu’il ressent. L’amour impossible mène vers l’abîme. Werther doit faire un choix final. Le roman révolutionnaire de Goethe qui a défini toute une génération. Publié en 1774, il a bouleversé l’Europe. Une histoire d’amour absolue, de passion romantique, d’émotions portées à leur paroxysme. Cette nouvelle traduction française restitue toute l’intensité émotionnelle et la beauté lyrique de l’original.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Johann Wolfgang von Goethe
Les Souffrances du jeune Werther
Nouvelle traduction française intégrale
Copyright © 2025 Novelaris
Tous droits réservés. Toute reproduction ou diffusion de ce livre est interdite sans l’autorisation écrite de l’éditeur.
ISBN: 9783689313487
Table des matières
Premier livre
Le 4 mai 1771
Le 10 mai
Le 13 mai
Le 15 mai
Le 17 mai
Le 22 mai
Le 26 mai
Le 27 mai
Le 30 mai
Le 16 juin
Le 19 juin
Le 21 juin
Le 29 juin
Le 1er juillet
Le 6 juillet
Le 8 juillet
Le 10 juillet
Le 11 juillet
Le 13 juillet
Le 16 juillet
Le 18 juillet
Le 19 juillet
Le 20 juillet
Le 24 juillet
Le 26 juillet
Le 26 juillet
Le 30 juillet
Le 8 août
Le 8 août
Le 10 août
Le 12 août
Le 15 août
Le 18 août
Le 21 août
Le 22 août
Le 28 août
Le 30 août
Le 3 septembre
Le 10 septembre
Deuxième livre
Le 20 octobre 1771
Le 26 novembre 1771
Le 24 décembre 1771
Le 8 janvier 1772
Le 20 janvier
Le 8 février
Le 17 février
Le 20 février
Le 15 mars
Le 16 mars
Le 24 mars
À titre d'information
Le 5 mai
Le 9 mai
Le 25 mai
Le 11 juin
Le 16 juin
Le 16 juin
Le 29 juillet
Le 4 août
Le 21 août
Le 3 septembre
Le 4 septembre
Le 5 septembre
Le 6 septembre
Le 12 septembre
Le 15 septembre
Le 10 octobre
Le 12 octobre
Le 19 octobre
Le 26 octobre
Le 27 octobre
Le 30 octobre
Le 3 novembre
Le 8 novembre
Le 15 novembre
Le 21 novembre
Le 22 novembre
Le 24 novembre
Le 26 novembre
Le 30 novembre
Le 1er décembre
Le 4 décembre
Le 6 décembre
Le 12 décembre
Le 14 décembre
Le 20 décembre
Après Eilfe
Cover
Table of Contents
Text
Premier livre
J’ai rassemblé avec diligence tout ce que j’ai pu trouver sur l’histoire du pauvre Werther et je vous le présente ici, sachant que vous m’en serez reconnaissants. Vous ne pouvez refuser votre admiration et votre amour à son esprit et à son caractère, ni vos larmes à son destin.
Et toi, âme généreuse, qui ressens la même envie que lui, trouve du réconfort dans ses souffrances et laisse ce petit livre être ton ami, si le destin ou ta propre faute t’empêchent d’en trouver un plus proche.
Le 4 mai 1771
Comme je suis heureux d’être parti ! Mon cher ami, que n’est-ce donc que le cœur humain ! Te quitter, toi que j’aime tant, dont j’étais inséparable, et être heureux ! Je sais que tu me pardonnes. Mes autres relations n’étaient-elles pas bien choisies par le destin pour effrayer un cœur comme le mien ? Pauvre Leonore ! Et pourtant, j’étais innocent. Étais-je responsable du fait que, tandis que les charmes obstinés de sa sœur me procuraient une agréable distraction, une passion se formait dans son pauvre cœur ? Et pourtant, suis-je tout à fait innocent ? N’ai-je pas nourri ses sentiments ? Ne me suis-je pas moi-même réjoui des expressions tout à fait naturelles qui nous faisaient si souvent rire, aussi peu ridicules fussent-elles ? N’ai-je pas… Oh, qu’est-ce que l’homme pour qu’il puisse se plaindre de lui-même ! Je veux, cher ami, je te le promets, je veux m’améliorer, je ne veux plus ruminer le moindre mal que le destin nous inflige, comme je l’ai toujours fait ; je veux profiter du présent, et le passé sera pour moi révolu. Tu as certainement raison, mon cher, les souffrances seraient moindres parmi les hommes s’ils ne s’occupaient pas – Dieu sait pourquoi ils sont ainsi faits ! – avec tant d’ardeur de leur imagination à se remémorer les maux passés, plutôt que de supporter un présent indifférent.
Sois gentil de dire à ma mère que je m’occupe très bien de ses affaires et que je lui donnerai des nouvelles dès que possible. J’ai parlé à ma tante et je ne l’ai pas trouvée aussi méchante que ce qu’on en dit chez nous. C’est une femme vive et fougueuse, au cœur très généreux. Je lui ai expliqué les plaintes de ma mère concernant la part d’héritage retenue ; elle m’a exposé ses raisons, les causes et les conditions dans lesquelles elle serait prête à tout remettre, et même plus que ce que nous demandions – bref, je ne veux pas en parler maintenant, dis à ma mère que tout ira bien. Et j’ai découvert, mon cher, dans cette petite affaire, que les malentendus et la paresse causent peut-être plus d’erreurs dans le monde que la ruse et la méchanceté. Du moins, ces deux dernières sont certainement plus rares.
D’ailleurs, je me sens très bien ici. La solitude est un baume délicieux pour mon cœur dans cette région paradisiaque, et cette saison de la jeunesse réchauffe pleinement mon cœur souvent frissonnant. Chaque arbre, chaque haie est un bouquet de fleurs, et l’on aimerait devenir un hanneton pour pouvoir flotter dans cette mer de parfums et y trouver toute sa nourriture.
La ville elle-même est désagréable, mais tout autour, la nature offre une beauté indescriptible. C’est ce qui a incité le défunt comte de M. à aménager un jardin sur l’une des collines qui se croisent avec la plus belle diversité et forment les vallées les plus charmantes. Le jardin est simple, et dès qu’on y entre, on sent que ce n’est pas un jardinier scientifique, mais un cœur sensible qui en a dessiné le plan, et qui voulait en profiter lui-même. J’ai déjà versé bien des larmes pour le défunt dans le petit cabinet délabré qui était son endroit préféré, et qui est aussi le mien. Je serai bientôt maître du jardin ; le jardinier m’est attaché, depuis quelques jours seulement, et il ne s’en trouvera pas mal.
Le 10 mai
Une merveilleuse sérénité a envahi toute mon âme, comme les douces matinées de printemps que je savoure de tout mon cœur. Je suis seul et je me réjouis de ma vie dans cette région, qui est faite pour des âmes comme la mienne. Je suis si heureux, mon cher, si absorbé dans le sentiment d’une existence paisible, que mon art en souffre. Je ne pourrais pas dessiner maintenant, pas même un trait, et je n’ai jamais été un plus grand peintre qu’en ces moments-là. Quand la chère vallée autour de moi fume, et que le soleil haut repose à la surface de l’obscurité impénétrable de ma forêt, et que seuls quelques rayons s’introduisent dans le sanctuaire intérieur, je m’allonge alors dans les hautes herbes près du ruisseau qui descend, et plus près de la terre, mille herbes variées m’apparaissent étranges ; quand je sens plus près de mon cœur le grouillement du petit monde entre les brins d’herbe, les innombrables formes insondables des vers, des moustiques, et que je sens la présence du Tout-Puissant qui nous a créés à son image, le souffle de l’Amour universel qui nous porte et nous soutient dans une félicité éternelle ; mon ami ! Quand le crépuscule tombe sur mes yeux, et que le monde autour de moi et le ciel reposent tout entiers dans mon âme comme la silhouette d’une bien-aimée, alors je soupire souvent et je pense : ah, si tu pouvais exprimer cela, si tu pouvais insuffler au papier ce qui vit en toi si pleinement, si chaleureusement, qu’il deviendrait le miroir de ton âme, comme ton âme est le miroir du Dieu infini ! Mon ami, mais cela me détruit, je succombe sous le pouvoir de la splendeur de ces apparitions.
Je ne sais pas si des esprits trompeurs fLottet autour de cette région, ou si c’est l’imagination chaleureuse et céleste dans mon cœur qui rend tout ce qui m’entoure si paradisiaque. Juste devant le village se trouve une fontaine, une fontaine qui me fascine comme Mélusine et ses sœurs. – Tu descends une petite colline et tu te retrouves devant une voûte, où une vingtaine de marches descendent vers une source d’eau limpide qui jaillit d’un rocher de marbre. Le petit mur qui entoure l’enceinte, les grands arbres qui couvrent l’espace tout autour, la fraîcheur du lieu ; tout cela a quelque chose de suggestif, de terrifiant. Il ne se passe pas un jour sans que je m’y asseye pendant une heure. Les filles de la ville viennent y chercher de l’eau, la tâche la plus innocente et la plus nécessaire, que les filles des rois elles-mêmes accomplissaient autrefois. Quand je suis assis là, l’idée patriarcale revit autour de moi, comme lorsque tous les anciens se rencontraient et se courtisaient à la fontaine, et comme si des esprits bienveillants flottaient autour des fontaines et des sources. Celui qui n’a jamais pu se rafraîchir à la fontaine après une longue randonnée estivale ne peut pas comprendre cela.
Le 13 mai
Tu me demandes si tu dois m’envoyer mes livres ? – Mon cher, je t’en prie, pour l’amour de Dieu, laisse-moi tranquille ! Je ne veux plus être guidé, encouragé, stimulé, ce cœur bouillonne déjà suffisamment de lui-même ; j’ai besoin d’une berceuse, et je l’ai trouvée en abondance dans mon Homère. Combien de fois j’apaise mon sang révolté, car tu n’as rien vu d’aussi inégal, d’aussi instable que ce cœur. Mon cher ! Ai-je besoin de te le dire, toi qui as si souvent porté le fardeau de me voir passer du chagrin à la débauche et de la douce mélancolie à la passion destructrice ? Je tiens aussi mon petit cœur comme un enfant malade ; chaque volonté lui est permise. Ne le répète pas ; il y a des gens qui m’en voudraient.
Le 15 mai
Les gens modestes du village me connaissent déjà et m’aiment, surtout les enfants. J’ai fait une remarque triste. Lorsque je me suis joint à eux au début, que je leur ai posé des questions amicales sur ceci et cela, certains ont cru que je me moquais d’eux et m’ont traité de manière assez grossière. Je ne m’en suis pas irrité ; j’ai seulement ressenti très vivement ce que j’ai déjà souvent remarqué : les gens d’un certain rang se tiendront toujours à distance du peuple, comme s’ils craignaient de perdre quelque chose en se rapprochant de lui ; et puis il y a des fugitifs et de mauvais plaisantins qui semblent s’abaisser pour rendre leur arrogance d’autant plus sensible au pauvre peuple.
Je sais bien que nous ne sommes pas égaux, ni ne pouvons l’être ; mais je considère que celui qui croit devoir s’éloigner de la soi-disant populace pour obtenir le respect est tout aussi blâmable qu’un lâche qui se cache devant son ennemi parce qu’il craint d’être vaincu.
Récemment, je suis arrivé à la fontaine et j’ai trouvé une jeune servante qui avait posé son récipient sur la marche la plus basse et regardait autour d’elle pour voir si une camarade allait venir l’aider à le mettre sur sa tête. Je descendis et la regardai. « Puis-je vous aider, mademoiselle ? » lui dis-je. Elle rougit de la tête aux pieds. « Oh non, monsieur ! » répondit-elle. « Pas de problème. » Elle arrangea ses boucles et je l’aidai. Elle me remercia et remonta.
Le 17 mai
Je me suis fait toutes sortes de connaissances, mais je n’ai encore trouvé aucune compagnie. Je ne sais pas ce que j’ai de si repoussant pour les gens ; ils sont si nombreux à m’aimer et à s’attacher à moi, et cela me fait mal quand notre chemin ne se croise que pour un court instant. Si tu me demandes comment sont les gens ici, je dois te répondre : comme partout ailleurs ! C’est une chose monotone, le genre humain. La plupart des gens passent la majeure partie de leur temps à vivre, et le peu de liberté qui leur reste les effraie tellement qu’ils cherchent tous les moyens de s’en débarrasser. Ô destin de l’homme !
Mais c’est un peuple plutôt sympathique ! Quand je m’oublie parfois, quand je profite parfois avec eux des joies qui sont encore accordées aux hommes, quand je m’amuse à une table bien garnie avec toute la franchise et la candeur qui s’imposent, quand j’organise une promenade, une danse au bon moment, et autres choses du même genre, cela me fait beaucoup de bien ; mais je ne dois pas penser qu’il y a encore tant d’autres forces en moi qui pourrissent inutilisées et que je dois soigneusement cacher. Ah, cela serre tellement le cœur. – Et pourtant ! Être incompris, c’est le destin des gens comme nous.
Ah, que l’amie de ma jeunesse soit partie, ah, que je l’aie jamais connue ! – Je dirais : tu es un imbécile ! Tu cherches ce qui ne se trouve pas ici-bas ! Mais je l’ai eue, j’ai senti son cœur, sa grande âme, en présence de laquelle je me sentais plus que ce que j’étais, parce que j’étais tout ce que je pouvais être. Bon Dieu ! Y avait-il une seule force de mon âme qui restait inutilisée ? Ne pouvais-je pas développer devant elle tout le merveilleux sentiment avec lequel mon cœur embrasse la nature ? Nos relations n’étaient-elles pas un éternel entrelacement des sentiments les plus fins, des plaisanteries les plus spirituelles, dont les variations, jusqu’à l’excentricité, étaient toutes marquées du sceau du génie ? Et maintenant ! Hélas, les années qu’elle avait d’avance l’ont conduite plus tôt que moi à la tombe. Je ne l’oublierai jamais, jamais sa détermination et sa divine tolérance.
Il y a quelques jours, j’ai rencontré un jeune V., un garçon ouvert, au visage très heureux. Il sort tout juste des académies, ne se croit pas sage, mais pense néanmoins en savoir plus que les autres. Il était également assidu, comme je le constate à bien des égards, bref, il a de belles connaissances. Quand il a appris que je dessinais beaucoup et que je connaissais le grec (deux météores dans ce pays), il s’est tourné vers moi et a déballé tout son savoir, de Batteux à Wood, de de Piles à Winckelmann, et m’a assuré qu’il avait lu toute la première partie de la théorie de Sulzer et qu’il possédait un manuscrit de Heynen sur l’étude de l’Antiquité. Je n’ai pas insisté.
J’ai également fait la connaissance d’un homme très respectable, le bailli princier, un homme ouvert et sincère. On dit que c’est une joie de le voir parmi ses enfants, dont il a neuf, et on fait particulièrement grand cas de sa fille aînée. Il m’a invité chez lui et je compte lui rendre visite dans les prochains jours. Il vit dans un pavillon de chasse princier, à une heure et demie d’ici, où il a été autorisé à s’installer après la mort de sa femme, car le séjour ici, en ville et dans la maison de fonction, lui était trop pénible.
Sinon, j’ai croisé quelques originaux excentriques qui sont insupportables à tous égards, surtout dans leurs manifestations d’amitié.
Adieu ! Cette lettre te conviendra, elle est tout à fait historique.
Le 22 mai
Beaucoup ont déjà pensé que la vie humaine n’était qu’un rêve, et ce sentiment m’habite aussi régulièrement. Quand je vois les contraintes qui entravent les forces actives et curieuses de l’homme ; quand je vois comment toute efficacité se perd à satisfaire des besoins qui n’ont d’autre but que de prolonger notre pauvre existence, et puis que toute tranquillité d’esprit sur certains points de la recherche n’est qu’une résignation rêveuse, car on peint les murs entre lesquels on est prisonnier avec des figures colorées et des perspectives lumineuses – tout cela, Wilhelm, me rend muet. Je retourne en moi-même et je trouve un monde ! Encore une fois, plus dans l’intuition et le désir obscur que dans la représentation et la force vivante. Et là, tout flotte devant mes sens, et je continue alors à sourire au monde de manière rêveuse.
Que les enfants ne savent pas pourquoi ils veulent, tous les professeurs et précepteurs érudits sont d’accord là-dessus ; mais que les adultes aussi, comme les enfants, titubent sur cette terre et, comme eux, ne savent pas d’où ils viennent ni où ils vont, n’agissent pas non plus selon de véritables objectifs, sont également gouvernés par les biscuits, les gâteaux et les verges de bouleau : personne ne veut le croire, et il me semble pourtant que cela saute aux yeux.
Je t’avoue volontiers car je sais ce que tu vas me répondre, que les plus heureux sont ceux qui, comme les enfants, vivent au jour le jour, traînent leurs poupées, les habillent et les déshabillent, rôdent avec beaucoup de respect autour du tiroir où maman a caché le morceau de sucre et, lorsqu’ils finissent par mettre la main dessus, le dévorent les joues pleines et s’écrient : « Encore ! » – ce sont des êtres heureux. Ceux qui donnent à leurs occupations futiles, voire à leurs passions, des titres ronflants et les présentent à l’humanité comme des opérations gigantesques pour son salut et son bien-être sont également heureux. Heureux celui qui peut être ainsi ! Mais celui qui, dans son humilité, reconnaît où tout cela mène, qui voit avec quelle élégance chaque citoyen qui va bien sait tailler son petit jardin pour en faire un paradis, et avec quelle persévérance même le malheureux sous le poids de son fardeau continue à haleter sur son chemin, et que tous s’intéressent de la même manière à voir la lumière de ce soleil une minute de plus – oui, celui-là est silencieux et forme aussi son monde à partir de lui-même et est aussi heureux, parce qu’il est un être humain. Et puis, aussi limité soit-il, il garde toujours dans son cœur le doux sentiment de liberté et le fait qu’il peut quitter cette prison quand il le souhaite.
Le 26 mai
Tu connais depuis toujours ma façon de cultiver la terre, de me construire une petite cabane dans un endroit intime et d’y vivre avec toutes les restrictions que cela implique. Ici aussi, j’ai trouvé un endroit qui m’a attiré.
À environ une heure de la ville se trouve un endroit qu’ils appellent Wahlheim [note de bas de page]. Son emplacement sur une colline est très intéressant, et lorsque l’on monte le sentier qui mène au village, on aperçoit soudain toute la vallée. Une bonne aubergiste, aimable et alerte malgré son âge, sert du vin, de la bière, du café ; et surtout, deux tilleuls couvrent de leurs branches étendues la petite place devant l’église, qui est entourée de fermes, de granges et de cours. Je n’ai pas facilement trouvé un endroit aussi intime, aussi secret, et j’y fais apporter ma petite table et ma chaise de l’auberge, j’y bois mon café et je lis mon Homère. La première fois que je suis arrivé par hasard sous les tilleuls par un bel après-midi, j’ai trouvé cet endroit si solitaire. Tout le monde était aux champs ; seul un garçon d’environ quatre ans était assis par terre et tenait dans ses bras un autre enfant d’environ six mois, assis entre ses pieds, de sorte qu’il lui servait en quelque sorte de fauteuil et, malgré la vivacité avec laquelle il regardait autour de lui de ses yeux noirs, il restait assis tout tranquille. Cette vue m’a amusé : je m’assis sur une charrue qui se trouvait en face et dessinai cette scène fraternelle avec beaucoup de plaisir. J’ajoutai la clôture voisine, une porte de grange et quelques roues de charrette cassées, tout cela tel que je le voyais, et au bout d’une heure, je constatai que j’avais réalisé un dessin bien ordonné et très intéressant, sans y ajouter le moindre élément de mon cru. Cela m’a conforté dans ma résolution de m’en tenir désormais uniquement à la nature. Elle seule est infiniment riche, et elle seule forme le grand artiste. On peut dire beaucoup de bien des règles, à peu près autant qu’on peut dire de bien de la société bourgeoise. Une personne qui se forme selon elles ne produira jamais rien de mauvais goût et de mauvais, tout comme une personne qui se laisse modeler par les lois et la prospérité ne peut jamais devenir un voisin insupportable, ni un méchant remarquable ; en revanche, toutes les règles, quoi qu’on en dise, détruisent le véritable sentiment de la nature et sa véritable expression ! Tu dis : « C’est trop dur ! Cela ne fait que restreindre, tailler les vignes luxuriantes », etc. – mon cher ami, veux-tu que je te donne une parabole ? C’est comme avec l’amour. Un jeune cœur est entièrement attaché à une jeune fille, passe toutes les heures de sa journée avec elle, gaspille toutes ses forces, toute sa fortune, pour lui exprimer à chaque instant qu’il s’abandonne entièrement à elle. Et voilà qu’un philistin, un homme qui occupe une fonction publique, lui dit : « Cher jeune homme ! Aimer est humain, mais vous devez aimer humainement ! Répartissez vos heures, consacrez celles du travail et celles du repos à votre jeune fille. Calculez votre fortune, et ce qui vous reste après vos besoins essentiels, je ne vous empêche pas de lui faire un cadeau, mais pas trop souvent, par exemple pour son anniversaire, sa fête, etc. – si l’homme suit ces conseils, il en résultera un jeune homme utile, et je conseillerai moi-même à chaque prince de le placer dans un collège ; seul son amour disparaîtra à la fin et, s’il est artiste, son art. Ô mes amis ! Pourquoi le courant du génie jaillit-il si rarement, déferle-t-il si rarement en flots puissants et bouleverse-t-il votre âme émerveillée ? – Chers amis, c’est là que résident, des deux côtés de la rive, ces messieurs sereins dont les abris de jardin, les parterres de tulipes et les champs de légumes seraient détruits, et qui savent donc, en temps voulu, parer le danger futur à venir à l’aide de digues et de dérivations.
Le 27 mai
Je vois que je me suis laissé emporter par l’extase, les paraboles et la déclamation, et que j’ai oublié de te raconter ce qui est arrivé aux enfants. Tout absorbé dans mes impressions picturales, que ma lettre d’hier te décrit de manière très fragmentaire, je suis resté assis sur ma charrue pendant deux bonnes heures. Vers le soir, une jeune femme s’est approchée des enfants, qui n’avaient pas bougé, un panier au bras, et leur a crié de loin : « Philipps, tu es très sage ». Elle m’a salué, je l’ai remerciée, je me suis levé, je me suis approché et lui ai demandé si elle était la mère des enfants. Elle répondit par l’affirmative et, tout en donnant un demi-petit pain à l’aîné, elle prit le petit dans ses bras et l’embrassa avec tout l’amour maternel. « J’ai confié le petit à mon Philipps, dit-elle, et je suis allée en ville avec mon aîné pour acheter du pain blanc, du sucre et une petite casserole en terre cuite. Je vis tout cela dans le panier dont le couvercle était tombé. « Je veux préparer une petite soupe pour mon Hans (c’était le nom du plus jeune) pour le dîner ; cet oiseau sauvage, le grand, a cassé la casserole hier en se disputant avec Philippsen pour la bouillie. – Je lui ai demandé où était l’aîné, et elle venait à peine de me répondre qu’il jouait dans le pré avec quelques oies, qu’il est arrivé en courant et a apporté au deuxième une baguette de noisetier. J’ai continué à discuter avec la femme et j’ai appris qu’elle était la fille du maître d’école et que son mari avait fait un voyage en Suisse pour récupérer l’héritage d’un cousin. « Ils ont voulu le tromper, dit-elle, et n’ont pas répondu à ses lettres ; alors il y est allé lui-même. J’espère qu’il ne lui est rien arrivé, je n’ai pas de nouvelles de lui. » J’eus du mal à me détacher de la femme, je donnai un kreuzer à chacun des enfants, et je lui en donnai un aussi pour le plus jeune, afin qu’elle lui apporte un petit pain pour accompagner sa soupe lorsqu’elle irait en ville, et nous nous séparâmes ainsi.
Je te le dis, mon amour, quand mes sens ne tiennent plus, la vue d’une telle créature, qui vit dans une sérénité heureuse, dans le cercle étroit de son existence, se débrouillant au jour le jour, voyant les feuilles tomber et ne pensant à rien d’autre qu’à l’arrivée de l’hiver, apaise tout ce tumulte.
Depuis lors, je suis souvent dehors. Les enfants sont tout à fait habitués à moi, ils reçoivent du sucre quand je bois mon café et partagent avec moi le pain beurré et le lait caillé le soir. Le dimanche, ils ne manquent jamais leur kreuzer, et si je ne suis pas là après la prière, la patronne a pour ordre de le leur verser.
Ils sont familiers, me racontent toutes sortes de choses, et je me délecte particulièrement de leurs passions et de leurs simples élans de désir lorsque d’autres enfants du village se rassemblent.
Il m’a fallu beaucoup d’efforts pour apaiser la crainte de leur mère qu’ils ne dérangent le monsieur.