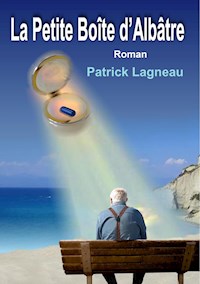6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
En 2010, Archibald Goustoquet, physicien nancéien de soixante-huit ans, travaille depuis quarante ans sur la mise au point d'une machine à voyager dans le temps. Son objectif : remonter dans le passé à l'époque des artistes de l'École de Nancy dont il est un fervent admirateur. Son premier essai l'envoie en février 1911 lors de l'inauguration de l'Excelsior, fleuron local de l'Art nouveau. Et c'est là qu'il rencontre Majorelle, Prouvé, Daum... Après un retour compliqué et quelques mésaventures, il se rend à New York pour présenter son invention au congrès mondial de physique. Dans le même avion, Julien Dorval, lycéen nancéien de dix-sept ans, va rejoindre pour la première fois Angie, sa correspondante américaine. Toujours dans le même avion, Malcolm Stuart, comptable dans une multinationale, rentre aux États-Unis après avoir été mandaté en France par le glacial président Shrub, pour annoncer des mesures de compression de personnel. Au-dessus de l'Atlantique, victime d'un attentat, l'avion explose. L'invention d'Archibald va leur sauver la vie, mais commence alors une avalanche de péripéties compliquées liées aux déplacements temporels. Trois destins qui ne devaient jamais se croiser, mais sous le signe des voyages temporels, tout devient possible. Pour le meilleur et pour le pire.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
À Peggy,
Aimer, c’est n’avoir plus droit au soleil de tout le monde. On a le sien.
Marcel Jouhandeau
Extrait de « Algèbre des valeurs morales »
Sommaire
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
Chapitre 14
Chapitre 15
Chapitre 16
Chapitre 17
Chapitre 18
Chapitre 19
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 22
Chapitre 23
Chapitre 24
Chapitre 25
Chapitre 26
Chapitre 27
Chapitre 28
Chapitre 29
Chapitre 30
Chapitre 31
Chapitre 32
Chapitre 33
Chapitre 34
Chapitre 35
Chapitre 36
Chapitre 37
Épilogue
1
Le gamin allongé sur le ventre, les coudes sur le sol, le menton appuyé dans ses mains, regardait avec circonspection sa locomotive à vapeur en bois. Passerait-elle sous le tunnel improvisé avec les vieux livres en cuir qu’il avait empilés les uns sur les autres, sans les faire tomber ? La question était cruciale. La réponse, décisive. Il se baissa et colla sa joue contre le balatum pour estimer la dimension du passage par rapport à la taille de la loco. Elle devait passer. Au lieu de lui donner de l’élan pour l’envoyer le plus loin possible comme l’aurait fait n’importe quel bambin de son âge, il l’approcha lentement de l’entrée du tunnel, centimètre par centimètre, vérifia toutes les deux secondes qu’elle ne raccrochait ni d’un côté, ni de l’autre, l’un des livres qui aurait pu éventuellement dépasser de l’alignement, et la poussa ainsi jusqu’à ce qu’elle disparaisse à moitié sous les Balzac, les Zola, les Chateaubriand et autres Victor Hugo. A ce stade, il lâcha la locomotive, contourna l’échafaudage littéraire, et se baissa à la sortie du tunnel, comme il l’avait fait devant l’entrée. Le moment le plus important, c’était là. Maintenant. Il scruta, visa, détailla, apprécia, analysa, sonda d’un œil expert, et finalement se releva, ravi. Il revint se positionner derrière la loco qu’il poussa complètement dans le tunnel jusqu’à ce que son petit bras ne puisse plus donner la moindre impulsion. Alors, sûr de l’exploit extraordinaire qu’il venait d’accomplir, il passa à nouveau du côté de la sortie, et exulta quand il aperçut le vernis brillant de la cheminée rouge et verte de la chaudière. Il la tira minutieusement en prenant garde que la cabine ne raccroche pas le haut du tunnel. Ce serait idiot. Il la mit en attente sur un vaisselier du XIXème en chêne clair, et s’appliqua à replacer tous les livres sur l’étagère du bas de la grande bibliothèque, avec ceux qu’il n’avait pas utilisés. Il avait bien essayé de mémoriser les dessins que Papa et maman appelaient des mots, pour remettre les livres dans le même ordre dans lequel ils étaient rangés au départ, mais il abandonna cette tâche ardue car il mélangeait tous ces dessins dont certains, parfois, se ressemblaient, en espérant que personne ne remarquerait qu’ils avaient été déplacés. Une fois que le rayonnage eut repris un aspect à peu près normal, il reprit la loco pour qu’elle poursuive son long voyage initiatique dans le capharnaüm familial.
Il la fit rouler sous les tables Louis Philippe, les armoires lorraines, entre les pattes des fauteuils crapaud de style Second Empire avec des tchou tchou rageurs. Mais le plus drôle fut de la faire rouler sur les gros coffres de pirate, car le bruit des roues changeait selon que la locomotive passait sur le bois ou sur les grosses ferrailles des charnières. Il se plut encore à la faire glisser dans un crissement strident sur les miroirs des armoires car avec le reflet, il avait l’impression d’en pousser deux en même temps. Bon, c’est sûr, il fallait faire ça quand maman n’était pas là. Et pour l’instant elle travaillait dans la vitrine du magasin, le bocal, depuis que Papa était sorti ce matin. Il ne risquait rien. Mais l’ombre de Papa planait. Il s’arrêta de pousser la loco tout en retournant le jouet entre ses mains. Il regrettait malgré tout que Papa fût parti. Quand il était là, il jouait souvent avec lui. Et puis aussi, il racontait toujours des histoires de monstres même que maman le disputait toujours parce qu’elle disait qu’il allait lui faire faire des cauchemars. Mais lui, il n’avait même pas peur. Enfin… Pas trop ! C’était un garçon, quand même ! Et c’était courageux les garçons. Les monstres, si un jour il en voyait un, il le tuerait avec une épée comme celles qui étaient accrochées au mur. Ou bien, il lui tendrait un piège pour qu’il tombe dans un des coffres qu’il fermerait à clef. Ou encore, il le pousserait dans l’escalier de la cave pour…
Gling, gling…
Il tourna d’un seul coup la tête en direction de ce bruit caractéristique.
Ouais, Papa est revenu !
Il lâcha la locomotive qui – heureusement, elle était en bois ! - tomba sans dommage sur le sol. Vite. Vite. Il fallait courir vite pour sauter tout en haut dans les bras de Papa. Comme à chaque fois qu’ils se retrouvaient.
- Maman, maman… C’est Papa ?
Il zigzagua rapidement entre les meubles et les mannequins de mode en bois, les vieux outils fermiers et les malles en osier, et se retrouva dans l’allée principale du magasin. A contre jour, il aperçut l’ombre de Papa.
Il allait se baisser, et il pourrait se jeter dans ses bras pour qu’il l’emporte tout en haut dans le ciel de son amour de Papa. Il se rapprochait de plus en plus, mais la silhouette à contre-jour ne se baissait pas. Bizarre ! Encore un peu plus près… un peu plus près… Toujours pas baissée… Plus près… Il ralentit et remarqua que cet homme-là était bien trop large pour être son père. Soudain, il stoppa net, tétanisé par la peur. Les yeux écarquillés, il le voyait bien maintenant. Il s’était trompé. Devant lui, là, immobile avec son cou jaune et vert, le monstre le regardait avec ses yeux globuleux prêt à lui sauter dessus. Il ne put faire aucun mouvement. Adieu Excalibur à la lame tranchante pendue au mur ! Adieu pièges astucieux et coffres prison !
D’un seul coup, la fée qui devait le sauver apparut. Sur le côté. Soudain, il poussa un hurlement et une décharge électrique le propulsa contre sa mère, dans la robe de laquelle il enfouit son petit visage.
- Maman, le monstre il est méchant. Il a une tête de crapaud…
Il allait en faire bien souvent des cauchemars.
2
C’était un petit coin de verdure en bordure de Moselle. La villa surplombait une vaste pelouse en pente douce jusqu’aux saules qui trempaient leurs larmes dans le courant de la rivière. Une haie de troènes nains masquait un grillage qui délimitait le terrain, non par goût des propriétaires, mais surtout par souci de sécurité pour les enfants.
Julien, cinq ans, tentait d’attraper sa sœur Laurine, six ans, qui lui échappait, à chaque fois qu’il était sur le point de la toucher, par de brusques changements de direction avec des gloussements de jubilation qui l’agaçaient au plus haut point.
- Je joue plus. J’arrive jamais à t’avoir.
- Quand tu s’ras plus grand, t’y arriveras. Tu veux jouer au ballon ?
- Ouais, mais on joue au foot. Moi j’ suis Zidane…
- C’est qui ?
- Tu connais pas Zidane ? I’ joue à Bordeaux. Papa dit qu’i’ va p’t-êt’ aller jouer en Italie bientôt. À la “Jus d’ Vantusse”, il a dit Papa. Alors moi, j’ suis Zidane.
- Si tu veux. Où il est l’ ballon ?
- I’ doit être au garage…
Les deux enfants coururent vers le devant de la maison et s’engouffrèrent dans le garage dont la porte automatique était relevée. Le Range Rover du père était stationné dans l’allée gravillonnée.
- I’ faut pas jouer près d’la voiture. Papa i’ veut pas.
- Je sais, dit Julien, on va jouer entre les deux arbres là, ça f’ra la cage. C’est toi qui fais gardien.
- Oh non ! C’est toujours moi. Pourquoi pas toi pour une fois ?
- Pa’ ce que !
- Pa’ ce que quoi ?
- Pa’ ce que j’ suis Zidane, et Zidane i’ joue pas dans la cage.
Imparable.
Laurine se plaça entre les deux bouleaux pendant que Julien s’éloignait, le ballon à la main. Il le posa sur la pelouse face à sa sœur et recula de quelques pas.
- J’ vais tirer un penalty…
- C’est quoi un penalty ?
- Oh là, là ! T’es vraiment nulle. C’est quand ‘y a eu une faute. Le joueur pose le ballon devant le gardien, et i’ doit tirer pour essayer de marquer un but.
- Oui, mais là, ’y a pas eu d’ faute…
- T’es vraiment casse-pieds. On fait semblant, là, c’est tout.
- Et moi j’ fais quoi alors ?
Julien soupira d’impatience.
- Tu l’ fais exprès ou quoi ? I’ fait quoi un gardien à ton avis ?
- Ben… il arrête les buts.
- Non, il arrête pas les buts, cria Julien, énervé. Il arrête le ballon, ‘y a un but quand le gardien il arrive pas à arrêter l’ ballon.
- Ouais, ben c’est pareil.
- Bon, moi j’tire le penalty et toi t’essayes de l’arrêter, d’accord ?
- D’accord, soupira Laurine.
- Attends ! Ça va pas…
- Qu’est-ce qui va pas encore ?
- T’es trop droite. On dirait un manche à balai.
Il s’approcha de sa sœur.
- Penche-toi en avant !
- Pour quoi faire ?
- Penche-toi en avant j’te dis, et laisse pendre tes bras de chaque côté. Et puis tu dois aussi plier les g’noux…
Laurine s’exécuta en pinçant les lèvres.
- Pourquoi j’dois m’ mettre comme ça ? On dirait un singe…
- J’en sais rien, mais les gardiens i’s’mettent toujours comme ça pour arrêter un penalty…
- Ben, moi j’veux pas, répliqua Laurine, butée, en se redressant les bras croisés.
- Comme tu veux.
Julien retourna derrière son ballon et recula de quelques pas. Il s’élança et balança un pointu dans la balle qui s’éleva bien au-dessus de Laurine. Elle le regarda passer sans broncher.
- Ouais, i’y est, jubila Julien.
- Ben, non, hein, il y est pas. Il est passé bien trop haut.
- Si. Il y est. Il est passé juste sous la barre.
- La barre ? Quelle barre ?
Julien soupira, exaspéré.
- La barre transversale… Au-d’ssus d’ toi…
Laurine regarda en l’air, dubitative.
- ’y a pas d’barre, affirma-t-elle.
- Ben si ! ’y a toujours une barre transversale dans les cages.
- P’t-êt’, mais là, ‘y a pas de barre.
- T’es bête ou quoi ? On fait semblant, j’te dis... On fait toujours comme ça quand on joue au foot.
- Le ballon est passé trop haut. J’ai d’jà vu moi à la télé. La barre, le gardien i’ peut la toucher avec les mains. Ben là, j’aurais même pas pu toucher le ballon, alors…
- Hé ! T’as même pas sauté… Tu peux pas savoir. Bon, d’accord. Je r’commence. Il est où l’ballon ?
Tous les deux se mirent à le rechercher. Ils se rendirent rapidement compte qu’il était introuvable.
- Il a dû rouler sous la haie…
Pas de ballon sous la haie.
- Ben, il est où ?
- C’est ta faute. T’avais qu’à pas taper si fort.
- T’avais qu’à l’arrêter toi.
- J’pouvais pas, il était trop haut… Tiens j’le vois, s’écria Laurine. Regarde, il est sous la voiture de Papa…
- Zut ! Comment on fait ?
- Je vais essayer de l’pousser avec le râteau…
Laurine courut au garage et revint aussitôt avec l’outil bien trop grand pour qu’elle puisse le manipuler avec efficacité pour dégager le ballon.
- Boug’ pas ! j’vais aller l’chercher…
- Non, Laurine, Papa i’veut pas qu’on va sous la voiture.
- Tu veux jouer au ballon ou quoi ? J’en ai pour pas longtemps. Il en saura rien. Tu l’diras pas hein, promis ?
- Papa, i’dit qu’c’est dangereux…
- Oh, mais j’vais aller vite, tu vas voir.
Elle s’allongea sur le gravier et commença à ramper sous le 4x4. Julien n’était pas rassuré, mais la regardait faire. Quand il entendit la porte de la villa s’ouvrir, il comprit aussitôt.
- Vite Laurine, dépêche-toi ! V’là Papa…
Il courut se cacher derrière une poubelle tout en épiant ce qui se passait.
Laurine approchait du ballon qui était bien coincé sous la voiture. Elle réussit à le dégager quand elle aperçut les chaussures de Papa qui approchaient. Elle cessa de respirer. Il ne fallait pas qu’elle bouge. Si Papa la voyait sortir de sous la voiture, sûr elle se ferait punir. Juste attendre qu’il reparte. Sans rien dire. Papa monta dans le 4x4 et claqua la porte. Julien n’avait pas perdu une miette de ce qui se passait. Il n’osa pas se montrer de peur de se faire gronder. Même s’il ne s’était pas glissé en dessous, il n’avait rien dit pour Laurine. Alors que Papa ne veut pas. Papa tourna la clef de contact. Le moteur se mit en marche. Laurine avait son petit cœur qui battait fort dans sa petite poitrine. Peut-être devrait-elle sortir avant que Papa ne démarre. Non. Surtout pas. Papa serait trop en colère. Tant pis. Le laisser partir et baisser la tête. Il n’en saura jamais rien.
Papa accéléra un coup pour faire rugir le moteur. Il était comme ça Papa depuis qu’il avait son Range Rover. À chaque fois qu’il démarrait, il accélérait un grand coup, juste pour le plaisir du bruit que ça faisait, il avait dit une fois à maman.
Quand Julien entendit le ronflement du moteur, il courut se cacher tout au fond du jardin, dans un petit coin de la haie où il aimait venir parfois pour regarder les brèmes sauter dans la Moselle.
Papa plaça dans le lecteur la Chevauchée des Walkyries de Wagner interprétée par l’orchestre philarmonique de Berlin sous la direction de Karajan. Laurine avait reconnu les « vaches-qui-rient » comme disait Julien. C’était toujours cette musique-là qu’il mettait, Papa, pour aller au travail. Aux premières notes, il monta le volume dans l’habitacle. Bien. Maintenant Papa allait partir. Il enclencha la première. Accéléra en même temps qu’il embraya. Comme d’habitude. Pour faire patiner les roues sur les gravillons. Le 4x4 bondit vers le portail ouvert sur la rue. Une patte de fixation du pot d’échappement raccrocha la bretelle de salopette de Laurine.
Le 4x4 eut un soubresaut. Le père freina.
Bon sang, encore les gosses ! Qu’est-ce qu’ils avaient laissé traîner cette fois-ci ?
Il descendit du Range Rover en laissant la porte ouverte.
La musique hurlait fort dans la voiture. Papa aussi.
3
Le soleil montrait à peine un bout de lumière au-dessus des toits de Nancy, juste assez pour allumer sur la place Stanislas la façade du musée des beaux-arts, les grilles nord-ouest finement ouvragées et rehaussées d’or et la fontaine majestueuse.
Un peu plus haut, Archibald Goustoquet remonta la rue Poincaré et parvint devant la brasserie l’Excelsior. Il y entra comme chaque jour pour prendre son café matinal. Les serveurs le saluèrent car c’était un habitué. Il s’installa sur sa banquette habituelle, à sa table habituelle et comme chaque matin, il laissa vagabonder son regard sur la décoration hallucinante de l’établissement.
L’Excelsior, que certains appelait le Flo depuis que la brasserie avait été rachetée par le groupe de restauration éponyme en 1987, était classée monument historique depuis 1976. Construit au début du XXème siècle, la sobriété de l’extérieur de l’immeuble offrait un contraste saisissant avec la décoration de la brasserie intérieure, authentique chef-d’œuvre de l’École de Nancy.
Archibald Goustoquet qui, contre vents et marées, persistait à l’appeler l’Excel’ comme les anciennes générations, était un fervent admirateur de l’Art Nouveau. Il ne se lassait pas de suivre des yeux les lignes courbes du volume intérieur, mariées aux thèmes végétaux de la décoration. Le mobilier en acajou massif répondait harmonieusement à l’essence exotique des lambris en tamarinier. Des vitraux enrichissaient de fougères, de pins et de feuilles de ginkgo biloba les larges baies. Une mosaïque de palmes stylisées était composée sur le sol. Des centaines de becs lumineux, des lustres et des appliques en cuivre ciselé éclairaient les voûtes du plafond parcouru d’un entrelacs de grandes fougères. Et cerise sur le gâteau, l’ensemble se reflétait dans de vastes miroirs muraux, prolongeant le faste et la magie pour le plaisir des yeux.
Archibald Goustoquet se plaisait à imaginer l’ouverture de la brasserie il y avait presque cent ans. A une table pas très éloignée de la sienne, un groupe d’hommes ressuscitait. Lucien Weissenburger, l’architecte du bâtiment, Louis Majorelle, Antonin Daum, Jacques Grüber les décorateurs sablaient le champagne devant le tout Nancy de l’époque, en extase devant la magnificence de la nouvelle brasserie.
- Et voilà, annonça le serveur en déposant sur la table une tasse de café et un croissant au beurre.
Archibald passa rapidement du champagne de son imagination au café noir fumant.
- Un peu de lait ?
- Non, merci André, pas aujourd’hui.
Il sortit de sa poche un GPS de randonnée, pointa les coordonnées géographiques et l’altitude de la salle, comme il le faisait toujours pour les endroits qu’il affectionnait particulièrement. Il s’arracha définitivement à sa contemplation pour se consacrer à la dégustation de son croissant. Après avoir bu son café, il déposa dans la soucoupe réservée à cet effet la monnaie correspondant au montant imprimé sur le ticket de caisse. Il quitta la brasserie après avoir salué le personnel, et fut ravi de se retrouver sur le trottoir ensoleillé. L’ambiance, l’air, la mine réjouie des gens qu’il croisait, tout annonçait une magnifique journée. Avant de rentrer chez lui, il décida de repasser par la place Stanislas.
Archibald Goustoquet était physicien. Chercheur. Il n’avait jamais travaillé ailleurs que chez lui pour la simple et bonne raison que l’héritage de ses parents lui avait permis d’installer son laboratoire dans la maison familiale de la vieille ville, une belle demeure bourgeoise, et de se consacrer exclusivement à ses recherches. Chaque année, il se rendait au congrès international de physique à New-York, pour suivre l’évolution des recherches de ses pairs et éventuellement faire part de ses propres découvertes. Dans son for intérieur, il savait que jusqu’à présent, il n’avait pas fait énormément progresser la science. Depuis quelques années, les théories dominantes du congrès étaient tournées essentiellement vers la naissance de l’univers, alors que lui, personnellement, axait ses propres recherches vers la physique quantique et plus particulièrement la physique des particules et de la matière condensée. Secrètement, il fondait ses expériences sur la déstructuration moléculaire et s’était fait le pari fou de démontrer qu’à partir de la loi sur la relativité d’Einstein, il était possible de voyager dans le temps. Évidemment, c’était un secret. Mais là, il touchait au but. Bientôt il pourrait présenter ses thèses sous forme d’un mémoire argumenté au prochain congrès.
Archibald Goustoquet avait soixante-huit ans. Il était de taille moyenne, portait un éternel costume en velours marron à côtes épaisses, une chemise blanche en coton dont le col était fermé par un original nœud papillon à carreaux verts et jaunes, un gilet de flanelle beige avec une montre à gousset dont la chaîne pendait de la poche droite. Il était légèrement voûté, sans doute à cause de sa position penchée sur les paillasses. Il souffrait d’une forte myopie et portait des lunettes dont les verres loupes augmentaient considérablement le volume apparent de ses yeux. Ses sourcils blancs étaient en bataille sous le front dégarni mais le reste de sa chevelure, qu’il portait en couronne, blanche également, était épaisse et retombait en mèches folles sur le col de sa veste.
Quand il marchait, il enfouissait ses mains dans les poches de son pantalon, et cela lui donnait la silhouette caricaturale d’un vieux professeur perdu dans ses pensées.
Aussi, quand on apprenait qu’Archibald Goustoquet était physicien et chercheur, personne n’était étonné, tant son allure correspondait à l’image que l’on s’en faisait.
Archibald descendit jusqu’à la rue Saint-Dizier pour rejoindre la rue Gambetta qu’il traversa. Il s’arrêta sous la porte cochère d’un immeuble protégé par un balcon à chaque étage, et regarda les façades des magasins en vis à vis. C’est ici qu’autrefois ses parents avaient tenu un commerce d’antiquités, juste à l’emplacement de cet ensemble de magasins modernes. Les affaires avaient été florissantes jusqu’à ce jour de 1943 où son père était sorti et n’était jamais revenu. Sa mère lui avait raconté plus tard qu’il faisait partie d’un réseau de résistants mais qu’elle n’avait jamais vraiment su ce qui lui était arrivé. On supposait qu’il avait été arrêté et déporté. C’est tout.
À l’époque, il avait trois ans. Il avait un vague souvenir de ce matin-là. Son père, dont l’image était floue dans son esprit, l’avait pris dans ses bras. Ensemble ils avaient traversé le magasin au milieu d’armoires, de fauteuils, de coffres et autres secrétaires. La dernière vision dont il se souvenait : il était à côté de sa mère sur le trottoir, et ensemble ils faisaient signe de la main à cet homme, son père, qui s’éloignait vers la place Stanislas. Avec le temps, il s’était transformé en une ombre diffuse qui avait disparu parmi les badauds.
Il sortit son GPS, pointa les coordonnées de l’endroit, puis descendit la rue et pénétra sur la place, entre le grand café Foy et l’Hôtel de ville, là où il avait vu son père pour la dernière fois.
Rénovée depuis 2005, la place Stanislas était le lieu privilégié de promenades et de rencontres de la plupart des Nancéiens. Il faut dire que la blancheur des pavés, les façades restaurées des bâtiments et les dorures des grilles avaient de quoi faire de la place Stan’, la fierté de la population. Ce n’était pas pour rien qu’elle était inscrite depuis 1983 sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Archibald traversa la place jusqu’à la rue Emmanuel Héré, l’architecte de la place, pour passer sous l’arc de Triomphe traverser la place de la Carrière et retrouver la vieille ville. Comme d’habitude, la circulation était dense. C’était l’heure où chacun rejoignait son lieu de travail, et participait au ballet incessant des voitures pour trouver une place de stationnement.
Tout en marchant, Archibald songeait à ce monde qu’il connaissait peu, ce monde qu’il frôlait comme s’il longeait un monde parallèle dans lequel il ne parvenait pas à s’intégrer. Cette notion de monde parallèle le ramena à ses dernières expériences. Il se replongea mentalement une semaine en arrière, quand il avait tenté de faire voyager une pomme dans le temps. Il avait failli réussir mais au moment de la déstructuration moléculaire, le fruit avait explosé, littéralement. Les jours suivants, Archibald avait opéré quelques modifications pour améliorer le processus. La veille, cela avait fonctionné. Après quarante ans de recherches laborieuses, il avait atteint son objectif. La pomme avait voyagé dans l’espace-temps. Il avait programmé la durée de son voyage pendant deux minutes dans le futur. Devant ses yeux, le fruit avait disparu et était réapparu au bout de ce laps de temps. Aujourd’hui, il était prêt à recommencer. Mais cette fois-ci, avec une programmation retour. Et devant témoin. Juste pour s’assurer qu’il était sur la bonne voie.
Il sursauta quand une voiture pila juste devant lui en klaxonnant. Dans l’enthousiasme de ses pensées, il avait traversé la rue en dehors du passage protégé, et qui plus est, sans un regard sur la circulation. Planté au milieu de la rue, il ne réagissait pas, et les klaxons vociféraient d’autant plus.
- Alors Papy, on rêve ? lança un jeune conducteur par la portière de sa voiture dont la vitre était baissée.
Archibald leva lentement le bras, dans un geste qui exprimait de vagues excuses et incitait amicalement son interlocuteur à la détente et à la relaxation. Il rejoignit le trottoir, poursuivit son chemin et retrouva immédiatement ses excitantes réflexions. Oui, aujourd’hui la pomme voyagerait encore et elle ouvrirait la porte vers d’autres expériences bien plus passionnantes. Il n’y avait pas une minute à perdre, le congrès avait lieu bientôt. Il fallait que cette année soit l’année Archibald Goustoquet, l’homme qui réussit à se déplacer dans le temps.
Le congrès de New-York ferait de lui, le physicien de l’année. Et pourquoi pas un prix Nobel ?
4
Un peu après la porte de la Craffe, flanquée de ses deux tours monumentales du XIVème siècle, Archibald parvint devant sa propriété dont il poussa la grille. Oh ! Il fallait vraiment savoir que si près de la vieille ville se dissimulait cet îlot de végétation au milieu duquel était plantée la maison familiale. Il avança sur l’allée gravillonnée, longea les massifs d’hortensias mauves et blancs qui bordaient une pelouse parfaitement entretenue. Il jeta un œil sur le toit d’ardoise de la demeure à trois étages, comme ça, juste pour s’assurer que la forme massive de la bâtisse imposait toujours cette impression de bienveillance protectrice. On accédait à l’intérieur de la maison par deux escaliers latéraux circulaires, qui se rejoignaient sur un perron commun. Archibald avait l’habitude d’entrer en empruntant l’escalier de gauche et de sortir par celui de droite. Il gravit donc les marches de l’escalier de gauche. Parvenu sur le seuil, il tourna la poignée d’une lourde porte en chêne et pénétra dans le hall. Il accrocha au portemanteau perroquet sa veste en velours qu’il troqua contre une de ses incontournables blouses blanches en coton, qu’il ne boutonnait jamais. L’intérieur de la maison exhalait une odeur de cire, délicieusement surannée. Sans doute, inconsciemment, Archibald conservait-il cette ambiance années quarante que sa mère, et sa grand-mère avant elles, avaient soigneusement entretenue.
Une femme d’une soixantaine d’années traversa le couloir pour se rendre de l’office vers le vaste salon. Ses cheveux étaient relevés en un chignon parfait. Elle portait une longue jupe noire, surmontée d’un bustier gris cintré sur un corsage blanc, dont les manches bouffantes se resserraient aux poignets par le jeu d’une ligne de boutons nacrés.
- Ah, Miraldine, il faut absolument que vous me réserviez un aller-retour Paris New-York pour la semaine prochaine.
- Pour quels jours, Monsieur ?
- Départ mardi. On sera le 22. Retour le 25.
- Bien Monsieur. J’espère qu’il y aura encore de la place.
- Prenez une première classe, voire une classe affaire si besoin. Enfin, faites au mieux !
- Bien Monsieur. Vous avez du courrier.
Elle lui tendit une feuille pliée qu’elle avait posée sur une étagère intégrée à un ensemble miroir-cadre en acajou dans le style Art Nouveau, attribué à Louis Majorelle.
- Pas d’enveloppe ? Juste une feuille pliée avec mon nom et mon prénom écrits à la main ? Vous l’avez lue, Miraldine ?
- Oh, je ne me le serais pas permis, Monsieur. Quelqu’un l’aura sans doute glissée directement dans la boîte aux lettres …
Il la déplia et la parcourut rapidement.
Archibald,
Laisse tomber tes expériences sur le voyage dans le temps. C’est possible mais les conséquences peuvent être dramatiques pour l’humanité et conduire à des complications à n’en plus finir. De plus, on ne peut rien changer de ce qui est écrit. Je l’ai vérifié, crois-moi ! Reprends tes travaux sur la nanophysique et les systèmes de basse dimensionnalité que tu as abandonnés il y a vingt ans. Ce sera moins dangereux. À bon entendeur.
Et en plus, c’était signé…
… Archibald Goustoquet.
Il fronça les sourcils, mais conclut très rapidement à une plaisanterie. Il replia la feuille en quatre et la glissa dans la poche intérieure droite de sa veste. Miraldine attendait à ses côtés, les mains croisées sur sa jupe.
- Des problèmes, Monsieur ?
- Non, non. Tout va bien. Merci Miraldine.
- Bien, Monsieur.
Elle retourna à la cuisine, pas convaincue que tout allait si bien que cela, car le sourcillement de son patron l’avait alertée. Elle commençait à bien le connaître cet Archibald. Miraldine Bergeron était la gouvernante de la maison. Il l’employait depuis une dizaine d’années. Elle avait passé sa vie dans différentes familles bourgeoises de Nancy avec son mari qui, lui, était chauffeur, jardinier, bref homme à tout faire. Ils avaient eu la chance, à chaque fois qu’ils recherchaient un emploi, de trouver un poste double mais le destin les avait rattrapés. Quand son mari avait contracté une leucémie foudroyante et qu’il était mort en deux mois, Miraldine n’avait pu conserver son dernier poste et avait répondu à l’annonce d’Archibald Goustoquet, qui l’avait prise à son service. Son apparence générale, sa prestance et son expérience l’avaient conduite à se fondre sans difficulté dans l’environnement petit-bourgeois de la maison.
Archibald consacrait tellement de temps à ses recherches, qu’il était resté célibataire sans s’en apercevoir. Cependant, depuis une lointaine et profonde déception sentimentale, il gardait, dans un tiroir secret verrouillé à double-tour de sa mémoire, l’image figée de celle qui en avait été la cause autrefois, quand il était jeune. Dans son esprit, elle était intacte. Elle n’avait jamais vieilli. Lui, si. Il n’avait jamais plus abordé d’autres femmes. Il n’acceptait que Miraldine dans son univers, puisqu’ils n’avaient a priori que des rapports employeur-employée. Mais si par hasard, leur conversation sortait de ce schéma, Archibald se troublait, bafouillait, et dans ces moments-là, conscient qu’il perdait ses marques, bougonnait et retournait s’isoler dans son laboratoire installé à la cave.
Miraldine souriait de sa maladresse quand les discussions tournaient autour de la mode, de la vie de famille, des enfants, mais quand le sujet virait sur la sexualité, alors là, branle-bas de combat dans la forteresse Goustoquet. Elle avait bien compris sa fragilité et bien après qu’elle eut fait son deuil de son mari, elle était devenue secrètement amoureuse de lui.
- Au fait, demanda Archibald, Maréchal est sorti ?
- Je n’en sais rien, Monsieur. Je ne surveille pas l’emploi du temps de Monsieur Fenouillet.
Elle abandonna Archibald dans le corridor et disparut dans une des nombreuses pièces du rez-de-chaussée. Miraldine savait que Maréchal était là. Il était descendu prendre le plateau de son petit-déjeuner qu’elle lui avait préparé, puis était remonté. Comme tous les jours. Mais ce n’était certainement pas elle qui favoriserait ses contacts avec Archibald.
*
Maréchal Fenouillet était un artiste. Peintre. Artiste peintre comme il aimait se présenter. Archibald l’avait rencontré sept ans en plus tôt alors qu’il exposait ses toiles sur la place du marché. Il était tombé en extase devant un tableau. Une femme de dos tenait un enfant par la main et agitait l’autre vers un groupe de personnages diffus, car le peintre l’avait noyé dans une sorte de brume. Ce qui avait subjugué Archibald, c’était cette main qui émergeait au bout du bras parfaitement net, dans un mouvement figé qui exprimait comme un ultime adieu à la femme et à l’enfant. Il en avait eu les larmes aux yeux, tant ce qu’il voyait se superposait avec son souvenir d’enfance. Bien qu’il eût presque soixante-dix ans, la souffrance engendrée par l’absence de son père avait ressurgi brutalement. Il en avait été secoué et l’artiste avait été bouleversé par l’émotion de cet homme devant sa toile. Il l’avait invité à s’asseoir quelques instants et ils avaient engagé une longue discussion comme s’ils se connaissaient depuis toujours. Archibald lui avait expliqué pourquoi la toile l’avait perturbé, et d’épanchements en confessions, le peintre lui avait raconté sa vie.
*
Il était du même âge qu’Archibald. Il était né le 22 juin 1940 à Paris, le jour de l’armistice, dans une famille de petits commerçants parisiens dont il était l’aîné de deux garçons. Leurs parents étaient morts pendant un bombardement alors qu’ils étaient à l’école. Comme héritage, ils ne leur avaient laissé que le patronyme avec pour lui, ce prénom ridicule, en hommage à Pétain dont ils avaient toujours cru que le prénom était Maréchal, et pour son frère cadet qui avait trois ans de moins, Pierre, malheureusement pour lui en référence à Laval, mais c’était plus discret. Pas vraiment une famille de résistants les parents Fenouillet. Pas vraiment collabos non plus. A la mort de leurs parents, les deux frères avaient passé leur enfance à l’orphelinat, puis plus tard, à l’adolescence, ils avaient été séparés pour être ballotés de familles d’accueil en familles d’accueil. Quand Maréchal eut dix-huit ans, il envoya balader son passé aux oubliettes. Il s’enrôla dans la marine marchande, fit plusieurs fois le tour du monde, jusqu’à ce qu’à Tahiti, il entre par hasard dans le musée dédié à Gauguin à Papeari. Bien qu’il n’y eût quasiment que des copies, ce fut le choc de sa vie. Il avait alors quarante ans. Quand il rentra en France il partit sur les traces de son idole, à Pont-Aven dans un premier temps puis, au fil de ses voyages, il écuma les musées de Paris, Londres, Rome, Boston. Quand il eut la certitude d’avoir cerné l’œuvre du maître, il décida d’être peintre. Malheureusement, son talent ne fut pas à la hauteur de son coup de foudre pour Gauguin, et aujourd’hui pour survivre, il en était réduit à vendre ses toiles sur les marchés, et à habiter dans une camionnette grossièrement aménagée qu’il appelait affectueusement sa « gauguinette ». Quant à son frère, de trois ans son cadet, il fit une brillante carrière dans la police qui l’avait conduit aux plus hautes responsabilités. D’ailleurs récemment Maréchal avait pu le présenter à Archibald par télévision interposée car à soixante-cinq ans, il venait d’être décoré de la légion d’honneur pour ses états de service en tant que commissaire divisionnaire au sein de la division antiterroriste de la Direction Centrale du Renseignement Intérieur. Sans se fréquenter pour des raisons de trajectoires différentes, il y avait entre eux un véritable lien filial que tous deux revendiquaient, mais qui ne se traduisait que par de fréquentes communications téléphoniques.
Archibald avait été touché par le destin de Maréchal, et il lui avait fait une offre spontanée qui allait bouleverser leurs deux existences : il lui avait proposé de venir habiter chez lui, d’aménager les combles pour y vivre et en faire son atelier, en échange de quoi, il entretiendrait le jardin et effectuerait les différents petits travaux intérieurs que lui-même était tout à fait incapable de réaliser. Maréchal avait d’abord failli refuser, puis après réflexion, il avait accepté à condition qu’en échange, Archibald accepte la toile qui l’avait marqué, et qui avait servi d’entrée en matière à leur conversation. Archibald en avait rougi de plaisir. Maréchal avait emménagé le lendemain.
Les deux hommes solitaires allaient conjuguer au pluriel leur existence, ravis.
Pas Miraldine.
*
Dans cette nouvelle vie qu’elle s’était construite dans le sillage d’Archibald, elle avait d’abord perçu l’arrivée de Maréchal comme un viol de leur intimité. Bien qu’elle fît des efforts pour cacher son aversion à son encontre, dans son esprit, il serait toujours non seulement le pique-assiette, mais le trublion de la romance qu’elle s’inventait de jour en jour avec Archibald. Pour résumer en un mot, elle était jalouse.
Si Maréchal avait compris l’origine de son agressivité à son égard, Archibald tombait toujours des nues et ponctuait toujours ses remarques acerbes d’un « Mais quelle mouche la pique ? » dont la naïveté amusait Maréchal.
« Mais quelle mouche la pique ? » songea justement Archibald après que Miraldine se fut éclipsée.
Il monta les deux étages jusque sous les combles et avança dans le couloir, dont le plancher grinçait à chaque pas, jusqu’à l’atelier de Maréchal. Il n’eut même pas besoin de frapper.
- Entre ! lança une voix derrière la porte.
- Impossible de te surprendre, répliqua Archibald en se retrouvant face à son ami.
Il était debout en face de son chevalet, une palette dans la main gauche, un pinceau dans la main droite, et pour l’heure, il avait pris du recul pour évaluer la progression de sa dernière toile. L’icône parfaite du peintre tel qu’on se l’imagine, mise en valeur par un rai de lumière qui plongeait de la fenêtre de toit, et allumait de fines poussières en suspension. Archibald s’approcha de la toile et crut discerner dans les formes colorées un paysage marin.
- C’est une petite île dans le coin de Bora Bora, anticipa Maréchal.
- Pourquoi ne peins-tu jamais autre chose que des paysages du Pacifique ?
- Parce qu’ils sont gravés dans ma mémoire. Ça me rappelle Gauguin. A l’époque, quand je les ai traversés, je ne peignais pas. Aujourd’hui, ils surgissent du passé.
- Avec toujours cette brume récurrente que l’on retrouve dans presque tous tes tableaux… Pourquoi ne cèdes-tu pas au réalisme du figuratif ? Pourquoi ne peins-tu pas des portraits, ou des natures mortes ?
- Dans ce que je peins, il y a toujours une part d’imaginaire avec des sensations personnelles. Comme chez Gauguin. C’est important l’imaginaire pour un artiste. C’est une soupape, un palliatif à la routine, au quotidien. Mais si tu viens me voir jusque dans l’atelier, je suppose que ce n’est pas pour parler de peinture…
- Non, tu as raison. Je viens te voir pour t’annoncer une grande nouvelle. C’est à propos de mes expériences…
- Tu as réussi ?
- Oui. Hier.
- La pomme ?
Archibald était maintenant au comble de l’excitation. Il hochait la tête avec un large sourire.
- Elle a voyagé…
Maréchal posa son pinceau et sa palette. Il n’en revenait pas.
- Tu es sûr ? Raconte-moi…
- Non. Je suis venu t’inviter dans mon laboratoire. Tu seras le premier à assister au voyage dans le temps. D’un fruit certes, mais le fruit… de mon imagination.
- C’est vrai ? Dans ton laboratoire ?
- Viens !
Archibald quitta l’atelier, Maréchal sur ses talons. Il ne parvenait pas à réaliser qu’il allait pouvoir entrer dans le laboratoire. C’était le seul endroit de la maison qu’Archibald gardait jalousement secret. Même Miraldine n’y avait jamais mis les pieds. Et de plus, son ami l’avait choisi lui, Maréchal, pour être le premier témoin oculaire de ses expériences. Bien que dubitatif, il n’en était pas moins curieux.
Ils dévalèrent les escaliers précipitamment. Le bruit de leurs pas piqua la curiosité de Miraldine qui apparut comme par enchantement. Il était rare qu’ils descendent ensemble, et de plus, avec autant de précipitation. Qu’elle soit tenue à l’écart de cette euphorie la faisait profondément souffrir. Quand ils arrivèrent près d’elle, Archibald crut lire dans son regard comme un éclair de colère. « Quelle mouche la pique ? » songea-t-il.
- Miraldine, nous ne déjeunerons pas dans la salle à manger aujourd’hui. Nous prendrons des sandwiches à l’office vers treize heures, voulez-vous ?
- Mais, le rôti aux chanterelles, Monsieur ?
- Ce soir. Nous le mangerons ce soir.
- Je vous rappelle, Monsieur, que vous ne mangez jamais de viande le soir…
- Eh bien, ce soir, je mangerai de la viande, Miraldine. Et qui plus est, nous boirons du bordeaux.
- Du vin, Monsieur ? Mais vous savez bien que le vin vous empêche de dormir…
- Ce soir sera un jour de fête, Miraldine. Nous serons à l’aube d’une ère nouvelle. Alors champagne !
- Du champagne aussi, Monsieur !
- Mais non, Miraldine ! C’est une expression.
Ils laissèrent Miraldine pantoise devant cet étrange comportement auquel elle ne comprenait rien alors qu’ils disparaissaient derrière la porte qui conduisait à la cave.
Tant de dérogations à sa vie bien réglée ne présageaient rien de bon. Elle allait devoir être vigilante. Sûr, c’était encore un coup de ce bon à rien de Maréchal. Ce « peintureux » de trois sous qui avait réussi à embobiner Archibald, et contrecarrait, par sa présence tous ses projets avec lui.
Oui, elle ouvrirait l’œil. Et le bon.
5
Les marches en pierres de l’escalier étaient disjointes. Les murs étaient froids. Bruts. Maréchal sentait poindre le mystère à chaque pas. Silencieux, il suivait Archibald. Il ne pensait pas que la cave fut aussi profondément enterrée. Ou peut-être n’était-ce qu’une impression. Ils parvinrent finalement devant deux portes qui se faisaient face.
- Celle-ci c’est la cave, dit Archibald en montrant celle de gauche. Mon laboratoire est ici.
Il s’approcha d’une porte en fer dans la serrure de laquelle il introduisit une clef. Maréchal n’en avait jamais vu d’aussi grosse. Le pêne glissa dans la gâche en deux tours de clef qu’Archibald manipula à deux mains. Il poussa la porte, fit passer son ami auquel il emboîta le pas, puis verrouilla la porte derrière lui. L’endroit était dans une pénombre relative car la lumière du jour pénétrait par un vasistas entrouvert, dont la vitre n’avait jamais dû être nettoyée. Archibald bascula un interrupteur et la lumière blanche et artificielle d’une série de quatre néons inonda le laboratoire.
Maréchal regarda autour de lui. Un doux grésillement permanent emplissait l’atmosphère. Pourtant quelque chose ne collait pas.
- Déçu ? demanda Archibald.
- Non, surpris. Je m’attendais à trouver des étagères partout avec des tas de… d’ustensiles de laboratoire.
- Des ballons, des béchers, des tubes à essais, des éprouvettes, des erlenmeyers, des fioles et j’en passe. Tout ça appartient à la panoplie des chimistes. Désolé de te décevoir Maréchal, moi je suis physicien. Quand on parle de laboratoire au commun des mortels, il se représente aussitôt tout cet attirail mis en scène par l’imaginaire cinématographique. En physique, c’est inutile. Le matériel est plus technique car mes travaux sont fondamentalement axés sur la structure moléculaire des corps. Et en particulier, sur la déstructuration moléculaire.
- Donc, c’est de la chimie.
- Euh, en quelque sorte… Mais c’est surtout à partir de la théorie d’Einstein sur la relativité que mes expériences reposent. Et aujourd’hui, Maréchal, je peux t’affirmer que tu as devant toi l’inventeur du voyage dans le temps. Viens ! Suis-moi !
Ils contournèrent plusieurs tables de travail recouvertes d’instruments électriques divers, d’écrans sur lesquels se croisaient des sinusoïdes, des fils de couleurs qui serpentaient d’un appareil à l’autre. Ils parvinrent au fond du laboratoire. L’espace était moins encombré. Un seul plan de travail s’appuyait contre le mur. Un fauteuil, sur le bras duquel s’articulait un pupitre de commande, lui faisait face. Archibald y prit place et ramena le pupitre devant lui.
- C’est un jeu vidéo ? demanda Maréchal.
- Non, c’est une TST : une télécommande spatiotemporelle. Elle est encore un peu trop volumineuse. Je dois la réduire.
Une gaine sortait de l’arrière du pupitre, remontait vers le plafond et retombait quelques mètres plus loin au sommet d’une parabole d’une cinquantaine de centimètres de diamètre orientée vers le plan de travail, sur lequel un plateau métallique lui était opposé, à la verticale, un peu plus bas.
- Voilà, c’est maintenant que tu vas assister à l’expérience la plus troublante qu’aucun homme ait jamais vécue depuis que le monde est monde.
Maréchal qui, quelques minutes auparavant, se réjouissait de découvrir le laboratoire, n’était plus rassuré du tout. Voir Archibald installé dans ce fauteuil aux commandes d’il ne savait trop quoi, le déstabilisait et il n’était plus certain de vouloir rester.
- Peur ? l’interrogea Archibald.
- Moi ? Non, bien sûr.
Archibald sourit devant l’inquiétude affichée de Maréchal.
- Viens ! Approche-toi ! Tu vas être mon assistant.
- Je… Que dois-je faire ?
- Regarde dans l’armoire réfrigérée, dit-il en montrant une sorte de petit congélateur.
Maréchal s’approcha et ouvrit la porte.
- Prends une des pommes sur l’étagère du bas !
Il prit une granny smith d’un vert éclatant.
- Bien. Centre-la sur le plateau, sous la parabole !
Maréchal déposa délicatement la pomme à l’endroit indiqué.
- Parfait. Viens te mettre derrière moi et regarde. Pour la première fois de ta vie, tu vas voir une pomme voyager deux minutes dans le futur, et revenir à son point de départ.
Dès que Maréchal fut derrière lui, Archibald appuya sur plusieurs touches de la TST sur lesquelles des diodes s’allumèrent. Une touche cubique rouge se mit à clignoter.
- Voilà. A toi l’honneur.
- Je fais quoi ?
- Tu n’as qu’à appuyer sur cette touche rouge clignotante et regarder la pomme.
- Maintenant ?
- Oui. Maintenant.
Les yeux d’Archibald brillaient d’impatience. Il savait ce qui allait se passer. Il voulait voir la réaction de son ami.
Maréchal approcha de la TST. Leva la main, index pointé. Archibald, au comble de la jubilation, l’encouragea d’un signe de tête. Après avoir inspiré profondément, Maréchal enfonça son doigt sur la touche qui resta allumée. Aussitôt, un vrombissement monta du plan de travail. Des éclairs bleutés zébrèrent le plateau métallique. La parabole diffusa une violente lumière blanche qui donnait l’impression de vouloir descendre vers le plateau, mais qui n’étaient en fin de compte que des flashes qui jaillissaient sur une dizaine de centimètres vers le bas, au plus. Après quelques secondes, les éclairs du plateau se concentrèrent sur le dessous de la pomme, alors qu’un arc lumineux descendait du centre de la parabole vers le haut du fruit. Le plateau se mit à trembler, tout comme l’ensemble du plan de travail. Une touche verte clignota sur la TST.
- Maintenant, cria Archibald.
Il appuya sur la touche qui, à son tour, resta allumée. Les arcs s’intensifièrent sous la cloche. Maréchal, subjugué ne quittait pas de vue la pomme. Soudain, comme on le percevrait sur un écran de cinéma par le biais d’un effet spécial, la pomme d’un blanc éblouissant se mit à vibrer puis la seconde suivante, disparut totalement. Aussitôt, les arcs cessèrent. La lueur sous la parabole fut comme absorbée par la gaine. Encore quelques crépitements puis le silence. Un silence, aussi soudain qu’assourdissant, qui traînait encore les échos de l’expérience.
Maréchal et Archibald, silencieux, fixait toujours le plateau. Il était vide.
- Mais… Où elle est ? interrogea Maréchal.
- Chut !
Le tremblement reprit, un arc s’alluma sous la parabole jusqu’au plateau, se scinda en deux et dans un éclair qui éclaboussa le laboratoire, la pomme réapparut, toute blanche. Les arcs diminuèrent. Les vibrations également. Le blanc du fruit vira au foncé. La pomme était à nouveau sur le plateau dans sa robe verte éclatante de granny smith. Maréchal applaudit la performance.
- Bravo. Quel superbe tour de magie !
- Tour de magie ? Tour de magie ? Quel tour de magie ? gronda Archibald.
- Je ne sais pas comment tu as fait, mais il y a forcément un truc.
- Un truc ? Tu oses appeler mon expérience un truc ? Mais espèce de mal embouché, je vais t’expliquer ce qui s’est passé. Quand on a placé la pomme sous le déstructurateur moléculaire…
- Le quoi ?
- Déstructurateur moléculaire, cette parabole, j’ai programmé un déplacement dans le temps de deux minutes. Quand tu as appuyé sur la touche rouge tu as lancé la déstructuration moléculaire de la pomme. La touche verte a lancé son aspiration spatio-temporelle. Elle a fait un bond de deux minutes dans le futur puis, selon ma programmation, elle est revenue à son point de départ. C’est un voyage dans le temps, comprends-tu ?
Dubitatif, Maréchal essayait de comprendre les explications. Il regardait Archibald avec suspicion.
- Tu n’es pas convaincu ? lui lança Archibald, amer.
- J’ai vu une pomme disparaître puis réapparaître. Ça, j’en suis sûr. Mais de là à affirmer qu’elle a voyagé dans le temps…
- Très bien. Alors écoute-moi deux secondes. Suis bien mon raisonnement. Je t’ai dit qu’après sa déstructuration et son aspiration, sa disparition si tu préfères, la pomme s’était déplacée de deux minutes dans le futur.
- Oui, c’est ce que tu m’as dit.
- Bien. Quand elle a disparu, partons de l’hypothèse qu’elle a effectivement voyagé de deux minutes dans le futur…
- Mais…
- C’est une hypothèse, d’accord ?
- Oui, mais…
- Bien. Alors, écoute. Admettons qu’elle ait disparu à l’heure H. Si elle s’est déplacée de deux minutes dans le futur, elle a forcément réapparu à l’heure H+2. Vrai ?
- C’est mathématique. Mais…
- Alors regarde bien le plateau. L’expérience a eu lieu il y a une minute trente. Logiquement, si ma théorie est exacte, la pomme devrait apparaître dans trente secondes, puis disparaître aussitôt pour retourner à l’heure H.
- Mais… elle est déjà sur le plateau…
- Ça, c’est celle qui est revenue. Mais ne dis plus rien. Et regarde !
Ils tournèrent la tête vers la pomme sur le plateau. Maréchal ne voyait pas très bien où son ami voulait en venir, mais il supposait qu’il essayait de l’endormir. Sacré Archibald ! Si les artistes vivent dans les rêves, les physiciens en sont les créateurs. C’est sans doute la raison pour laquelle, ils se sont si bien entendus et que…
Le plan de travail se mit à vibrer. Un arc se dessina sous la parabole autour de la pomme. Une lumière éblouissante l’entoura et aussitôt une seconde pomme se matérialisa à côté de la première, d’un blanc diffus qui se transforma en un vert éclatant. Sur le plateau, il y avait deux granny smith.
Archibald jeta un coup d’œil à Maréchal. Il avait pâli. Il ouvrait des yeux comme des billes et ne parvenait pas à détacher son regard des deux fruits. A peine eut-il surmonté le choc, qu’à nouveau l’arc se matérialisait sous la parabole jusqu’à la disparition de la seconde pomme. Quand le calme fut revenu, il fixait toujours le plateau où ne reposait plus qu’une seule pomme.
- Où est l’autre ? bredouilla-t-il.
- Mais elle est là. Devant toi.
- Non, je parle de la seconde.
- Les deux ne forment qu’une seule et même pomme.
- Je n’y comprends plus rien.
- Laisse-moi t’expliquer. La première fois, la pomme, qu’on va appeler A s’est déplacée de deux minutes dans le futur grâce à un aller-retour que j’ai programmé. Tu me suis ?
- Jusque-là, ça va.
- Bien. La pomme A, partie de l’heure H, a voyagé dans le futur, où elle s’est matérialisée à H+2, avant de se dématérialiser et revenir à nouveau à son point de départ en H. D’accord ?
Maréchal acquiesça d’un hochement de tête.
- Parfait. C’est donc cette pomme A que nous avions devant les yeux depuis son retour sur le plateau. Quand les deux minutes se sont écoulées, nous avons assisté à l’apparition de la pomme B, copie de A, à H+2, à côté de la pomme A.
- Mais alors… ce n’était pas deux pommes différentes, mais la même pomme.
- Tout à fait. La même pomme à deux moments de son existence : sa vie normale, et celle dans laquelle elle a voyagé.
- Et si, quand elle est apparue à côté de la première, nous l’avions enlevée de sous la parabole, que se serait-il passé ?
- Nous l’aurions empêchée de revenir en H, son point de départ, donc la pomme A aurait disparu du plateau, et il ne nous serait resté que la pomme B, celle que nous aurions soustraite à l’expérience.
- C’est incroyable. Alors c’est donc vrai ? Tu as trouvé le moyen de voyager dans le temps.
- Pour le moment, le processus n’en est qu’aux balbutiements, et je dois passer par toute une batterie de tests avant de tenter quoi que ce soit qui mettrait la vie d’un être humain en danger.
- Un être humain ? Quel être humain ? Tu ne vas pas risquer ta vie, j’espère ?
- Non, évidemment. Mais ma prochaine expérience se fera malgré tout sur des êtres vivants.
6
Il était 18h00. Julien, adolescent de dix-huit ans, quitta le lycée Chopin, où il suivait une filière littéraire avec deux langues étrangères, l’anglais et l’espagnol. Celle qu’il préférait était l’anglais. Depuis toujours, et bien avant de rentrer au collège, la sonorité, la musicalité des mots l’avaient interpelé au point de recopier phonétiquement les paroles des chansons anglo-saxonnes qu’il entendait sur la bande FM, puis de les chanter en imitant le mieux possible l’accent des interprètes. Il monta dans le tramway dont s’était dotée récemment l’agglomération, et pendant le trajet, isolé par les écouteurs de son Ipod, il regardait défiler machinalement les bâtiments. La rue Saint-Jean était noire de monde. Le tramway semblait pénétrer le flot incessant de la foule, comme une épée dans le ventre mou d’un monstre obscur. Parvenu à sa station, Julien descendit et parcourut à pieds la centaine de mètres qui le séparait de l’immeuble où il habitait avec ses parents. Enfin ses parents… façon de parler… Son père, chirurgien notoirement connu sur la place, consacrait plus de seize heures par jour à son travail, même le dimanche, prenait au plus quelques jours de vacances, et encore, pour participer à des séminaires à l’étranger. Il partait seul, ne les emmenait jamais, lui et sa mère. Il soupira. Sa mère… Pouvait-on appeler une mère une femme qui passait sa vie à dormir, et se nourrissait presque exclusivement de barbituriques, de neuroleptiques et de neurodépresseurs ? Pouvait-il considérer comme sa mère cette femme qui vivait - depuis quand était-elle déjà comme ça ? Toujours peut-être - dans un état comateux, et qui passait le plus clair de son temps - mais le temps avait-il un sens ? – à regarder les toits par la fenêtre ?
Heureusement, il y avait Marianne, que son père employait comme infirmière particulière et nounou multicartes, comme la qualifiait gentiment Julien. Il s’entendait bien avec elle. Elle était là depuis… longtemps, et à elle seule, elle était un peu son père et sa mère… Une profonde affection était née entre eux, et Julien y trouvait un équilibre avec la situation financière dont il bénéficiait grâce à son père. Il s’était complètement adapté à cet état de fait, même si ses parents, chacun avec ses propres absences, lui manquaient parfois terriblement. Il avait appris, avec les années, à enfouir sa souffrance au plus profond de lui-même, mais elle ressurgissait toujours quand il comparait sa vie avec celle de certains de ses camarades. Ils lui racontaient leurs vacances avec leurs familles dont pourtant ils dénonçaient l’intolérance et l’emprise quasi fasciste qu’elles avaient sur eux. Julien souriait tristement intérieurement du qualificatif qu’ils employaient, car son degré de maturité lui permettait de discerner dans leurs propos l’expression réactionnaire d’un conflit générationnel lié à l’adolescence.
Lui avait Marianne. Non seulement elle remplaçait affectivement à elle seule ses parents, mais de plus, elle était sa confidente et son amie. Elle était présente tous les matins à huit heures et repartait le soir vers vingt-et-une heures, quand elle avait couché sa mère.
Marianne avait quarante ans. Célibataire et mère d’une fille de vingt-trois ans qui travaillait maintenant à Paris, elle avait accepté cet emploi lourd sur le plan des horaires, surtout parce qu’elle était bien rémunérée, et que son salaire lui avait permis d’assurer les études de sa fille. Sa vie maintenant était ici, dans cette maison. Quand elle repartait le soir dans son appartement, elle souffrait de solitude. Plus jeune, elle aurait aimé trouver un compagnon, mais les hasards de la vie ne lui avaient fait rencontrer que des hommes que la présence de son enfant avait fait fuir.
Consciente de l’univers dans lequel évoluait Julien, elle l’avait pris sous sa coupe depuis qu’elle avait été embauchée. Julien avait alors sept ans. Elle avait cru comprendre qu’auparavant, la famille avait vécu un drame, mais elle n’avait jamais posé de questions. Julien lui avait juste dit au début, qu’avant, il avait une grande sœur, mais qu’elle était partie en voyage et qu’elle ne reviendrait plus jamais. Marianne n’avait jamais rien su de plus.
Julien sortit de l’ascenseur et avança dans le couloir feutré jusqu’à la porte de son appartement dans lequel il entra. Il embrassa Marianne, passa dans le grand salon où se trouvait sa mère, comme il le faisait chaque jour. Elle dormait dans son fauteuil face à la fenêtre qui donnait sur les toits. Il l’embrassa sur le front et s’agenouilla près d’elle. Elle ouvrit un œil, l’aperçut, esquissa un sourire quand elle le reconnut, passa un doigt sur sa joue. Puis l’ébauche de sourire disparut pour faire place au sempiternel masque blafard, figé dans une expression de profonde tristesse, et son œil se referma sur ses monologues intérieurs.
- Tu crois qu’un jour elle pourra s’en sortir ? demanda Julien à Marianne une fois qu’il eût regagné la cuisine où elle préparait le dîner.
- Je ne sais pas. Peut-être. Je ne suis pas médecin.
- Parfois, comme aujourd’hui, elle ouvre un œil et j’ai l’impression qu’elle me reconnaît. Mais dès qu’elle me touche, on dirait que ça lui fait mal. Je ne lui ai rien fait pourtant.
Elle passa sa main dans les boucles blondes de l’adolescent.
- Pour se protéger de la réalité, elle s’est retirée dans son monde.
- Mais je suis sa réalité…
- Oui. C’est vrai. Une partie. Mais avant, il s’est sans doute passé quelque chose de grave qui a bouleversé sa vie.
- Tu crois que ça a un rapport avec ma sœur ?
- Je ne sais pas. Peut-être. Tu m’as dit qu’avant, vous habitiez au bord d’une rivière. Je ne pense pas que ta sœur soit partie en voyage. On dit cela aux enfants quand on veut leur cacher qu’un être cher est décédé.
- Tu crois que ma sœur est…