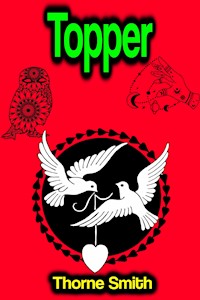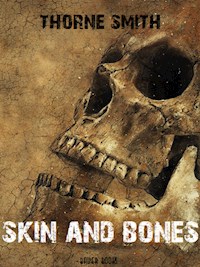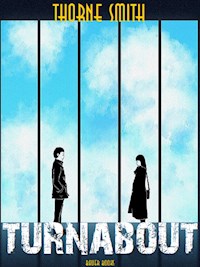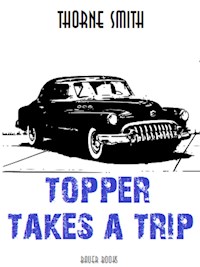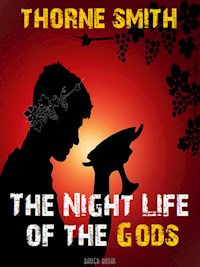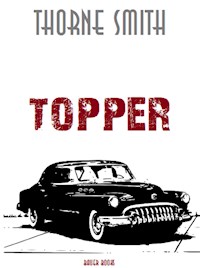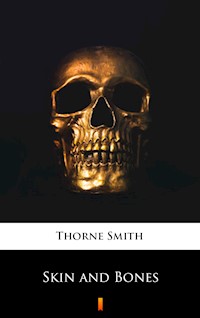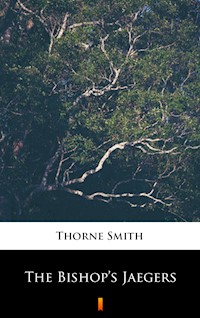Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Terre de Brume
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Et si finalement vous aviez épousé une sorcière … ?
T. Wallace Wooly Jr, hypocrite et prétentieux homme d’affaires aux revenus confortables, est une figure respectable de Warburton, petite ville de l’État de New York. Veuf et père d’une fille unique, il a un faible pour sa blonde secrétaire. Ces sentiments, heureusement réciproques, sont sur le point d’être avoués lorsque M. Wooly, que les incendies fascinent, sauve d’un hôtel en flammes une étrange jeune femme nue. En quelques jours, Jennifer Broome va bouleverser sa vie pour le pire. Partagé d’emblée entre le dégoût et l’attirance, M. Wooly épouse Jennifer, au grand désespoir de sa secrétaire — et de tous ses proches. Il découvre bientôt ce dont sa femme est capable : commerce étrange avec les animaux, don de double vue, ensorcellements divers, incendies… C’est vers le désordre, l’anarchie… bref, l’enfer que la féline Jennifer cherche à l’attirer !
À l’origine du film de René Clair et de la célèbre série Ma sorcière bien-aimée, voici pour la première fois en version complète et non expurgée Ma femme est une sorcière, dans toute sa perverse et diabolique splendeur…
A PROPOS DE L’AUTEUR
Thorne Smith entra dans les forces de la Marine pendant la Première Guerre mondiale. C’est à cette époque qu’il débuta sa carrière littéraire comme écrivain pour une gazette de soldats. Le succès est rapidement au rendez-vous, avec son personnage maladroit répondant au nom de Biltmore Oswald. Son premier roman, Topper, confirme son talent, et est adapté au cinéma. Thorne Smith se caractérise par sa plume satirique mais toutefois fantasque, acérée, dépeignant une critique de la société.
EXTRAIT
De derrière la porte de chêne verni des toilettes pour dames des bureaux de la société T. Wallace Wooly, coulait un son ténu et mélodieux qui flottait, solitaire, dans les pièces vides et ensoleillées. On eût dit un murmure sans paroles, une brise d’automne amassant les feuilles mortes, ou bien une fuite intermittente dans une conduite de vapeur. Si vous vous étiez arrêté un instant pour écouter ce son, et mieux valait que vous ne le fissiez pas, vous n’auriez sans doute identifié ni sa source ni sa signification; si vous aviez fait une pause plus longue, cependant, vous l’auriez infailliblement identifié comme la vocalisation du chagrin féminin… Nous ne savons pas, nous ne pouvons pas savoir—et c’est sans doute préférable—combien de grandes blondes sont, au moment même où nous parlons, en train de dissoudre leur beauté hautement soluble dans les larmes, de New York à Detroit, de Detroit à Albuquerque, et au-delà, recueillant le produit de ce chagrin dans un petit mouchoir, une épaule contre le mur des toilettes pour dames, et tout cela au nom de l’amour ou de son absence. Le cas de Mlle Betty Jackson est en lui-même assez triste pour nous occuper.
Au dehors, la lumière du soleil et la verdure emplissaient les rues pimpantes de Warburton; un samedi après-midi typique, plein d’une plaisante promesse, inévitablement suivi d’un dimanche, sursis supplémentaire pour toutes les petites gens qui se hâtaient de rentrer chez eux ou d’aller jouer au golf, ou de toute autre chose; des lendemains d’ivresse planaient dans le brumeux lointain, et même la clameur des klaxons des automobiles parvenaient dans les bureaux par les fenêtres ouvertes avec comme une expression de quête et de désir. Mais Mlle Jackson continuait de pleurer. Toute la matinée, depuis que M. Wooly l’avait rabrouée, elle s’était promis ce moment, ce rendez-vous avec son chagrin. Elle l’avait tenu. Elle pleurait sans un mot, le dos au mur…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 404
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CHAPITRE I
RENDEZ-VOUS DANS LES TOILETTES POUR DAMES
De derrière la porte de chêne verni des toilettes pour dames des bureaux de la société T. Wallace Wooly, coulait un son ténu et mélodieux qui flottait, solitaire, dans les pièces vides et ensoleillées. On eût dit un murmure sans paroles, une brise d’automne amassant les feuilles mortes, ou bien une fuite intermittente dans une conduite de vapeur. Si vous vous étiez arrêté un instant pour écouter ce son, et mieux valait que vous ne le fissiez pas, vous n’auriez sans doute identifié ni sa source ni sa signification ; si vous aviez fait une pause plus longue, cependant, vous l’auriez infailliblement identifié comme la vocalisation du chagrin féminin… Nous ne savons pas, nous ne pouvons pas savoir — et c’est sans doute préférable — combien de grandes blondes sont, au moment même où nous parlons, en train de dissoudre leur beauté hautement soluble dans les larmes, de New York à Detroit, de Detroit à Albuquerque, et au-delà, recueillant le produit de ce chagrin dans un petit mouchoir, une épaule contre le mur des toilettes pour dames, et tout cela au nom de l’amour ou de son absence. Le cas de Mlle Betty Jackson est en lui-même assez triste pour nous occuper.
Au dehors, la lumière du soleil et la verdure emplissaient les rues pimpantes de Warburton ; un samedi après-midi typique, plein d’une plaisante promesse, inévitablement suivi d’un dimanche, sursis supplémentaire pour toutes les petites gens qui se hâtaient de rentrer chez eux ou d’aller jouer au golf, ou de toute autre chose ; des lendemains d’ivresse planaient dans le brumeux lointain, et même la clameur des klaxons des automobiles parvenaient dans les bureaux par les fenêtres ouvertes avec comme une expression de quête et de désir. Mais Mlle Jackson continuait de pleurer. Toute la matinée, depuis que M. Wooly l’avait rabrouée, elle s’était promis ce moment, ce rendez-vous avec son chagrin. Elle l’avait tenu. Elle pleurait sans un mot, le dos au mur…
Enfin, enfin les larmes cessèrent de couler. Ses yeux se dirigèrent vers le miroir, ce qui mit un point final à sa crise.
– Oh, cette figure ! s’écria-t-elle, épouvantée. Regardez-moi ça !
Et elle s’essaya à réparer du mieux qu’elle le pouvait les dommages qu’elle avait causés.
Betty était amoureuse de son patron, T. Wallace Wooly Jr. Elle pleurait parce qu’elle était amoureuse, mais aussi parce qu’il se montrait depuis quelque temps soucieux, préoccupé. Betty était inquiète. Même s’il ne devait jamais être sien, elle voulait prendre soin du petit homme du mieux qu’elle le pouvait, pour autant qu’il la laissât faire. Bien sûr, son chagrin n’était pas complètement amer, car elle vivait comme un privilège la simple possibilité d’être près de lui, jour après jour, même s’il la regardait à peine et ne lui parlait, les rares fois où cela se produisait, que des affaires de la société T. Wallace Wooly, assurances et immobilier.
Nul n’était à Warburton plus actif, dans ses affaires professionnelles et publiques, que M. Wooly. Il était secrétaire, président et administrateur de toutes sortes d’institutions, à l’exception des associations amicales ou frivoles, naturellement. Il prenait souvent la parole à la chambre de commerce, devant la Société littéraire et au cours masculin d’étude de la Bible de la First Church. Il se dressait — ou semblait se dresser — comme un phare, sans jamais douter de la solidité de ses fondations, ni de sa lumière, éclairant les eaux sombres et souvent confuses de la vie à Warburton. Dans son enfance, on ne l’avait jamais appelé que « Junior » ; à présent même — il avait trente-neuf ans —, quelque vieil ami parfois lui donnait ce nom. Il n’avait jamais avoué à personne à quel point ce sobriquet lui faisait horreur. Il était le portrait craché de son père, le premier T. Wallace Wooly, qui avait tant fait pour la prospérité de la famille. Il avait aussi les manières de son père : il avait gardé le bureau de ce dernier et, après sa mort, il avait aussi conservé sa secrétaire, une demoiselle Ogilvie, qui eût bien pu être un hybride d’humain et de cheval — mais pas du meilleur sang, à en juger par son apparence. Laquelle était cependant un certificat de vertu aux yeux du patron de Mlle Ogilvie. Jusqu’à son dernier souffle, Mlle Ogilvie était restée aussi concentrée, aussi industrieuse que sous le règne du père de Junior. Notre M. Wooly, cependant, l’avait toujours abhorrée, sentiment qu’il avait loyalement dissimulé.
Betty Jackson, qui était, en proportions apparemment similaires, un cheval d’une toute autre robe, avait été envoyée à M. Wooly par Simpson, le gros chef de bureau, qui l’avait immédiatement sélectionnée au milieu d’une foule de postulantes. Simpson s’était fait des idées sur le futur qui ne lui avaient été d’aucun bénéfice. Il s’était imaginé que M. Wooly, étant ce genre d’abruti qui peut garder une Mlle Ogilvie des années, serait insensible aux charmes de Betty. Il se trompait lourdement. Et, du reste, Betty n’eut, dès le premier jour, d’yeux que pour M. Wooly. (Dans ses instants de rêverie, elle ne l’appelait ni « monsieur » ni « Junior », mais par de nombreux autres noms, certains plus doux et d’autres plus grandioses). Quant à M. Simpson, en dépit de ses fréquentes apparitions dans le champ de vision de Betty, il eût bien pu être l’Homme invisible en personne…
Comme cette chronique a pour sujet principal M. T. Wallace Wooly Jr, digne fils — non, admirable fils — de son fameux père, autant dévoiler immédiatement le trait essentiel de sa personnalité. Ce nabab de banlieue était, malgré toute sa fausse assurance, tout son bagout, aussi timide qu’un petit lapin. Lorsque le chauffeur de M. Wooly, l’impavide Swanson, le conduisait à une réunion où il devait prendre la parole, M. Wooly restait assis tout seul sur le siège arrière de sa limousine bleue, les mains crispées, l’estomac noué en une béante et vibrante tremblante douleur d’appréhension, comme en ses premiers jours d’école — comme en tous les jours qui avaient suivi. Au retour, les oreilles résonnant encore du fracas des applaudissements, il était un autre homme, plein d’assurance et d’admiration pour sa propre personne. Le père avait été d’une seule pièce, le fils était un alliage. M. Wooly Jr avait même songé une fois très sérieusement à tout quitter pour aller vivre à Bali sur un schooner à la quille noire… Et puis, et puis… la routine du quotidien et ses responsabilités personnelles et publiques l’avaient retenu.
Pour tout dire, il avait peur de Betty, dont il avait interprété de façon complètement erronée la conduite distante et froide. Il était loin d’être insensible à ses charmes. Parfois, il regardait le dos de sa jolie tête dorée et se demandait quelles pensées elle pouvait bien dissimuler. (Les siennes étaient, il pouvait bien se l’avouer, absolument choquantes.) Il était, dans tous ses rapports avec elle, d’une correction scrupuleuse et hautaine… Et s’il avait élevé la voix en ce samedi matin ensoleillé, c’était simplement parce qu’il s’était surpris à vouloir traverser la pièce pour aller l’embrasser.
Une bien triste méprise, à tout prendre, que quelques paroles audacieuses eussent dissipée sur le champ.
Ayant fait ce qu’elle pouvait pour son visage ravagé, Mlle Betty Jackson sortit des toilettes pour dames. De son menton à ses pieds, son rendez-vous avec le chagrin n’avait en rien diminué la beauté qui était la sienne — sa poitrine ne montrait aucun signe de désespoir, sa taille n’avait rien perdu de sa finesse. Ses longues jambes n’étaient point fléchies par la douleur, et ses pieds fins et cambrés n’étaient pas devenus plats et lourds comme son humeur. La robe de soie verte, toute simple, la ceinture dorée, les bas fins, les sandales à talons hauts de daim vert n’avaient pas changé. Elle avait toujours sur la tête ses beaux cheveux d’or, mais, juste en dessous, pour ainsi dire, se trouvait un visage pitoyable, le bleu de ses yeux faussement éteint par le vif éclat rouge de ses paupières, la lugubre pâleur de ses joues d’enfant contrastant trop durement avec un nez aussi rouge qu’une cerise, aussi rouge que le rouge à lèvres de sa douce et triste petite bouche. Les yeux papillonnant sur un ultime reniflement, elle revint de son pas ferme mais gracieux à la porte de verre du sanctuaire des sanctuaires, l’ouvrit, se rassit à son bureau, qui se trouvait là, et se remit au travail. Il y avait toujours quelque chose à faire. Toujours. Il y veillait. Bientôt le nez de Betty perdit en couleur et son chagrin en force. Sa beauté revint.
De même que M. Wooly.
Elle leva la tête, surprise, et eut un sourire angélique. Il avança dans cette illumination, petit homme en costume croisé, tiré à quatre épingles. Plein d’une discrète élégance. Il avait l’allure d’un maréchal en civil, une allure napoléonienne… ou plutôt celle d’un millionnaire épiscopalien. C’était d’ailleurs ce qu’il était — un millionnaire épiscopalien. Sa démarche était celle d’un conquérant, mais ses grands yeux sombres étaient inquiets. Il n’était revenu que pour inviter Betty à déjeuner. C’était la toute première fois. Il était extrêmement nerveux.
Il eut à son bureau un moment de trompeuse tranquillité, puis il commença à se tortiller comme si une colonne de fourmis aux antennes ardentes étaient en train d’explorer les derniers recoins de son pantalon. Il se tortillait, se trémoussait — lui d’ordinaire si calme, si posé ; il recula son fauteuil et sa propre personne d’une trentaine de centimètres de son bureau et, d’un orteil primesautier, les fit tournoyer, une fois, deux fois, trois fois. Le résultat sonore de cet accès de folie résonnait aux oreilles de la pauvre Mlle Jackson, qui n’osait lever les yeux. Il finit par s’arrêter. D’une voix forte et irritée, il s’écria :
– Vous allez arrêter ce boucan ? J’ai quelque chose à vous dire, Mlle Jackson.
Le cœur de Betty se recroquevilla. Il allait la virer, elle en était sûre.
Elle se retourna lentement.
Il haussa le menton. Il rit, d’un rire qui se voulait joyeux. Ce fut un désastre. La chair de poule, en vagues infinies, envahit toute la surface du corps de Mlle Jackson.
– Vous avez déjeuné ? Qu’est-ce qu’il y a ? Qu’est-ce que vous regardez comme ça ?
Elle secoua la tête.
– Voulez-vous déjeuner avec moi ? demanda-t-il, saisi par la panique, les cheveux dressés sur la tête.
Elle retrouva enfin l’usage de la parole.
– Cela me ferait grand plaisir, M. Wooly.
– Eh bien, ne me faites pas attendre !
Elle était stupéfaite, bouleversée. Ils sortirent des bureaux vides du samedi après-midi pour se retrouver dans la rue principale de Warburton.
Swanson, le chauffeur de M. Wooly, un Suédois osseux aux favoris mélancoliques, remua le bout du pied, et la longue automobile bleue glissa sur le macadam.
Ce ne fut pas un grand moment d’hilarité, ce premier déjeuner qu’ils passèrent ensemble. Sur le chemin du Barkley, ils étaient tous les deux très silencieux, et lorsqu’on les eut conduits vers une table isolée de l’établissement qui était le meilleur restaurant de Warburton et qu’ils furent assis l’un en face de l’autre, avec entre eux diverses choses à manger, et non, comme au bureau, d’un carnet de sténo, des formulaires d’assurance et de la photographie de la défunte Mme Wooly dans un cadre d’argent, la situation paraissait si insolite que Betty n’avait aucune idée de ce dont elle pouvait bien parler : en conséquence elle continua à se taire.
La balle était dans le camp de M. Wooly. Il s’acquitta de cette tâche du mieux qu’il put, sans trahir par la moindre de ses expressions son immense inquiétude ni ses incertitudes. Il rompit la glace avec un bref exposé de l’opinion qu’il avait des cocktails et autres boissons alcoolisées.
– Je n’y touche jamais, dit-il, ce qui était une mauvaise nouvelle pour Betty, car elle venait de se dire que ce genre de situation nécessitait justement deux ou trois Old Fashioned, une sorte de décoction ou d’entremet amphibie qu’elle affectionnait, prétendant que la chose était bien plus facile à digérer qu’une salade de fruits, à laquelle elle ressemblait beaucoup, et que ses effets étaient bien plus rapides et bien plus agréables.
Mais en lieu et place des Old Fashioned, ils eurent chacun un verre de jus de carottes, « bourré de vitamines » lui assura M. Wooly. Après ce jus de carottes, M. Wooly aborda divers sujets, dont il décida qu’ils pouvaient vraiment intéresser Betty, cette fille splendide qu’il voyait presque tous les jours depuis un mois, et qui cependant était encore à ses yeux une parfaite étrangère. Il parla de l’éducation de sa fille, Sara. Sara avait quinze ans et fréquentait un lycée de New Rochelle. Il y avait aussi la question de la police d’assurance de l’hôtel Monroe. La Cie Wooly venait de la mettre au point, et c’était une excellente affaire. Apparemment réchauffé par le jus de carottes, M. Wooly se jeta sur un plat bourré de divers sels minéraux — fer, calcium, magnésium et ainsi de suite. Les sels avaient pris l’apparence d’une salade de céleri, de noix, de tomates en tranches et de fromage blanc. Tout craquant, tout croustillant, M. Wooly, enveloppant Betty du regard de ses grands yeux sombres, en vint à parler de lui. Betty en conclut que M. Wooly tenait davantage à ses propres yeux de Charlemagne que du premier venu, et qu’il n’ignorait pour ainsi dire rien de la valeur de l’immobilier et des polices incendie. Il ne se contenta pas de lui expliquer pourquoi il était un tel exemple de santé, mais aussi pourquoi son intellect était aussi vif, aussi créatif. Tandis que M. Wooly déversait sa belle et factice assurance dans les mares limpides que formaient les fidèles iris de Betty, le jeune lapin de garenne qui lui tenait lieu d’âme arrêta de galoper en cercles terrifiés ; son petit cœur retrouva un rythme ordinaire ; M. Wooly, en un mot, se faisait son cinéma. Quant à Betty, il n’était pas question pour elle d’être conquise ; elle l’était déjà complètement ; et elle croyait tout ce qu’il disait avant même qu’il l’eût dit. Elle était amoureuse ; elle n’avait pas même pris ombrage du jus de carottes, mais elle était déterminée à ne plus manger de nourriture, ni boire de boissons, comme elle en avait l’habitude. Désormais, elle absorberait des vitamines et des sels minéraux, car sa santé, pourtant déjà exceptionnelle, ne pourrait jamais l’être assez pour son M. Wooly.
Quand ils sortirent de table, le maître d’hôtel s’inclina, de même que quelques autres convives, avec respect et cordialité.
– Je puis lire leurs pensées, dit M. Wooly à Betty avec un sourire comique. Ils se disent : « Mais voilà le riche M. T. Wallace Wooly, l’homme qui a réussi. » Avec, vous savez, comme un soupçon d’envie. Cependant, nous ne devrions jamais éprouver de jalousie envers quiconque. Et ils sont bien loin de soupçonner la lourde responsabilité qu’implique le fait d’être M. Wooly. Ce n’est pas un lit de roses, ajouta le petit homme.
– Oh non ! soupira-t-elle.
Même si c’était au sens figuré, Betty était heureuse qu’il lui ait parlé de lit. Elle ne bougea pas lorsque, se rejetant au fond du siège de la voiture bleue, M. Wooly la pressa quelque peu sur le côté.
– Non seulement, disait M. Wooly, vous êtes une femme fichtrement séduisante, Mlle Jackson, mais vous parlez vraiment bien, si je puis vous faire un compliment aussi direct ; une vraie causeuse, pour tout dire, et c’est une espèce est rare de nos jours !
– Merci, M. Wooly, dit-elle d’une petite voix, agrémentée d’un sourire plein de sentiment.
Elle n’avait presque rien dit mais cela ne la troublait pas, ni n’infirmait le compliment. Quant à M. Wooly, sa propre allocution, et chacune des soixante minutes de l’heure qu’elle avait duré, ne lui avait laissé aux oreilles que les plus plaisants des échos ; il en attibua généreusement quelques-uns à Betty.
Ayant laissé cette dernière à la porte de sa pension de famille, une maison de bois ornée d’une grande véranda, perdue au milieu de ses semblables dans une rue morose des bas quartiers de Warburton, M. Wooly se rejeta au fond du siège, ferma les yeux et pensa à sa secrétaire, laissant un sourire accroché à ses lèvres, comme une guirlande oubliée après Noël.
La voix de Swanson le tira de ses songes.
– Ja ?
En ouvrant les yeux (il n’était pas en train de dormir, ce n’était qu’un rêve éveillé), M. Wooly vit le visage osseux et moustachu de son chauffeur au-dessus du siège avant. Ce visage était lourd de désapprobation.
– À la maison, Swanson, dit M. Wooly d’un ton bref.
Swanson secoua lentement la tête. Il parla.
– Il faut faire attenshion où vous mettez les pieds, M. Wooly.
Le gaillard était impossible.
– Swanson, que voulez-vous dire par là ?
Le chauffeur se retourna vers le volant.
– Vous le shavez bien, dit-il.
Bien qu’aussi lugubre qu’à son habitude, il était visiblement heureux. Au moins, il avait réussi à décrocher ce fichu sourire du visage de son patron. De fait, le plaisir de M. Wooly et son assurance en furent grandement diminués. Swanson, homme sévère et vertueux, avait été embauché par M. Wooly Sr, une douzaine d’années plus tôt, et il s’était débrouillé pour devenir plus ou moins son représentant terrestre. Il savait, et M. Wooly savait qu’il savait, que si M. Wooly avait sur le visage cette sorte de sourire aux yeux fermés après avoir déjeuné avec sa blonde secrétaire, c’est qu’il avait des pensées qui eussent foncièrement déplu au défunt M. Wooly Sr.
Swanson continua à conduire dans un silence lourd de commentaires. En théorie, bien sûr, M. Wooly aurait pu licencier l’individu séance tenante ; il en mourait d’envie, mais ne le faisait pas : à dire vrai, Swanson lui faisait peur. Swanson le dominait psychologiquement. M. Wooly s’imagina lui infligeant l’humiliation de sa vie (jusqu’à son apogée dramatique : « Et maintenant, vous pouvez partir ! »), même s’il savait très bien qu’il n’en aurait jamais l’audace.
Il se sentit soudain déprimé. Il se demanda même s’il avait brillé aux yeux de Betty avec autant d’éclat qu’il avait pu le penser la minute d’avant.
Dans le lointain, un hululement s’éleva au-dessus des toits. La sirène à incendie. M. Wooly était un amateur confirmé et passionné de l’incendie — non point criminellement, bien sûr, mais platoniquement et professionnellement. Il était de surcroît vice-chef de la brigade des pompiers de Warburton, un titre honoraire qui lui avait été décerné lorsqu’il avait offert un nouveau camion de pompiers à la ville.
Swanson jeta un coup d’œil dans le rétroviseur.
– À la caserne ? suggéra-t-il.
– En vitesse, s’il vous plaît, dit M. Wooly.
S’ils y parvenaient à temps, il pourrait même aller sur les lieux de l’incendie — si incendie il y avait — dans le nouveau camion des pompiers.
CHAPITRE II
DE CHARYBDE…
Même si l’intérêt de M. Wooly pour les incendies était intense, il ne les appréciait aucunement — du moins, lorsqu’ils n’étaient pas maîtrisés. D’abord, ils lui rappelaient l’enfer — chacune des flammes paraissant annoncer la conflagration surnaturelle qui nous attend peut-être tous. De surcroît, les incendies avaient pour conséquence de faire sortir de ses compagnies une partie des sommes qu’elles avaient engrangées, ce qui lui apparaissait comme une procédure peu orthodoxe. Mais le feu exerçait sur M. Wooly une fascination d’une autre sorte. La personnalité même du feu, pour ainsi dire. Le feu enflait et grondait ; il se cachait derrière des nuages monstrueux, reflétés sur les visages levés de la foule. Et comme le papillon va à la flamme, M. Wooly allait aux incendies.
Le camion descendit Brick Street en hurlant. Son chauffeur ne vit pas M. Wooly faire des gestes désespérés dans sa voiture, et, naturellement, ne s’arrêta pas. Très bien, en ce cas M. Wooly irait en limousine. Il ordonna à Swanson de ne pas traîner. Swanson ne traîna pas. Le soir avait fondu sur Warburton. Dans le lointain s’élevait une lueur rosée et un pilier de fumée noire haut de plus d’un kilomètre. M. Wooly gémit. C’était l’hôtel Monroe, qu’il venait tout juste d’assurer. Ils arrivèrent bien avant les pompiers. La façade donnant sur la rue semblait intacte ; le feu s’était déclaré de l’autre côté. M. Wooly dit à Swanson de l’attendre et entra jeter un coup d’œil.
La réception, avec ses vieux fauteuils de cuir et son bureau en arc de cercle, offrait une apparence de grande tranquillité, de grande solitude. La balustrade de noyer de l’escalier qui montait droit à l’étage luisait, sombre, et la fille de bronze poli qui tenait une lampe au-dessus du pilier central ne paraissait pas concernée par les événements. Mais ailleurs, dans d’autres pièces, il y avait quelqu’un qui murmurait et crachait, quelqu’un qui faisait des vooouu et des vooouufff ! C’était l’incendie en maraude, qui se tordait comme un serpent et feulait comme un tigre jaune. M. Wooly finit par comprendre que tout le monde avait dû sortir par l’arrière, et décida d’en rester là. Il se dirigea vers la porte qui donnait sur la rue. Soudain, les lumières s’éteignirent et il se retrouva dans les ténèbres. Il eut alors le réflexe de vouloir courir vers la sortie sans perdre un instant (plus tard, il regretta amèrement de ne pas avoir cédé à cette impulsion). Mais voilà, il s’arrêta. Une voix de femme s’était élevée :
– Au secours ! Aidez-moi !
Il cria :
– Venez, sortez de là, où que vous soyez !
Aucune réponse, hors celle de l’invisible incendie.
M. Wooly n’avait aucune envie d’aller à l’étage pour y périr brûlé. Il appela à nouveau, monta quelques marches.
– Une hystérique mal éduquée, sans doute, marmonna-t-il avec irritation.
Une porte s’ouvrit brutalement. L’incendie bondit, se rua en avant, rampant avec agilité tout autour du brasier, dévorant, aboyant, pour se masquer ensuite dans sa propre fumée. Au beau milieu de cet effroyable spectacle une femme apparut. Elle s’effondra dans les bras de M. Wooly, qui venait de surgir. Il eut un grognement. Ils restèrent là un moment, comme les deux morceaux d’un escabeau. Il comprit qu’il n’y avait qu’une seule chose à faire en la circonstance, même s’il n’avait aucun goût pour la manipulation de femmes qui lui étaient complètement étrangères. Il la hissa sur une de ses épaules et l’y cala, remarquant au passage qu’en dépit de la situation, la peau de la femme était fraîche. Sa peau ? Il la tâta à nouveau, ici, là, partout où ses mains pouvaient aller. Il finit par parler, et pour une raison inconnue le fit à voix basse.
– Mais où sont passés vos vêtements ? demanda-t-il.
– Je ne sais pas, dit-elle.
Sa voix venait de derrière M. Wooly, bien en dessous de sa nuque. Elle était pliée sur son épaule comme un sac, les pieds devant.
Réponse qui ne semblait guère convenable. Il insista :
– Que voulez-vous dire ? Vous ne savez vraiment pas où sont vos vêtements ?
– L’hôtel est en feu, dit-elle d’une voix patiente.
– Je sais. Je suis vice-chef de la caserne des pompiers.
Cette déclaration paraissait, même à ses propres oreilles, assez superfétatoire.
– Ce n’est qu’un titre honorifique, ajouta-t-il. C’est comme lorsque la reine est nommée colonel d’un régiment.
– Quelle reine ? demanda la femme.
– N’importe quelle reine. N’importe quel régiment. C’est juste un exemple.
– Vous voulez dire que c’est une pure hypothèse ?
Elle semblait déçue.
Il frissonna des pieds à la tête.
– Ne me soufflez pas sur la colonne vertébrale, supplia-t-il. Ça me donne le frisson.
– Il faut bien que je respire, répliqua-t-elle. Est-ce que nous allons rester ici et griller de conserve, comme un kebab géant ? Ou allons-nous enfin descendre ?
– Arrêtez de vous trémousser, dit-il, et il descendit deux marches dans les ténèbres fumeuses.
Il s’arrêta pour reprendre son souffle.
– Ça va ?
Elle répondit par l’affirmative.
– Mais n’essayez pas de tourner la tête, le pria-t-elle. Votre menton gratte. Ou êtes-vous peut-être en train d’essayer de m’embrasser ?
– En aucune façon ! s’exclama-t-il, exprimant dans toute son ampleur le choc qu’elle venait de lui causer. Quelle idée !
– Oh, je ne peux pas savoir, dit-elle.
– Dans un moment comme celui-ci ?
La créature avait le don de vous embringuer dans des discussions sans fin.
– Je vous assure que la seule chose à votre sujet qui me fasse de l’effet, c’est votre poids. C’est exactement comme si j’étais en train de porter un sac, et non une personne.
Elle le pinça en un endroit de sa personne qui se trouvait juste au niveau de ses mains pendantes.
– Aïe ! gémit-il, et il donna un coup de pied en arrière.
Il avait hâte d’en finir. Leur descente ne devait pas se prolonger encore bien longtemps, et lorsqu’ils auraient atteint le rez-de-chaussée, il y aurait la populace, ses mille yeux, ses mille oreilles. Il voyait, même de là où il se trouvait, des lumières bouger au-delà de la double porte de verre. Les gars de la caserne étaient arrivés. Et avec eux la multitude, la moitié de Warburton, attendant avec un bel et tolérant espoir que le vieil hôtel divulguât des secrets peut-être longtemps dissimulés. C’était un hôtel de catégorie intermédiaire, vieillot, un peu négligé, et plus aussi strict qu’il l’avait été autrefois. Il vint ceci à l’esprit de M. Wooly : personne ne l’avait vu entrer — une foule allait bientôt le voir sortir. Il commença à se poser des questions cruciales, à regretter l’impulsion prématurée qui l’avait fait se ruer à l’étage pour sauver cette femme.
Et si elle sortait toute seule… et s’il la suivait de la façon la plus discrète possible ? Il s’arrêta à nouveau. Derrière eux, le feu sifflait et crachait dans des tourbillons de fumée noire. L’étrangère sur son épaule avait une peau très douce, et d’une inexplicable fraîcheur. Et d’ailleurs, elle sentait la rose, ou du moins l’avait sentie avant que la fumée n’épaississe. Sa posture n’était guère conventionnelle, et ce n’était pas le genre de posture que peut prendre une femme que vous venez juste de rencontrer. Elle avait les jambes devant. Tout ce qu’il pouvait voir d’elle, du coin gauche de son œil gauche, était imprécis, une ou deux pâles éminences. Il ne prenait aucun plaisir à la situation ; il n’y avait aucun doute à ce sujet, et cependant il ne put s’empêcher de comprendre qu’ils avaient déjà noué une relation qui avait quelque chose d’intime.
– Il fait de plus en plus chaud, dit-elle.
Vraiment ? Il répondit que cela ne le gênait pas. D’ailleurs, maintenant qu’il l’avait ramenée au rez-de-chaussée, il avait bien envie de remonter à la recherche de quelques autres hôtes égarés.
– J’étais la dernière, dit-elle. J’étais en train de prendre un bon petit bain quand ils sont venus me dire que l’hôtel était en feu. Je me suis séchée, et j’ai sauté dans un négligé. Et quand le feu est arrivé, il me l’a arraché et brûlé!
– Quand le feu est arrivé ! repris M. Wooly. Vous parlez du feu comme d’un représentant en brosses.
Elle rit tout contre sa colonne vertébrale.
À présent, l’air était étouffant et brûlant.
Dehors, devant l’entrée, les pompiers avaient dirigé leurs puissants projecteurs électriques sur la façade de l’hôtel et tout rayonnait comme en plein jour. M. Wooly remit l’étrangère sur ses pieds.
– Vous ne pouvez pas sortir comme ça, dit-il, en prenant soin de ne pas la regarder en face, maintenant qu’elle était visible.
– Je ne vois pas pourquoi.
– Eh bien, dans ce cas, vous n’avez qu’à sortir tout de suite. Et je resterai ici un moment, en attendant que l’excitation retombe.
– Vous allez brûler vif.
Mais n’était-ce pas, se demanda-t-il, préférable au spectacle qu’ils allaient présenter à la foule massée au dehors ?
– Si vous insistez, je vais porter votre pantalon, dit la femme.
La solution semblait idéale, jusqu’à ce qu’il ait l’idée de répliquer :
– Et qu’est-ce que je vais porter, moi ?
– Vous avez bien un caleçon, tout de même ?
Il eut une vision très claire de ce que cela allait donner. Trop claire. Il comprit que leur apparition — lui en caleçon, elle avec son pantalon, sortant tous les deux de l’hôtel Monroe — ferait immédiatement date dans l’histoire de Warburton. Il n’en avait aucune envie.
– Je me sens beaucoup mieux, dit la femme. Plus forte. Je pourrais peut-être vous porter dehors ?
Il considéra la proposition un instant et finit par la rejeter également. Elle n’arrangeait rien. À présent les braises pleuvaient dans l’escalier, tout autour d’eux. Il fallait vraiment songer à sortir d’ici. Que faire ? La femme résolut la question au moyen d’un petit gémissement suivi d’un prompt (enfin, pas tant que cela) évanouissement. Il la rattrapa et la hissa de nouveau sur son épaule. Les pompiers, qui avaient ouvert la porte de l’hôtel, reculèrent devant le spectacle qui s’offrait à leurs yeux. Le vaste perron, derrière l’entrée encadrée de deux colonnes, ressemblait assez à une scène de théâtre. De l’assemblée nombreuse monta une rumeur approbative, puis un murmure, puis une forte clameur d’admiration. Les flashes des photographes rendirent la vive lueur des projecteurs plus aveuglante encore. Pendant quelques instants les bons bourgeois et les pompiers furent si impressionnés que personne ne vint aider M. Wooly. Puis, s’arrachant enfin à leur fascination, les pompiers le soulagèrent de son fardeau, qu’ils enveloppèrent dans un manteau de toile cirée. Un hourra pour le héros s’éleva dans la lueur calamiteuse, et avec lui (ou M. Wooly se méprit-il ?) un rire venu d’on ne sait où. « Ah, ah ! M. Wooly ! »
– Qui est-elle ? demandèrent les gens.
Personne ne le savait.
M. Wooly trouva son chauffeur et sa voiture qui l’attendaient juste derrière les barrières des pompiers. Le visage de M. Wooly était maculé de cendres, son costume était froissé. Il se sentit obligé de donner une explication à Swanson.
– Je viens de sauver une dame, expliqua-t-il.
– Ja ?
Swanson n’était pas homme à se laisser impressionner par l’utilisation d’un style aussi lapidaire que lourd de sens.
– J’ai vu, ajouta-t-il, réflexion qu’il fit suivre, comme à l’ordinaire, du commentaire pesant de son silence nordique.
M. Wooly, feignant la nonchalance, épousseta d’une main légère les revers de son costume.
– Eh bien, c’est fait, dit-il.
– Ja ? Sha ne fait que commensher, dit Swanson. De Charybde…
– Nous rentrons immédiatement, ordonna M. Wooly. Son ton était glacial.
– Ja, dit Swanson, faisant en sorte d’exprimer par cette seule syllabe cette simple assurance : lui seul, Swanson, estimait à leur juste valeur les aventures de la journée. M. Wooly n’avait rien compris du tout.
CHAPITRE III
M. WOOLY VA SE COUCHER TÊTE BASSE
Le lit de M. Wooly avait autrefois appartenu à son arrière-grand-oncle, un monsieur qui n’avait jamais écrit son autobiographie car elle eût été, pour l’essentiel, impubliable, fait que son propre fils et son propre petit-fils avaient pu dissimuler à notre M. Wooly. C’était un meuble Empire, avec quatre gras piliers de cerisier rougeâtre, abondamment sculptés. Le monogramme W brillait en courbes sculptées et dorées sur le devant du baldaquin. Le lit lui-même était d’une inhabituelle superficie. Toute la maison Wooly, les six ou sept domestiques, y compris Bentley, le majordome, qui était très gros, voire même un cheval ou deux, eussent pu y dormir sans se sentir mal à l’aise, supposition absurde, naturellement, car la résidence Wooly comprenait de nombreux et spacieux appartements. Les rideaux du lit étaient de brocard bleu pâle, et toute cette splendeur était couronnée d’une immense glace de la meilleure qualité. Lorsque la lampe rose du chevet de M. Wooly était allumée, il pouvait rester couché et, les yeux levés tout droit vers le miroir, tester les expressions de son visage et les gestes qui orneraient son discours du lendemain, délivré devant la Convention des agents immobiliers, ou dans un dîner de charité pour l’amélioration de l’habitat.
Quand il voulait se retirer, il sonnait toujours Bentley, le majordome. Bentley ne dévêtissait pas Wooly, mais il rangeait ses vêtements. Et il écoutait avec un intérêt poli mêlé d’approbation le récit que M. Wooly faisait de son excellente journée, de l’éloquence avec laquelle il avait parlé, de l’intérêt dont avait fait montre l’audience.
Après avoir dit : « Vous pouvez y aller, Bentley. Bonne nuit », M. Wooly allait d’un pas délibéré et pensif vers son lit, regardait le thermostat pendu au mur, remontait sa montre, jetait un coup d’œil aux titres des livres très sérieux posés sur la table de chevet, pour finalement entrer dans son lit avec lenteur et dignité, s’étirer sur le dos et, croisant dans le miroir son propre regard, murmurer froidement, sans frémir : « Un bon discours, un excellent discours, parbleu ! », ou quelque autre éloge, puis éteindre la lampe et se glisser immédiatement dans un sommeil sans rêves. Il dormait le plus souvent sur le dos, sans ronfler, sans jamais se retourner comme s’il se battait contre quelque problème. D’ailleurs, il n’avait jamais aucun problème. Du moment où il se réveillait et sortait de son lit à celui où il y retournait, il était le plus occupé des hommes. Qu’il fût éveillé ou qu’il dormît, les lendemains étaient pour lui une absolue certitude et non, comme pour nombre d’entre nous, une menace. À dire vrai, M. Wooly, ce digne veuf de Warburton, était d’un certain point de vue parfaitement adapté à l’existence. D’un autre point de vue, il était à peu près aussi vivant qu’un pantin de bois. À l’aune de la Grande Faucheuse, cela ne revient-il pas au même ?
En tout cas, la nuit qui suivit son retour de l’incendie de l’hôtel Monroe, il n’appela pas Bentley (qui, en conséquence, ne ferma pas l’œil de la nuit) mais, après un bain hâtif, alla se coucher en catimini. Pour la première fois, il évita de croiser son propre regard dans le grand miroir. Il éteignit immédiatement la lumière. Il se retourna, d’abord sur la gauche puis sur la droite. Il soupira. Pour la première fois, il eût voulu défaire la séquence des événements, annuler la journée qui venait tout juste de finir. Il ne vivait plus en sécurité. On l’avait démasqué. Son armure était percée. Il ne comprenait pas très bien la nature de ces nouveaux sentiments. Mais le seul fait de les voir éclore lui faisait réaliser une chose qu’il avait au fond de lui-même toujours sue. Quoi qu’il fût l’homme le plus occupé, le plus en vue, le plus important de Warburton, il avait toujours vécu terré, aussi éloigné de la vraie vie qu’une tortue dans sa carapace.
Il n’avait aucune sympathie pour cette femelle qu’il avait sauvée de l’incendie. Rien, pas une once de sentiment. Mais, quand il pensait à elle, il ne pouvait pas dormir. Chose curieuse, alors que son esprit refusait de se souvenir, sa main continuait à garder un écho de la sensation que lui avait donnée sa peau fraîche. Ses bras se souvenaient. Les démons de l’enfer se déchaînaient dans son âme. Il aurait mieux valu, finit-il par conclure, qu’elle brûlât vive ! Au diable la femme, qui s’invite ainsi dans mon existence ! Et il n’était ni assez gentil ni assez stupide pour ne pas la suspecter de certains desseins. À quarante ans à peine, il avait un revenu plus que suffisant et une collection — et quelle collection ! — de bons d’État défiscalisés. Il était riche. Riche et sans femme ! Seuls les pauvres peuvent se permettre de ne pas avoir de soupçons. M. Wooly pria en silence. Et priant, il se souvint des flammes. Il pensa aux flammes de l’enfer jusqu’à ce que, devenue gigantesque, toute la scène de l’hôtel Monroe se fût métamorphosée en une rencontre avec Lui, le Prince des ténèbres. Au mieux, un trou minable, l’hôtel Monroe ! Il essaya de penser à Betty, mais d’une certaine façon elle semblait se confondre avec la créature qu’il avait portée dans l’escalier. Quand il eut fini par s’endormir, il remua et grogna comme une âme tourmentée, car il se mit immédiatement à rêver qu’elle était là, près de lui, et que le lit tout entier était en feu. Hélas, lui aussi !
CHAPITRE IV
JENNIFER
Le Dr Frank Mannix, qui avait le menton long et bleuté et portait des lunettes aux verres épais de trois centimètres, regarda M. Wooly avec des yeux rendus aussi petits que des pois chiches par l’effet de loupe inversé. La pluie obscurcissait les fenêtres du bureau du médecin à l’hôpital de Warburton, au bout de Brick Street. C’était l’après-midi d’après l’incendie, lequel avait, incidemment, complètement ravagé l’hôtel, laissant tout juste assez de cendres noires pour remplir une cave. Un feu remarquablement destructeur. Le docteur était en train de parler à M. Wooly de sa patiente. Il avait déjà dévoilé son nom, Jennifer Broome 1. Selon les dires de la jeune femme, elle avait vécu jusqu’à ces derniers jours à Cagnes-sur-Mer, qui se trouve, naturellement, sur la Côte d’Azur. Elle était d’origine mi-anglaise, mi-américaine, et du côté anglais elle était liée à certaines grandes familles ; quant à son état de santé, il était… Le bon docteur se tut et enveloppa M. Wooly d’un regard pénétrant, comme si ce malheureux hébété avait été en mesure de dissimuler quelques faits essentiels. Il dit :
– Son état, M. Wooly, est extraordinaire. Il est merveilleux. Quand et pourquoi, ajouta-t-il, lui avez-vous ôté ses vêtements ?
La réfutation de M. Wooly tenait en cinq mots.
– Je n’ai rien ôté, dit-il. Ils ont brûlé. Elle a traversé une mer de flammes, docteur.
Le docteur secoua doucement la tête.
– L’œil humain, dit-il avec une condescendance des plus irritantes, nous joue souvent des tours, M. Wooly. Cette femme n’a traversé aucune mer de flammes, je vous l’assure.
M. Wooly commençait à prendre le médecin en grippe.
– J’étais là, Dr Mannix.
– Oh, je le sais bien. Grand dieux, M. Wooly, toute la ville est au courant.
Il eut un sourire complice, le sourire que l’on a entre vieux salauds.
– Tandis que vous, si je puis me permettre de vous le rappeler, n’y étiez pas.
– Dieu merci ! dit le docteur avec un sourire. Nous autres médecins, vous le savez, devons être prudents. Je veux dire que nous ne pouvons pas nous permettre de fréquenter des lieux tels que le Monroe. En tout cas, pas au vu et au su de tous. Mais là-bas, ce que vous avez cru voir, M. Wooly, vous ne l’avez pas vraiment vu ; et si je sais cela, M. Wooly, c’est que si elle avait traversé cette fournaise ardente, comme vous dites…
– J’ai dit « une mer de flammes ».
M. Wooly regarda par la fenêtre triste. L’expression de son visage aux traits lisses et nets était réticente. Il pensait au don de dix mille dollars qu’il avait fait à cet hôpital. Plutôt s’exiler à Hoboken que de lui redonner le moindre cent.
– Je juge d’un événement par ses effets, dit le docteur d’un ton qui donnait à penser que M. Wooly en jugeait, lui, par la numérologie ou l’étude des feuilles de thé. La peau de Mlle Jennifer Broome est intacte, sans une seule blessure, parfaitement indemne des effets du feu. Il y a cependant une petite marque rose sur son épaule droite. Elle ressemble (il partit en quête du mot approprié, pénétrant l’âme de M. Wooly de ses petits yeux distants) à une morsure, finit-il par dire.
« Et ce n’est pas une morsure de moustique, ajouta-t-il. Dites-moi, M. Wooly, depuis quand connaissez-vous Mlle Broome ?
– Je ne l’avais jamais vue avant de monter l’escalier, répliqua M. Wooly avec dignité. Quant à la morsure, si c’en est bien une, je ne mords pas.
Le Dr Mannix eut un bon gros rire.
– Les chiens aboient comme ils remuent la queue, dit-il en hochant la tête.
On eût dit qu’il s’adressait à un bon vieux copain.
M. Wooly se rendit compte qu’avant la nuit dernière, le Dr Mannix n’aurait jamais eu l’effronterie de l’interroger de cette manière. Il n’en avait d’ailleurs pas fini.
– En ce cas, poursuivit-il, je dois comprendre que c’est une flamme récente, et non point une vieille passion ?
Ce qui eut l’air de le réjouir ; il appliqua à M. Wooly une claque blessante sur le genou.
– Cachottier ! dit le Dr Mannix. Qui l’aurait cru ?
– Qui aurait cru quoi ?
Le Dr Mannix cligna de l’œil.
– Un vrai renard ! dit-il.
Il ajouta, dans un spasme d’inspiration :
– Ou bien un chaud lapin ! Ha, ha, ha !
À présent M. Wooly commençait à comprendre que, comme zpersonne ne l’avait vu entrer dans l’hôtel — la foule n’avait pas commencé à se rassembler autour des lieux avant que Mlle Broome et lui-même ne fassent leur sortie remarquable, laquelle était, paradoxalement, l’entrée la plus dramatiquement efficace jamais exécutée à Warburton —, nombreux étaient ceux qui avaient dû penser que Mlle Broome et lui-même étaient occupés à quelque affaire à l’étage. Avec indignation, mais dans les moindres détails, il raconta sa version des faits au bon docteur. Le docteur, se remémorant, sans aucun doute, la question très secondaire des dix mille dollars de l’année passée, et sentant bien qu’il était allé trop loin, l’écouta avec, sur le visage, une expression d’intérêt respectueux…
Après quoi, M. Wooly monta à l’étage des femmes et frappa à la porte qu’on lui avait indiquée comme étant celle de Mlle Broome.
De l’intérieur de la chambre, sa voix s’éleva, chantante :
– Qui est-ce ?
La voix le transperça. Elle ne lui plaisait pas. Il y entendait comme le miaulement du chat, haut et clair, comme une suggestion de fond de jardin, de gémissement ou de fredonnement — une voix de violon. Non, cette voix ne lui plaisait vraiment pas, mais, comme la veille, dans son lit, le fait de penser à Mlle Broome fit battre son cœur plus vite, et ses genoux faiblirent.
– C’est moi, dit-il, comme un ensorcelé, au lieu de dire « M. Wooly », ou quelque chose d’intelligent.
– Oh, soupira-t-elle, entrez, entrez.
La plupart des femmes ont meilleure apparence quand elles sont au lit que lorsqu’elles sont debout, à vaquer à leurs affaires. La raison principale en est que, tant qu’elles sont au lit (c’est du moins ainsi que les choses apparaissent au visiteur de passage), la plus grande partie de leur personne est dissimulée. Une autre raison est qu’elles ont également l’occasion de tirer le plus grand bénéfice possible des quelques cheveux qu’elles ont en les arrangeant habilement sur l’oreiller. D’ailleurs, même s’ils sont couleur de poussière, le contraste avec la blancheur neigeuse de l’oreiller provoque une illusion des plus charmantes… et la plus malgracieuse des femmes peut rester coucher sur le dos aussi élégamment que sa prochaine. C’est un talent naturel.
Mais lorsqu’une femme a une couronne somptueuse de cheveux brillants et sombres, lorsqu’elle a des yeux en amande, à demi fermés, des iris d’un jaune clair et lumineux luisant dans l’ombre de la chambre, lorsqu’elle a une bouche incurvée en un sourire bref, semblable à celui d’un chat, cruel et passionné, de petites dents blanches se montrant en un sourire de joie sans mélange, une main, aussi blanche que neige, se tendant avec impatience.
– Ah, M. Wooly, vous êtes venu !
La paume de la main de M. Wooly passa par-dessus la sienne, en refusant le contact ; il saisit du bout des doigts le bout des doigts de Mlle Broome, et s’inclina légèrement à partir de la taille. Il avait décidé que cette rencontre devait être marquée par un certain formalisme sans aucune chaleur, et par le refus délibéré et de bon goût de toute allusion au contretemps de la veille.
– Mlle Broome, je présume ?
Elle le regarda avec stupéfaction. S’il avait été de ceux qui ont la moindre intuition concernant les sentiments des autres, M. Wooly eût compris sans mal, en voyant ses sourcils magnifiques et longs se rapprocher légèrement, et son sourire se figer, qu’elle n’était pas seulement stupéfaite, mais également fort mécontente.
D’une voix égale, à l’accent très « Mayfair », très acide, elle dit :
– Eh bien, que le diable m’emporte.
– Je vous demande pardon ?
Elle se raidit, elle aussi.
– Ne voulez-vous pas… prendre un siège ?
– Merci.
Il s’assit sur le bord d’une chaise. La chambre était petite. Il était par nécessité assis tout près de son lit. Sur l’oreiller d’un blanc neigeux, la petite tête sombre de Mlle Broome se tourna vers lui.
– Puis-je me présenter ? T. Wallace Wooly.
– Si vous pouvez vous présenter ? Pourquoi pas ? Comment allez-vous ?
Elle lui toucha la joue, et la chaleur de la paume de sa main resta imprimée en lui : sa peau en avait gardé le souvenir.
– Faut-il vraiment… que nous soyons aussi guindés ? demanda-t-elle. Après tout, je vous dois la vie. Ma vie vous appartient, M. Wooly. Je suis à vous. Et vous entrez ici, aussi lointain qu’un directeur de banque qui parle à un mauvais client, ou que l’ambassadeur de Chine. Ce n’est pas du tout ce à quoi je m’attendais. Aux yeux de tout Warburton, que suis-je à présent ?
Elle se toucha la poitrine du bout des doigts.
« De vraies grenades », pensa M. Wooly.
Ses pensées étaient confuses, teintées de méfiance, de bon sens, mais aussi d’autre chose — un sentiment de sympathie pour cette pauvre victime. Et, dans ce mélange, se dégageaient des termes isolés, telles que « grenades » (fruits durs, peu comestibles et pleins de graines, du reste), et cette question : Quo vadis, qui signifiait en latin « Et partant de là, où vas-tu ? » ou quelque chose de ce genre. Et les Sabines ? Que venaient-elles faire là ? Lui revint à l’esprit un grand tableau représentant les Sabines, qu’il avait vu dans un livre d’art. L’une d’elles, une femme brune, était couchée et avait un regard de côté. Le Viol des Sabines, tel était le titre du tableau, et comme la chose n’avait pas plus de rapport avec sa situation présente que la fête de Néron dans Quo vadis ? — et quelle fête ! —, pourquoi y pensait-il ? Où étaient donc passées ses pensées habituelles, froides et disciplinées ? En déroute, en fuite, une Berezina psychique, par tous les dieux, et cela juste parce que sa joue avait gardé le souvenir du contact de la paume de la jeune femme. Pendant tout ce temps, il n’avait pas cessé de la regarder. Chaque fois que ses lourdes paupières se soulevaient, le regard de ses yeux jaunes croisaient le sien. Alors la lumière se faisait obscurité tout autour du champ visuel de ses yeux fascinés, et il n’y avait plus au monde que ce rayon clair et jaune.
À ce moment précis, au beau milieu de cet étrange silence, survint une infirmière impeccable et chaleureuse, en blouse bleue, tablier blanc amidonné, et bonnet ailé, semblable à l’ange de l’Annonciation, ou au Saint-Bernard tel qu’il apparaît à l’alpiniste prostré. Elle portait un plateau chargé d’un repas constitué de mets abondants et divers, et de quelques journaux. Elle gazouilla et sourit, dressa la table du lit, fit cliqueter les couverts et les assiettes, ne ménagea ni les « chérie », ni les « mon cœur », efficace et impersonnelle, ou feignant de l’être, et se repaissant, l’œil cynique et pâle, du spectacle de la voluptueuse invalide et du fameux M. Wooly, raide et vertueux. On ne peut jamais rien dire, pensait-elle ; ces hommes petits, on dit que… Et elle, quelle excitée, hein ? Il faut voir comment elle le dévore des yeux… et ainsi de suite, ne cessant de s’inventer de petites choses à faire de manière à pouvoir traîner encore un moment dans l’atmosphère d’élégante luxure qu’elle croyait être celle de la chambre, jusqu’à ce que M. Wooly, ayant transformé ses yeux en deux marrons soigneusement polis, darde sur elle un regard incendiaire qui la fit fuir en courant.
Le repas normalisa la situation. Les pensées de M. Wooly se réformèrent et acceptèrent de se discipliner lorsqu’il vit Jennifer manger. Elle se nourrissait comme une aristocrate — avec une sensualité délicate, comme un loup aux bonnes manières, à la griffe élégante. Elle mangea des huîtres, les inspectant les unes après les autres avant de les absorber ; elle avala un bol de crevettes roses, et un steak à la peau noire, saignant de l’intérieur. De temps à autre, elle souriait à M. Wooly, lui offrant de goûter au steak, dont elle fit les louanges, sans remarquer les trémulations du petit homme.
Sans nécessité particulière, elle finit par dire :
– Je me sens vraiment en pleine forme. Je partirai demain.
– Où irez-vous ?
Elle eut une expression de tristesse, écarta d’elle la table.
– Je ne sais pas.