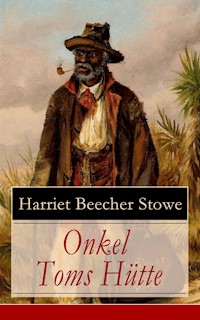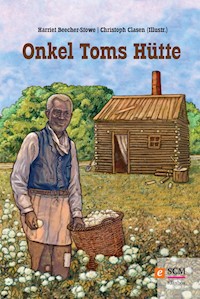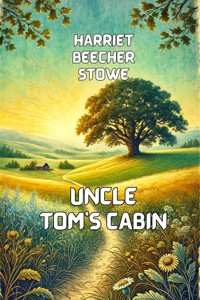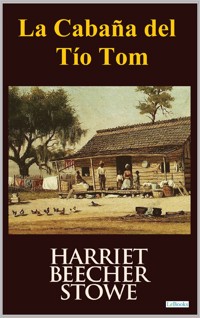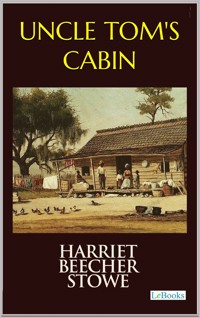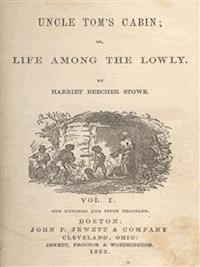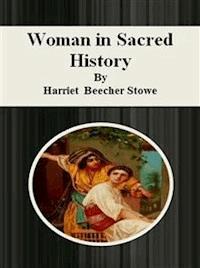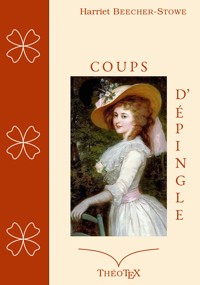Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Après le retentissant succès de La Case de l'Oncle Tom un petit nombre de nouvelles et de romans d'Harriet Beecher Stowe furent traduits en français par des maisons d'édition protestantes, sans que la critique en renvoie beaucoup d'échos. Ces compositions tombées dans l'oubli valent pourtant leur temps de lecture, pour qui veut mieux connaître à la fois l'Amérique du XIXe siècle et le caractère d'une femme hors du commun. Bien qu'écrit à la première personne sous un masque masculin (Harry Henderson), on devine en effet dans Ma femme et moi des éléments autobiographiques de l'auteur, surtout ceux qui se rapportent à son enfance. Sans doute les oeuvres d'H.B.S. sont toutes dirigées par un but militant : il s'agit ici de plaider les droits de la femme dans le mariage, comme autrefois les droits des noirs dans une société esclavagiste. Le mouvement féministe des années 1970 aux US n'a d'ailleurs pas manqué d'essayer de récupérer à son compte le renom d'Harriet. Cependant l'atmosphère évangélique qui imprègne ses pages, reste le composant essentiel de leur parfum, qui communique encore aujourd'hui plaisir et sérénité à les lire. Cette numérisation ThéoTeX reproduit la traduction d'Hélène Janin, parue en 1872.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 621
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ce fichier au format EPUB, ou livre numérique, est édité par BoD (Books on Demand) — ISBN :
Auteur Harriet Beecher-Stowe. Les textes du domaine public contenus ne peuvent faire l'objet d'aucune exclusivité.Les notes, préfaces, descriptions, traductions éventuellement rajoutées restent sous la responsabilité de ThéoTEX, et ne peuvent pas être reproduites sans autorisation.ThéoTEX
site internet : theotex.orgcourriel : theotex@gmail.comPendant la publication de cette histoire dans le journal l'Union chrétienne, la presse périodique a souvent répandu le bruit que quelques-uns des caractères sont des portraits d'individus réels et vivants.
Il n'en est rien. Cette supposition provient d'un examen imparfait des principes de la composition dramatique. Le romancier ne se propose nullement de faire le portrait d'un individu quelconque, choisi parmi les personnes de sa connaissance. Certains caractères sont nécessaires pour le but qu'il se propose. Il les imagine et les crée, et ils deviennent pour lui des êtres réels et vivants, qui ont une manière à eux de parler et d'agir. Mais, d'un autre côté, il est guidé dans cette création par sa connaissance et son expérience du genre humain et il étudie des exemples et des incidents particuliers, seulement pour s'assurer de la possibilité et de la probabilité du caractère qu'il crée. S'il réussit à produire un caractère vrai et naturel, le lecteur est souvent tenté de l'identifier avec quelqu'un de sa connaissance. Un incident de peu d'importance, une anecdote, un article de journal, fournissent souvent le fond d'un caractère de ce genre, et le procédé par lequel il est formé est semblable à celui du professeur Agassiz qui, avec une seule arête, reconstruit la forme entière d'un poisson inconnu. Mais appliquer cette ébauche à une personne vivante quelconque, c'est une erreur qui pourrait faire tort à l'auteur et à la personne désignée.
L'auteur ne connaît certainement point d'original qui réponde pleinement au caractère de Mme Cerullan, par exemple, quoiqu'elle ait entendu faire la description d'une telle personne ; il y a sans doute en elle des traits qui sont également la part de toutes les belles enthousiastes qui s'abusent en s'imaginant que l'influence de leurs charmes sur l'autre sexe est une véritable supériorité intellectuelle.
Il y a heureusement plusieurs jeunes femmes dont la vigoureuse et vigilante carrière est semblable à celle d'Ida van Arsdel, et les expériences réelles d'une aimable jeune personne de New-York ont fait naître les premières inspirations du caractère d'Eva ; cependant toutes les deux sont, quant à l'exécution, des peintures absolument imaginaires adaptées à l'histoire. Enfin, dans quelques cas, deux ou trois caractères réels fournissent les germes, mais seulement les germes, desquels de nouveaux caractères sont développés.
Twin Mountain House, N. H., octobre 1871
Ne dirait-on pas, à voir avec quelle persévérance digne d'un meilleur but, le monde réclame des « histoires. » qu'il retourne à sa seconde enfance ? Histoires, histoires partout ! histoires dans les journaux, dans les revues, dans les coins, les crevasses, les fentes des maisons, histoires qui tombent de la plume aussi facilement que les feuilles d'automne avec lesquelles elles ont mille rapports d'ombres, de formes et de couleurs ! Les histoires nous arrivent par rafales de l'Angleterre ; on nous en traduit du français, du danois, du suédois, de l'allemand, du russe. Il y en a toute une série pour les adultes dans le Monde illustré, Terre et Mer, le Globe, etc. ; il y en a pour les adolescents dans Nos jeunes amis, le Petit caporal, le Bord du ruisseau, le Compagnon du jeune âge ; bientôt nous verrons paraître celles destinées à la chambre des enfants, nous aurons de charmantes revues illustrées telles que le Berceau, la Petite maman, la Première dent.
Je me suis souvent demandé ce qu'aurait dit Salomon s'il avait vécu de nos jours. Le pauvre roi était déjà, à ce qu'il paraît, quelque peu blasé sur la littérature de son temps, car il affirmait que l'étude était « une fatigue de la chair. » Cependant l'imprimerie n'existait pas encore, et les livres étaient tous écrits à la main, avec ces lettres hébraïques dont la plus petite exige autant de travail à elle seule qu'une inscription tumulaire tout entière. Malgré cela, c'est presque avec impatience que Salomon se plaignait de la science et des livres.
Qu'aurait-il dit s'il avait lu le catalogue d'un libraire de nos jours ?
Il est entendu qu'un journal n'est pas complet s'il ne contient son feuilleton ; et le filage de ces nouvelles met en mouvement des milliers de roues et de métiers. Quiconque veut s'attirer la faveur du public par l'exposé de quelque théorie nouvelle se voit forcé de le faire dans une revue hebdomadaire. Celui qui, selon St Paul, a une doctrine, une révélation, une interprétation quelconque, la fait paraître sous forme de roman. C'est ainsi que l'on traite aujourd'hui les questions des prisons, du travail, du libre-échange, des droits de la femme ; le catholicisme et le protestantisme, l'église, le libéralisme, les luttes religieuses, dans lesquelles un des combattants convertit toujours l'autre suivant la foi personnelle de l'écrivain, tout se discute dans les journaux.
Et la chose menace fort de continuer : bientôt il sera nécessaire que chaque prédicateur débite, dimanche après dimanche, à ses ouailles toute une série de sermons sur le même sujet. Les annonces des journaux de la localité nous avertiront que le Révérend Dr Ignace, de l'Église de Ste Marie, commencera un roman intitulé : Les flèches de St Sébastien, dans lequel il exposera les devoirs, les épreuves et les tentations des chrétiens de nos jours. Le Dr Boanerges, de l'Église du Rocher de Plymouth, nous expliquera sous forme de roman les traits principaux de la théologie protestante. Le Révérend Dr Fraîchombre poursuivra son intéressante publication sur l'Influence dissolvante du christianisme, dans laquelle il fera comprendre à ses lecteurs que toutes choses se ressemblent, que toutes choses ont un but et que toutes choses doivent prendre fin ; que, par conséquent, il importe que chacun prenne la vie par le bon bout et fasse le meilleur usage possible des biens de ce monde.
Grâce à l'instruction que procureront tous ces romans, le système de l'enseignement par paraboles prendra un développement extraordinaire. Le Voyage du Pèlerin ne se verra plus nulle part ; le chemin de la cité céleste sera aussi clair aux yeux de la foule que la grande route de Broadway — et beaucoup plus intéressant ! Finalement, les sciences, les arts, les métiers, tout sera expliqué dans les revues périodiques, si bien que la vie présente et la vie à venir ne formeront plus qu'une seule et même histoire. C'est à cette époque qu'aura lieu le Millénium.
En attendant, je vais, de mon côté, écrire une nouvelle hebdomadaire pour les lecteurs de l'Union chrétiennea et je choisis pour cela le sujet qui vient à la pensée de tout le monde, que l'on discute à toutes les tables, dont chacun se préoccupe et qui fait vibrer une corde dans le cœur de tout homme ; à savoir :
J'espère que Miss Anthony, Miss Stanton et toutes les prophétesses de nos jours remarqueront la convenance et l'humilité de mon titre. Je n'ai pas dit : Moi et ma femme ; oh ! non, mais bien Ma femme et moi. Qui suis-je, en effet, et qu'est-ce que la maison de mes pères pour que j'inscrive mon nom avant celui de la compagne de ma vie ?
Mais pourquoi l'écrivez-vous spécialement pour l'Union chrétienne ? nous demandera le lecteur. A cela, répondons-lui dans un esprit d'amour :
— Notre but n'est-il pas évident, ô bien aimé ? Cette raison de commerce qui s'offre à nous sous le titre de Ma femme et moi n'est-elle pas la plus ancienne et la plus respectable forme d'union chrétienne dont nous puissions avoir souvenance ? Où, je vous le demande, en trouverez-vous une meilleure, une plus sage, plus forte, plus douce, plus populaire et plus agréable ?
Naturellement, il y a eu des temps où cette vénérable maison était traitée de vieillerie et où on lui proposait toutes sortes de remplaçants ; on disait que Ma femme et moi représentait une corporation des plus égoïstes, incapable de s'allier avec la bienveillance universelle ; que Ma femme et moi, dans une communauté céleste, n'avaient pas plus de droit l'un sur l'autre qu'aucun des milliers de frères et de sœurs de la race humaine. On a dit aussi que Ma femme et moi, au lieu de former une indissoluble unité, n'étaient que des associés temporaires, libres de se quitter en s'avertissant trois mois à l'avance, et de s'engager ailleurs.
Ce n'est pas ainsi que nous l'entendons.
Ma femme et moi, à notre point de vue, est le signe d'une union aussi sacrée que la religion, aussi indissoluble que l'âme, aussi infinie que l'éternité ; c'est le symbole choisi par un Dieu d'amour pour représenter son union éternelle avec l'âme de ses créatures.
Une fontaine de jeunesse éternelle jaillit au foyer de toutes les maisons ; tout homme ou toute femme qui a réellement aimé a eu son roman, sa poésie.
Aussi, dans mon histoire, tiens-je à rejeter toute autre source d'intérêt. N'y cherchez ni trappes mystérieuses, ni maisons hantées, ni conspirations, ni assassinats ; vous n'en trouverez aucun. Vous aurez simplement la vieille et simple histoire d'un Adam hébété, désolé, solitaire sans son Ève, la manière dont il la chercha et la trouva, et leur existence à partir de ce jour.
N'est-ce pas là, en définitive, la substance de tous les romans qui ont été écrits ? aussi, tant qu'il y aura des Adams et des Èves dans la race humaine, les lecteurs sympathiques ne me feront pas défaut.
C'est ainsi que moi, Henri Henderson, simple Yankee des montagnes du New-Hampshire, aujourd'hui citoyen de New-York, je vais commencer mon histoire.
Ma vie se divise en trois phases distinctes :
Dans le cours de ce récit vous verrez, chers amis, que nous saisirons l'occasion de discuter tous les sujets à l'ordre du jour, afin de nous tenir autant que possible au niveau de ce siècle qui prétend connaître toutes choses.
La Bible nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul ; c'est là une vérité qui s'est présentée à moi avec une force extraordinaire dès mon plus jeune âge ; en effet, j'avais à peine sept ans que j'avais déjà choisi ma femme et demandé le consentement paternel.
Il est bon que vous sachiez que j'étais un petit homme très isolé, ayant le tort d'appartenir à cette malheureuse catégorie d'individus qui arrivent dans ce monde en des circonstances où personne ne les désire ni ne les attend. Mon père était un pauvre pasteur des montagnes du New-Hampshire, avec un salaire de six cents dollars, et neuf enfants à élever. Je fus le dixième. On ne m'attendait pas, mon prédécesseur immédiat avait cinq ans et les commères du voisinage avaient déjà félicité ma mère « d'avoir fini son ouvrage à midi, et de pouvoir se reposer le reste de la journée. »
Sa layette bien usée avait toute été donnée, le berceau avait été relégué au grenier, et ma mère eût été inexcusable si elle n'avait pas présidé chaque semaine la réunion de prières, chaque mois l'Association maternelle et la Société des missions, sans compter mille visites pastorales parmi les « vraies veuves de la paroisse. »
Naturellement, personne n'avait jamais songé à voter quelque augmentation de salaire en considération de tous ces devoirs qui absorbaient une si large portion du temps qu'elle aurait voulu consacrer aux soucis de la maison, soucis qu'augmentaient les appointements si limités de mon père. Ces six cents dollars, cependant, étaient considérés par les fermiers de l'endroit comme un revenu princier, et s'ils n'avaient pas regardé mon père comme le meilleur homme du monde, jamais ils n'auraient consenti à lui allouer un chiffre pareil.
Ma mère était une de ces petites femmes douces, tranquilles, qui savent adoucir par leur présence et leurs paroles les sentiers ardus de la vie. Malgré son pas léger, ses mouvements souples comme ceux d'une ombre, son œil et sa main se faisaient sentir partout. Sa maison, vrai miracle d'ordre et de propreté, ses enfants de tous les âges et de toutes les dimensions, les mille et une occupations de tout genre qui accablent une maison où il n'y a pas de domestiques, tout se fondait entre ses mains comme par enchantement.
Elle était quelque peu fée aussi, ma mère, si c'est être fée que d'être journellement en contact avec le surnaturel ; elle avait une toute petite chambre, sa chambre, où, sur un rayon, s'ouvrait la grande Bible de famille, et là, quand l'ouvrage la pressait, que l'écheveau de la vie s'embrouillait plus que d'habitude, que la maladie menaçait l'un de nous, elle se réfugiait et, s'agenouillant près de la Bible, elle s'emparait d'une Main invisible, paternelle et compatissante qui redressait devant elle les voies tortueuses et aplanissait les montagnes.
— Pauvre Mme Henderson, encore un garçon ! dirent les commères le jour où je fis mon entrée dans le monde. Quelle honte, pauvre femme ! Enfin ! grand bien lui fasse !
Mais elle, me serrant contre son sein, pria Dieu de me bénir ; elle regardait comme un trésor tout ce qu'il lui envoyait. — Qui sait, dit-elle affectueusement à mon père, si ce n'est pas là notre perle de grand prix ?
— Amen ! dit mon père en nous embrassant tous les deux, puis il retourna continuer la rédaction d'un traité important destiné à établir la conciliation entre les décrets divins et le libre arbitre de l'homme, et que mon entrée en ce monde l'avait forcé à interrompre pendant quelques heures. Son sermon, à ce que j'appris plus tard, réussit admirablement, et tous ceux qui l'entendirent n'eurent plus désormais le moindre doute sur cette question.
Quant à moi, mes richesses mondaines étaient faciles à compter, et se réduisaient à quelques jupons-de flanelle jaunie, et à quelques bandes taillées dans les vieilles robes de mes sœurs.
Le premier enfant dans une famille en est le poème, c'est une sorte de fête de la nativité ; chacun s'incline devant le jeune étranger, les mains chargées de myrrhe, d'encens et d'aloès. Mais le dixième enfant n'en est plus, hélas ! que la prose et ne reçoit rien au-delà de ce qui lui est légitimement dû ; ni festons, ni dentelles, ni broderies idéales n'ornent le dixième berceau.
En grandissant je me trouvai en quelque sorte isolé dans notre grande maison, où retentissaient les cris et les appels incessants de frères et de sœurs plus âgés que moi et trop occupés de leurs propres projets pour faire attention à moi.
Tout alla bien tant que je ne dépassai pas les limites de la première enfance ; tous répétaient à l'envi que j'étais le plus bel enfant du monde, et aussi longtemps que dura cette qualité je fus gâté et choyé ; mes sœurs couvraient ma tête blonde d'une infinité de petites boucles, me faisaient de merveilleuses petites robes et m'emmenaient avec elles pour me faire admirer. Mais quand je grandis, que mes boucles d'or eurent fait place à mes cheveux plats, et qu'on m'eut installé dans la veste et le pantalon coupés par Miss Abia Ferkin dans la dernière jaquette de mon frère aîné, alors je dus marcher seul dans le monde. L'enfance avait passé, l'adolescence n'avait pas commencé, je n'étais plus qu'un « garçon. »
Mes frères et mes sœurs me témoignaient de l'affection à leur manière, mais pas plus qu'il n'en fallait, et comme je l'ai dit, avaient tous leurs diverses occupations. L'aîné était à l'université, le second marchait bravement sur ses traces ; une de mes sœurs s'était mariée, les deux suivantes étaient de vives et folâtres jeunes filles, pourvues d'une suite d'adorateurs qui tout naturellement prenaient leur temps et leurs pensées ; la dernière avait cinq ans de plus que moi, et me regardait par conséquent comme un petit garçon indigne de sa société. Quand ses deux ou trois amies venaient la voir, il leur fallait s'occuper de leurs poupées et de leurs joujoux, et je les embarrassais toujours ; elles se moquaient de ma gaucherie, critiquaient mon nez, mes cheveux, mes oreilles avec ce sans-gêne féminin au moyen duquel le sexe faible aime tant, lorsqu'il le peut, à rabaisser le plus fort. Je m'arrachais souvent à leur société le cœur plein d'une rage impuissante. — Je ne veux plus m'amuser avec vous, m'écriais-je. — Personne n'a besoin de toi, me répliquaient-elles, il y a longtemps que tu nous ennuies !
Mais comme j'étais un gros et robuste petit garçon, mes aînés jugeaient à propos de me confier toutes les tâches et missions qui pouvaient coopérer à leur bien-être. C'était moi que l'on envoyait près de la fenêtre quand la neige tombait, que le vent soufflait par les moindres fentes, et que frères et sœurs voulaient tous se rapprocher du feu. — Oh ! ce n'est qu'Henri ! il n'a qu'à attendre ! disaient mes sœurs.
Mes occupations, mes intérêts personnels, étaient tout à fait oubliés. J'étais censé avoir l'esprit complètement libre pour répondre aux demandes incessantes de ma bande d'aînés. — Ici, Henri, descends à la cave me chercher des pommes, me disait mon frère à l'instant où je construisais un superbe château de cartes. — Henri, cours à ma chambre chercher le livre que j'ai laissé sur mon lit. — Henri, va ramasser ma balle dans la grange. — Henri, porte ceci au grenier. — Henri, cours chercher cet outil, va prendre cela. — Telles étaient les phrases que j'entendais sans cesse retentir à mes oreilles et qui mettaient à néant mes beaux projets de fermes, de ponts, de moulins, mes petites voitures que traînaient mes chevaux de bois. Quel est donc le chrétien d'âge mûr qui supporterait avec patience les interruptions continuelles qui assaillent journellement un petit garçon de cinq ans ?
Il y avait pour moi de plus amers désappointements. S'il venait à la maison quelque étranger en l'honneur duquel gâteaux et confitures apparussent sur la table, et que la conversation plus animée que de coutume fit battre mon cœur d'aise, j'étais sûr d'entendre dire : — Il n'y a pas besoin de mettre d'assiette pour Henri, il peut bien attendre.
Je puis me rappeler plus d'une privation de mon âge mûr qui me causa moins d'amertume que cette sentence d'exclusion. De même, lorsqu'on attendait Jim Fellows, l'adorateur de ma sœur, et qu'on allumait le feu du salon pour le recevoir, combien je désirais rester debout pour entendre ses histoires ! Je me cachais dans le recoin le plus obscur de la chambre, dans l'espoir d'échapper à la vigilance de la police domestique. Mais, non : — Maman, est-ce qu'Henri ne doit pas s'aller coucher ? criaient toutes mes sœurs, désireuses d'avoir le champ libre pour leurs manœuvres.
Quoi qu'il en soit, je me sentais, non pas dépourvu d'aucune des nécessités matérielles de la vie, mais très isolé dans cette maison si gaie, si animée, si bruyante, où je n'avais pas le moindre compagnon.
— Il me semble que nous devrions envoyer Henri à l'école, dit ma mère à mon père un jour que j'avais versé dans son sein le récit de mes tribulations. Pauvre petit ! il n'a personne avec qui jouer ici !
A l'école donc je fus envoyé, revêtu d'un beau tablier bien propre, et portant dans mon petit panier mon dîner, et une serviette que je devais apprendre à coudre. Je partis tremblant et rougissant tout à la fois à la pensée des grands garçons qui m'avaient promis de me battre, mais dès la première heure j'oubliai toute appréhension : j'avais entrevu ma petite femme-enfant, Susanne Morril
Qu'elle était donc mignonne et jolie ! Je la vis d'abord debout à la porte de la salle d'école ; son cou était blanc comme la cire ; ses yeux étaient bleus et quand elle souriait on apercevait sur ses joues fraîches deux petites fossettes semblables à celles que le soleil trace sur l'eau limpide ; elle portait un fourreau d'indienne rose avec un tablier blanc que sa mère, dont elle était l'unique enfant, avait garni d'une jolie broderie.
— Susanne, lui dit ma mère qui me tenait par la main, voici mon petit garçon que j'amène à l'école et qui va devenir ton camarade.
Comme elle me reçut avec grâce et affabilité, cette petite Ève, toute sourires et encouragements envers le gauche et timide Adam ! Comme elle me fit asseoir près d'elle et passant son petit bras potelé autour de mon cou ; avec quelle câlinerie elle posa son alphabet sur mes genoux en me disant : — Moi, je sais mes lettres, et toi ?
Ma mère avait été mon institutrice, j'avais été un écolier docile, aussi ne fut-ce pas sans orgueil que je répondis à la petite Susanne que je savais déjà épeler ; je vis à l'instant « le respect se mêler à la surprise » dans ses grands yeux violets ; mon âme se dilata et mon petit corps frémit lorsque, se tournant vers ses compagnes, la fillette leur dit : Pensez ! il sait épeler !
Je me sentis grandir dans ma propre estime, deux ou trois enfants me regardèrent avec déférence.
— Ne veux-tu pas t'asseoir de notre côté ? me demanda Susanne ; Mlle Elisabeth te le permettra bien, elle dit que les grands garçons tourmentent toujours les petits. — Et comme elle était la favorite de Mme Elisabeth, elle obtint sans peine de me faire asseoir confortablement à côté d'elle sur le banc dur et sans dossier où je restai à balancer mes jambes, ayant tout à fait l'air d'un petit oiseau sans queue qui vient de sortir de son nid, et qui promène sur le monde ses yeux tout ronds et tout inquiets. Les grands garçons ricanèrent, me firent des grimaces derrière leurs abécédaires, et ce sauvage de Tom Halliday, pour me témoigner son dédain, me lança une boulette de papier mâché qui alla s'aplatir sur le mur au-dessus de ma tête, mais un coup d'œil jeté sur Susanne me rendit courage. Je ne pouvais me lasser de suivre les ondulations de ses boucles d'or, j'admirais sa robe rose et son tablier blanc, ses ravissants petits souliers rouges, ses mains si actives et si adroites ; elle prépara l'ourlet de ma serviette et me le faufila le mieux du monde, puis elle sortit de sa poche sa broderie ; je suivis sa belle aiguille brillante, son fil léger, son doigt orné d'un tout petit dé de cuivre jaune ; à mes yeux ce dé était de l'or, ses mains de vraies perles et elle-même une petite fée, ce qui ne l'empêchait pas de lever souvent ses grands yeux bleus en souriant et en secouant la tête d'un air approbateur comme pour m'encourager, et je sentais courir au-dedans de moi un frisson de plaisir qui faisait battre mon cœur sous mon tablier à carreaux bleus.
— S'il vous plaît, mademoiselle, demanda-t-elle, Henri ne peut-il pas venir s'amuser avec nous ? les grands garçons sont si méchants !
Mlle Elisabeth sourit, et à partir de ce moment je fus le plus heureux des mortels. Susanne m'apprit tous les amusements de son âge, dans lesquels elle était passée maîtresse et où j'étais des plus novices.
Mais quand des jeux plus virils suivirent je pris ma place avec honneur ; je me couvris de gloire en escaladant une balustrade de cinq pieds de haut et en m'élançant à terre de cette hauteur vertigineuse ; une vache s'étant permis d'apparaître sur la pelouse de l'école, je marchai droit à elle avec un bâton et lui intimai si bravement l'ordre de partir sur-le-champ qu'elle s'empressa d'obéir. Ces actes de courage inspirèrent à Susanne un certain degré de confiance en moi ; je savais « épeler, » sauter les balustrades, et je n'avais pas peur des vaches, décidément j'étais un homme accompli !
L'école était si loin de la maison que j'y restais pour le dîner ; Susanne y apportait aussi le sien, et nous fîmes ensemble plus d'un repas délicieux. Nous avions établi notre tente sous un grand marronnier au pied duquel l'herbe était courte et verte. Notre domaine formait un square dont les limites étaient tracées par de gros blocs détachés du mur que nous rangeâmes symétriquement ; une large pierre plate, dont le transport faillit me casser le dos, représentait la table ; un mouchoir de poche servait de nappe et Susanne utilisait les grandes feuilles des arbres en guise de plats et d'assiettes. Sous sa direction, je construisis un office et une petite chambre où nous étions censés laver notre vaisselle et soigner les reliefs de nos repas. Le dit office était un trou en pierre où nous cachions nos pommes, nos noix, et nos gâteaux, quand il nous en restait. Nous ornâmes notre salon de bouquets de branches d'or et de fleurs bleues, et nous décidâmes de n'y recevoir qu'une société choisie. Susanne installa sa poupée dans cette maisonnette ; nous la déposions soigneusement sur un petit lit d'herbes fraîches, tout tremblants à l'idée que les méchants écoliers pourraient venir dévaster notre Eden ; mais les petites filles avaient leur récréation en premier lieu ; quand on nous rappelait, Susanne enveloppait sa favorite dans une serviette et la déposait avec précaution dans le coin de son pupitre, pendant que les grands garçons criaient et gambadaient au dehors, sautant et hurlant comme de vrais démons.
— Comme c'est heureux qu'Henri aille à l'école toute la journée, entendis-je une de mes sœurs dire à l'autre ; il était toujours sur notre route à se mêler de tout. — Oui, et il écoutait tout ce qu'on disait ; les enfants ont des oreilles partout.
— Je crois que le pauvre petit est plus heureux maintenant, dit ma mère, il a quelqu'un avec qui s'amuser.
C'était là le fin mot de l'énigme.
Le samedi après-midi je demandais régulièrement la permission d'aller voir Susanne, et mes sœurs enchantées brossaient mes cheveux, me mettaient un tablier propre, bien raide et bien empesé et m'envoyaient trottinant comme le plus heureux des amoureux.
Combien la vie me souriait en ces jours, alors que les rayons du soleil passant à travers les fentes des balustrades dansaient en bandes d'or sur le tapis d'herbe touffue, que les arbres s'inclinaient en murmurant et que j'ornais de fleurs notre maisonnette sous le grand marronnier. Nous nous amusions ensuite dans la grange. Nous cherchions les œufs des poules, et je plongeais sous le foin dans les recoins ténébreux où elle n'osait s'aventurer ; je grimpais au sommet des hautes meules de foin où elle avait peur de me voir, et je rapportais des provisions d'œufs qu'elle recevait dans son petit tablier blanc.
Sa toilette toujours fraîche et soignée excitait ma constante admiration ; je portais des vestes lourdes et raides et des tabliers de toile et, à ce que répétaient mes sœurs, mes coudes et mes genoux étaient invariablement ornés de trous qu'elles étaient fort peu satisfaites de raccommoder, mais jamais je ne pouvais découvrir de taches sur la robe et les mains de la petite Susanne ; ses boucles d'or semblaient toujours sortir de dessous la brosse, et lors même qu'elle sautait et courait avec moi dans la grange, dans l'herbe humide et autres endroits plus ou moins compromettants, elle n'en avait pas moins toujours l'air d'une rose.
Mais tandis que je l'admirais ainsi, elle, de son côté, s'extasiait sur mon courage et mes prouesses ; pour la défendre je sentais en moi l'étoffe d'un vrai paladin. Je me rappelle que le poulailler, que nous traversions pour aller à la grange, était tyrannisé par un vieux dindon au bec renfrogné qui caquetait et enflait son cou en piaillant, à la grande terreur de Susanne ; elle me raconta qu'elle avait essayé à plusieurs reprises de traverser seule la cour, mais que le méchant volatile s'était élancé vers elle en battant des ailes, et même une fois l'avait jetée par terre ! La première fois qu'il voulut m'en faire autant je marchai droit à lui et, grâce à un détour, je réussis à emprisonner son bec d'une main, et, lui serrant fortement les ailes sous mon bras, je le portai honteusement hors de la cour.
Susanne était radieuse ; je lui racontai tout ce que je ferais pour la protéger ; elle m'avait avoué qu'elle avait une peur mortelle des « ours ; » j'en profitai pour lui dire que, dans le cas d'une attaque à l'heure présente, j'irais immédiatement chercher le fusil de mon père et que je tuerais l'ours sans miséricorde ; elle me crut de confiance. Je m'étendis à loisir sur ma manière de faire fuir les voleurs qui tenteraient de dévaliser notre maison : j'irais tout de suite chercher des poignées de charbons rouges que je leur laisserais tomber sur le dos, ce qui les obligerait bien à s'enfuir ! Ce qu'étaient des ours et des voleurs nous n'en avions pas une idée très précise, mais c'était une satisfaction de penser que j'étais prêt à leur faire face en toutes circonstances.
Quelquefois, le samedi après-midi, Susanne venait à la maison ; j'allais solliciter humblement cette faveur auprès de sa mère qui, après l'avoir lavée, peignée, habillée de pied en cap, me la confiait en lui recommandant de repartir une demi-heure avant le coucher du soleil. Susanne observait consciencieusement l'ordre maternel, mais pour moi je n'étais jamais d'accord avec elle, et j'étais toujours persuadé qu'elle partait une heure trop tôt. Mes sœurs la caressaient beaucoup lors de ses visites, elles roulaient ses longues boucles autour de leurs doigts et essayaient l'effet de différents objets de toilette sur son teint rose et frais ; elles lui demandaient en riant si elle voulait être ma petite femme, question à laquelle Susanne répondait gravement oui.
Oui ; elle devait être ma femme, c'était chose convenue entre nous. Mais quand ? je ne voyais pas pourquoi nous serions forcés d'attendre que nous fussions grands ; j'étais isolé loin d'elle, elle l'était loin de moi, pourquoi ne l'épouserais-je pas à présent et pourquoi ne l'emmènerais-je pas à la maison avec moi ? Je lui demandai ce qu'elle en pensait, elle me dit qu'elle ne demandait pas mieux, mais que sa maman ne pourrait pas se passer d'elle ; je lui dis alors que ma maman irait la chercher et que la sienne ne pourrait pas refuser puisque mon papa était le ministre de la paroisse.
Je tournai l'affaire en tous sens dans ma tête en cherchant l'occasion de voir ma mère seule pour lui présenter ma requête ; un soir, assis à ses pieds sur mon petit tabouret, tout en regardant flamber un beau feu d'automne, je crus le moment favorable et commençai :
— Maman, pourquoi est-ce que les enfants ne se marient pas ?
— Les enfants ! répéta ma mère en arrêtant son tricotage et en me regardant, tandis qu'un sourire errait sur ses lèvres ; à quoi Henri pense-t-il donc ?
— Maman, pourquoi est-ce que Susanne et moi nous ne pouvons pas nous marier ? je m'ennuie tout seul, et si elle était ici nous serions ensemble toute la journée.
Mon père, qui méditait son sermon du dimanche suivant, leva la tête et regarda ma mère qui riait de tout son cœur.
— Mais, mon enfant, dit-elle, ne sais-tu pas que ton papa est pauvre, et qu'il a bien du mal à élever tous ses enfants ? il n'a pas le moyen de se donner encore une petite fille.
L'argument était sans réplique ; la difficulté pécuniaire, qui sépare tant d'amoureux, m'accablait au début de la vie.
— Maman, dis-je après une longue minute de réflexion, je te promets de manger la moitié moins qu'aujourd'hui et de ne plus salir mes habits pour les faire durer bien longtemps.
Ma mère avait de beaux yeux brillants où l'on distinguait en ce moment les larmes à travers le rire, elle me prit sur ses genoux et appuya ma tête contre son sein.
— Un jour, quand mon petit garçon sera un homme, Dieu lui donnera une femme qu'il aimera de tout son cœur ; les maisons et les richesses viennent des parents, mais une femme bonne est un don du Seigneur.
— C'est vrai, ma chère, dit mon père en la regardant avec tendresse, personne ne le sait mieux que moi.
Ma mère me berça doucement dans ses bras tandis que les ombres du soir s'allongeaient, et tout en me caressant m'assura que lorsque je serais devenu, suivant son désir, un bon et digne ministre comme mon père, j'aurais une jolie petite maison à moi.
— Et est-ce que Susanne y sera ?
— Il faut l'espérer, dit ma mère ; qui peut savoir ?
— Mais, maman, est-ce que tu n'en es pas très sûre ?
— Mon enfant, notre Père céleste connaît seul l'avenir ; aujourd'hui ce que tu as de mieux à faire, c'est de te hâter d'apprendre, afin de devenir un homme instruit et de pouvoir prendre soin d'une petite femme.
Les paroles de ma mère éveillèrent mon enthousiasme : j'avais un but devant moi. J'allai me coucher pour mieux réfléchir à tous les moyens de grandir promptement. Je me rappelais l'histoire de Samson ; comment s'y était-il pris pour devenir si fort ? il avait été sans doute un jour aussi petit que moi. Allait-il garder les vaches ? me demandais-je ; essayait-il de soulever des poids trop lourds pour ses petites mains ? ou bien montait-il à nu le vieux cheval de son père quand ses jambes étaient de la longueur des miennes ? Tout cela je le ferai, oui, je porterai tous les jours de grands seaux d'eau, je monterai tout en haut de la grange et je jetterai de gros tas de foin par terre, et autres expédients semblables.
Ma conversation matrimoniale avait eu lieu un vendredi, le lendemain je reçus la permission d'aller voir Susanne.
Il y avait derrière la maison de sa mère une prairie qui servait à nos jeux ; elle était couverte de marguerites, de boutons d'or et d'herbes odorantes, mais ce qui nous y attirait le plus, c'était l'espoir d'y trouver, bien cachés dans l'herbe touffue, des bouquets de fraises sauvages, ces belles fraises rouges, parfumées, haut perchées sur leur tige, trois ou quatre à la fois. Quelle fête qu'une après-midi tout entière passée dans cette prairie en compagnie de Susanne ! en ce temps-là mon bonheur dépassait grandement celui que j'éprouve aujourd'hui à la perspective d'un voyage de trois semaines.
Quand, après mille précautions et recommandations, sa mère se décidait enfin à me la confier, quand nous avions tourné le dos à la maison, et que nous étions hors de portée, alors notre félicité était complète. Avec quel soin jaloux je l'aidais à franchir le vieux mur moussu tout bordé de framboisiers, de fougères et de branches de lierre qui fermait notre empire ! De ce bosquet épais et épineux nous descendions dans un autre monde : la prairie émaillée de fleurs nous recevait dans son sein maternel. Nous nous cachions dans l'herbe comme de petits oiseaux, et au-dessus de nos têtes les marguerites blanches et les bluets se penchaient avec de grands airs mélancoliques, et quel plaisir de penser que personne ne pouvait nous voir ! Deux linottes dont le nid était caché dans les environs montaient la garde sur un vieux pommier, et perchées sur un rameau flexible disaient : chack, chack, chack ! en agitant leurs ailes blanches et noires, et se laissaient entraîner à des roulades mélodieuses et compliquées ; c'étaient là nos seuls témoins ; nous étions persuadés qu'ils nous connaissaient, nous aimaient et ne se laisseraient jamais aller à trahir notre retraite.
Nous avions tous les deux des secrets en profusion. Personne que nous ne savait les « bons coins » où croissaient les belles fraises écarlates ; les grands garçons ne s'en doutaient pas plus que les grandes filles ; avec quelle ardeur nous les cherchions, et les oh ! les ah ! quand une place merveilleuse s'offrait à nous !
Ce n'était pas tout. Nous avions découvert un nid de pinsons caché sous un rosier sauvage. En vain la pauvre mère s'en éloignait, puis voletait précipitamment ailleurs pour nous donner le change, nous ne nous laissions pas tromper ; nos mains curieuses séparaient le léger voile de fougères, et avec mille exclamations étouffées nous comptions les œufs tachetés, pointillés, d'un bleu verdâtre ! qu'ils étaient ronds, frais et artistiquement taillés ! et quel mystère que le nid douillet qui les abritait ! — Chers petits oiseaux, disions-nous, n'ayez donc pas peur ! nous ne le dirons à personne. — Puis nous nous promettions de n'en jamais souffler mot ni à Tom Halliday, ni à Jim Fellows, et nous nous sentions tellement surchargés par ce secret que c'était tout ce que nous pouvions faire durant toute la semaine que d'éviter d'en parler à tout le monde. Nous informions tous les enfants de l'école que nous savions quelque chose qu'ils ne savaient pas ! quelque chose que nous ne dirions jamais ! quelque chose de si drôle qu'on nous avait défendu de répéter ; car il faut remarquer que, comme de braves enfants, nous avions mis nos deux mamans dans notre confidence et que nous en avions reçu la recommandation de garder le secret.
Dans notre prairie croissaient les grands lis d'or dont les clochettes serrées les unes contre les autres se balançaient sur leur tige élancée comme les cloches des tourelles d'un pays enchanté ; nous les voyions au-dessus de nos têtes parmi les marguerites, les bluets et les rouges coquelicots, et nous regardions avec une admiration profonde leurs jolis cœurs d'or tachetés de velours noir.
— Oh ! ne les cueille pas, je t'en prie ! me dit Susanne un jour que j'étendais la main pour en prendre un. Nous laissâmes donc vivre les plus grands, mais nous cueillions sans remords les tout petits qui venaient augmenter notre moisson de fraises et de fleurs.
A travers la prairie courait un ruisseau qui gazouillait et chantait en roulant sur des cailloux aux mille couleurs, et qui de temps à autre se changeait en une cascade lorsque son onde argentine rencontrait quelque gros bloc impertinent. Pour nous, les chutes de ce petit ruisseau égalaient les cataractes de Trenton ou toute autre qui attire la foule ; c'était notre ruisseau, notre cascade ; c'était nous qui les avions découverts, et nous avions l'intime conviction que personne d'autre ne les avait jamais vus.
Ce fut près de notre cascade, qui pouvait bien mesurer un pied et demi de haut, que nous nous assîmes pour arranger nos fleurs et nos fraises le jour où je fis part à Susanne de ce qu'avait dit ma mère. Je la vois encore, ce petit brin de femme, riant de tout son cœur. — Cela lui était bien égal, disait-elle, elle aimait tout autant attendre que je fusse un homme, et puis, nous pouvions toujours aller à l'école ensemble et nous amuser le samedi après-midi. — N'y pense plus, Hazzy Dazzy, me dit-elle en se rapprochant de moi et en passant affectueusement son petit bras autour de mon cou, nous nous aimerons toujours autant et tout est si joli autour de nous.
Je voudrais savoir pourquoi l'un des premiers mouvements de l'affection nous porte à changer le nom de la personne aimée. Donnez un nom à un enfant ; quelque court et musical qu'il soit, quelle est la mère qui ne trouvera pas moyen de lui faire subir quelque variante ? Aussi Susanne, quand elle était bien disposée, m'appelait-elle Hazzy, et parfois Hazzy Dazzy ; nous en riions tous les deux en nous demandant ce que diraient les étrangers s'ils nous entendaient, et s'ils devineraient de qui elle voulait parler. A mon tour, je l'appelais Pâquerette quand nous étions seuls, parce qu'elle me paraissait aussi mignonne et fraîche qu'une fleur des champs, et qu'elle portait le dimanche un petit chapeau plat tout à fait semblable à une marguerite.
— Ecoute, lui dis-je, je vais devenir aussi fort que Samson.
— Oh ! mais comment feras-tu ? demanda-t-elle d'un air de doute.
— Je vais courir, sauter, grimper toute la journée ; je porterai l'eau pour maman, j'irai à cheval jusqu'au moulin, je ferai toutes les commissions, et je deviendrai bien vite un homme, et quand je serai grand je construirai une maison tout exprès pour toi et pour moi ; je la ferai moi-même, elle aura un salon, une salle à manger, une cuisine, une chambre à coucher…
— Et des armoires pour soigner nos affaires, suggéra la petite ménagère.
— Certainement, autant que tu en voudras, accordai-je généreusement, et puis nous demeurerons ensemble, je prendrai soin de toi, je chasserai bien loin les lions, les ours et les voleurs ; si l'un d'eux venait contre toi, Pâquerette, je le déchirerais en deux comme Samson, tu verrais !
A cette description, Pâquerette se cacha la tête sur mon épaule en assurant que j'étais très courageux ; et les linottes gazouillèrent en sautillant dans les branches, et peu à peu, quand le soleil, semblable à une énorme boule d'or, descendit à l'horizon, nous reprîmes en trottinant le chemin de la maison, nos mains chargées de lis et nos paniers pleins de fraises.
Je me souviens encore de plus d'une joyeuse après-midi de cet été, le plus beau de ma vie. Quand vint l'automne, nous errâmes dans les bois en faisant une ample moisson de châtaignes et de noix. Quel plaisir pour nous de soulever les feuilles mortes et de les faire retomber en pluie d'or autour de nous ! Avec quelle habileté je découvrais les meilleurs noyers, et comme j'étais fier d'y grimper comme un chat, et, à cheval sur les plus hautes branches, de secouer les noix vertes qui tombaient lourdement à terre et que Susanne, au pied de l'arbre, ramassait activement. Comme elle savait encourager mes prouesses ! Tom Halliday avait beau être plus grand, il ne savait pas monter aussi vite que moi sur les arbres, et quant à ce méchant Jim Fellows, elle aimerait voir la mine qu'il ferait au bout d'une de ces branches qui ne manquerait pas de se casser et de l'envoyer par terre. Le tableau qu'en traçait Susanne nous faisait souvent rire aux larmes. Aujourd'hui encore, je regarde comme une faiblesse de mon sexe le plaisir intime que nous éprouvons quand celle que nous aimons plaisante sur le compte des autres jeunes gens ; nous l'encourageons à égratigner de son mieux la personne révérée de Tom et de Jim et nous trouvons qu'elle s'y prend de la manière la plus divertissante ; il est entendu entre nous qu'elle n'y met aucune malice, que Jim et Tom sont de bons garçons, seulement qu'il y a quelqu'un qui leur est bien supérieur, etc., etc.
Susanne et moi, nous nous félicitions de notre prévoyante cueillette d'automne ; aucun couple d'écureuils n'aurait mieux fait ses affaires ; j'avais creusé moi-même une cave dans laquelle nous serrions nos provisions de noix, de noisettes et de châtaignes qui devaient nous durer tout l'hiver, et dont l'arrangement nous prit bien des heures.
Et la joie que causait l'arrivée des tonneaux de cidre nouveau dans la maison paternelle ! Avec quel soin je coupais et préparais des liens de paille qu'à l'école je montrais en cachette à Susanne pour qu'elle vît d'avance les plaisirs que nous promettait le samedi après-midi. Elle nous arrivait ce jour-là en souliers de cuir et en tablier de toile, afin de pouvoir sans crainte descendre à la cave ; et là, juchés chacun sur un gros bloc de bois des deux côtés d'un tonneau de cidre, nous plongions nos chalumeaux dans la bonde défoncée et nous aspirions avec délices la mousse enivrante. Plus d'une fois mes vêtements se ressentirent de mon zèle ; Susanne alors se moquait de moi et essuyait mon tablier d'un geste maternel : — Comment fais-tu pour te salir ainsi, Henri ? disait-elle. — Comment fais-tu pour rester toujours aussi propre ? répliquais-je, et elle de rire en m'appelant son cher sale petit Henri. Elle plaisantait souvent à mes dépens, la petite fée, mais dès qu'elle voyait le sang me monter aux joues, elle s'arrêtait et les plaisanteries cédaient le pas aux éloges, ainsi qu'il convient à une véritable fille d'Ève.
Elle prenait aussi des airs de supériorité morale et me faisait parfois les plus jolis sermons du monde. Comme elle était fille unique, on lui montrait sans cesse les voies les plus droites où peuvent marcher de petits pieds, et sa conscience était aussi blanche que sa robe. J'étais vif et ardent, et sous l'empire de la colère je me laissais aller aussi près des jurons qu'il est permis à un fils de ministre. Quand les grands garçons ravageaient notre maisonnette ou nous lançaient des pierres, je me laissais entraîner aux dernières limites et je leur, criais : « … vous emporte ! allez-vous en au… ! » avec une vigueur qui faisait ressembler ma phrase à quelque chose de beaucoup plus violent. Dans ces moments-là Susanne pâlissait, et quand la raison reprenait chez moi le dessus, elle me grondait bravement et me ramenait dans les sentiers de la vertu ; elle me répétait les enseignements de sa mère que j'écoutais avec un respect sincère.
Elle était surtout stricte observatrice du dimanche et comme sur ce point-là, chez les enfants, la chair est faible, elle m'exhortait rigoureusement.
J'observais ses recommandations en pensant que je la verrais à l'église, et je prenais grand soin de mes habits du dimanche au divertissement de mes sœurs, qui se lançaient des coups d'œil d'intelligence. A l'église nous occupions deux grands bancs tout rapprochés l'un de l'autre ; mon plaisir consistait à regarder de ma place Susanne tout en blanc, son petit chapeau couvert de rubans bleus et ses deux jolis souliers dépassant le bord de sa robe.
Elle m'avait dit que les petites filles ne doivent jamais s'occuper de leur toilette, aussi je m'efforçais de croire qu'elle était entièrement absorbée par le culte, et qu'elle ne se doutait pas de la fixité avec laquelle j'épiais chacun de ses mouvements.
La nature humaine, chez les petits comme chez les grands saints, n'atteint jamais à la perfection absolue ; aussi je remarquais que parfois, sans doute par accident, ses grands yeux bleus rencontraient les miens et qu'un sourire qui ressemblait à s'y méprendre à un fou-rire s'étouffait à grand'peine. Elle se remettait, il est vrai, et regardait gravement le ministre dont, avec la meilleure volonté du monde, elle ne pouvait comprendre un seul mot, mais peu à peu les paupières se fermaient comme la pimprenelle bleue à l'approche de l'orage, la tête allait deçà delà jusqu'à ce qu'enfin la maman prît pitié de la petite et, lui mettant les pieds sur le banc, la laissât dormir jusqu'à la fin du sermon.
Quand vint l'hiver je tourmentai mon frère aîné pour qu'il me fit une « luge. » Les traîneaux comme en possèdent tous les enfants des grandes villes étaient choses inconnues dans nos montagnes, le mien sortait d'une manufacture très primitive.
Mon frère me demanda en riant si mon traîneau devait aussi servir à Susanne, et sur ma réponse affirmative il le peignit magnifiquement de rouge et de bleu. Mon âme frémit au-dedans de moi quand je partis avec ce splendide attelage pour aller chercher Susanne.
Quel est donc le jeune homme qui ne sent pas son cœur palpiter lorsqu'il conduit pour la première fois sa voiture sous les yeux de la beauté qu'il veut se rendre favorable ? Grande fut ma joie quand je m'arrêtai à la porte de Susanne et que je lui dis de se dépêcher de mettre son chapeau, que j'allais la conduire à l'école en traîneau.
Quel charmant tableau elle offrait avec son petit capuchon de tricot bleu, ses mitaines rouges, ses boucles soulevées par le vent et ses joues colorées par l'air vif. Une colline rapide nous séparait de l'école ; assis derrière elle, je la franchis dans toute ma gloire. Ce fut un hiver de rudes montées, de joues rouges, de nez violets et de pieds gelés, mais que nous importait ? Susanne, sous l'œil vigilant de sa mère, me tricota une paire de mitaines qui me réchauffèrent tout à la fois le cœur et les mains ; et moi de mon côté j'empilai le bois, je portai l'eau et, grâce à ma scrupuleuse économie, je réussis à gagner assez d'argent pour lui acheter un beau cœur en sucre candi, gros comme mes deux poings, où l'on voyait d'un côté deux colombes reliées par un ruban bleu, de l'autre deux cœurs enflammés transpercés par la même flèche. Jamais œuvre d'art ne me causa pareils transports ! Susanne lui donna la place d'honneur dans la maison de sa poupée et bien qu'il fût des plus doux, — comme le prouvaient certains bords par trop dentelés, — cependant le sentiment artistique étant au-dessus des attractions de la gourmandise, le cœur de sucre candi fut condamné à ne réjouir que les yeux.
La mère de Susanne était une intime amie de la mienne, et la brebis la plus docile et la plus confiante du troupeau de mon père. Elle regardait la famille du ministre et tous ceux qui s'y rattachaient avec un respect profond. Ma mère lui avait raconté ma demande en mariage et les deux matrones en avaient ri ensemble, puis soupiré en disant : — Qui sait ? on a vu des choses plus extraordinaires.
La mère de Susanne répétait qu'elle avait connu son mari lorsqu'il était encore petit garçon ; pourquoi la chose ne se reproduirait-elle pas ? Puis toutes les deux en revenaient à dire que les choses de ce monde sont bien incertaines et que nous ne savons jamais ce que nous apportera le lendemain.
Notre idylle, il faut l'avouer, était encouragée par mes frères et mes sœurs, qui faisaient de Susanne leur jouet favori, et se divertissaient fort de la gravité avec laquelle nous nous consacrions l'un à l'autre.
Oh ! mes beaux jours d'ignorance ! mon Eden enfantin ! pourquoi ne devait-il pas durer ? …
Mais il devait bientôt finir ; il s'en allait avec le chant des chardonnerets, avec les lys d'or, avec la verdure et les marguerites ; les anges du ciel aimaient trop ma pauvre Pâquerette pour la laisser grandir dans ce monde insensible et brutal.
L'hiver passa, le printemps revint, Susanne et moi nous entendîmes ensemble le chant du premier pinson ; nous cueillîmes ensemble les premières violettes blanches et bleues et l'école nous revit tous les deux jusqu'aux chaleurs d'été. A cette époque, une épidémie éclata dans nos montagnes, les villages voisins en furent atteints, et le doigt de l'invisible faucheur s'appesantit sur ma pauvre Pâquerette.
Je me rappelle si bien notre dernière après-midi dans la prairie où nous avions cueilli l'an dernier les fleurs et les fraises ! nous y étions descendus gaiement et nous les avions ramassées en babillant joyeusement quand Susanne commença à se plaindre d'avoir mal à la tête et à la gorge ; je la fis asseoir près du ruisseau, et après avoir rafraîchi son front, je l'engageai à me laisser achever seul notre moisson. Mais bientôt elle m'appela en gémissant. — Oh ! Hazzy, je veux m'en aller, dit-elle, emmène-moi vers maman ! — Je me hâtai d'aller à son secours, mais elle pleurait tant que je finis par faire comme elle et ce fut en sanglotant tous les deux que nous arrivâmes à la porte de sa maison.
Quand sa mère nous ouvrit, la petite s'efforça de retenir ses larmes et, jetant ses deux bras autour de mon cou, elle m'embrassa. — Ne pleure pas, Hazzy, me dit-elle, nous nous reverrons bientôt !
Sa mère la prit dans ses bras et l'emporta, et je ne revis plus jamais ma petite femme-enfant ! Là où croissaient les marguerites et les boutons d'or, où les lis d'argent secouaient leurs clochettes, où chantaient les fauvettes, dans la salle d'école aux cent voix bruyantes, sur le vieux banc de l'église, jamais, jamais je ne revis la petite fée aux grands yeux violets, aux boucles d'or !
Le dernier baiser de ma Pâquerette et la fièvre qui l'avait atteinte faillirent m'emmener avec elle. Je me souviens que je revins à la maison en pleurant, que je me détournai avec dégoût de mon souper et que je montai me coucher en me traînant, le corps tout à la fois brûlant et glacé, et mes tempes battant avec force. Le matin suivant, le docteur déclara que j'étais attaqué de l'épidémie dont souffraient tous les enfants du voisinage : la fièvre scarlatine.
Je me rappelle encore vaguement que pendant bien des jours ma tête brûlait, que j'avais chaud et soif et que l'on me refusait impitoyablement un verre d'eau fraîche, suivant les bonnes vieilles règles de la médecine de ces temps ; je croyais entrevoir comme à travers un brouillard plusieurs personnes assises la nuit près de mon lit, et mettant d'interminables drogues dans ma bouche obéissante. Les jours passaient lentement, je restais couché, ne pensant à rien et regardant les rayons du soleil et le reflet de la danse des feuilles sur la muraille.
Une après-midi, je m'en souviens encore ! j'entendis la cloche du village sonner lentement six coups ; les sons vibraient et tremblaient dans l'air avec de longs et solennels intervalles ; c'était le nombre des années que ma Pâquerette avait passées sur la terre, c'était l'annonce de son départ pour un monde où il n'y a plus ni jour ni nuit !
Quand je commençai à me rétablir, ma mère me dit que ma petite Susanne était au ciel ; en l'écoutant je me sentis envahir par un frisson glacial, mais je ne pleurai pas. En me rappelant aujourd'hui ce qu'éprouvait alors mon pauvre petit cœur, je crois ressentir encore ces paroxysmes de douleur muette qui ne me prenaient que lorsque j'étais seul.
J'entendais un jour mes sœurs dire que la mort de Susanne ne m'avait guère impressionné.
— Oh ! les enfants sont comme les animaux, ils oublient ce qu'ils ne voient pas !
Mais je n'oubliais pas, moi ; je n'allais plus dans la prairie où nous avions cueilli des fraises, sous les arbres où nous avions ramassé des noix, et parfois, subitement, à l'école ou dans nos jeux, le souvenir désolant d'un passé que je ne devais jamais revoir s'emparait de moi comme une souffrance physique.
Quand les enfants grandissent au milieu de personnes qui les mettent de côté pour s'occuper de leurs propres intérêts, il existe toujours en eux une dose extrême de gaucherie et de timidité qui les empêche d'exprimer leurs sentiments intérieurs qui n'en deviennent que plus vifs et plus profonds. Mais le langage de l'enfant est imparfait ; son bagage littéraire ne comprend guère que les noms et les qualités physiques des objets qui l'entourent, il n'en a pas pour peindre ses émotions.
Ce que je ressentais en pensant à ma petite compagne c'était une douleur amère, étourdissante, angoissante. Les enfants peuvent éprouver cette sensation aussi vivement que les grandes personnes, mais l'homme lui-même n'a point de termes pour la définir.
Ma mère seule, avec ce divin instinct des mères, me devinait. — Qui sait, disait-elle à mon père, si cette mort ne sera pas pour lui un avertissement d'En-Haut ?
Elle s'assit un soir sur le bord de mon lit et me parla longuement des splendeurs du ciel en me disant qu'aujourd'hui la petite Susanne était un bel ange vêtu de blanc.
Je me laissai aller à un déluge de larmes : — Je la veux ici ! répétais-je, je veux qu'elle revienne !
Ma mère recommença toutes ses explications, mais je sanglotais toujours, la tête sous mes couvertures :
— Je ne peux pas la voir ! oh ! maman, maman ; je veux qu'elle vienne ici !
Cette nuit-là, je fis un beau rêve.
Il me sembla que j'étais dans notre prairie tout émaillée de fleurs ; le soleil brillait, le ciel était bleu et nos grands lis s'inclinaient mollement, mais j'étais seul au milieu de ces richesses quand tout à coup ma petite Susanne vint au-devant de moi avec sa robe rose et son tablier blanc, ses boucles d'or éparses autour de son cou.
— Oh ! Pâquerette, Pâquerette ! m'écriai-je en courant au-devant d'elle, es-tu bien vivante ? on m'avait dit que tu étais morte.
— Non, Hazzy, je ne suis pas morte, ne va pas le croire, — et je sentis ses deux petits bras autour de mon cou ; — ne t'avais-je pas dit que nous nous reverrions ?
— Mais on m'assurait que tu étais morte ! répétais-je étonné en la regardant ; elle riait comme elle en avait l'habitude, mais ses doux yeux avaient une expression mystérieuse qui me faisait frissonner.
— Je ne suis pas morte, Hazzy, on ne meurt pas là où je suis, je t'aimerai toujours ; — et à ce moment-là mon rêve trembla et devint nuageux comme lorsque la brise frôlant l'eau limpide disperse en mille fragments l'image qu'elle reflétait. Je crus distinguer encore une harmonie céleste, deux bras qui m'entouraient, et je m'éveillai avec le sentiment que quelqu'un m'aimait, me plaignait et me consolait.
Je ne puis exprimer l'impression de réalité que ce rêve me laissa ; il réchauffa ma vie entière, il rendit à mon pauvre petit cœur un peu de ce qui en avait été arraché. Peut-être n'est-il pas un lecteur qui n'ait fait par lui-même l'expérience du pouvoir qu'un rêve exerce sur les heures de veille, et il ne paraîtra pas extraordinaire que désormais, au lieu d'éviter la prairie où nous avions joué ensemble, j'éprouvasse un véritable soulagement à m'y aller promener tout seul, cueillant des fraises, observant les nids des oiseaux, ou me couchant dans l'herbe pour regarder le ciel bleu à travers un voile de marguerites blanches, me répétant que je n'étais pas seul, que Susanne était avec moi.
N'en est-il peut-être pas ainsi ? Les verts pâturages et les eaux paisibles du monde invisible ne peuvent-ils pas s'étendre le long de cette vie agitée, et ceux qui nous connaissent mieux que nous ne les connaissons ne peuvent-ils traverser quelquefois le ruisseau que nous appelons la Mort pour venir nous consoler ?
Pourquoi donc sont-ils faits ces doux anges dont la venue nous apporte tant de joie, et dont le départ nous plonge dans la tristesse et le deuil ? Si nous croyons à l'amour divin, pourquoi ne pas croire aussi qu'ils ont envers nos âmes souffrantes une mission spéciale ? L'amour que nous avons pour eux est le plus sacré que l'âme puisse ressentir, et qui sait si ceux qui nous quittent pour le Monde de Lumière ne déroulent pas en s'éloignant une chaîne invisible par laquelle ils nous attirent à eux ?
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: