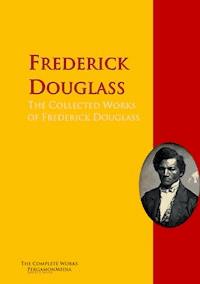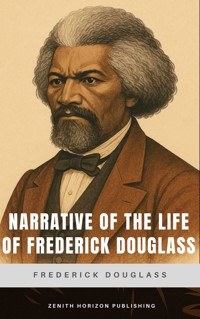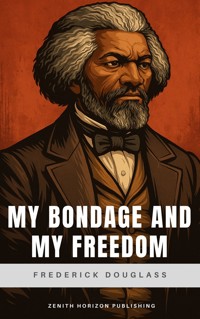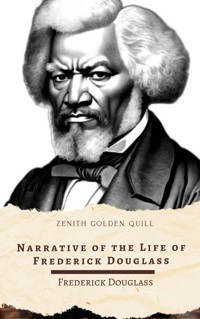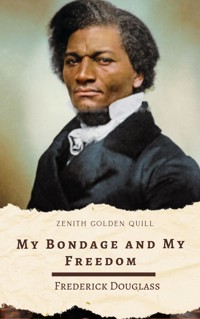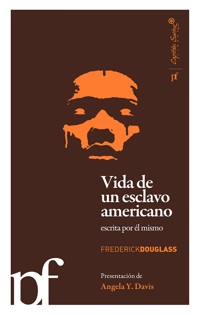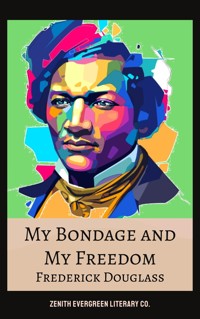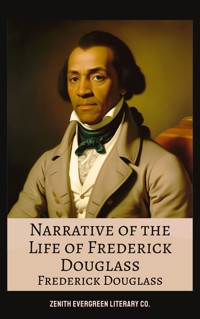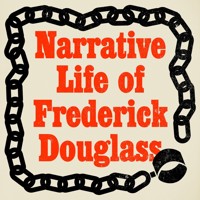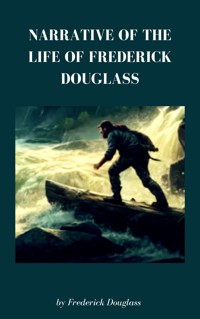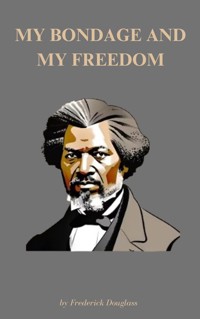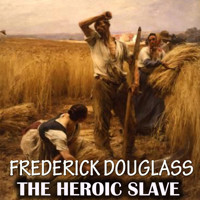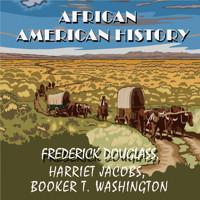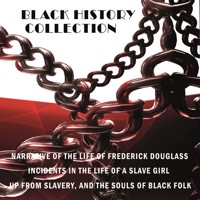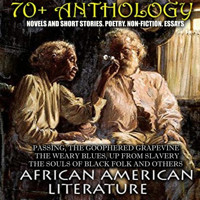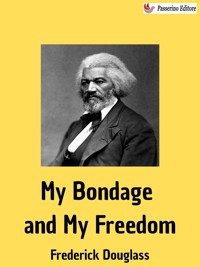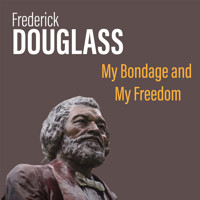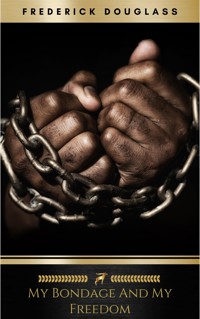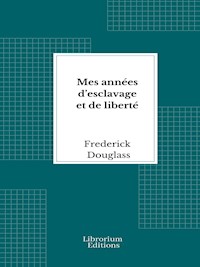
1,59 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Prenez une carte d’Amérique, États-Unis. Cherchez l’État de Maryland ; vous trouverez, près d’Easton, comté de Talbot, un petit district maigrement peuplé, lequel n’a de remarquable que l’aridité de son sol, la dégradation de ses fermes, la ruine de ses clôtures, la noblesse de ses habitants, leur indigence, et la fièvre à perpétuité.
C’est là, dans ce plat territoire bordé par le Choptank, la plus paresseuse comme la plus fangeuse des rivières ; entouré d’une population blanche toujours oisive et constamment ivre ; au milieu de nègres esclaves en parfaite harmonie avec ce bas niveau ; c’est là que, sans qu’il y eût de ma faute, je vis le jour.
De ma famille je n’ai rien, ou presque rien à dire. L’arbre généalogique ne pousse pas sur terre esclave.
Un père ! la chose, pour l’esclave, n’existe ni dans l’ordre des faits, ni dans celui des lois. Mon âge ! difficile à fixer. Je n’ai jamais rencontré un esclave qui pût me dire le sien. Toute recherche, toute question sur ce sujet, était regardée par les maîtres comme une indiscrète curiosité. Faute de connaître les mois de l’année ou les jours du mois, les noirs comptaient par saisons et par récoltes. Mes calculs, néanmoins, basés sur certains événements dont j’ai dès lors appris la date, font remonter ma naissance à février 1817
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
MES ANNÉES
D’ESCLAVAGE ET DE LIBERTÉ
PAR
FRÉDÉRIK DOUGLASS
MARSHAL DE COLOMBIE
1883
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782383837770
TABLE DES MATIÈRES
PREMIÈRE PARTIE : ESCLAVAGE
i. naissance et parenté
ii. séparé de grand’mère
iii. chagrins d’enfant
iv. coup d’œil sur la plantation
v. l’intendant
vi. raisonnements d’enfant
vii. contrastes
viii. m. austin gore
ix. changement de résidence
x. j’apprend à lire
xi. progrès
xii. l’âme réveillée
xiii. vicissitudes de la vie esclave
xiv. saint-michel
xv. le rompeur des nègres
xvi. la main du dompteur s’appesantit
xvii. le point tournant
xviii. nouvelles relations et nouveaux devoirs
xix. complots
xx. mon apprentissage
xxi. espoir réalisé
DEUXIÈME PARTIE : LIBERTÉ
i. l’évasion
ii. liberté
iii. quelques abolitionnistes.
iv. rhode-island.
v. les conférences.
vi. le royaume-uni.
vii. luttes.
viii. john brown — madame beecher stowe.
ix. le sud s’exaspère.
x. le commencement de la fin.
xi. la guerre.
xii. l’étoile du matin.
xiii. après la guerre.
xiv. vivre, apprendre.
xv. peser dans la balance.
xvi. le temps nivelle tout.
xvii. croquis à la plume.
xviii. garfield — in memoriam.
xix. conclusion.
xx. note du traducteur.
AU LECTEUR
Nul orateur, en Amérique, ne monte sur la plateforme sans que le chairman, chambellan des solennités de la parole, ne le présente au public.
Frédérik Douglass, né esclave, marshal des États-Unis[1], écrivain, orateur, défenseur de sa race, témoin vivant de ce qu’elle était, de ce qu’elle deviendra ; lui, le fils de ses œuvres, n’a pas besoin d’introducteur parmi nous. Il se présente son livre à la main, front haut, en pleine lumière : lui, l’esclave, le fugitif, l’ouvrier, le vainqueur !
Quiconque lira ces pages connaîtra l’homme. On ne signera pas tout peut-être ; on regrettera dans l’ordre spirituel quelques lacunes, ou peut-être quelques réticences ; on voudrait que l’aigle, déployant plus largement ses ailes, s’enlevât plus haut dans les cieux ; tel quel, individualité puissante, facultés hors ligne, viril, sincère, généreux, épris des faibles, on l’aimera. L’admirer, on ne peut autrement. L’estimer, cela se fait tout seul, à mesure que tournent les feuillets, que s’affirme le caractère, que marche la vie, que s’exerce l’action : arrivé au bout, il se trouve que l’estime est devenue du respect.
Le sanctuaire domestique de Frédérik Douglass reste clos ; il en a soigneusement fermé les portes. L’honourable marshal de Columbia est marié, il a des fils ; nous n’en savons pas plus.
Sur l’écrivain, sur l’orateur, nous avons l’opinion de l’Amérique et de l’Angleterre, exprimée par deux hommes éminents, dont s’honorent l’un et l’autre pays.
En voici le résumé :
« Aucun de nos orateurs vivants, écrit M. George Buffin (Boston)[2], n’égale Frédérik Douglass. Son éloquence est bien sienne : originale, sans précédents, ne s’inspirant que de ses convictions. Si absolument on cherchait à la classer, elle trouverait sa place quelque part entre Fox et Henry Clay. Ses auditeurs les plus prochains, ceux que frappent en même temps l’aspect et la voix, en subissent plus que d’autres la puissance. Elle a pour caractère le feu. Je dis exprès le feu : ce brasier solide, intense, qui ne se dépense pas en fugitives étincelles. On se souvient de tel jour, où de tels emportements de passion, d’indignation jaillissaient de ce cœur sur la plate-forme abolitionniste, que, épouvanté, le peuple croyait voir l’Etna jeter ses laves : fleuve ardent que ni les jours, ni les mois, ni les années ne parviennent à refroidir.
« Si le triomphe de la parole consiste à émouvoir les hommes, à créer les convictions, Frédérik Douglass est un maître. Logique, enthousiasme, bon sens, pathétiques élans, humour, saillies, il a tout ; et tour à tour on rit, on pleure, on s’irrite, on raisonne, on suit ardemment cette pensée, on obéit à cette volonté.
« Pour grave que soit Frédérik Douglass, je ne sais quelle intuition de burlesque, je ne sais quelle fine plaisanterie — on la voit de loin se jouer sur ses lèvres — éclaire par degrés le discours, jusqu’au moment où elle s’épanouit en une gerbe de rayons.
« Directeur et rédacteur de journaux, écrivant en plus d’une revue, Douglass n’a rien à envier aux plus accrédités de nos auteurs américains. Son style, pur, clair, heureux, il le doit à l’âme, au caractère, à l’érudition personnelle qui ont fait son éloquence.
« Ni universités, ni collèges n’ont rien enseigné au lettré ; pas plus que ses années d’esclavage n’ont préparé la carrière de l’homme.
« Par droit de conquête ! Ce mot exprime tout. »
Écoutons maintenant la voix anglaise :
« Il est présenta mon souvenir, s’écrie le révérend Davis Thomas DD[3]. Je le vois encore, l’esclave fugitif, alors que debout, dressé de toute sa taille, la tête largement modelée par l’ampleur de sa pensée, son noir visage illuminé de génie, ses grands yeux tantôt embrasés d’éclairs, tantôt pénétrés de tendresse, selon qu’il attaquait les oppresseurs ou défendait les opprimés, je le vois, il y a trente-six ans de cela, lorsque s’adressant à l’auditoire que contenaient malles murs de mon église — Londres — il le secouait de sa forte main.
« Je n’ai pas, dès lors, entendu d’orateur supérieur à Douglass. Flexibles autant qu’ils étaient sonores, ses accents se modulaient, s’atténuaient, s’enflaient comme les menait sa pensée. Le geste, parfaitement naturel, avait en lui ce fluide électrique dont le courant embrase tout. Les infamies de l’esclavage, il les dramatisait ; elles étaient là, fougueuses, sanglantes ! Dix hommes pareils, dans notre Chambre des communes, feraient reculer la tourbe des quasi-patriotes, des politiques salariés, enflammerait les courages, révolutionnerait le monde moral ! »
Pour être prononcés d’un ton plus calme, les quelques mots par où se termine la lettre de John Bright, membre du Parlement, à l’éditeur anglais[4], n’en ont pas moins de valeur :
« — Puisse ce livre, écrit-il, trouver place dans des milliers de Homes anglais ! »
Nous qui l’offrons à la France, nous disons : Puisse-t-il réveiller en des milliers de cœurs français, les énergies qui créent la liberté.
Traducteur.
↑
District de Columbia.
↑
Appendice B du volume anglais.
↑
Appendice C du volume anglais.
↑
Introductory note
, en tête du volume.
naissance et parenté
Prenez une carte d’Amérique, États-Unis. Cherchez l’État de Maryland ; vous trouverez, près d’Easton, comté de Talbot, un petit district maigrement peuplé, lequel n’a de remarquable que l’aridité de son sol, la dégradation de ses fermes, la ruine de ses clôtures, la noblesse de ses habitants, leur indigence, et la fièvre à perpétuité.
C’est là, dans ce plat territoire bordé par le Choptank, la plus paresseuse comme la plus fangeuse des rivières ; entouré d’une population blanche toujours oisive et constamment ivre ; au milieu de nègres esclaves en parfaite harmonie avec ce bas niveau ; c’est là que, sans qu’il y eût de ma faute, je vis le jour.
De ma famille je n’ai rien, ou presque rien à dire. L’arbre généalogique ne pousse pas sur terre esclave.
Un père ! la chose, pour l’esclave, n’existe ni dans l’ordre des faits, ni dans celui des lois.
Mon âge ! difficile à fixer. Je n’ai jamais rencontré un esclave qui pût me dire le sien. Toute recherche, toute question sur ce sujet, était regardée par les maîtres comme une indiscrète curiosité. Faute de connaître les mois de l’année ou les jours du mois, les noirs comptaient par saisons et par récoltes. Mes calculs, néanmoins, basés sur certains événements dont j’ai dès lors appris la date, font remonter ma naissance à février 1817.
Les souvenirs du premier âge me ramènent sous le toit de ma grand mère : Betsy Bailey.
Soit la veillesse, soit les services rendus, lui avaient assuré une position à part. Vivant dans une cabine séparée du quartier des esclaves, hautement estimée de tous, elle exerçait ses talents, tour à tour comme infirmière, jardinière, batelière, sans compter les filets, qu’elle nouait et reprisait à merveille. Que de fois je l’ai vue, dans l’eau jusqu’à la ceinture, jeter la seine ou le cerceau ! Sa main n’avait pas moins de bonheur lorsqu’il s’agissait de planter les patates, si bien que, superstition aidant, on l’appelait de droite et de gauche pour mettre les tubercules en terre, quitte à lui faire bonne part, quand réussissait la récolte.
À ces fonctions, grand’mère en joignait une autre : garder les négrillons.
Car les mères, louées à de grandes distances lorsque le travail baissait chez le planteur, n’apercevaient leur progéniture que de loin en loin. Faire de l’homme une brute, moins que cela : une chose ; tel était le système.
Les cinq filles de ma grand’mère, louées de la sorte, me demeuraient presque inconnues.
Mais ma mère ! La mienne ! Franchissant de nuit, une fois son travail terminé, l’espace considérable qui la séparait de moi, elle apparaissait, me contemplait, m’étreignait, puis reprenait sa course pour répondre dès l’aube à l’appel du conducteur.
Quelque rares, quelque rapides que fussent ces entrevues, l’image s’est gravée, ineffaçable, en moi. — De taille élevée et svelte, ma mère avait les traits réguliers, le port majestueux, une dignité souveraine.
Sur mon père, il faut le répéter, je ne sais rien. L’esclavage de la mère suffit. Une fois prouvé, le système n’a pas à se préoccuper d’autre chose. La condition de la mère, d’après ses lois, fixe invariablement le sort de l’enfant. Mère esclave, fils esclave. Le père fût-il libre, le fils est esclave. Qu’une imperceptible goutte de sang africain circule dans les veines de l’enfant, le père vendra son fils, sans sourciller.
II
séparé de grand’mère.
Étais-je esclave ? Je ne m’en doutais pas.
Enveloppé des tendresses de grand’mère, j’appris bien des choses, avant d’apprendre celle-là.
Notre cabane avait pour moi les beautés d’un palais.
Au premier étage, son plancher de bois, qui nous servait de couchette ; sa terre battue au plain-pied ; sa poussière, son toit de chaume, ses parois sans fenêtres ; et ce miracle de menuiserie, l’échelle qui montait au dortoir ; et le trou creusé devant l’âtre, ce trou dans lequel grand’mère, l’automne venue, enfouissait les patates pour les préserver de la gelée, tout m’intéressait, tout me ravissait. Les écureuils ne grimpaient ils pas aux troncs, ne grignotaient-ils pas leurs noix sur les branches ? Le puits n’avait-il point son grand balancier, pointé vers le ciel, si délicatement suspendu que, d’une main, je faisais remonter le seau plein d’eau vive ? Et le moulin de M. Lee, avec sa gigantesque roue ; et les charrettes combles de blé qui du matin au soir en prenaient le chemin !
J’étais heureux, vous pouvez m’en croire.
Cela ne dura guère. Bientôt la lumière, une triste clarté, se fit. Notre hutte, le nid de mon enfance, n’appartenait pas à grand’mère ; ce nid avait un possesseur, que je n’avais jamais vu, qui demeurait au loin.
Plus lamentable encore cette autre découverte : grand’mère, les négrillons dont elle prenait soin, moi-même, nous étions la propriété de cet inconnu, qu’avec une vénération mêlée de terreur, grand’mère appelait le Vieux Maître !
Ainsi je rencontrai ma première douleur.
D’autres révélations l’accrurent. — Ces négrillons enlevés, sitôt le premier âge passé, sur un ordre du Vieux Maître, ils disparaissaient pour toujours.
Grand’mère était mon tout. Viendrait-on, moi aussi, m’arracher d’elle ?
Ce maître mystérieux, dont le nom : Captain Aaron Anthony, ne se prononçait qu’en tremblant, n’était pourtant pas le vrai maître. Homme important, propriétaire de maintes fermes, il exerçait l’emploi d’intendant sur les terres de notre patron, le colonel Lloyd.
Captain Anthony habitait la plantation du colonel, une des plus considérables de l’État.
Plus m’arrivait la connaissance, plus s’ébranlait mon bonheur.
Oh ! pensais-je, si je pouvais ne pas grandir ! Vieux chaume, vieux arbres, vieux puits, j’embrassais tout d’un regard passionné.
Grand’mère, qui savait mes frayeurs, et que le moment se faisait proche, gardait le silence. — Elle le garda ce matin même, ce glorieux malin d’été, où nous primes le sentier de la forêt.
Douze milles, séparaient notre cabane de l’habitation du colonel. — Douze milles, c’était beaucoup pour mes petites jambes. Aussi grand’mère, vigoureuse en dépit des années, son noir visage encadré par les plis du turban éclatant de blancheur, le pas élastique et résolu, me jucha-t-elle plus d’une fois sur son épaule.
Chère, respectée grand’mère, bénie soit ta mémoire !
Elle m’aurait porté jusqu’au bout, n’était que, me sentant un homme, je ne le permis pas. Mais tout en cheminant, bien serré contre elle, ma main avait vite fait de saisir ses jupes lorsqu’un objet étrange, quelque branche tordue en façon de serpent, quelque tronc orné de gueule, yeux, pattes et griffes, monstre prêt à me dévorer, se dressait dans les profondeurs du bois.
Vers la nuit, nous atteignîmes le but du voyage.
Je me trouvai tout à coup entouré de plus d’enfants noirs, marrons, cuivrés, quasi blancs, que je n’en avais vu de ma vie. Nouveau venu, l’intérêt général se fixa sur moi. Rires, cris, bons tours, rien n’y manquait. Après quoi, les camarades m’invitèrent à jouer avec eux.
Mon cœur n’y était pas. Je refusai.
Grand’mère me regardait tristement. Une séparation nouvelle, succédant à tant d’autres ; elle savait cela. Passant sa main sur ma tête :
— Sois bon garçon ! fit-elle : Va, rejoins-les, ce sont tes parents. Voilà ton frère Perry, tes sœurs, Clara, Eliza !
Mais je ne les avais jamais aperçus. Ces noms de frère, de sœur, bien qu’entendus souvent, ne me disaient rien. Le sang nous liait, l’esclavage nous faisait étrangers. Initiés aux mystérieuses habitudes du vieux maître, eux, m’examinaient avec une sorte de compassion. — Jouer !… et si pendant ce temps, graud’mère allait partir, me laisser !
Pourtant, sur un signe d’elle, je m’y décidai.
Le dos au mur, témoin de leurs ébats, je ne m’y mêlais pas. Soudain, un des marmots, accourant de la cuisine, s’élança vers moi, criant de sa voix grêle, avec une sorte de joie arrogante :
— Fed ! Fed ! Grand-ma loin !
Impossible ! D’un bond je fus dans la cuisine. Plus de grand’mère !
C’était vrai.
Ai-je besoin d’en dire davantage ?
Le cœur brisé, étendu sur le sol, je pleurai ces larmes amères, dont l’âge mur n’oublie pas la désolation.
Mon frère me tendit des pêches, mes sœurs les approchèrent de ma bouche, je repoussai tout.
Une sorte de ressentiment se mêlait à ma douleur : Pour la première fois, grand’mère m’avait trompé.
III
chagrins d’enfant.
Transplanté sur cette partie de la plantation que gouvernait plus spécialement Captain Aaron Anthony, incorporé dans le bataillon enfantin qui m’avait accueilli, le jour néfaste entre tous, je passai sous les ordres de tante Katy.
Elle exerçait sur nous autorité plénière. Esclave elle même, stricte observatrice des règlements ; revêche, cruelle par nature, recherchant avant tout les bonnes grâces du Vieux Maître — dont, en sa qualité de cordon bleu, elle avait conquis les faveurs — tante Katy trouvait, dans la haute position qu’elle occupait, amples occasions d’exercer sa méchanceté.
Seule entre toutes, elle conservait ses enfants ; elle ne les épargnait guère ; en revanche, leurs portions s’enflaient à nos dépens.
La faim me travaillait de l’aube au soir. Captain Anthony, directeur suprême, au lieu d’allouer une quantité déterminée de nourriture à chacun, livrait les denrées à tante Katy, qui, la cuisson opérée, les distribuait selon son bon plaisir.
La diète consistait en maïs grossier : diète est le mot. Parcimonieusement mesurées, nos portions laissaient plus d’un grain aux doigts crochus de tante Katy. — Il m’est arrivé, dévoré par la faim, tantôt de disputer quelques reliefs au vieux dogue Ralph, tantôt de suivre d’un pas leste Zoé, la fille de service, pour recueillir les miettes ou les menus os qui tombaient de la nappe, alors qu’elle la secouait devant poules, coqs et chats.
Tremper une croûte de pain sec dans l’eau où avait plongé le bouilli, c’était un régal ; sucer la peau desséchée de quelque jambon à moitié gâté, nous semblait un luxe inouï.
On le comprendra sans peine, tante Katy étant donnée, il m’arrivait souvent de l’offenser.
Elle avait adopté un mode facile de châtiment : elle m’affamait.
Je ne sais quel jour, en vertu de je ne sais quel grief, tante Katy me supprima déjeuner et diner.
Bien. À force d’énergie masculine, je tins bon jusqu’au soir. Alors, il faut l’avouer, la dignité s’évanouit, le courage s’affaissa. En guise de pitance, tante Katy, me foudroyant du regard, déclara, tout en coupant de larges tranches de pain et les distribuant aux camarades : qu’elle me tirerait le souffle du corps. J’avais espéré quelque apaisement de sa part, mais lorsque je vis le pain disparaître, les mâchoires de mes compagnons broyer la prébende et leurs visages s’illuminer, le désespoir l’emporta ; je fus derrière le mur de la cuisine, pleurer toutes les larmes de mes yeux.
Tante Katy cependant, et les négrillons, s’étaient éloignés. Je retournai vers l’âtre ; je m’y pelotonnai, l’estomac trop creux pour pouvoir dormir. — Tandis que je songeais, un épi de maïs, laissé par mégarde en un coin, frappa mes regards ; j’enlevai… pas mal de grains, je les fis rôtir sous les cendres, au risque d’être impitoyablement battu. Éclatés, odorants, je les plaçais en un joli tas sur l’escabeau, lorsqu’un pas s’avoisina.
Tante Katy ? — Non, ma mère, ma propre mère bien-aimée ! Oh ses bras, m’y enfouir, moi, misérable garçon abandonné !
Pourrais-je l’oublier jamais, sa fierté native, l’ineffable expression de ses traits, quand je lui dis ma détresse ? Pourrais-je l’oublier jamais, ce mélange d’amour et de courroux ? Comme elle répandit, d’un geste indigné, les grains de maïs ; comme elle les remplaça par un épais quartier de tarte au gingembre ! Quelle réprimande elle infligea, du haut de sa royauté de mère, à tante Katy !
Cette nuit-là, oh ! cette nuit bénie, j’appris que je n’étais pas seulement un enfant quelconque, mais l’enfant de quelqu’un.
Assis sur les genoux de ma mère, je me sentais plus puissant qu’un empereur.
Court fut mon triomphe. Accablé de sommeil, je me retrouvai le matin sans mère, à la merci de cette virago, dont l’ombre seule me glaçait d’effroi.
Ma mère avait franchi douze milles pour m’embrasser, douze milles pour retourner au travail. — Je ne l’ai pas revue. La mort, bientôt après, lui octroya la liberté.
Mon éternel regret, c’est de l’avoir si peu connue ; d’avoir thésaurisé un si petit nombre de ses paroles, dans le sanctuaire de mes souvenirs.
Parmi la population noire de Tuckahoe, seule elle savait lire. Comment y était-elle parvenue, dans ce milieu plus défavorable que pas un ? Son ardeur passionnée pour l’instruction opéra le miracle.
C’est à elle, à ma noble mère, à ma mère esclave, à ma mère au teint d’ébène — non certes à mon anglo-saxonne origine présumée — que je dois et mes aspirations, et ces facultés natives, inaliénables possessions de la race persécutée… et méprisée.
IV
coup d’œil sur la plantation.
L’esclavage passait pour revêtir, dans l’État de Maryland, sa forme la plus bénigne. Il n’y présentait disait-on, aucune de ces circonstances atroces, habituelles aux territoires du Sud et de l’Ouest. Le voisinage des États libres, l’influence de leur foi, de leur humanité, de leur moralité, tempérait les rigueurs du système. Là où s’exerçait cette influence, une certaine contrainte muselait, jusqu’à un certain point, la férocité des maîtres, des surveillants et des conducteurs. Mais cette influence, loin de s’étendre à tout le Maryland, restait circonscrite. Tels recoins, telles localités écartées, ne recevaient pas un rayon de cette bienfaisante lumière. Protégé par son isolement, enveloppé dans ses ténèbres, l’esclavage pouvait y être dépravé sans vergogne, cruel sans frisson, meurtrier sans risquer la geôle ou l’échafaud.
Les terres du colonel Lloyd, éloignées de tout centre commercial, de toute ville ou même de tout village, se trouvaient dans ces conditions.
Un instituteur, M. Page — Greenfied, Massachussets — enseignait les petits-enfants da colonel. Grand, maigre, osseux, taciturne et solennel, il n’adressait pas douze fois en douze mois la parole à un noir.
Les fils des employés supérieurs, placés dans un collège de l’État, ne risquaient pas d’en rapporter des idées subversives du système. Aucun ouvrier blanc n’était admis sur la plantation. Nul, par conséquent, n’y introduisait quelque infection d’indépendance ; nul n’emportait au dehors quelque sanglant souvenir.
Maîtres, surveillants, esclaves, ces trois classes comprenaient tout.
Forgerons, charrons, charpentiers, menuisiers, cordonniers, tisserands et tailleurs étaient esclaves. Chaque feuille poussée, chaque grain mûri sur les fermes du colonel, entassés dans les flancs d’embarcations qui lui appartenaient et que montait un équipage esclave — sauf le capitaine — allaient se débiter à Baltimore. Ces barques en ramenaient les objets nécessaires à l’établissement. Un réseau de propriétés, dont les maîtres soutenaient d’intimes relations avec le colonel, entourait ses terres, et maintenait intact, le fait de la séquestration. Pas un souffle de liberté, pas une vibration d’idées, pas un écho des voix qui parlaient au dehors ! Royaume à part, despotiquement gouverné, ayant son code, ses règlements, son langage, sans recours possible à qui ou à quoi que ce fût !
L’intendant, arbitre souverain, à la fois accusateur, jury, juge et bourreau, décidait en premier et dernier ressort. — Muet par ordre, le prévenu n’était jamais admis à témoigner, sauf contre un autre esclave.
Ni questions politiques, ni questions religieuses ne franchissaient le mur d’enceinte. Sermonner les maîtres ! Quel prédicateur l’eût osé ? Et quant aux noirs, trop bas était le niveau, trop profonde l’ignorance, pour qu’on essayât même de les décrasser.
Et cependant, quelques lueurs d’Évangile traversaient notre nuit.
Souillée de corruptions, ensanglantée de crimes, la plantation s’épanouissait au soleil, dans toutes les gloires d’une végétation splendide, dans le joyeux rayonnement d’une incessante activité.
Malgré les regrets que me laissaient grand’mère et mon home, je m’acclimatai vite. Nécessité fait vertu. Impossible de fuir. Il ne me restait donc qu’un parti à prendre : accepter mon sort.
Les camarades ne manquaient pas, non plus les aspects nouveaux.
Là, je vis pour la première fois, un moulin à vent découper dans l’azur ses grandes ailes blanches que faisait tourner la brise. Là, sur les eaux de la Swash, posait le sloop du colonel : Sally Lloyd, ainsi nommé en l’honneur de sa fille favorite. Sur le sentier, brillait la maison rouge de M. Seveir, un surveillant ; plus loin, s’étendait le quartier long, construction au toit surbaissé, fourmillant d’esclaves de tout âge, sexe, taille et couleur. Un bâtiment analogue, même population, couronnait la hauteur voisine. Huttes, cabanes, granges, écuries, magasins, ateliers, éparpillés çà et là, entouraient l’habitation du Vieux Maître, Captain Anthony ; tandis que, dominant l’ensemble, trônant au milieu des cuisines, laiteries, buanderies, basses-cours, pigeonniers, volières, pavillons, serres et tonnelles, mes yeux émerveillés contemplaient le plus majestueux édifice qu’eussent imaginé mes rêves : la Grande Maison !
Des arbres gigantesques, des vergers combles de fruit, de gracieux bosquets achevaient l’enchantement.
Ce palais, demeure du colonel, était en bois. Ses pavillons projetés de trois côtés, son vaste portique à colonnade, lui prêtaient je ne sais quoi de royal.
Tant de beauté, tant de magnificence, pouvaient-elles bien exister ici-bas !
On y arrivait par une route pavée de cailloux blancs, qui serpentait parmi les gazons admirablement tenus. Sur la droite et sur la gauche se dilatait le parc, immense, où daims et lièvres gambadaient, sans que nul vint les molester, pendant que perchés au sommet des peupliers, se balançaient les merles, battant de leurs ailes rouges, chantant et gazouillant à l’envi.
Non loin de la Grande Maison, une enceinte de sombre apparence renfermait les sépulcres des Lloyd défunts. Monuments, saules pleureurs, noirs cyprès inspiraient une terreur vague. D’étranges apparitions, avaient rencontré quiconque se hasardait en ces parages. Spectres drapés dans leur suaire, cavaliers montés sur des chevaux pâles, boules de feu se promenant par les airs, voix lugubres entendues après minuit ; il n’en fallait pas plus pour tenir les curieux à l’écart. — Ajoutons que les nègres, assez forts théologiens pour envoyer conducteurs et surveillants en enfer, leur supposaient un ardent désir d’en sortir, fouet levé, et ne se souciaient en aucune façon de risquer l’entrevue.
Vingt à trente fermes, chacune avec son surveillant, ordonnateur suprême, formaient la propriété du Colonel.
M. Lloyd était riche. Ses esclaves constituaient, à eux seuls, un énorme capital. Et, bien qu’il ne s’écoulât pas de mois sans que les acheteurs de Géorgie n’emmenassent quelque lot de marchandise ébène, le stock humain ne semblait pas diminuer.
Emmenés en Géorgie ! Ceux qui partaient, ceux qui restaient, pleuraient d’une même douleur l’horrible événement.
Tout esclave exerçant un métier quelconque, portait le titre d’oncle, sans que le moindre lien de parenté l’unit à ceux qui le lui donnaient. Quelque invraisemblable, quelque puérile que puisse paraître la chose en un peuple si durement traité, si constamment abaissé, aux prises avec de telles vicissitudes, vous ne trouverez chez nul autre, pareille vénération pour le grand âge. Nulle race ne vous fournira, comme la race africaine, de quoi faire ce qu’on appelle : un gentilhomme.
Parmi les notabilités noires, oncle Isaac Cooper occupait un des premiers rangs. — Jamais l’esclave ne porte de surnom ; le surnom reste privilège exclusif des blancs. Toutefois, oncle Isaac, en vertu de je ne sais quelle faveur, possédait le sien : on l’appelait docteur Isaac. Ses degrés, conférés par l’opinion publique, lui donnaient le droit de médicamenter la plantation. Une jambe plus courte que l’autre, incapable de travail, invendable sur le marché, oncle Isaac était vif, alerte, béquillant partout où il pressentait un malade à guérir, un conseil à offrir. Sa pharmacopée embrassait quatre articles. Pour les affections du corps : sels d’Epsom, huile de ricin. Pour les affections de l’âme : la Prière dominicale, plus trois ou quatre sanglées de bouleau !
Nous nous rendions chaque matin, mes camarades et moi, chez docteur Isaac, à cette fin d’y apprendre la prière en question.
Juché sur un tabouret à trois pieds, armé de la fameuse gaule (dont le bout nous atteignait toujours, quelque éloignés que nous fussions) le docteur criait :
— À genoux !
Cela fait : — Notre Père ! commençait-il.
— Notre Père ! — répétait vivement le bataillon noir.
— Qui est aux cieux !
Ici, le bataillon hésitait, balbutiait, sur quoi docteur Isaac, allongeant sa gaule et nous en caressant le dos, remettait son armée au pas.
Prière et gaule me semblaient étrangement associées.
Que voulez-vous, chacun, dans le Sud, est saisi du besoin de bâtonuer quelqu’un.
Mon épouvante, à l’endroit de Captain Anthony, s’était effacée. Au lieu de me guetter du fond de son repaire, de bondir sur moi pour me pulvériser, Captain semblait ignorer mon existence. Qu’étais-je ? Une tête de plus dans son bétail.
La famille de Captain consistait en deux fils : Richard et André ; puis une fille, récemment mariée au capitaine Thomas Auld.
Tante Katy régnait dans la cuisine, ayant sous ses ordres tante Esther — bien plus jeune — sans compter dix ou douze négrillons de mon âge à peu près.
Captain Anthony possédait trois fermes (district Tuckahoe) ; sur ces fermes trente esclaves, dont chaque année il vendait un. Le marché lui rapportait tantôt sept cents, tantôt huit cents dollars, lesquels s’ajoutant au revenu de ses fermes et à ses honoraires d’intendant, formaient un joli denier.
Les plus aristocratiques distinctions régnaient sur la plantation Lloyd. — La famille de Captain Anthony n’était pas reçue dans la Grande Maison. Même distance, infranchissable, séparait le clan Seveir, du clan Aaron Anthony. — Les Lloyd, cela va de soi, n’abordaient pas nos quartiers.
Et pourtant, je jouais fréquemment avec un des petits-fils du colonel : Danied Lloyd ; et c’est à lui que je dois d’avoir perdu, dès l’enfance, l’accent avec le parler nègre. — Juste effet des lois de compensation qui régnent ici-bas : nos maîtres ne pouvaient maintenir notre ignorance, sans en voir s’étendre sur eux les ombres ; ils ne pouvaient nous rapprocher d’eux, sans qu’un rayon de leur lumière ne vint nous éclairer.
Un autre des petits-fils du colonel, Edward, bien que sans relations directes avec nous, s’était attiré notre respect. Il ne nous avait jamais témoigné de mépris : cela suffisait.
V
l’intendant.
Captain Anthony, je viens de le dire, m’ignorait.
Dans les rares occasions on il s’était douté de mon existence, je l’avais trouvé bienveillant.
Peu de mois suffirent à me révéler son vrai caractère. Ni la bonté ni la douceur n’en faisaient les traits distinctifs. Ces qualités n’apparaissaient qu’à l’état d’éclairs.
Captain Anthony pouvait, selon l’occurrence, non-seulement rester insensible aux droits de l’humanité, sourd aux appels de la victime contre l’oppresseur, mais perpétrer lui-même des actes infâmes, ténébreux, monstrueux.
Or, cet homme n’avait pas une pire nature que les autres.
Élevé dans un État libre, au milieu d’une société civilisée, sous les lois communes qui assurent mêmes droits à chacun, Captain Anthony ne serait pas, selon toute probabilité, descendu au-dessous du commun niveau.
L’âme revêt, du plus au moins, la couleur de l’atmosphère qui l’entoure. Le gouverneur d’esclaves, tout autant que l’esclave même, subit l’action de l’esclavage. Il n’existe pas, sous les cieux, de conditions plus funestes à la moralité, que celles du propriétaire de chair humaine.
Quiconque eût vu Captain Anthony me tendre la main, passer complaisamment ses doigts sur mes joues ; quiconque l’eût entendu me parler d’un ton caressant, m’appeler son petit Africain, l’eût pris pour le père de notre noire colonie.
Mais les faveurs du despote sont capricieuses et transitoires. Rarement elles apparaissent, vite elles s’envolent. Maints ennuis exerçaient la patience du Vieux Maître. À vrai dire, vexations ou plaisirs ne changeaient pas grand’chose à son humeur. Tout enfant que j’étais, je devinais en lui un homme inquiet et malheureux. Ses gestes bizarres excitaient ma surprise, son air triste éveillait ma compassion. Il n’errait guère sans grommeler ; parfois il tempêtait seul, comme s’il se fût agi de tenir tête à une armée. Blasphémant, sacrant, maudissant, on l’eût dit possédé du démon. En guerre avec son âme, avec les blancs, avec les noirs, avec tout, peu lui importait d’être entendu de nous autres gamins ; pas plus que si nous eussions été un troupeau d’oies ou de canards. — Mais quand son front s’enténébrait, que ses sourcils se rapprochaient, que sa crinière se hérissait ; quand le pouce faisait craquer l’index, alors nous filions au large… et bien nous en prenait.
Une circonstance fortuite acheva de m’ouvrir les yeux.
Helen, esclave du Captain, était accourue d’une de ses fermes, pour demander justice et protection. — M. Plumner, le brutal dépravé qui gouvernait les noirs du Captain, avait grièvement outragé Helen. La malheureuse s’était sauvée, elle était venue à son maître ; elle arrivait exténuée, palpitante, suppliante, nu-pieds, nu-tête, les épaules et le cou déchirés, une large plaie au visage. — Le maître, pensais-je, va s’embraser de rage, foudroyer le bandit sous son courroux ! — Il n’en fut rien. D’un ton irrité :