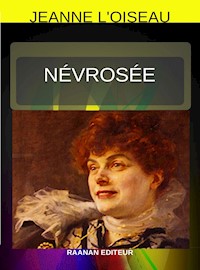
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Jeanne Loiseau, est une femme de lettres française, connue sous le nom de plume de Daniel Lesueur.
Extrait
| Chapitre I
Rien n’a plus de charme qu’un très joli matin d’avril, sur le Boulevard, à Paris, entre la Madeleine et l’Opéra.
Le printemps, avec ses rayons, ses frissons et ses sourires, exerce partout sa puissance, mais il est des endroits qui, mieux que d’autres, savent lui faire fête. L’énorme capitale, parmi les brutalités et les frivolités de son ardente vie, exprime avec des délicatesses pénétrantes la fugitive poésie des saisons. En son quartier le plus tapageusement mondain, la grâce attendrie du renouveau emplit les âmes et les yeux d’une délicieuse langueur.
On s’en apercevait, à cet instant matinal et d’une exceptionnelle beauté, durant lequel Maxime Dulaure atteignait, de sa marche lente et ferme, l’angle du Café de la Paix.
La vaste place, les grandes voies qui y aboutissent, le lourd et somptueux Opéra, resplendissaient d’une fine clarté rose. Dans l’air caressant et lumineux, les voitures de maître, les modestes fiacres, et même les pesants omnibus à trois chevaux, circulaient allègrement, presque sans bruit sur le pavé de bois, faisant pétiller, sous le doux soleil un peu voilé, des myriades d’étincelles arrachées à l’acier des mors et des gourmettes. Peu de coupés ou de landaus ; les victorias reprenaient possession de la chaussée.
Contre la façade du Café de la Paix, dans les angles des renfoncements, des familles d’étrangers, sorties du Grand Hôtel, prenaient en plein air leur café ou leur chocolat du matin. Des young ladies blondes, au visage de keepsake, au teint d’une fraîcheur invraisemblable, regardaient de leurs grands yeux, à la fois innocents et hardis, ces jeunes hommes parisiens qui ralentissaient leur marche en passant auprès d’elles.
Des officiers s’asseyaient en riant, avec de grands bruits de sabre, ne résistant pas au désir de s’attarder dans ce ravissant décor, de regarder aller et venir les femmes, qui, toutes, portaient épanouie dans les yeux et sur les lèvres, une folle floraison printanière de coquets sourires et de provocants coups d’œil...|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
SOMMMAIRE
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
Chapitre XV
Chapitre XVI
DANIEL LESUEUR
NÉVROSÉE
roman
Paris, 1890
Raanan Editeur
Livre 702 | édition 1
Chapitre I
Rien n’a plus de charme qu’un très joli matin d’avril, sur le Boulevard, à Paris, entre la Madeleine et l’Opéra.
Le printemps, avec ses rayons, ses frissons et ses sourires, exerce partout sa puissance, mais il est des endroits qui, mieux que d’autres, savent lui faire fête. L’énorme capitale, parmi les brutalités et les frivolités de son ardente vie, exprime avec des délicatesses pénétrantes la fugitive poésie des saisons. En son quartier le plus tapageusement mondain, la grâce attendrie du renouveau emplit les âmes et les yeux d’une délicieuse langueur.
On s’en apercevait, à cet instant matinal et d’une exceptionnelle beauté, durant lequel Maxime Dulaure atteignait, de sa marche lente et ferme, l’angle du Café de la Paix.
La vaste place, les grandes voies qui y aboutissent, le lourd et somptueux Opéra, resplendissaient d’une fine clarté rose. Dans l’air caressant et lumineux, les voitures de maître, les modestes fiacres, et même les pesants omnibus à trois chevaux, circulaient allègrement, presque sans bruit sur le pavé de bois, faisant pétiller, sous le doux soleil un peu voilé, des myriades d’étincelles arrachées à l’acier des mors et des gourmettes. Peu de coupés ou de landaus ; les victorias reprenaient possession de la chaussée.
Contre la façade du Café de la Paix, dans les angles des renfoncements, des familles d’étrangers, sorties du Grand Hôtel, prenaient en plein air leur café ou leur chocolat du matin. Des young ladies blondes, au visage de keepsake, au teint d’une fraîcheur invraisemblable, regardaient de leurs grands yeux, à la fois innocents et hardis, ces jeunes hommes parisiens qui ralentissaient leur marche en passant auprès d’elles.
Des officiers s’asseyaient en riant, avec de grands bruits de sabre, ne résistant pas au désir de s’attarder dans ce ravissant décor, de regarder aller et venir les femmes, qui, toutes, portaient épanouie dans les yeux et sur les lèvres, une folle floraison printanière de coquets sourires et de provocants coups d’œil.
C’était une griserie générale, si évidente et si universellement sentie, que tous ces gens avaient un air de joyeuse entente. Les regards se parlaient, à défaut des bouches. On mettait en action, ce matin-là, sur le Boulevard, le mystérieux roman que Baudelaire fait tenir tout entier dans ce vers plein de profonde passion inassouvie :
Ô toi que j’eusse aimée ! Ô toi qui le savais !
Un seul homme traversa cette scène, étranger aux impressions qu’elle éveillait, ne sentant pas frémir dans ses veines le voluptueux frisson qui ébranlait la foule, toute la ville, et jusqu’aux ormes rabougris, aux marronniers anémiques, dont le fragile feuillage étalait une verdure encore vierge de poussière.
Cet homme marchait absorbé, sans rien voir, mais non sans attirer bien des regards curieux.
Maxime Dulaure était un de ces êtres d’exception qui, nulle part, ne peuvent passer inaperçus.
Très grand, les épaules larges, la stature puissante bien que sans lourdeur, la tournure et la démarche fières, le visage glabre, d’une beauté, d’une régularité de médaille antique, les cheveux assez longs, touffus et bouclés, il eût rappelé les dieux bornés et sensuels d’Athènes et de Rome, si le feu de ses prunelles noires n’eût révélé tout l’affinement de l’esprit moderne le plus élevé, le plus aigu.
Il avait à peine trente-cinq ans, mais on pouvait lui donner indifféremment plus ou moins, car ses traits, d’un dessin net et vigoureux, qu’une volonté de fer maintenait toujours impassibles, n’étaient pas de ceux que les années ou les passions marquent d’une facile empreinte.
Les gens qui, ce matin-là, le croisèrent sur le Boulevard, se dirent tout bas ou murmurèrent entre eux : « Qui est-ce ? »
On se sentait sûr qu’il était quelqu’un, au point d’être gêné de ne savoir pas mettre un nom sur sa figure.
Dans le quartier de l’Opéra, personne ne put répondre à l’involontaire question. Le long du boulevard Saint-Michel ou dans la rue des Écoles, quelque étudiant eût répliqué à mi-voix, tout en soulevant son chapeau : « C’est Dulaure, pour qui la nouvelle chaire de biologie vient d’être créée au Collège de France. »
Vingt personnes à peine en Europe étaient capables d’apprécier comme il convenait la renommée de ce jeune homme, dont les travaux, à ce moment, reculaient d’une façon tout inattendue les limites de la science.
Son existence même était absolument ignorée de ce qu’on appelle le grand public.
Quant à sa remarquable physionomie, elle n’était familière ni dans les salons, ni dans les théâtres, ni dans les cabarets élégants devant lesquels, ce matin-là, il cheminait à grands pas sûrs et tranquilles. Maxime ne fréquentait pas le monde. En dehors des muséums, des amphithéâtres de dissection, des retraites où se cachent certains travailleurs acharnés, ses confrères, on ne le rencontrait nulle part. Si sa boutonnière s’ornait d’un mince filet rouge, si une chaire nouvelle venait d’être fondée exprès pour lui au Collège de France, ni les démarches ni les protections n’y avaient contribué. Mais un tel cri d’enthousiasme vint d’Allemagne et d’Angleterre après l’apparition successive de ses deux ouvrages, Traité de Psychométrie et De l’énergie spécifique des nerfs, que le Gouvernement français ne crut pas pouvoir faire moins.
Maxime venait de traverser le vaste refuge carré qui s’étend au milieu de la place de l’Opéra, lorsqu’un encombrement de voitures le retint sur place quelques minutes.
Il eut alors un soubresaut, comme si une telle interruption l’eût réveillé de son rêve. D’un regard machinal, il explora le décor qui l’entourait. Un dur éclair passa dans ses yeux.
« Comment ! » songea-t-il, « j’ai pu venir aussi loin sans m’en apercevoir… Et, cette fois, ce n’est pas un problème de science qui m’occupe… Ne puis-je déjà plus me défendre de songer à elle ? Quoi ! cette méprisable maladie me gagne donc, moi aussi, à la fin ?… Amoureux, moi !… Ce serait fort ! »
Il ricana presque tout haut.
Mais une exclamation vint couper court à ses pensées. Quelqu’un, dans une Victoria qui frôlait le trottoir, s’écria très haut :
— Maxime !
Puis un beau garçon brun, de son âge à peu près, sauta du marchepied, et dit, les deux mains tendues :
— Je ne me trompe pas… C’est bien toi… Ah ! que je suis content !
Malgré dix ans de séparation, Maxime Dulaure reconnut immédiatement Lucien Gerbier.
— Bonjour, mon cher Lucien, dit-il avec froideur. Tu vas bien, j’espère …
On aurait dit qu’il l’avait quitté la veille. Déjà il cherchait comment il allait pouvoir se débarrasser de lui sans trop d’impolitesse.
Mais, au bout d’un instant, cette enveloppe glaciale que Maxime plaçait systématiquement entre lui et le monde, entre son cœur et les émotions, entre sa pensée et l’importunité des banales et fausses relations humaines, se fondit à la chaleur d’une ancienne et ineffaçable amitié.
— Pardonne-moi, dit-il à Lucien. Tu te moquais de ma sauvagerie autrefois… Si tu savais ce qu’elle est devenue !
— Ainsi c’est exprès que tu n’as pas répondu à mes dernières lettres, à mes tentatives pour te retrouver ?…
— Je fais des recherches qui m’absorbent. L’engrenage des expériences me tient.
— C’est moi qui te tiens en ce moment, dit Lucien. Tu vas déjeuner avec moi.
— Nous n’allons pas à la maison, reprit-il, quand il eut décidé, non sans peine, le jeune professeur à monter en voiture. Ma femme nous gênerait pour causer…, la première fois…, et après si longtemps ! Mais tu la connaîtras bientôt… Tu la verras…
Il ajouta en riant :
— Elle te convertira au mariage, célibataire endurci !
Deux pas plus loin, le cocher arrêta devant un grand restaurant du Boulevard. Lucien, en descendant, lui donna l’ordre de rentrer rue du Château-d’Eau et d’avertir Madame qu’on eût à déjeuner sans l’attendre, qu’il était avec M. Dulaure.
— Elle saura bien ce que cela veut dire, ajouta-t-il en se tournant vers Maxime. Nous avons si souvent parlé de toi ! Elle te connaît et t’aime autant que je le fais moi-même, ma Suzanne.
Maxime souriait, heureux maintenant de se laisser envelopper par tant d’affection, mêlée à tant de souvenirs. Il était dans une de ses crises noires, tout à l’heure, quand il avait si mal accueilli cet ami d’autrefois, le seul intime, véritable, le seul qui ne se fut pas laissé rebuter par la misanthropie naissante de l’étudiant de jadis.
— Lui en veux-tu toujours autant, voyons, Maxime, à cette pauvre humanité ?
— Moi ?… Lui en vouloir ?… De quoi ?… De sa bêtise et de son égoïsme fonciers ?… de son insatiable besoin de mensonge ?… Mais non : je ne lui en veux pas plus qu’aux loups de croquer les brebis et qu’à la ciguë de produire du poison. Je constate, et je ne m’indigne pas – ce serait ridicule, – et je hais encore moins – ce serait absurde.
— Ah ! disait Lucien, tu n’as pas changé. Je reconnais jusqu’à tes phrases d’autrefois. L’impassibilité de la science !… Moi, vois-tu, je ne suis qu’un bourgeois… Encore plus bourgeois que dans le bon vieux temps, au quartier Latin. Comme tu vas me mépriser !
Il disait cela d’un air content, comme si le mépris de Maxime, c’eût été après tout quelque chose de précieux, comparé à son indifférence. Rien de touchant comme l’étalage naïf, chez ce beau grand garçon brun et barbu qu’était Lucien, d’une pareille amitié de terre-neuve. Ses mouvements mêmes donnaient l’idée du bon gros chien qui voit revenir, après une absence, l’enfant de la maison, le compagnon chéri des premières années. Il ne tenait pas en place, mais tournait, remuait, se démenait dans ce petit salon particulier de restaurant où se dressait leur couvert. Chaque fois que les garçons sortaient, il revenait serrer les mains de Maxime. Celui-ci, malgré son aversion pour toute démonstration extérieure, se sentait maintenant trop ému pour témoigner de l’impatience.
Lorsque Lucien, en face de son calme, répéta sa plaisanterie, vieille entre eux de quinze ans, sur l’impassibilité de la science, Maxime répondit :
— Ah ! mon ami, comme tu as raison de me taquiner !… Dans des moments tels que celui-ci, je sens combien tous les mouvements de l’âme sont supérieurs à nos analyses… Il est meilleur de s’y abandonner, va, que d’en chercher le mécanisme. Si tu savais la puissance avec laquelle me ressaisissent mes souvenirs, là, en regardant ta chère figure… Avec quelle patience et quelle gaîté tu supportais mes boutades ! Je n’ai tenté de les imposer à personne depuis lors. Ta place dans mon existence est restée vide. J’ai vécu en solitaire, en ours… Je comprends trop bien les hommes, et je ne me soucie pas d’être compris par eux.
— Pauvre philosophe ! dit Lucien, pauvre savant ! Que vous voyez mal la vie, vous autres, à force de vouloir la connaître mieux que nous !
— Chacun la voit comme il peut, répondit Maxime avec une nuance de tristesse. Mais, voyons, parle-moi de la tienne… Tu as l’air d’en être assez satisfait.
— Je suis le plus heureux des hommes.
— À la bonne heure.
— Oui…, dit Lucien. – Et sa joyeuse physionomie soulignait éloquemment ses paroles. – Tu as démontré dans tes bouquins que le bonheur n’existe pas. Moi, je l’ai découvert, le bonheur… Tu sais que je suis marié ?
— Et c’est en cela que ta félicité consiste ?… demanda Maxime, en relevant la tête avec un mouvement ironique des sourcils.
— Mais oui… Tu ne vas pas me croire, peut-être ?…
— Certes non, dit Maxime. Je ne crois pas au bonheur de l’homme par la femme.
Une ombre passa sur les traits du jeune professeur lorsqu’il fit cette réponse. Son ami la vit et s’étonna. « Aurait-il aimé ? Aurait-il souffert ? » songea Lucien. Car on ne trouve pas des théories pareilles dans les laboratoires. Jamais la plus impassible science n’amènera l’homme à parler de la femme d’une façon désintéressée.
« Je ne veux pas le questionner, » pensa Lucien, qui le connaissait. « Ce serait un moyen infaillible de le faire se replier intérieurement. Il est trop fier pour avouer une faiblesse de cœur, autrement que dans un mouvement de colère contre lui-même, mouvement qui se produira tôt ou tard. »
Alors il se mit à raconter quelle avait été sa vie depuis que tous deux ne s’étaient pas vus.
Peu de temps après que Maxime fut reçu docteur en médecine et quitta Paris pour Berlin, où il voulait se mettre au courant de la psychologie allemande, Lucien conquit sa licence en droit. Bien que destiné à une carrière industrielle, le jeune homme tenait à pousser au moins jusque-là ses études. Un soir que, tout fier de son diplôme, il fêtait ses meilleurs camarades dans son petit appartement de garçon de la rue Soufflot, on vint l’appeler en toute hâte. Rien qu’à voir en bas, au coupé de sa mère, le cheval fumant de sueur, et, sur le siège, la figure bouleversée du cocher, il comprit que le messager ne lui avait pas tout dit et que son père était mort.
M. Gerbier, qui, en effet, venait de succomber par suite de la rupture d’un anévrisme, était un fils de ses propres œuvres. Parti d’une situation très modeste, – il avait commencé par être conducteur de scie dans une simple scierie à eau de province, – il expirait, à cinquante-six ans, chef de la plus importante scierie mécanique de France. Les perfectionnements apportés par lui à cette industrie lui valaient une sorte de petite gloire. Il conquit la renommée d’inventeur, qui releva son caractère d’ouvrier parvenu. Il faillit être décoré. Le mirage toujours fuyant de ce bout de ruban rouge, suprême idéal du bourgeois français, remplit de déceptions amères ses dernières années, peut-être même hâta sa fin. Du moins il connut toutes les satisfactions de la grande richesse. Son mariage fut heureux, et il eut un fils – c’était Lucien – qui, dès les petites classes du lycée, lui fit beaucoup d’honneur.
— Ah ! disait Maxime, remontant avec son ami jusqu’à leurs plus lointains souvenirs d’enfance, tu étais ce qu’on appelle un fort en thème, toi, Lucien, tandis que moi, peu s’en fallait qu’on ne me signalât comme un cancre.
Cet homme – l’un des esprits les plus profonds et les plus originaux de son temps – fut, en effet, un élève détestable. Il ne faisait bien que ce qui l’intéressait, et ce n’était pas toujours la leçon du lendemain. Jamais, ni au lycée, ni ailleurs, il ne put « emboîter le pas » derrière personne.
— Te rappelles-tu le jour où le proviseur, entrant dans la classe, demanda nos places de composition ? « Voilà encore M. Gerbier qui est premier, fit-il, et son Pylade, M. Dulaure » est le dernier. C’est bien le cas de dire que les extrêmes se touchent. »
— Je crois bien, répondit Lucien. Tu t’obstinais à trouver aux théorèmes des démonstrations plus rapides que celles de nos livres. Cela exaspérait le professeur, qui savait les siennes mot à mot et qui ne pouvait plus suivre dès qu’on l’en écartait. Quand tu alignais triomphalement ton c.q.f.d. sur le tableau, comme il ne pouvait nier les résultats, il en devenait vert, le pauvre homme.
— Ce qui me valait les plus cruelles humiliations, reprit Maxime, c’étaient les Discours, latins ou français. Non, moi qui ai l’horreur des phrases, ce que cela me coûtait de faire pérorer les grands hommes ! Quand il fallut composer la Harangue de César à ses troupes au moment de passer le Rubicon, tout ce que je pus lui faire dire, c’est : « Alea jacta est ! »
« Et tu fus privé de sortie… Et j’allai sans toi voir les Pilules du Diable, où je ne pris aucun plaisir.
L’histoire de Lucien Gerbier, ramenée ainsi par un détour aux années de collège, menaçait de ne plus les dépasser. Cependant ces années, comme sa vie d’étudiant, ne l’avaient pas séparé de Maxime, et, par conséquent, n’offraient aux deux amis que le charme des souvenirs communs. Mais ce charme est si fort qu’ils continuèrent à se rappeler l’un à l’autre mille circonstances bien connues, au lieu d’entamer le récit de ce qu’ils ignoraient.
Un souvenir surtout les amusa. C’était celui d’une grisette du quartier Latin, pour laquelle tous deux éprouvèrent un goût très vif. Chacun s’était abstenu de faire la cour à la jolie fille, dans la persuasion que l’autre en avait tout obtenu. Aujourd’hui seulement, ils découvraient que cette délicatesse toute chevaleresque avait doublement fait fausse route.
— Comment, ce n’était pas toi ?
— Non, ma parole ! Tu veux plaisanter, mais c’est inutile, maintenant. Avoue que tu l’as emporté sur moi, beau misanthrope qui n’as pas toujours été misogyne. Je ne t’en voudrai pas, va.
— Ah ! Lucien, je n’aurais pas demandé mieux, mais je te jure…
— Et qui était-ce donc, alors ?
Ils décidèrent que ce devait être un certain élève en pharmacie, leur voisin, garçon bête et sournois, qui étonnait les femmes par son énorme chevelure blonde toute bouffante et frisée.
— Cet horrible apothicaire !… Est-ce assez vexant !
Malgré ces digressions infinies, Maxime venait tout juste d’apprendre, lorsqu’on apporta le café, que Lucien continuait avec succès les affaires de son père, faisait prospérer la scierie, adorait sa femme, et que celle-ci lui avait donné plusieurs enfants. Le nombre en resta pour lui incertain. L’entrée du garçon les ayant interrompus, il oublia de le demander.
— Quelle espèce de cigares veux-tu ? dit Lucien en poussant les boîtes de son côté.
— Je ne fume que des cigarettes.
Et Maxime en prit une dans un fort élégant étui de maroquin, orné d’un chiffre en or, qu’il posa ensuite sur la table.
La vue de cet étui tourna les idées de Lucien dans une voie toute commerciale.
— Cela te rapporte beaucoup d’argent, ton cours, tes bouquins ? demanda-t-il.
Maxime haussa les épaules.
— Mon cours ?… Figure-toi que l’argent manquait pour le fonder. On aurait délibéré, tergiversé encore longtemps, empilé cinquante paperasses, si je n’avais passé par-dessus les bureaux et offert au Ministre de commencer sans aucune espèce de rétribution. Je désirais le faire pour moi-même, ce cours. C’est pour moi que j’y parle, et non pas pour les gens qui m’écoutent.
Lucien eut quelque peine à comprendre qu’un esprit scientifique eût besoin de se fixer à lui-même un cadre, de s’astreindre à des développements, de se présenter des difficultés pour se condamner à les résoudre, de se forcer à tout expliquer pour s’empêcher d’admettre des conclusions hâtives, et de s’imposer, en un mot, cette discipline que Maxime avait recherchée en acceptant une chaire au Collège de France.
— Quant à mes bouquins, poursuivit le jeune professeur, ils font blanchir les cheveux des éditeurs assez dévoués à la science pour consentir à s’en charger.
— Comment ?
— On les tire à cinq cents exemplaires, dont on ne vend pas la moitié, et les frais d’imprimerie sont formidables. Je rature et surcharge tellement mes épreuves, que le bon à tirer ne contient plus une seule ligne identique au manuscrit.
Maxime plaisantait-il ? Son ami n’osa le suivre sur ce terrain. Il n’avait pas lu le traité De l’énergie spécifique des nerfs, et n’avait nulle idée de ce que cet ouvrage pouvait contenir. Croyant comprendre que le jeune professeur de biologie constatait des déboires dans sa carrière, le bon Lucien prit un air vague de sympathie attristée qui amusa beaucoup son ancien camarade.
— Bah ! s’écria-t-il, avec ta fortune, tu peux te passer de succès pécuniaires.
Ce que Lucien appelait la « fortune » de Maxime – trente mille livres de rente – paraissait une misère à côté des millions rapportés par la scierie. Mais c’était une large indépendance assurée au savant, qui, sans cela n’eût pas été, à ce qu’il affirmait, capable de gagner sa vie.
— Je n’aurais pas même su fabriquer des lunettes, comme Spinosa, disait-il.
Ces trente mille francs de rente représentaient le dernier débris d’une grande opulence, que les Dulaure, vieille famille bourgeoise, avaient constituée, au siècle dernier, par de brillants succès au barreau et par de fort belles alliances. Maxime se déclarait fier de l’ancienneté et de l’honorabilité absolue de son nom, bien que ce nom fût roturier.
— Sans l’émiettement actuel de la famille et l’anéantissement du foyer domestique – un mot dénué de sens à notre époque – je me serais soucié d’avoir un fils qui continuât notre modeste et vaillante lignée, disait-il. Mais à quoi bon ?
— Pour moi, lui dit Lucien Gerbier, j’ai fait un mariage d’amour…
Maxime sourit.
— …Un mariage tout à fait inespéré. Ma femme est la propre petite-fille du marquis et de la marquise d’Épeuilles.
— Ce sont des Bretons, comme les Dulaure, et même les deux familles sont des environs de Vannes, fit observer Maxime. Ainsi, ta femme est une demoiselle d’Épeuilles ?
— Durand-d’Épeuilles… Ce n’est pas tout à fait la même chose.
Ce nom archi-roturier de Durand, accolé aux nobles syllabes que, dès la guerre des Deux Jeanne, d’illustres capitaines ont rendues historiques, montrait que Mme Gerbier n’avait pas, la première de sa famille, choisi son mari en dehors de sa caste. Sa propre mère, en effet, follement éprise de l’illustre compositeur Albert Durand, qui jouait chez les d’Épeuilles les merveilleux fragments de ses opéras, attendit pendant des années le consentement de sa famille, arracha ce consentement durant la crise suprême d’une dangereuse maladie, et épousa le musicien.
Dans leur vieillesse, le marquis et la marquise d’Épeuilles virent avec quelque chagrin leur petite-fille, Suzanne Durand, renouveler contre eux la même lutte en refusant tout autre mari que Lucien Gerbier. Ils étaient les tuteurs de la jeune fille, restée orpheline avec sa petite sœur Étiennette. Mais, cette fois, ils offrirent une résistance moins vive. Peu de temps après la demande du jeune et riche industriel, les journaux annoncèrent les fiançailles, puis le mariage, de M. Lucien Gerbier, propriétaire de la grande scierie mécanique, avec Mlle Suzanne Durand-d’Épeuilles, fille de l’illustre compositeur Albert Durand, et petite-fille du marquis et de la marquise d’Épeuilles.
— Et… voilà combien d’années que tu es marié ? demanda Maxime.
— Près de sept ans.
— Parle-moi franchement, dit tout à coup Maxime après un instant de silence. Comment considères-tu le mariage ? Comme un pis-aller naturel et social, ou bien comme une chose bonne en soi ?
— Comme une chose excellente en soi, et qui m’a parfaitement réussi.
— Oui ?… dit rêveusement Maxime.
Il s’arrêta, émietta une cigarette d’un mouvement nerveux, machinal, tandis qu’il examinait curieusement Lucien, puis il dit :
— Oui… Il y a des raisons pour cela. Je vois… Oui…
Lucien, vaguement impatienté par cette attitude, rougissait sans savoir pourquoi sous ce regard perçant.
— Ah çà ! je te fais donc l’effet d’une bête curieuse ? On dirait que tu prends mentalement la mesure de mon crâne.
Maxime sourit encore, sans rien dire, de son sourire aigu devant lequel, soit qu’il le voulût ou non, on éprouvait un irrésistible sentiment d’immense infériorité.
— Je te parais sans doute profondément ridicule ? dit Lucien avec sécheresse.
— Oh ! mon ami…
La crainte de l’avoir blessé mit alors Maxime sur une pente où plusieurs fois, mais en vain, Lucien avait essayé de l’engager.
— Ridicule ?… Ah ! tu ne peux pas l’être autant que moi, je t’en réponds.
— Toi, le sage, le philosophe ? Toi qui traites les passions comme un accès de fièvre ou comme une crise du foie ?… Toi qui méprises les femmes ?… Eh ! mon pauvre Maxime, que veux-tu dire ? Est-ce que tu serais amoureux, par hasard ?…
— Amoureux… Tu l’as dit. Et d’une femme dont je ne connais pas même le nom. Je l’ai aperçue souvent…, dans des circonstances particulières… Mais enfin, je ne sais pas qui elle est. C’est idiot, c’est insensé !… Je ne me retrouve plus. Faut-il que je tombe dans un piège aussi grotesque, à trente-cinq ans ?… Moi, moi !… Une jolie figure, un je ne sais quoi… Et je l’aime, il n’y a pas à dire.
Il se leva, marcha de long en large.
— Mais tu verras, Lucien, tu verras comment un esprit vraiment robuste sait guérir le cœur de ce mal humiliant. Je te montrerai la puissance de la volonté et de la raison… Je les ferai triompher en moi de la sensibilité impulsive, aveugle, de cette sensibilité qui domine chez les femmes, chez tous les êtres inférieurs, et qui nous rapproche de l’animal… Je…
— Est-ce une femme épousable ? interrompit Lucien.
— J’ai tout lieu de le croire.
— Eh bien ! fais-toi présenter. Demande sa main. Emploie ta volonté et ta raison, puisque tu en parles, à conquérir la femme qui peut te rendre heureux.
— Heureux ?… La femme qui peut me rendre heureux ? répéta Maxime, s’adossant à la cheminée sans feu. Mais qu’est-ce que c’est que le bonheur ? Mais quel est le bonheur qu’une femme peut donner ? Si je ne l’aimais pas…, encore ! Mais la femme qu’on aime n’est pas une source de bonheur. Elle est une source d’angoisses et d’abaissements de toutes sortes : dégoût du travail, tyrannie du sentiment, préoccupations ridicules ou mesquines, jalousies, esclavage de la pensée, abdication intellectuelle et morale entre les mains d’un être dénué par nature d’intelligence et de moralité.
— Oh !… s’écria Lucien.
— Eh ! c’est ainsi, mon cher. Cela choque tes préjugés héréditaires d’Européen façonné par le christianisme et par la chevalerie. Le Moyen Âge a exalté la femme, et faussé, en ce qui la touche, les conceptions des races dites supérieures. Mais à mesure que la civilisation la haussait extérieurement plus près de nous, cette même civilisation élargissait l’abîme qui nous sépare d’elle, et qui fait de nous des êtres à jamais différents. Tandis que l’homme progresse, la femme reste immobile. Tu vois la différence entre un sauvage et un membre de l’Institut. Dis-moi donc celle qui sépare une jolie Polynésienne parée de fleurs ou de verroteries, d’avec une élégante Parisienne consultant son carnet de visites et vêtue à la dernière mode ?
Quand Maxime Dulaure abordait ce chapitre, il parlait vivement et beaucoup, ce qui n’était pas dans ses habitudes. Lucien éprouvait à l’écouter un sentiment pénible, pris de soudaines inquiétudes et de doutes secrets quant à sa propre tranquillité conjugale. Il n’était plus si sûr d’être heureux devant les raisonnements du philosophe. C’était, semblait-il, son bonheur personnel que son savant ami démolissait avec des statistiques de divorce, des mensurations de crâne, des courbes de moyennes, des abscisses et des ordonnées crayonnées sur la nappe, prouvant, clair comme le jour, que l’homme et la femme sont aussi peu faits que possible l’un pour l’autre, que la félicité conjugale est une exception ou une duperie, et que l’amour est, chez un être supérieur, la plus honteuse, la plus démoralisante des faiblesses.
— Tiens, partons, dit tout à coup Lucien. Tu m’as donné la migraine… J’ai une indigestion de paradoxes. Il me faut respirer un peu d’air.
Ce brusque accès d’humeur fit rire Maxime.
— Va, ris, grand philosophe. Je t’attends au premier démenti que tu te donneras à toi-même. Tu es amoureux, je n’ai qu’à te laisser faire. Un de ces jours, tu viendras me serrer les deux mains en me disant : « Ah ! mon cher Lucien ! Elle est adorable ! Et nous nous aimons ! Ah ! que je suis heureux ! »
— Jamais ! dit Maxime. Je viendrai te dire : « Lucien, j’ai voulu guérir, je suis guéri. » Cette femme ne sera rien pour moi. Je me suis juré de ne pas même rechercher qui elle est. Et je sais me tenir parole.
— Très bien. Nous verrons, dit Lucien. Ma voiture doit être en bas. Où veux-tu que je te conduise ?
Chapitre II
Quelques jours après cette conversation, Maxime Dulaure fit son dernier cours de la saison au Collège de France.
À trois heures précises, il entra, par la petite porte de l’estrade, dans la grande salle du rez-de-chaussée, s’assit au pupitre et posa près de lui son chapeau, dans lequel il jeta ses gants.
Sa résolution était prise ; il ne tournerait pas la tête à gauche ; il ne regarderait pas si elle était là. – Elle, cette jeune fille inconnue, qui avait le courage d’assister à des leçons tellement difficiles, demandant pour être comprises des années de travaux antérieurs, et qui semblait les suivre avec aisance, avec intérêt, son petit cahier de notes sur les genoux… Non, il ne regarderait pas.
Il la vit cependant, sans avoir besoin de jeter un coup d’œil dans l’angle obscur où, modestement, elle s’asseyait toujours. Il sentit sa présence en une commotion de tout son être.
Un effet bizarre se produisit dans les prunelles, endurcies volontairement, du jeune professeur. Il lui sembla que, de cet angle sombre, un peu en arrière de lui, venait un rayon doux qui était le reflet de ses cheveux, à elle – très blonds, du blond délicieux des chevelures norvégiennes, qui, par leur nuance presque immatérielle, divinisent une tête de femme, il perçut ou devina cette clarté, et comprit qu’elle se trouvait, ce jour-là comme les autres, à sa place habituelle.
« Ah ! » se dit-il avec une sorte de rage, « nous verrons si elle comprendra ce que je vais dire aujourd’hui. À moins qu’elle ne soit bonne comédienne, son visage va, tout à l’heure, exprimer quelque effarement. »
Maxime commença.
« Messieurs, » dit-il, « vous avez remarqué que, depuis plusieurs leçons, je vous ai conduits peu à peu du terrain de la biologie proprement dite sur celui de la psychologie expérimentale. Aux yeux des spécialistes à outrance, je suis peut-être sorti du domaine que je devais explorer avec vous. Mais, si vous avez observé les étapes du chemin que nous avons suivi, vous aurez saisi le fond de ma pensée et constaté avec moi que les deux sciences n’en font qu’une. »
Le jeune savant parlait avec une simplicité, une limpidité d’expressions extraordinaire. Nul autant que lui ne parvenait à être profond sans, pour ainsi dire, le paraître. On devait presque en savoir autant que lui pour saisir la haute portée de certaines phrases dépourvues de termes saillants et prenant, dans sa bouche, des allures inoffensives de lieux-communs. Le charme de sa voix, l’élégance de ses façons, s’ajoutaient à cette absence de pédanterie pour donner à ses leçons le caractère extérieur d’une grave causerie mondaine.
Mais il ne fallait pas s’y tromper. Parmi les nombreux auditeurs venus là, se croyant capables d’affronter les difficultés d’une science aussi peu prétentieuse, beaucoup se contentaient d’entendre, très peu savaient écouter ; car une culture immense et très variée était indispensable pour aborder les questions que traitait Maxime Dulaure.
Cependant on apercevait des femmes, une douzaine peut-être, groupées autour de l’estrade dans l’enceinte spéciale qui leur est réservée. D’abord leur présence agaça, gêna Maxime. Que venaient-elles faire là ? Il était impossible qu’elles comprissent. Elles pouvaient saisir des mots, l’énonciation de certains faits ; mais pénétrer au fond des choses, l’organisation même de leur cerveau, aussi bien que leur éducation première, le leur interdisait absolument.
Elles continuèrent pourtant à assister aux cours, et même leur nombre s’augmenta. Parmi elles ne se trouvaient peut-être pas deux Françaises.
Cinq ou six étudiantes russes étaient reconnaissables à leur face large et blême, à leurs petits yeux bridés, à leur toque disgracieuse posée cavalièrement sur des cheveux coupés très court. Des Anglaises laissaient deviner leurs membres secs dans de longs ulsters de drap collant, et montraient, sous le petit feutre masculin, quatre ou cinq mèches pâles étroitement tortillées sur leur nuque maigre. Des Allemandes, des Suédoises, quelques pauvres filles déjà mûres, à nationalité vague comme leur sexe, composaient ce bizarre auditoire féminin.
« Voilà pourtant, » se disait Maxime avec dégoût, « ce que devient la femme quand elle veut s’élever au-dessus du rôle modeste que la nature lui a départi. »
À l’expression vague, au regard vide offerts par la plupart de ces physionomies ingrates, le professeur voyait distinctement d’ailleurs à quel moment exact ces femmes cessaient de le suivre.
« Pourquoi viennent-elles ? » se répétait-il avec irritation.
Il devinait au fond de leur pédantisme une immense vanité, et aussi, chez quelques-unes, l’âpre besoin de s’asseoir pendant une heure au pied de cette estrade, d’entendre cette chaude voix d’homme, de dévorer des yeux cette tête énergique, peut-être d’en rêver ensuite, obscurément, pendant toute une semaine.
Rien ne saurait rendre l’exaspération de Maxime devant l’évidence de ces choses.
« On devrait leur interdire nos salles de cours, » se disait-il.
Quelquefois il avait essayé d’éloigner à jamais cette partie de son auditoire, soit en traitant trop crûment des questions délicates, soit en démontrant avec une dureté voulue l’irrémédiable infériorité de la femme. Mais il avait trouvé ces représailles mesquines, et son bon goût d’homme bien né, bien élevé, l’arrêtait au moment de l’exécution.
Il arriva qu’un jour son observation perçante, sans cesse en éveil même lorsqu’il parlait, lui montra les regards de ses auditeurs souvent dirigés, comme involontairement, vers l’angle de la salle situé à sa gauche, au-dessous des fenêtres. Il jeta un coup d’œil de ce côté. Il la vit. Dès lors, qu’il regardât directement ou non, il ne perdit plus un détail de sa physionomie, de son expression, de son attitude, ni même de sa toilette.
C’était une jeune fille qui paraissait âgée de dix-huit ou vingt ans – peut-être en avait-elle un peu plus. – Fort élégante dans la grande simplicité de son costume de drap et de son chapeau de velours sombre, elle ne venait jamais seule. Une femme d’âge moyen, sorte de gouvernante, l’accompagnait et portait sa petite serviette en maroquin, à coins et à chiffre d’argent. Toutes deux avaient choisi leur place à l’écart, soit pour n’être pas trop remarquées, soit pour éviter la bouche de chaleur qui s’ouvre au pied de l’estrade. Elles venaient sans doute d’assez bonne heure pour s’assurer la possession de ces deux sièges, voisins de la porte, et elles sortaient vivement les premières, aussitôt la séance terminée.
Maxime devina dans cette attitude l’horreur des contacts avec la foule, ainsi qu’un certain dégoût pour les endroits mal tenus et poussiéreux. Dès qu’il eut remarqué l’allure aristocratique de cette jeune fille, il eut conscience de l’état hideux de désordre où le personnel du Collège laisse une salle qui devrait être, en quelque mesure, imposante. L’estrade, en particulier, avec son tableau crasseux, ses chaises empilées ou renversées, les toiles d’araignées qui en assombrissent les murs, offre un aspect tout à fait choquant. Maxime, chaque fois, hésitait avant de poser son chapeau.
L’inconnue, évidemment, appartenait à l’élite de la société. De sa personne émanait plus encore que de la distinction : une délicatesse à la fois timide et farouche, qui, par instinct, voudrait tout tenir à distance, et qui pourtant cherche à se vaincre ou du moins à se faire pardonner. Dans la douceur hautaine des grands yeux bleu foncé, dans la mobilité des narines très fines, dans le léger retroussement de la lèvre supérieure, on sentait l’exquise essence d’une nature produite par très lente sélection, quelque chose comme une de ces extraordinaires fleurs épanouies pour un jour et incapables de fructifier, dont les efforts d’ingénieux horticulteurs gratifient parfois les expositions des concours.
Les traits menus de cette enfant gardaient toutefois, malgré leur évidente fierté, une expression enjouée, presque mutine. Sa peau, d’une ténuité extrême, se rosait légèrement sur les joues, mais offrait, près des cheveux et autour de ses mignonnes oreilles, des blancheurs de satin. Une seule natte, longue et épaisse, d’un blond septentrional très doux, tombait sur son dos, nouée vers la taille par un étroit ruban cramoisi.
La frêle beauté de cette jeune fille, délicieuse et inquiétante à la fois par son mélange d’orgueil et de puérilité, d’affinement excessif et d’épanouissement charnel, fit sur Maxime Dulaure, presque à première vue, une impression telle qu’il n’en avait jamais éprouvé de semblable. Ce n’est pas trop de dire que, dès le premier jour, il l’aima, car, dès le premier jour, il eut l’idée de redouter ce sentiment et de s’en défendre.
« Cela me sera aisé, » songea-t-il, « puisqu’il s’agit d’une femme ayant le ridicule énorme d’étudier la biologie. »
Durant les leçons suivantes, il l’observa. Son coup d’œil aigu et rapide lui permettait de tout voir sans même paraître regarder.
L’inconnue fixait sur lui des yeux intelligents et tranquilles, qui s’enflammaient à certains moments comme si le vif rayon d’une idée plus lumineuse les eût pénétrés tout à coup. Leur éclat changeant suivait – il n’y avait pas à s’y tromper – tous les raisonnements de Maxime. Le jeune professeur dut en convenir avec lui-même : c’étaient là des regards qui comprenaient. De temps à autre, elle baissait la tête vers son inévitable serviette de maroquin à coins d’argent – le comble de l’affectation aux yeux de Maxime – et elle inscrivait rapidement une note. Ce mouvement correspondait toujours à l’énonciation par le professeur de quelque vérité importante ou de quelque opinion tout originale et personnelle. Il prenait alors un involontaire plaisir à voir onduler la belle natte blonde sur ce long cou d’une invraisemblable blancheur.





























