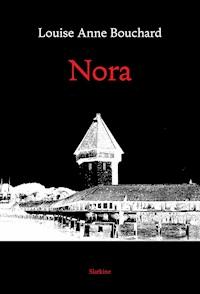
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions Slatkine
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Une nouvelle enquête pour la journaliste Helen Weber.
À Lucerne, Helen Weber, jeune journaliste, s’intéresse à un meurtre commis sur les hauteurs du Rigi.
La disparition de Paul Mutter ne surprend personne, étant donné le passé trouble de ce trentenaire. Mais il va manquer à ceux qui l’ont aimé: Jackson, le policier démis de ses fonctions, et Inana Santini, l’amoureuse discrète qui tient boutique le long de la Reuss.
Ces protagonistes nous mènent vers un accident plus ancien et tout aussi mystérieux : celui de la jeune Nora. Helen Weber enquête, rivalise d’astuces pour élucider ce crime, nous promène dans la ville, croise des personnages tous plus suspects les uns que les autres… Jackson suit Helen dans ses recherches, surpris par les méthodes de cette jeune femme ambitieuse pour trouver un coupable.
Non, Lucerne n’est pas une ville tranquille.
Découvrez sans plus attendre cette enquête policière particulière et sombre, dont le passé des personnages devient un élément clé pour résoudre l'énigme d'une disparition.
EXTRAIT
Une lune coupante et froide allume un versant du Pilate, point de mire de toute la Suisse et au sommet duquel des touristes du monde entier peuvent observer, à l’aide de lunettes grossissantes, l’entièreté de ce si petit pays. En plein jour, on verrait le col ciselé de cette montagne, ses côtés escarpés, les nuages qui se forment avant l’extrémité du pic. On observerait que toute la face nord de ce roc projette son calme dans l’eau du lac des Quatre-Cantons. Mais, sur ce ciel sombre, on n’aperçoit que le profil du Pilate. La ligne pâle qui dessine sa silhouette brute, coupée en deux par l’eau du lac, descend pour indiquer une ville, signalée par un petit bouquet de lumières. Il fait chaud, c’est la nuit, et voici Lucerne. Et dans cette ville il y a Helen Weber. Qui est assise, lasse, ou qui fait semblant de l’être, dans un fauteuil de velours cordé, au milieu d’une aire qui ne fait pas plus de quinze mètres carrés. Elle balance sa jambe par-dessus un des bras du fauteuil. On dirait un scanner. Son mouvement est embarrassé, nerveux. Tension des derniers jours ? Stress du scoop qu’elle ne parvient pas à décrocher ? Possible. Le journal qui l’emploie attend qu’elle redresse (à elle seule) les ventes hebdomadaires. Facile à dire ! Soixante-quinze mille habitants, presque jamais rien qui se passe, sauf des mouvements de masse d’Américains ou de Japonais qui ne cessent de bombarder la ville de clichés… Rien ? Pas tout à fait. Parfois, au bord de la rivière, un jeune homme ou une très jeune femme meurt : ils font partie des paumés qui tiennent lieu d’escadron à la Reuss, les yeux hagards, fixés sur quelque chose connu d’eux seuls, une aiguille plantée dans une veine, des résidus de came au fond d’une cuillère sale.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Une excellente surprise pour un récit parfaitement orchestré dans sa brièveté et dans son ambiance trouble où l’émotion et les souvenirs de l’auteur affleurent à chacune des pages de ce roman policier singulier. -
Bibliosurf
À PROPOS DE L'AUTEUR
Canado‐suisse,
Louise Anne Bouchard habite en Europe depuis vingt‐cinq ans. Photographe de formation, scénariste, elle a publié douze romans et de nombreuses nouvelles. Elle a reçu le Prix Contrepoint de la Littérature (Paris) en 1994 pour son roman, La Fureur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 196
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Dédicace
À Sheila et Sara
Chapitre 1
Une lune coupante et froide allume un versant du Pilate, point de mire de toute la Suisse et au sommet duquel des touristes du monde entier peuvent observer, à l’aide de lunettes grossissantes, l’entièreté de ce si petit pays. En plein jour, on verrait le col ciselé de cette montagne, ses côtés escarpés, les nuages qui se forment avant l’extrémité du pic. On observerait que toute la face nord de ce roc projette son calme dans l’eau du lac des Quatre-Cantons. Mais, sur ce ciel sombre, on n’aperçoit que le profil du Pilate. La ligne pâle qui dessine sa silhouette brute, coupée en deux par l’eau du lac, descend pour indiquer une ville, signalée par un petit bouquet de lumières. Il fait chaud, c’est la nuit, et voici Lucerne. Et dans cette ville il y a Helen Weber. Qui est assise, lasse, ou qui fait semblant de l’être, dans un fauteuil de velours cordé, au milieu d’une aire qui ne fait pas plus de quinze mètres carrés. Elle balance sa jambe par-dessus un des bras du fauteuil. On dirait un scanner. Son mouvement est embarrassé, nerveux. Tension des derniers jours ? Stress du scoop qu’elle ne parvient pas à décrocher ? Possible. Le journal qui l’emploie attend qu’elle redresse (à elle seule) les ventes hebdomadaires. Facile à dire ! Soixante-quinze mille habitants, presque jamais rien qui se passe, sauf des mouvements de masse d’Américains ou de Japonais qui ne cessent de bombarder la ville de clichés… Rien ? Pas tout à fait. Parfois, au bord de la rivière, un jeune homme ou une très jeune femme meurt : ils font partie des paumés qui tiennent lieu d’escadron à la Reuss, les yeux hagards, fixés sur quelque chose connu d’eux seuls, une aiguille plantée dans une veine, des résidus de came au fond d’une cuillère sale. Fils et filles de banquiers désillusionnés, gosses de riches, la plupart du temps, à qui on a tout donné, sauf un avenir et de l’espoir. On met un entrefilet dans le journal : la nouvelle ne mérite même plus l’éditorial. Helen, distraitement, balaye la pièce d’un air ennuyé. Son unique pièce. Toute sa vie est éparpillée, là, dans cette aire qu’on aura vite fait de débarrasser, en cas d’accident. Elle est plutôt jolie, Helen. Un regard glauque, une peau lisse (comment peut-il en être autrement quand on a vingt-cinq ans ?), des cheveux noirs et brillants, une frange qui couvre de mèches folles et irrégulières son front, une moue dédaigneuse. Un tempérament de marbre, apparemment. Sa pièce, son métier, sa vie, ses objectifs. Elle martèle chacun des mots au fond de sa tête en fixant les meubles. Une étagère qui résiste – Dieu sait comment encore ! – à une avalanche de documents dont les notes manuscrites cascadent jusqu’au sol. Un immense lit, défait, des draps écrus et une penderie, ouverte, qui offre à sa vue des vêtements d’homme et de femme. Helen se lève, s’avance en chaloupant, avec, dans la démarche, comme un mal qui l’engourdit. Elle allonge le bras, suspend son mouvement, le laisse en attente, puis décroche un veston d’homme. Le regarde, le palpe et le remet à sa place. Helen n’est pas encore convaincue d’avoir noyé sa peine. Définitivement. Son regard s’est ombragé. Elle s’en veut de cette dépendance obsessionnelle qui l’a liée à un homme. Les yeux d’Helen se faufilent, à la recherche d’un objet, d’une chose qui puisse la dérober à ce souvenir qui la cisaille. Un téléphone aux couleurs amusantes, un télécopieur, un ordinateur portable, une large fenêtre qui donne sur la rue. Sur la Winkelriedstrasse. Sur une artère grouillante. Cafés, bistrots et terrasses. On y cause dans une polyphonie qui, parfois, sème la confusion des sentiments. Quatre langues officielles. Des dialectes à n’en plus finir. Une tour de Babel sur une aussi petite surface. Des tilleuls, des pins, du béton, une architecture aux couleurs pastel, des marchés odorants deux fois par semaine et une eau si propre qu’on peut la boire en faisant une coupe de ses deux mains réunies. Une toile de fond superbe dans cette cacophonie. Helen respire. Ce pays apparemment si propre. La mémoire de la jeune femme se permet un entracte. Le bruit des glaçons qu’elle agite d’un doigt blanc au fond d’un verre de cristal. Du revers de sa main libre, elle lisse, pour personne, le tissu de son kimono sombre. Comme si ce geste attentif, qui ne sert à rien, à rien du tout, la faisait se souvenir qu’elle est une femme seule. Helen lève son verre, le cogne à l’imaginaire et avale une gorgée. Le souvenir semble la briser un moment encore, mais elle finit par se persuader, en tournant le dos à la fenêtre, qu’on est toujours seul et qu’alors il serait complètement idiot d’éprouver une jalousie quelconque. Un rai de lumière filtre sous la porte d’entrée. Helen entend des voix gaies, jeunes aussi, des silences qu’elle envie maintenant et des rires joyeux étouffés dans les étreintes qu’elle devine. La vie dans cet escalier, éclairé par les couleurs pilées ensemble d’un immense vitrail qui date du début du siècle. Helen va vers le fond de la pièce, à la recherche d’un espace pour dissoudre sa nostalgie. Sa table de travail. Ce n’est pas un métier, journaliste ! Les livres s’empilent, offrent des rames jaunies ou écrues, des pages ouvertes et des documents qu’on laisse traîner (expositions et cocktails de toutes sortes), des histoires à suivre et des coupures de journaux dans lesquelles elle s’efforce de lire entre les lignes. Mais rien ne se passe vraiment, dans cette ville. Le regard d’Helen se réanime, le temps d’un éclair, lorsque le télécopieur s’active. Elle dépose sa coupe au milieu de papiers roulés en boule, destinés à sa corbeille déjà pleine, s’approche et attend, impatiente, que les mots s’alignent sur la copie. Le message vient du Luzerner Press : on lui annonce, en phrases télégraphiques, concises et ô combien précises !, qu’elle risque d’être virée dans les jours qui viennent si elle ne trouve aucune nouveauté. Elle retire la feuille de la rame, entreprend de la chiffonner, lentement. Depuis deux ans, elle a une connaissance parfaite de ces menaces qui lui parviennent régulièrement. Elle a appris, jeune, qu’elle n’aurait droit à aucune indulgence, de personne, et que lorsque l’on tend vers un but il faut être convaincu d’y parvenir. De sa main très blanche, elle fouille un moment au milieu du chaos de sa table, à la recherche d’un stylo ou d’un document, pressée de se remettre à la tâche. C’est la photo de Pierre qui fait surface, Pierre et son regard malicieux et moqueur, désormais fixé sur une rivale qu’Helen ne connaît pas encore. Tout ce qu’elle sait de cette inconnue, c’est qu’elle est sud-américaine, qu’elle est venue en Suisse pour parfaire des études de traduction et que Pierre la fréquente sans remords aucun. Le choc de cette photo récente et détourée cueille Helen en plein mouvement. Un court instant. Puis, avec un geste de colère, Helen retire sa perruque noire et l’envoie valser sur une tête de celluloïd, coupée au ras du cou, qui se trouve sur une commode, entourée de divers produits et babioles. Les cheveux d’Helen apparaissent maintenant, courts et roussâtres, boucles aplaties auxquelles elle redonne vie en s’ébouriffant sauvagement, des dix doigts ensemble, le crâne et la nuque. Dans sa folle naïveté, elle a peut-être cru que Pierre lui reviendrait si elle s’accordait au diapason physique des beautés du Sud. Peut-être. Helen réfléchit en regardant les cheveux synthétiques qui se balancent encore sur ce relief de visage humain, mais qui apparaît sans yeux, sans bouche et amputé de toute expression, dans cette lumière mobile et laiteuse du début de la nuit. Les cheveux noirs se figent enfin sur le modelé des joues, des mèches lourdes et noires s’accrochent aux pores graveleux du support déjà ancien.
Chapitre 2
Jackson marche d’un pas rapide sur la Waldstatterstrasse : il sait que Paul ne supporte pas qu’on le fasse attendre. Jackson a une connaissance parfaite de cette ville : il y a presque toujours vécu. Ses parents, de souche américaine, ont exploité à Zoug (localité à la fiscalité légère), de longues années durant, une firme pharmaceutique. La bataille fut dure, mais ils obtinrent le succès escompté. Ils ont acheté une maison à Lucerne, dans la vieille ville. Jackson y a grandi, fait une partie de ses études, connu ses premières et brèves amours et, lorsque les Clark décidèrent de rentrer en Amérique couler une retraite qu’ils avaient largement méritée, avec des mots sages et avec des promesses d’aller les rejoindre dès que possible, Jackson choisit de poursuivre sa vie en Suisse. Peut-être était-ce son lien profond avec la nature de ce pays qui l’avait empêché de partir. Il éprouve toujours une vibration heureuse lorsqu’il regarde cette ville et ses alentours. Et tant et aussi longtemps qu’il ressentira cette secousse il restera. Méthodique, Jackson a toujours calculé son existence par tranches de vie et, alors qu’il entame sa quarantaine, il a choisi de passer encore dix ans ici. Jackson aperçoit les premières chaises en rotin de la terrasse de l’Helvetia. La terrasse donne directement sur la rue, et sa petite surface qui sert à accueillir les clients est recouverte de larges parasols écrus qui, le jour, protègent de la chaleur et, le soir, comme maintenant, servent de réflecteurs à la lumière artificielle. Il y a beaucoup de bruit. Et de gens. Jackson reconnaît certains visages pour les avoir trop souvent croisés dans la ville. Des conversations futiles qu’il a cherché à oublier, mais qui, à force de banalités, viennent quand même s’installer dans la mémoire. Fait beau, fait chaud, machin veut se séparer… Certains jours, la promiscuité et l’absence de toute intimité de cette petite ville l’agacent. Comme aujourd’hui. Jackson reconnaît Amin, un Marocain venu faire Dieu sait quoi dans cette ville. S’il comprend que sa tête habilement dessinée de jeune seigneur africain puisse plaire aux femmes, Jackson ignore les raisons des gens qui s’attachent à Amin. Toujours un pied dans la tradition quand ça l’arrange, mais toujours également prêt à vendre sa mère pour une poignée de centimes. Jackson rase les tables qui donnent sur la rue, et Amin détecte immédiatement sa présence. Il a le flair d’un voyou pour repérer rapidement à qui il pourrait emprunter quelques francs. Amin se lève, balance le bras en l’air et, avec des paroles qui s’évanouissent au-dessus des tables, invite Jackson à venir les rejoindre, lui et une bande d’amis. Jackson sourit, mais tapote rapidement sa montre, qui lui sert d’alibi. C’est un prétexte, une toute petite opération de coulisse fiable : pressé. Très pressé. Amin se rassoit, semble déçu. Jackson sait qu’Amin va le suivre du regard un moment et que demain ou après-demain il lui demandera, ironique :
– Paul Mutter va bien ?
Lucerne est si petite que même les enfants n’arrivent pas à s’y perdre. La lune danse un moment au-dessus de la ville, brouillée par un nuage qui s’agite devant elle. Un orage se prépare peut-être, encore qu’ici, dans ce coin de pays, le microclimat reste imprévisible. Quelques connaissances se retournent sur le passage de Jackson. Têtes qu’il ignore, parce qu’il vient d’apercevoir Paul assis, tendu, au milieu de ce bouquet de Lucernois et de touristes.
Paul a le regard qui flotte au-dessus de son alcool froid. Le col de sa chemise est ouvert, non pas tant à cause de la chaleur, mais surtout à cause de cette impression de doigts immenses qui l’étranglent. Depuis le matin. Paul fore un terrain vague, enfoui dans le brouillard. Jackson pose sa main sur son épaule et Paul sursaute. Jackson s’assoit, après une brève salutation. Pour l’instant, toute l’explication de Paul est consignée dans un seul « bonsoir ». Paul juge qu’il est urgent de rompre le malaise. Il s’empare d’un verre de vin devant lui, dilué dans de l’eau minérale, le remplit et le tend à Jackson.
– Tu fréquentes de drôles de gens, Paul.
– On ne peut pas tous naître dans le fric, Clark.
Le regard des deux hommes se lâche. Il y a quelque chose qui s’emballe dans le cerveau de Jackson. Il aurait envie de crier une irrationnelle pensée, mais il ne doit pas. Le plus traqué des deux, ce n’est pas lui. Une malédiction se mêle à la conversation, et Jackson hume le danger qui rôde autour de Paul. Jackson fouille au fond de sa poche, s’empare d’un briquet embossé d’initiales et allume une cigarette. Il met le briquet bien en vue entre eux. Une preuve de son impuissance. Même en étant à l’aise. Même avec tout l’or du monde. Jackson n’est pas troublé : il rage.
– Elle te manque, fait Paul en effleurant la calligraphie du métal.
– Devine.
– Excuse-moi.
– Je suis supposé faire quoi, au juste, avec toi ?
– M’accompagner.
Jackson souffle longuement une bouffée de cigarette qui monte haut au-dessus de la table et qui se mêle à une centaine d’autres volutes. L’ambiance est encore indifférente aux sueurs froides de Paul. On jacasse autour d’eux. On entend des rires et, happé par ses souvenirs, Jackson croit reconnaître celui de sa femme. Il prend conscience qu’il rêve lorsqu’il entend la fille du café, la même qui s’est usée partout dans cette ville, dans tous les bistrots, pendant vingt ans, à servir tout le monde, sauf elle, droite, plantée devant la table, avec une vague ondulation de tout le corps, qui cherche à séduire, encore, un plateau à la main. Une fille toute banale, qui s’est collée au fond de bien des draps, dans l’espoir de trouver.
– Besoin de rien, Jackson ? fait-elle d’une voix lasse.
Jackson aurait envie de dire oui tant son souvenir le matraque. « Je voudrais m’en aller », voudrait-il prononcer. Mais il secoue la tête, envoie valser son nœud de nostalgie et reprend son face-à-face avec Paul. Demeure en attente un moment. Le temps de comprendre.
– Tu veux que je te serve d’escorte pour une soirée dansante, si je comprends bien ?
– Ça risque de valser, effectivement.
Paul n’a pas souri. À peine une lumière biseautée dans son regard, que Jackson capte comme un remerciement. Les meilleurs amis du monde. Rarement le besoin entre eux de rétablir la continuité des choses. Depuis le temps ! Cette amitié-là, c’est la plus belle chose que Paul ait connue. Paul regarde Jackson, avise l’expression désolée de son visage et, pour un peu, lui dirait que c’est une mauvaise blague, qu’ils vont aller finir la soirée au Magdalena, rue Eisengasse, se perdre et s’enivrer parmi les paumés, rire et ne se soucier de rien. Comme tant d’autres.
– Et si je te paie une rente jusqu’à la fin de tes jours, tu pourrais t’arrêter, non ?
Paul sait que Jackson lui reproche sa faiblesse de caractère. Cette fois-ci, pourtant, Paul ne va pas arracher de l’argent à l’adversaire, il va en donner. Il se penche, attrape une petite sacoche de cuir souple qu’habituellement les voyageurs portent autour de la taille, l’ouvre et froisse entre le pouce et l’index une infinie quantité de billets colorés. À la lumière des quartz au-dessus des tables, Jackson évalue la somme à plusieurs milliers de francs. Jackson tire à lui l’accessoire noir et en remonte tranquillement la fermeture. Le bleu d’un billet se coince dans le métal et produit un craquement sec. La sacoche reste au milieu de la table. Paul se tait, avec la manière coutumière qu’il a d’exprimer sa peur. Jackson fouille au fond de sa poche, en retire quelques francs qu’il dépose dans une assiette de faïence blanche. Les deux hommes se lèvent, passent entre les tables, et Jackson dédaigne encore les appels d’Amin qui agite le bras dans la chaleur de la nuit. Ils s’éloignent de l’Helvetia, d’une atmosphère de fête que Paul n’est pas certain de jamais retrouver. Jackson marche devant lui comme si déjà il s’adaptait à son rôle d’éclaireur.
À l’angle de la Waldstatterstrasse et de la Moostrasse, une silhouette floue s’asperge la nuque avec l’eau de la fontaine. Helen reconnaît Paul pour l’avoir souvent vu en photo. Elle sait aussi qui l’accompagne. Puis, à la lumière d’une charretée d’étoiles au-dessus d’elle, elle fixe l’élégante calligraphie noire d’une carte qu’elle tient à la main.
Chapitre 3
Jackson et Paul se tiennent appuyés contre la carrosserie d’une Volvo. Les phares sont allumés comme un signal convenu. Deux faisceaux lumineux éclairent le chemin graveleux, devant eux. C’était d’abord un petit morceau de route escarpée en direction du Rigi, puis c’est devenu une aire lisse, qu’on dirait défrichée expressément. Ils se sont arrêtés là. Et ils attendent. C’est un tout petit endroit, un territoire à prendre. Des bruits incertains, des animaux qui rôdent sans doute autour. Et il fait une chaleur d’enfer. De temps à autre, un éclair déchire le ciel. Paul triture nerveusement sa cigarette et, entre deux mouvements de tête rapides, porte la main à son ventre. Chaud et mal. La sueur perle sur son front. Jackson pense maintenant qu’il rentrera en Amérique. Il ira retrouver ses vieux. Il ira oublier ailleurs. On appelle cela l’illusion géographique. Il croit qu’il sera mieux, sans cette ville qui le nargue, sans ses souvenirs constants. Il emmènera Paul aussi. Il lui fera traverser l’océan. Il le planquera quelque part jusqu’à ce que ses ambitions tordues disparaissent. Pour un temps, ils dédaigneront les soirées, les rencontres. Ils se referont. Comme si un courant télépathique le traversait, Paul oscille de la tête. Regarde sa montre. Fait non et puis oui. Penchant la tête de côté, il prend son air de gamin tranquille. Il a cessé de tressaillir comme un animal traqué. Quelque chose l’a empalé soudainement. On dirait que le bon sens l’irrigue de nouveau, qu’il est soudainement préparé à vivre. Il est encore temps.
– On doit me remettre un jade. Mais je n’en veux plus. Je dirai qu’ils ont pris l’argent et que je n’ai rien pu faire.
Paul ouvre sa veste de coton, remonte son T-shirt marine et retire la sacoche noire qui lui ceint le ventre. Il se penche et la dépose au sol. Il regarde Jackson, et leurs visions se fondent. Complices. Un sourire flotte. Étale sur les deux visages. Une étoile rase le sol, jaillit d’un buisson à dix mètres d’eux. La première détonation touche Jackson. Paul n’a pas le temps de remettre de l’ordre dans ses pensées, Jackson semble être projeté en avant, attiré par la lumière de la lune. Il ouvre les bras, surpris par la brûlure. Un temps de folie. Tout va trop vite. Il y a des bruissements de feuilles autour d’eux, des bruits d’ailes qui battent à un rythme fou puis qui s’envolent en tous sens. Une atmosphère électrique s’empare du ciel. Un autre coup part. Derrière eux. Le visage de Paul exprime de la stupeur, de l’étonnement, presque un ravissement enfantin. Paul ressent comme un coup de poing dans le dos. Puis il a mal quand il respire. Il a l’impression que la nuit devient poudreuse autour de lui. Un mur de cendres se dresse et danse devant ses yeux. Le sol le rattrape. Il s’effondre. Se relève. Sa veste sent désormais la poussière. Il voit Jackson, au sol, face contre terre, qui ne remue pas. Paul ne fait plus aucun effort pour bouger. Un goût de rouille lui serre la gorge. Le souvenir de quelques bons moments lui brouille désormais la vue. Une vague douleur le parcourt. Il se sent calme. Quelque chose éclate encore au milieu de sa poitrine. Le sang part en rigoles aux commissures de ses lèvres. Paul surmonte l’épreuve du passé qui défile devant lui. Ça fait juste l’effet d’une pointe de cristal dont la lumière et la chaleur irriguent chaque veine. Ses yeux clignent. Il n’a pas l’impression de souffrir, au contraire, il sent qu’il pourrait vivre heureux, maintenant. Le ciel le sait aussi, mais il le laisse mourir.
Chapitre 4
Jackson ouvre les yeux. Un feu d’artifice blanc lui brouille encore la vue. Le décor refait tranquillement surface autour de lui et Jackson devine, plus qu’il ne voit, les traits d’Helen à quelques centimètres de son visage. Le visage de la journaliste lui semble d’abord figé dans un masque de cire. Puis il voit ses yeux, bleu-vert, sa bouche et enfin ses longs doigts qu’elle agite devant lui, serrés autour d’un morceau de métal. Petit calibre, mais suffisamment fort pour tuer un homme.
– Je m’apprêtais à écrire un article sensationnel pour vanter les mérites du « fitness », mais là, dit-elle en agitant la balle devant ses yeux, je ne sais plus…
La quarantaine enveloppée de Jackson vient de lui sauver la vie. L’adversaire a tiré dans le gras de la taille épaisse. Jackson porte la main à sa blessure, et ses doigts devinent un sparadrap large, sous le tissu de sa camisole. Il bouge la tête en signe de remerciement, capte les alentours rapidement. Il y a des habitudes de flic qu’on ne perd jamais : un détail arraché peut avoir une valeur d’or. Il voit sa chemise sale et poussiéreuse sur le dossier d’une chaise, ses chaussures l’une contre l’autre sur le siège recouvert de motifs de tapisserie. Bien rangées. Trop bien rangées dans ce désordre. Un chaos calculé. Un capharnaüm élégant. Helen se relève. L’échancrure de son kimono bâille, et Jackson l’évalue rapidement, la vingtaine, cette peau nue et blanche qui fait contraste avec le mordoré de l’habit. Helen enfourne la balle dans la poche du vêtement et s’arrête devant la large fenêtre qui donne sur la Winkelriedstrasse. La lueur froide de la lune enveloppe son visage d’une lumière douce. Elle regarde droit devant elle. Ses jambes nues sortent du vêtement court.
– Je viens de vous sauver la vie, Jackson.
– Qui vous a dit mon nom ?
– C’est le nom que votre partenaire a prononcé avant de mourir. J’ai supposé que c’était vous, poursuit-elle sans se retourner. Il s’appelait comment ?
– Paul.
– Je n’ai rien pu faire pour lui.
Jackson s’assoit enfin et, pour la première fois depuis plusieurs minutes, il ne ressent plus cette douleur qui le cisaillait à la taille, mais il a mal ailleurs : avec remords, il éprouve une sorte de délivrance pour Paul. Jackson se lève, vacille, se rattrape au tissu de la chaise, devant lui, et l’étourdissement se calme. Il fait quelques pas dans la pièce, bute contre une petite table en rotin sur laquelle traînent une bouteille d’alcool et quelques verres sales, s’appuie avec la paume sur la table de travail bon marché, va vers Helen qui ne s’est pas encore retournée.
– Vous étiez seule ?
Elle le regarde enfin, le nargue en plein visage, soutient sa question avec témérité.
– Ils étaient deux. Armés. Quand ils ont cru que vous étiez morts, Paul et vous, ils se sont approchés et ont ramassé un sac au sol. Ils ont disparu rapidement. Ils étaient affolés, je crois. Je n’ai pas vu leur voiture, mais j’ai entendu le bruit d’un moteur qui s’éloignait dans la nuit. J’ai ramené l’essentiel : un vivant et les affaires de Paul que j’ai là, dans mon sac, fait-elle en pointant l’accessoire sur sa table de travail.
Jackson a envie de jouer à l’embrouiller.
– Vous avez pris les papiers de Paul ?
– Il n’avait aucune carte d’identité sur lui.





























