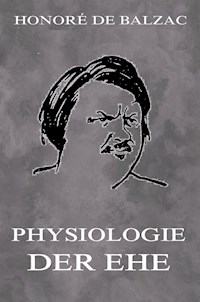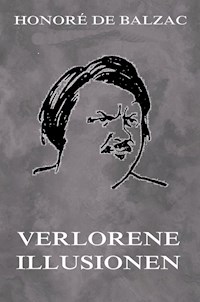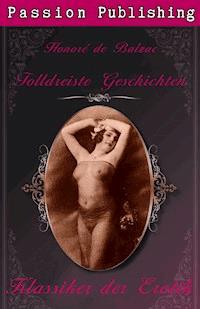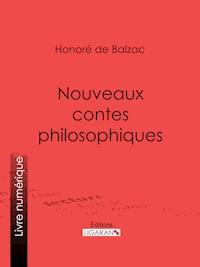
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "En 1479, le jour de la Toussaint, au moment où cette histoire commença, les vêpres étaient dites à la cathédrale de Tours, et l'archevêque, Hélie de Bourdeilles, se levait de son siège pour donner lui-même la bénédiction aux fidèles. Le sermon ayant duré longtemps, la nuit était venue pendant l'office, et l'obscurité la plus profonde régnait alors dans certaines parties de cette belle église..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Comme celui qui conte, ainsi comme une histoire,
Que les fées jadis les enfançons volaient ;
Et, de nuit, aux maisons, secrètes, dévalaient
Par une cheminée…
(DE LA FRESNAYE-VAUQUELIN.)
En 1479, le jour de la Toussaint, au moment où cette histoire commença, les vêpres étaient dites à la cathédrale de Tours, et l’archevêque, Hélie de Bourdeilles, se levait de son siège pour donner lui-même la bénédiction aux fidèles.
Le sermon ayant duré longtemps, la nuit était venue pendant l’office, et l’obscurité la plus profonde régnait alors dans certaines parties de cette belle église, dont les deux tours n’étaient pas encore achevées. Cependant bon nombre de cierges brûlaient en l’honneur des saints sur les porte-cires triangulaires destinés à recevoir ces pieuses offrandes, dont aucun concile n’a su nous expliquer le mérite ; les luminaires de chaque autel et tous les candélabres du chœur étaient allumés ; mais ces masses de lumière, inégalement semées à travers la forêt de piliers et d’arcades qui soutient les trois nefs de la cathédrale, en éclairaient à peine l’immense vaisseau. En projetant les fortes ombres des colonnes ou les légères découpures des ornements sur les hautes et longues galeries de l’édifice, ces clartés vacillantes y produisaient mille fantaisies, et faisaient vigoureusement ressortir les ténèbres dans lesquelles étaient ensevelis les arceaux élevés, les cintres, les voussures, et surtout les chapelles latérales déjà si noires en plein jour. La foule offrait des effets non moins pittoresques. Certaines figures se dessinaient si vaguement dans le clair-obscur qu’on pouvait les prendre pour des fantômes ; tandis que plusieurs autres, frappées en plein par des lueurs éparses, attiraient l’attention comme les têtes principales d’un tableau. Puis, les statues semblaient animées, et les hommes pétrifiés ; çà et là, des yeux brillaient dans le creux des piliers ; la pierre jetait des regards ; les marbres parlaient ; les voûtes répétaient des soupirs ; enfin, l’édifice entier paraissait doué de vie.
L’existence des peuples n’a pas de scènes plus solennelles ni de moments plus majestueux. À l’homme en masse, il faut toujours du mouvement pour faire œuvre de poésie ; mais à ces heures de religieuses pensées, quand les richesses humaines sont mariées aux grandeurs célestes, il y a d’incroyables sublimités dans le silence, de la terreur ou de l’espoir dans le repos, de l’éloquence dans les genoux pliés et dans les mains jointes. Le concert de sentiments qui résume la force des âmes en un même élan produit alors un inexplicable phénomène de spiritualité. La mystique exaltation de tous les fidèles assemblés réagit probablement sur chacun d’eux, et le plus faible est porté peut-être sur les flots de cet océan d’amour et de foi. Puissance tout électrique, la prière arrache ainsi notre nature à elle-même en la concentrant ; et cette involontaire union de toutes les volontés, également prosternées à terre, également élevées aux cieux, contient sans doute le secret des magiques influences que possèdent le chant des prêtres et les mélodies de l’orgue, les parfums et les pompes de l’autel, les voix de la foule et ses contemplations silencieuses.
Aussi ne devons-nous pas être étonnés de voir au Moyen Âge tant d’amours commencées à l’église après de longues extases, amours souvent dénouées peu saintement, mais dont les femmes finissaient, comme toujours, par faire pénitence. Le sentiment religieux avait alors certaines affinités avec l’amour ; il en était ou le principe ou la fin. Alors, l’amour était encore une religion ; il avait encore son beau fanatisme, ses superstitions naïves, ses dévouements sublimes qui sympathisaient avec ceux du christianisme ; et si leurs mystères concordaient si complaisamment, les mœurs de l’époque peuvent assez bien expliquer cette singulière alliance.
D’abord, la société ne se trouvait guère en présence que devant les autels. Seigneurs et vassaux, hommes et femmes n’étaient égaux que là ; là seulement, les amants savaient se voir et correspondre. Puis, les fêtes ecclésiastiques composaient presque tout le spectacle du temps ; et l’âme d’une femme était alors plus vivement remuée au milieu des cathédrales qu’elle ne l’est aujourd’hui dans un bal ou à l’Opéra : or, presque toutes les fortes émotions ramènent les femmes à l’amour. Enfin, à force de se mêler à la vie et de la saisir dans tous ses actes, la religion s’était rendue également complice et des vertus et des vices. La religion avait passé dans la science, dans la politique, dans l’éloquence, dans les crimes, sur les trônes et dans la peau du malade et du pauvre ; elle était tout.
Ces observations demi-savantes justifieront peut-être la vérité de cette historiette, dont certains détails pourraient effaroucher la morale perfectionnée de notre siècle, un peu collet-monté, comme chacun sait.
Au moment où le chant des prêtres vint à cesser, quand les dernières notes de l’orgue se mêlèrent aux vibrations de l’amen sorti de la forte poitrine des chantres, et pendant qu’un léger murmure retentissait encore sous les voûtes lointaines, au moment où toute cette assemblée attendait, dans le recueillement, la bienfaisante parole du prélat, un bourgeois, pressé de rentrer en son logis, ou craignant pour sa bourse le tumulte de la sortie, se retira doucement, au risque d’être réputé mauvais catholique.
Aussitôt, un gentilhomme tapi contre un des énormes piliers qui environnent le chœur, où il était resté comme perdu dans l’ombre, s’empressa de venir prendre la place abandonnée par le prudent Tourangeau ; mais, en y arrivant, il se cacha promptement le visage dans les plumes qui ornaient son haut bonnet gris, et s’agenouilla sur la chaise avec un air de contrition auquel un inquisiteur aurait pu croire.
Après l’avoir assez attentivement regardé, ses voisins parurent le reconnaître, et se remirent à prier en laissant échapper certain geste indéfinissable, par lequel ils exprimèrent une même pensée, pensée caustique, railleuse ; c’était comme une médisance muette. Deux vieilles femmes hochèrent même la tête en se jetant un mutuel coup d’œil, et ce coup d’œil voyait dans l’avenir.
La chaise, dont le jeune homme s’était emparé, se trouvait près d’une chapelle pratiquée entre deux piliers, et fermée par une grille de fer.
Le chapitre louait, moyennant d’assez fortes redevances, à certaines familles seigneuriales, ou même à de riches bourgeois, le droit d’assister aux offices, exclusivement, eux et leurs gens, dans les chapelles latérales, situées le long des deux petites nefs qui tournent autour de la cathédrale. Cette simonie se pratique encore aujourd’hui. Une femme avait alors sa chapelle à l’église, comme de nos jours elle prend une loge aux Italiens. Les locataires de ces places privilégiées ayant en outre la charge d’entretenir l’autel qui leur était concédé, chacun mettait son amour-propre à décorer somptueusement le sien, vanité dont l’église s’accommodait assez bien.
Or, dans cette chapelle et près de la grille, une jeune dame était agenouillée sur un beau carreau de velours rouge à glands d’or, précisément auprès de la place précédemment occupée par le bourgeois. Une lampe d’argent vermeil suspendue à la voûte de la chapelle, devant un autel magnifiquement orné, jetait sa pâle lumière sur le livre d’Heures que tenait la dame ; et ce livre trembla violemment dans ses mains quand le jeune homme vint près d’elle.
– Amen…
À ce répons, chanté d’une voix douce, mais cruellement agitée, et qui heureusement se confondit dans la clameur générale, elle ajouta vivement et à voix basse :
– Vous me perdez !…
Cette parole fut dite avec un accent d’innocence auquel devait obéir un homme délicat ; elle allait au cœur et le perçait ; mais l’inconnu, sans doute emporté par un de ces paroxysmes de passion qui étouffent la conscience, resta sur sa chaise et releva légèrement la tête, pour jeter un coup d’œil dans la chapelle.
– Il dort !… répondit-il d’une voix si bien assourdie, que cette réponse dut être entendue par la jeune femme comme un son par l’écho.
Elle pâlit ; et son regard furtif, quittant pour un moment le vélin du livre, se dirigea sur un vieillard que le jeune homme avait regardé.
Quelle terrible complicité ne se trouvait-il pas dans cette œillade !…
Lorsque la jeune femme eut examiné ce vieillard, elle respira fortement et leva son beau front orné d’une pierre précieuse vers un tableau où la Vierge était peinte ; ce simple mouvement, son attitude, son regard mouillé, disaient toute sa vie avec une imprudente naïveté. Perverse ; elle eût été dissimulée.
Le personnage qui faisait tant de peur aux deux amants était un petit vieillard bossu, presque chauve, de physionomie farouche, ayant une large barbe d’un blanc sale et taillée en éventail. La croix de Saint-Michel brillait sur sa poitrine. Ses mains rudes, fortes, sillonnées de poils gris, et que, d’abord, il avait sans doute jointes, s’étaient légèrement désunies pendant le sommeil auquel il se laissait si imprudemment aller. Sa main droite semblait prête à tomber sur sa dague, dont la garde formait une espèce de grosse coquille en fer sculpté. Par la manière dont il avait rangé son arme, le pommeau se trouvait sous sa main ; et si, par malheur, elle venait à toucher le fer, nul doute qu’il ne s’éveillât aussitôt, et ne jetât un regard sur sa femme. Or, il y avait sur ses lèvres sardoniques, et dans son menton pointu capricieusement relevé, les signes caractéristiques d’un malicieux esprit, d’une sagacité froidement cruelle qui devait lui permettre de tout deviner, parce qu’il savait tout supposer. Son front jaune était plissé comme celui des hommes habitués à ne rien croire, à tout peser, et qui, semblables aux avares faisant trébucher leurs pièces d’or, cherchent le sens et la valeur exacte des actions humaines. Il avait une charpente osseuse et solide ; il était nerveux, paraissait très irritable ; bref, vous eussiez dit un ogre manqué.
Donc, au réveil de ce terrible seigneur, un inévitable danger attendait nécessairement la jeune dame ; car, mari jaloux, il ne manquerait pas de reconnaître la différence qui existait entre le vieux bourgeois, dont il n’avait pas pris ombrage, et le nouveau venu, courtisan jeune, svelte, élégant.
– Libera nos à malo !… dit-elle en essayant de faire comprendre ses craintes au cruel jeune homme.
Celui-ci leva la tête vers elle et la regarda. Il avait des pleurs dans les yeux ; pleurs d’amour ou de désespoir. À cette vue la dame tressaillit, elle se perdit. Tous deux résistaient sans doute depuis longtemps, et ne pouvaient peut-être plus résister à un amour grandi de jour en jour par d’invincibles obstacles, couvé par la terreur, fortifié par la jeunesse.
La dame était médiocrement belle, mais son teint pâle accusait de secrètes souffrances qui la rendaient intéressante, rien qu’à la voir. Au reste, elle avait les formes distinguées et les plus beaux cheveux du monde. Gardée par un tigre, elle risquait peut-être sa vie en disant un mot, en se laissant presser la main, en accueillant un regard. Si jamais amour n’avait été plus profondément enseveli dans deux cœurs, plus délicieusement savouré, jamais aussi passion ne devait être si périlleuse. Il était facile de deviner que, pour ces deux êtres, il y avait dans l’air, dans les sons, dans le bruit des pas, dans les dalles, dans les choses les plus indifférentes aux autres hommes, des qualités sensibles, des propriétés particulières qu’ils devinaient ; et peut-être l’amour leur faisait-il trouver des truchements fidèles jusque dans les mains glacées du vieux prêtre auquel ils allaient dire leurs péchés, ou dont ils recevaient une hostie en approchant de la sainte table ; amour profond, amour entaillé dans l’âme comme, dans le corps, une cicatrice qu’il faut garder pendant toute la vie.
Quand ces deux jeunes gens se regardèrent, la femme sembla dire à son amant :
– Périssons, mais aimons-nous !…
Et le cavalier parut lui répondre :
– Nous nous aimerons, et ne périrons pas !…
Alors, par un mouvement de tête plein de mélancolie, elle lui montra une vieille duègne et deux pages. La duègne dormait. Les deux pages étaient jeunes, et paraissaient assez insouciants de ce qui pouvait arriver de bien ou de mal à leur maître.
– Ne vous effrayez pas à la sortie, et laissez-vous faire…
À peine le gentilhomme eut-il dit ces paroles à voix basse, que la main du vieux seigneur coula sur le pommeau de son épée. En sentant la froideur du fer, le vieillard s’éveilla soudain. Ses yeux jaunes se fixèrent aussitôt sur sa femme ; et, par un privilège assez rarement accordé même aux hommes de génie, il retrouva son intelligence aussi nette et ses idées aussi lucides que s’il n’avait pas sommeillé. C’était un jaloux !…
Si le jeune cavalier donnait un œil à sa maîtresse, de l’autre, il guignait le mari ; alors, il se leva lestement, et s’effaça derrière le pilier au moment où la main du vieillard voulut se mouvoir ; puis il disparut, léger comme un oiseau. Ayant promptement baissé les yeux, la dame feignit de lire et tâcha de paraître calme ; mais elle ne pouvait empêcher son visage de rougir, et son cœur de battre avec une violence inusitée. Le vieux seigneur entendit le bruit des pulsations profondes et sonores qui retentissaient dans la chapelle, remarqua l’incarnat extraordinaire répandu sur les joues, sur le front, sur les paupières de sa femme ; et alors, il regarda prudemment autour de lui ; mais, ne voyant personne dont il dût se défier :
– À quoi pensez-vous donc, ma mie ?… lui dit-il.
– L’odeur de l’encens me fait mal… répondit-elle.
– Il est donc mauvais d’aujourd’hui !… répliqua le seigneur.
Malgré cette observation, le rusé vieillard feignit de croire à cette défaite ; et, soupçonnant quelque trahison secrète, il résolut de veiller encore plus attentivement sur son trésor.
La bénédiction était donnée. Sans attendre la fin du secula seculorum, la foule se précipitait comme un torrent vers les portes de l’église. Le seigneur attendit prudemment, suivant son habitude, que l’empressement général fût calmé ; puis il sortit en faisant marcher devant lui la duègne et le plus jeune page qui portait un fallot. Il donna le bras à sa femme, et l’autre page les suivit.
Au moment où le vieux seigneur allait atteindre la porte latérale ouverte dans la partie orientale du cloître, et par laquelle il avait coutume de sortir, un flot du monde se détacha de la foule qui obstruait le grand portail. En refluant avec impatience vers la petite nef où se trouvait la famille, cette masse compacte l’empêcha de retourner sur ses pas. Alors le seigneur et sa femme furent poussés au-dehors par la puissante pression de cette multitude. Le mari tâcha de passer le premier en tirant fortement la dame par le bras ; mais, en ce moment, il fut entraîné vigoureusement dans la rue, et sa femme lui fut arrachée par le bras d’un étranger.
Le terrible bossu comprit soudain qu’il était tombé dans une embûche préparée de longue main. Se repentant d’avoir dormi si longtemps, il rassembla toute sa force ; d’une main, ressaisit sa femme par la manche de sa robe, et, de l’autre, essaya de se cramponner à la porte. Mais l’ardeur de l’amour l’emporta sur la rage de la jalousie ; et le jeune gentilhomme, prenant sa maîtresse par la taille, l’enleva si rapidement et avec une telle force de désespoir, que l’étoffe de soie et d’or, le brocart et les baleines, se déchirèrent bruyamment. La manche resta seule au mari. Un rugissement de lion couvrit aussitôt les cris poussés par la multitude, et l’on entendit bientôt une voix terrible hurlant ces mots :
– À moi, Poitiers !… Au portail, les gens du comte de Saint-Vallier !… Au secours !… Ici !
Et le comte Aymar de Poitiers, sire de Saint-Vallier, tenta de tirer son épée et de se faire faire place ; mais il se vit environné, pressé par trente ou quarante gentilshommes qu’il était dangereux de blesser, et parmi lesquels plusieurs, de haut rang, lui répondirent par des quolibets en l’entraînant avec eux.
Le ravisseur avait emmené la comtesse, avec la rapidité de l’éclair, dans une chapelle ouverte où il l’assit derrière un confessionnal, sur un banc de bois. À la lueur des cierges qui brûlaient devant l’image du saint auquel cette chapelle était dédiée, ils se regardèrent un moment en silence, en se pressant les mains, étonnés l’un et l’autre de leur audace ; et la comtesse n’eut pas le cruel courage de reprocher au jeune homme la hardiesse à laquelle ils devaient ce périlleux, ce premier instant de bonheur.
– Voulez-vous fuir avec moi dans les États voisins ? lui dit vivement le gentilhomme. J’ai près d’ici deux genets d’Angleterre capables de faire trente lieues d’une seule traite.
– Eh ! s’écria-t-elle doucement, il n’y a d’asile en aucun lieu du monde pour une fille du roi Louis !…
– C’est vrai !… répondit le jeune homme stupéfait de n’avoir pas prévu cette difficulté de son entreprise.
– Pourquoi donc m’avez-vous arrachée à mon mari ?… demanda-t-elle avec une sorte de terreur.
– Hélas !… reprit le cavalier, je n’ai pas compté sur le trouble où je suis en me trouvant près de vous, en vous entendant me parler, en recueillant vos regards !… J’ai conçu deux ou trois plans ; eh bien ! maintenant, tout me semble accompli, puisque je vous vois…
– Mais je suis perdue !… dit la comtesse.
– Nous sommes sauvés !… répliqua le gentilhomme avec l’aveugle enthousiasme de l’amour. Écoutez-moi !…
– Ceci me coûtera la vie… reprit-elle en laissant couler les larmes qui roulaient dans ses yeux. Le comte me tuera ce soir peut-être ! Mais, allez chez le roi ! racontez-lui les tourments que depuis cinq ans sa fille a endurés… Il m’aimait bien quand j’étais petite ; et il m’appelait en riant Marie-pleine-de-grâce, parce que j’étais laide !… Ah ! s’il savait à quel homme il m’a donnée, il se mettrait dans une terrible colère… Si je n’ai pas osé me plaindre, c’est par pitié pour le comte !… D’ailleurs, comment ma voix serait-elle parvenue jusqu’au roi !… Mon confesseur lui-même est un espion de Saint-Vallier. – Si je me suis prêtée à ce coupable enlèvement, c’est dans l’espoir de vous avoir pour défenseur ; mais puis-je me fier à…
– Oh ! dit-elle en pâlissant et s’interrompant, voici le page !…
La pauvre comtesse se fit comme un voile avec ses mains pour se cacher la figure.
– Ne craignez rien !… reprit le jeune seigneur, il est gagné ! Vous pouvez vous servir de lui en toute assurance, il m’appartient… Et… quand le comte viendra vous chercher, il nous préviendra de son arrivée.
– Il y a dans ce confessionnal, ajouta-t-il à voix basse, un chanoine de mes amis ; il sera censé vous avoir retirée de la bagarre, et mise sous sa protection dans cette chapelle. – Ainsi, tout est prévu pour tromper Saint-Vallier…
À ces mots, les larmes de la comtesse se séchèrent ; mais une expression de tristesse vint rembrunir son front par degrés.
– On ne le trompe pas ! dit-elle. Ce soir, il saura tout !… Prévenez ses coups… – Allez au Plessis, voyez le roi, dites-lui que…
Elle hésita ; mais quelque souvenir lui ayant donné le courage d’avouer les secrets du mariage :
– Eh bien ! oui, reprit-elle ; dites-lui que, pour se rendre maître de moi, le comte me fait saigner aux deux bras, et m’épuise… dites qu’il m’a traînée par les cheveux… dites que je suis prisonnière… dites que…
Son cœur se gonfla, les sanglots expirèrent dans son gosier, quelques larmes tombèrent de ses yeux ; et, dans son agitation, elle se laissa baiser les mains par le jeune homme auquel il échappait des mots sans suite.
– Personne ne peut parler au roi… Pauvre petite !… J’ai beau être le neveu du grand-maître des arbalétriers, je n’entrerai pas ce soir au Plessis !… Ma chère dame… ma belle souveraine ! – Mon Dieu, a-t-elle souffert !… Marie, laissez-moi vous dire deux mots, ou nous sommes perdus !…
– Que devenir ?… s’écria-t-elle.
Puis, apercevant à la noire muraille un tableau de la Vierge, sur lequel tombait la lueur de la lampe :
– Sainte mère de Dieu, conseillez-nous !… dit-elle.
– Ce soir, reprit le jeune seigneur, je serai chez vous !…
– Et comment ?… demanda-t-elle naïvement.
Ils étaient dans un si grand péril, que leurs plus douces paroles semblaient dénuées d’amour.
– Ce soir, reprit le gentilhomme, je vais aller m’offrir en qualité d’apprenti à maître Cornélius, l’argentier du roi ; j’ai su me procurer une lettre de recommandation qui me fera recevoir. Son logis est voisin du vôtre. Une fois sous le toit de ce vieux ladre, à l’aide d’une échelle de soie, je saurai trouver le chemin de votre appartement…
– Oh ! dit-elle pétrifiée d’horreur, si vous m’aimez, n’allez pas chez maître Cornélius !…
– Ah ! s’écria-t-il en la serrant contre son cœur avec toute la force que l’on se sent à son âge, vous m’aimez donc !…
– Oui, dit-elle. N’êtes-vous pas mon espérance ? Vous êtes gentilhomme, je vous confie mon honneur !
– D’ailleurs, reprit-elle en le regardant avec dignité, je suis trop malheureuse pour que vous trahissiez ma foi. Mais à quoi bon tout ceci ?… Allez, laissez-moi mourir plutôt que d’entrer chez Cornélius ! Ne savez-vous pas que tous ses apprentis…
– Ont été pendus ! reprit en riant le gentilhomme ; mais croyez-vous que ses trésors me tentent ?…
– Oh ! n’y allez pas, vous y seriez victime de quelque sorcellerie !…
– Je ne saurais trop payer le bonheur de vous servir ! répondit-il en lui lançant un regard de feu qui lui fit baisser les yeux.
– Et mon mari ?… dit-elle.
– Voici qui l’endormira !… reprit le jeune homme, en tirant de sa ceinture un petit flacon.
– Pas pour toujours ?… demanda la comtesse en tremblant.
Pour toute réponse, le gentilhomme fit un geste d’horreur.
– Je l’aurais déjà défié en combat singulier, s’il n’était pas si vieux !… ajouta-t-il ; mais Dieu me garde jamais de vous en défaire en lui donnant le boucon !…
– Pardon !… dit la comtesse en rougissant, je suis cruellement punie de mes péchés. Dans un moment de désespoir, j’ai voulu tuer le comte, et je craignais que vous n’eussiez eu le même désir… Ma douleur est grande de n’avoir point encore pu me confesser de cette mauvaise pensée ; mais j’ai eu peur que mon idée ne lui fût découverte, et qu’il ne s’en vengeât…
– Je vous fais honte !… reprit-elle, offensée du silence que gardait le jeune homme. J’ai mérité ce blâme.
Elle brisa le flacon en le jetant à terre avec une soudaine violence.
– Ne venez pas !… s’écria-t-elle, le comte a le sommeil léger. Mon devoir est d’attendre secours du ciel ; ainsi ferai-je !…
Elle voulut sortir.
– Ah ! s’écria le gentilhomme, ordonnez, je le tuerai, madame !… Vous me verrez ce soir.
– J’ai été sage de dissiper cette drogue !… répliqua-t-elle d’une voix éteinte par le plaisir de se voir si ardemment aimée. La peur de réveiller mon mari nous sauvera de nous-mêmes.
– Je vous fiance ma vie !… dit le jeune homme en lui serrant la main.
– Si le roi le veut, le pape saura casser mon mariage ; et alors nous serions unis !… reprit-elle en lui lançant un regard plein de délicieuses espérances.
En ce moment, le page accourut.
– Voici monseigneur ! s’écria-t-il.
Aussitôt le gentilhomme, étonné du peu de temps pendant lequel il était resté près de sa maîtresse, et surpris de la célérité du comte, prit un baiser que sa maîtresse ne sut pas refuser ; puis il lui dit :
– À ce soir !…
Il s’esquiva de la chapelle ; et, à la faveur de l’obscurité, gagna le grand portail en s’évadant de pilier en pilier dans la longue trace d’ombre que chaque grosse colonne projetait à travers l’église.
Un vieux chanoine sortit tout à coup du confessionnal, vint se mettre auprès de la comtesse, et ferma doucement la grille devant laquelle le page se promena gravement avec une assurance de meurtrier.
De vives clartés annoncèrent le comte. Accompagné de quelques amis et de gens qui portaient des torches, il tenait à la main son épée nue, et ses yeux sombres semblaient percer les ténèbres profondes et visiter les coins les plus noirs de la cathédrale.
– Monseigneur, madame est là !… lui dit le page en allant au-devant de lui.
Le sire de Saint-Vallier trouva sa femme agenouillée aux pieds de l’autel, et le chanoine, debout, disant son bréviaire. À ce spectacle, il secoua vivement la grille, comme pour donner pâture à sa rage.
– Que voulez-vous, une épée nue à la main dans l’église ?… demanda le chanoine.
– Mon père, monsieur est mon mari !… répondit la comtesse.
Alors le prêtre tira la clef de sa manche, et ouvrit la chapelle. Le comte jeta presque malgré lui des regards autour du confessionnal, y entra ; puis, il se mit à écouter le silence de la cathédrale.
– Monsieur, lui dit sa femme, vous devez des remerciements à ce vénérable chanoine qui m’a retirée ici…
Le sire de Saint-Vallier, pâlissant de colère, n’osant regarder ses amis, qui étaient venus là plutôt pour rire de lui que pour l’assister, repartit brièvement :
– Merci Dieu !… mon père, je trouverai moyen de vous récompenser !
Il prit sa femme par le bras ; puis, sans la laisser achever sa révérence au chanoine, il fit un signe à ses gens, et sortit de l’église sans dire un mot à ceux qui l’avaient accompagné. Son silence avait quelque chose de farouche.
Impatient d’être au logis, et préoccupé des moyens de découvrir la vérité, il se mit en marche à travers les rues tortueuses qui, à cette époque, séparaient la cathédrale du portail de la chancellerie, où s’élevait le bel hôtel alors récemment bâti par le chancelier Juvénal des Ursins, sur l’emplacement d’une ancienne fortification que Charles VII avait donnée à ce fidèle serviteur, en récompense de ses glorieux labeurs.
Là commençait une rue, nommée, depuis lors, de la Scéellerie, en mémoire des sceaux qui y furent longtemps. Elle joignait le vieux Tours au bourg de Châteauneuf, où se trouvait la célèbre abbaye de Saint-Martin, dont tant de rois furent simples chanoines.
Depuis cent ans, et après de longues discussions, ce bourg avait été réuni à la ville. Beaucoup des rues adjacentes à celle de la Scéellerie, et qui forment aujourd’hui le centre du Tours moderne, étaient déjà construites ; mais les plus beaux hôtels, et notamment celui du trésorier Xancoings, maison qui subsiste encore dans la rue du Commerce, étaient situés dans la commune de Châteauneuf.
Ce fut par là que les porte-flambeaux du sire de Saint-Vallier le guidèrent vers la partie du bourg qui avoisinait la Loire. Il suivait machinalement ses gens, lançant de temps à autre un coup d’œil sombre à sa femme et au page, en tâchant de surprendre entre eux un regard d’intelligence qui jetât quelque lumière sur le singulier évènement dont il était stupéfait et désespéré.
Enfin il arriva dans la rue du Mûrier, où son logis était situé. Lorsque tout le cortège fut entré, que la lourde porte fut fermée, un profond silence régna dans cette petite rue étroite, où logeaient alors quelques seigneurs ; ce nouveau quartier de la ville étant le plus rapproché du Plessis, séjour habituel du roi.
La dernière maison de cette rue était aussi la dernière de la ville, et appartenait à maître Cornélius Hoogworst, vieux négociant brabançon, auquel le roi Louis XI accordait toute sa confiance pour les transactions financières que sa politique astucieuse l’obligeait à faire au-dehors du royaume.
Par des raisons toutes favorables à la tyrannie qu’il exerçait sur sa femme, le comte de Saint-Vallier s’était jadis établi dans un hôtel contigu au logis de ce maître Cornélius ; et la topographie des lieux expliquera les bénéfices que cette situation pouvait offrir à un jaloux.
En effet, la maison du comte, nommée l’hôtel de Poitiers, avait un jardin bordé par le mur et le fossé qui servaient d’enceinte à l’ancien bourg de Châteauneuf, et près desquels passait la levée récemment construite par Louis XI entre Tours et le Plessis. Or, de ce côté, des chiens défendaient l’accès du logis. Puis, une grande cour le séparait, à gauche, des maisons voisines ; alors, il n’avait de contact qu’avec le logis de ce maître Cornélius, auquel il se trouvait adossé par son flanc droit.
Ainsi, la maison du défiant et rusé seigneur, isolée de trois côtés, ne pouvait être nuitamment envahie que par les habitants de la maison brabançonne, dont les combles et les chéneaux de pierre se mariaient à ceux de l’hôtel de Poitiers.
Sur la rue, toutes les fenêtres de la façade, étroites et découpées dans la pierre, étaient, suivant l’usage de ce temps, garnies de barreaux en fer ; et la porte, basse et voûtée comme les portes de nos vieilles prisons, avait une solidité à toute épreuve. Un banc de pierre, qui servait de montoir, se trouvait près du porche.
En voyant le profil des logis occupés par maître Cornélius et par le comte, il était facile de croire que les deux maisons avaient été bâties par le même architecte, et destinées à des tyrans.
Toutes deux, d’aspect sinistre, ressemblaient à de petites forteresses, et pouvaient être longtemps défendues avec avantage contre une populace furieuse. Les angles en étaient protégés par des tourelles semblables à celles que les amateurs d’antiquités remarquent dans certaines villes où le marteau des démolisseurs n’a pas encore passé. Les baies, ayant peu de largeur, permettaient de donner une force de résistance prodigieuse aux volets ferrés et aux portes. Les émeutes et les guerres civiles, si fréquentes en ces temps de discorde, justifiaient toutes ces précautions.
Lorsque six heures sonnèrent au clocher de l’abbaye Saint-Martin, le gentilhomme amoureux de la comtesse passa devant l’hôtel de Poitiers, et s’y arrêta pendant un moment. Il entendit dans la salle basse le bruit que faisaient les gens du comte en soupant ; et, après avoir jeté un regard sur la chambre où il présumait que devait être sa dame, il alla vers la porte du logis voisin.
Partout, sur son chemin, le jeune seigneur avait entendu les accents joyeux des repas faits, dans les maisons de la ville, en l’honneur de la fête. Toutes les fenêtres, mal jointes, laissaient passer des rayons de lumière ; les cheminées fumaient ; et les bonnes odeurs des rôtisseries pénétraient dans les rues. L’office achevé, la ville entière se rigolait, et poussait des murmures que l’imagination comprend mieux que la parole ne les peint. Mais, en cet endroit, régnait un profond silence. Il y avait dans ces deux logis deux passions qui ne se réjouissent jamais. Au-delà les campagnes se taisaient ; et là, sous l’ombre des clochers de l’abbaye Saint-Martin, ces deux maisons, muettes aussi, séparées des autres, et situées dans le bout le plus tortueux de la rue, ressemblaient à une léproserie. Le logis qui leur faisait face, appartenant à des criminels d’état, était sous un séquestre.
Un jeune homme devait être facilement impressionné par ce subit contraste ; aussi, sur le point de se lancer dans une entreprise horriblement hasardeuse, le gentilhomme resta pensif devant la maison du Lombard, en se rappelant tous les contes dont maître Cornélius était le sujet, et qui avaient causé le singulier effroi de la comtesse.
À cette époque, un homme de guerre, et même un amoureux, tout tremblait au mot de magie ; car, alors, il se rencontrait peu d’imaginations incrédules pour les faits bizarres, ou froides aux récits merveilleux ; et l’amant de la comtesse de Saint-Vallier, une des filles que Louis XI avait eues de madame de Sassenage, en Dauphiné, tout hardi qu’il pût être, devait y regarder à deux fois au moment d’entrer dans une maison ensorcelée.
L’histoire de maître Cornélius Hoogworst expliquera complètement la sécurité que le Lombard avait inspirée au sire de Saint-Vallier, la terreur manifestée par la comtesse, et l’hésitation qui arrêtait l’amant ; mais, pour faire comprendre entièrement à des lecteurs du dix-neuvième siècle, comment des évènements assez vulgaires en apparence étaient devenus surnaturels, et pour leur faire partager les frayeurs du vieux temps, il est nécessaire d’interrompre légèrement cette histoire pour jeter un rapide coup d’œil sur les aventures de maître Cornélius.
Cornélius Hoogworst, l’un des plus riches commerçants de Gand, s’étant attiré l’inimitié de Charles, duc de Bourgogne, avait trouvé asile et protection à la cour de Louis XI.
Le roi, concevant tout le parti qu’il pouvait tirer d’un homme lié avec les principales maisons de Flandre, de Venise et du Levant, avait anobli, naturalisé, et même flatté maître Cornélius, ce qui arrivait rarement à Louis XI. Le monarque plaisait, d’ailleurs, au Flamand, autant que le Flamand plaisait au monarque. Tous deux rusés, défiants, avares ; également politiques, également instruits ; supérieurs tous deux à leur époque, ils se comprenaient à merveille ; quittaient et reprenaient avec une même facilité, l’un, sa conscience, l’autre, sa dévotion ; ils aimaient la même Vierge ; l’un par conviction, l’autre par flatterie ; enfin, s’il fallait en croire les propos jaloux d’Olivier le Daim et de Tristan, le roi allait se divertir dans la maison du Lombard, mais comme se divertissait Louis XI. L’histoire a pris soin de nous transmettre les goûts licencieux de ce monarque, auquel la débauche ne déplaisait pas ; et le vieux Brabançon trouvait sans doute joie et profit à se prêter aux capricieux plaisirs de son royal client.
Cornélius habitait la ville de Tours depuis neuf ans ; et pendant ces neuf années il s’était passé chez lui des évènements extraordinaires qui l’avaient rendu l’objet de l’exécration générale. En arrivant, il dépensa dans sa maison des sommes assez considérables pour y mettre ses trésors en sûreté. Les inventions que les serruriers de la ville exécutèrent secrètement pour lui, les précautions bizarres qu’il avait prises pour les amener dans son logis de manière à s’assurer forcément de leur discrétion, furent pendant longtemps le sujet de mille contes merveilleux qui charmèrent les veillées de Touraine. Les singuliers artifices du vieillard le faisaient supposer possesseur de richesses orientales. Aussi les narrateurs de ce pays, la patrie du conte en France, bâtissaient des chambres d’or et de pierreries chez le Flamand, et ne manquaient pas d’attribuer à des pactes magiques la source de cette immense fortune.
Maître Cornélius avait amené jadis avec lui deux valets flamands, une vieille femme, plus un jeune apprenti de figure douce et prévenante. Ce jeune homme lui servait de secrétaire, de caissier, de factotum et de courrier.
Dans la première année de son établissement à Tours, un vol considérable eut lieu chez lui. Les enquêtes judiciaires prouvèrent que le crime avait été commis par un habitant de la maison. Là-dessus, le vieil avare fit mettre en prison ses deux valets et son commis.
Le jeune homme était faible, il périt dans les souffrances de la question, tout en protestant de son innocence.
Les deux valets avouèrent le crime pour éviter les tortures ; mais quand le juge leur demanda où étaient les sommes volées, ils gardèrent le silence, furent réappliqués à la question, jugés, condamnés, et pendus. En allant à l’échafaud, ils persistèrent à se dire innocents, suivant l’habitude de tous les pendus.
La ville de Tours s’entretint longtemps de cette singulière affaire ; mais comme c’étaient des Flamands, l’intérêt que ces malheureux et que le jeune commis avaient excité s’évanouit promptement ; car les guerres et les séditions de ce temps-là fournissaient des émotions perpétuelles, et le drame du jour faisait pâlir celui de la veille.
Plus chagrin de la perte énorme qu’il avait éprouvée que de la mort de ses trois domestiques, maître Cornélius resta seul avec la vieille Flamande qui était sa sœur. Il obtint du roi la faveur de se servir des courriers de l’État pour ses affaires particulières, mit ses mules chez un muletier du voisinage, et vécut, dès ce moment, dans la plus profonde solitude, ne voyant guère que le roi, faisant son commerce par le canal des juifs, habiles calculateurs, qui le servaient fidèlement, afin d’obtenir sa toute-puissante protection.
Cependant, quelque temps après cette aventure, le roi procura lui-même à son vieux torçonnier (Louis XI appelait ainsi familièrement maître Cornélius) un jeune orphelin, auquel il portait beaucoup d’intérêt. Le pauvre enfant s’adonna soigneusement aux affaires du Lombard, sut lui plaire, et gagna ses bonnes grâces. Mais, pendant une nuit d’hiver, les diamants déposés entre les mains de Cornélius par le roi d’Angleterre, pour la sûreté d’une somme de cent mille écus, ayant été volés, les soupçons tombèrent sur l’orphelin. Louis XI se montra d’autant plus sévère pour lui qu’il avait répondu de sa fidélité. Aussi le malheureux fut-il pendu, après une interrogation assez sommairement faite par le grand prévôt.
Personne n’osait aller apprendre l’art de la banque et le change chez maître Cornélius. Cependant, deux jeunes gens de la ville, Tourangeaux pleins d’honneur et désireux de fortune, y entrèrent successivement. Des vols considérables coïncidèrent avec l’admission des deux jeunes gens dans la maison du torçonnier ; et les circonstances dont ces crimes furent accompagnés, la manière dont ils furent exécutés, prouvaient si clairement que les auteurs avaient des intelligences secrètes avec les habitants du logis, qu’il était impossible de ne pas en accuser les nouveau-venus. Le Brabançon, étant devenu de plus en plus soupçonneux et vindicatif, déféra sur-le-champ la connaissance de ce fait à Louis XI, qui chargea son grand prévôt de ces affaires ; et chaque procès fut promptement instruit, et plus promptement terminé.
Le patriotisme des Tourangeaux donna secrètement tort à la promptitude de Tristan. Coupables ou non, les deux jeunes gens passèrent pour des victimes, et Cornélius pour un bourreau. Les deux familles en deuil étaient estimées, leurs plaintes furent écoutées ; et, de conjectures en conjectures, elles parvinrent à faire croire à l’innocence de tous ceux que l’argentier du roi avait envoyés à la potence.
Les uns prétendaient que le cruel avare, imitant le roi, essayait de mettre la terreur et les gibets entre le monde et lui ; qu’il n’avait jamais été volé ; que ces tristes exécutions étaient le résultat d’un froid calcul, et qu’il voulait être sans crainte pour ses trésors. Le premier effet de ces rumeurs populaires fut d’isoler Cornélius. Les Tourangeaux le traitèrent comme un pestiféré ; l’appelèrent le tortionnaire ; nommèrent son logis la Malemaison ; et, quand même le Lombard aurait pu trouver des étrangers assez hardis pour entrer chez lui, tous les habitants de la ville les en eussent empêchés par leurs dires.
L’opinion la plus favorable à maître Cornélius était celle des gens qui le regardaient comme un homme funeste. Il inspirait aux uns une terreur instinctive ; aux autres, ce respect profond que l’on porte à un pouvoir sans bornes ou à l’argent ; pour plusieurs personnes, il avait tout l’attrait du mystère. Son genre de vie, sa physionomie, et la faveur du roi, justifiaient tous les contes dont il était devenu le sujet. Cornélius voyageait assez souvent en pays étrangers, depuis la mort de son persécuteur le duc de Bourgogne ; or, pendant son absence, le roi faisait garder le logis du banquier par des hommes de sa compagnie écossaise. Cette royale sollicitude faisait présumer aux courtisans que le vieillard avait légué sa fortune à Louis XI.
Comme il sortait très peu, les seigneurs de la cour lui rendaient de fréquentes visites ; il leur prêtait assez libéralement de l’argent ; mais il était fantasque : à certains jours il ne leur aurait pas donné un sou parisis ; le lendemain, il vous offrait des sommes immenses, moyennant toutefois un bon intérêt et de grandes sûretés.
Du reste, il était bon catholique, allait régulièrement aux offices, mais il venait à Saint-Martin de très bonne heure ; et comme il y avait acheté une chapelle à perpétuité, là, comme ailleurs, il était séparé des autres chrétiens. Enfin un proverbe populaire de cette époque, et qui subsista longtemps à Tours, était cette phrase : – Vous avez passé devant le Lombard, il vous arrivera malheur.
– Vous avez passé devant le Lombard !… expliquait les maux soudains, les tristesses involontaires et les mauvaises chances de fortune. Même à la cour, on attribuait à Cornélius cette fatale influence que les superstitions italienne, espagnole et asiatique, ont nommée le mauvais œil. Sans le pouvoir terrible de Louis XI qui s’était étendu comme un manteau sur cette maison, à la moindre occasion le peuple eût démoli la Malemaison de la rue du Mûrier… Et c’était pourtant chez Cornélius que les premiers mûriers plantés à Tours avaient été mis en terre ; alors les Tourangeaux le regardèrent comme un bon génie. Comptez donc sur la faveur populaire !…
Quelques seigneurs ayant rencontré maître Cornélius hors de France, furent surpris de sa bonne humeur. À Tours, il était toujours sombre et rêveur ; mais il y revenait toujours. Une inexplicable puissance le ramenait à sa noire maison de la rue du Mûrier. Semblable au colimaçon, dont la vie est si fortement unie à celle de sa coquille, il avouait au roi qu’il ne se trouvait bien que sous les pierres vermiculées et sous les verrous de sa petite bastille, tout en sachant que, Louis XI mort, ce lieu serait pour lui le plus dangereux de la terre.