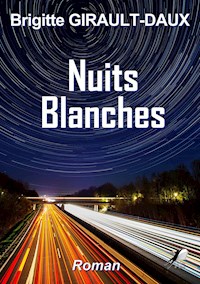
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Libre2Lire
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Tout commence par une rencontre inopinée à une station-service entre une enseignante et l’un de ses anciens élèves. Le contact se renoue et, au hasard de conversations à bâtons rompus, des questions banales font entrevoir au professeur de lycée des zones d’ombre dans le quotidien du jeune homme.
À quelques encablures de là, dans la cité des Bleuets, chacun presse le pas les soirs où des silhouettes cagoulées s’installent en faction sous des réverbères aux ampoules cassées. Ces nuits-là, des bolides surgissent de parkings souterrains pour se lancer à pleine vitesse sur les autoroutes. Dans leurs coffres, une marchandise de plusieurs millions d’euros, au volant, des conducteurs qui mettent en jeu leur vie pour en garantir la livraison. Mais qui sont-ils ces pilotes de Go Fast ? Le découvrir vous confirmera que rien dans l’existence n’est jamais blanc ou noir et que les nuances de gris sont nombreuses.
Réfléchissez bien avant d’ouvrir ce livre, car vous pourriez perdre quelques certitudes et vous attacher aux personnages.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Brigitte Girault-Daux est une auteure bordelaise de nouvelles et de romans. Après avoir participé à des concours littéraires qui ont abouti à la publication de plusieurs de ses textes dans des recueils collectifs, elle publie deux recueils personnels de nouvelles "Nos parts d’ombre" et "Douze clés pour le paradis", suivis de quatre romans "Randonnée Fatale", "D’une rive à l’autre", "Un parfait coupable" et "Partie d'échecs contre un assassin".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Brigitte GIRAULT-DAUX
Nuits Blanches
Roman
Cet ouvrage a été composé et imprimé en France par Libre 2 Lire
www.libre2lire.fr – [email protected], Rue du Calvaire – 11600 ARAGON
Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle réservés pour tous pays.
ISBN papier : 978-2-38157-260-4ISBN Numérique : 978-2-38157-261-1
Dépôt légal : Mars 2022
© Libre2Lire, 2022
À mes anges disparus.
« Les hommes sont des anges stagiaires »
Victor Hugo
CHAPITRE 1
C’est sur cette injonction que j’ai rompu avec mon milieu professionnel pour entrer de plain-pied dans l’univers de la retraite, dans ce monde à part regardé par les actifs comme un no man’s land plombé par le ciel noir d’une vieillesse fixée à soixante ans, concept totémique resté inébranlable dans les mentalités du XXIe siècle. Peu importe qu’une sexagénaire d’aujourd’hui n’ait plus rien de commun avec les contemporaines de Louis XIV, poudrées, perruquées, édentées, vérolées, alitées par les attaques de goutte, saignées à la moindre indisposition, au moindre étourdissement. La veille de son anniversaire, on s’endort bercé par la maturité, après minuit on se réveille géronte et cacochyme. L’intervalle où l’on enjambe officiellement la ligne de démarcation est matérialisé par le pot de départ. On y mâche et déglutit à l’unisson dans une coutume héritée des sociétés primitives qui partageaient le mammouth abattu, l’auroch dépecé, la volaille décapitée. Sa fonction est de confirmer au héros de la fête son appartenance au passé. Il est là mais déjà étranger au groupe, figé dans un autre espace temporel. Réminiscence des traditions indiennes où les barbons se retiraient dans les montagnes pour mourir loin de leur tribu, de ces mœurs rurales indignes où l’on remplissait en dernier l’assiette du patriarche trop âgé pour assurer sa quote-part de travail dans les champs. Un discours le plus souvent interminable et sans intérêt est méthodiquement déroulé, sa carrière laborieusement, minutieusement rappelée, rien ne lui est épargné depuis son arrivée en tant que grouillot dans un service dont quarante ans plus tard, personne ne se souvient qu’il eût jamais existé. La péroraison d’un hiérarchique aux galons plus ou moins fournis selon le degré d’estime accordé par l’entreprise au déserteur, s’attarde avec un incompréhensible attendrissement sur des équipements antédiluviens pour montrer à quel point les évolutions technologiques ont facilité les tâches de tous ces trentenaires si insoucieux de leur chance et qui, très logiquement, s’en foutent comme de leurs premières Pampers :
L’accumulationde ces considérations néandertaliennes alourdit encore le poids des ans sur les épaules du salarié vétéran, accélèrent sa transmutation cellulaire vers son statut de jeune retraité, retarde l’accès au buffet et aux bulles de champagne, multiplie ici et là les soupirs contenus, tétanise des sourires polis qui se muent en rictus. La station debout prolongée coince les articulationsdes arthritiques, catapulte des vessies en zone rouge, attise les glandes salivaires de ceux qui reniflent les plats garnis de toasts au foie gras, au saumon, de lunchs colorés, fait flotter sur l’auditoire le rêve d’étrangler l’orateur perdu dans ses détails, dans ses fiches, de ne plus l’écouter bafouiller, se risquer à de consternants traits d’humour. À cet instant précis, nous assistons à la répétition de notre oraison funèbre, à cette différence près que nous participons au banquet prévu en notre honneur au lieu de le suivre rigidement étendus sur une couche en soie capitonnée et surpiquée. Les protagonistes ont-ils alors conscience que notre façon de les observer n’est plus la même, que cette réunion quasi biblique ayant pour référence la Cène est le terminus avant la séparation des chemins ? Que l’on s’applique à compter les Judas en s’alarmant de les voir bien plus nombreux qu’à la table du Christ ?
En franchissant dans une trajectoire sans retour la porte de ce lycée privé où j’enseignais le français, enraciné depuis trois siècles dans les beaux quartiers bordelais, une extraordinaire sensation de liberté m’envahit, anima mon pas. Je n’avais pas imaginé qu’elle serait aussi puissante, ni qu’elle m’embarquerait avec une telle force. On était fin décembre, l’hiver charriait une pluie glaçante, floutait le halo de la lune, les réverbères des boulevards s’épuisaient à éclairer la nuit, balançaient sous mes pas des rayons trop anémiques pour m’éviter de glisser sur un tapis de feuilles mortes. Je n’ignorais pas que devant moi s’ouvrait une période trufféed’inquiétants aléas car l’avancée en âge fragilise, laisse une main squelettique s’emparer de la nôtre pour nous guider progressivement vers une échéance inéluctable. Mais l’entièreté de ce temps m’appartenait désormais, je pouvais en disposer à ma guise, une multitude de plages horaires s’offrait à mes centres d’intérêt, à mes passions, à des moments de convivialité choisis, et c’était là une idée grisante, enivrante, insolite. Finis les levers à l’aube frileuse, brumeuse, terminéesles corrections de centaines de copies, les entrevues avec des parents convaincus que j’avais le talent de transformer le QI désespérément banal de leur rejeton en prix Nobel de littérature.
Tu veux vraiment que je sois sincère, désolant géniteur de ce sale gosse ? Il n’y a que l’autorité pour répondre à ce que tu appelles son besoin de stimulation et dans sa scolarité, il coche toutes les cases qui auraient justifié ta vasectomie. Il est juste anormalement chiant, ton môme et si tu n’apprends pas à le canaliser, tous ceux qui le croiseront auront légitimement, comme moi, envie de le trucider dixfois par jour. Mais deux qualités sont indispensables pour s’enrôler dans l’Éducation nationale. La compétence (ou l’aptitude à la simuler) et la maîtrise de phrases immensément creuses mais politiquement exprimables :
Quelle mère, quel père est prêt à entendre que son gamin a un bulbe crânien strictement identique à celui de 99,9 % de la population, que seuls son caractère et son éducation le distinguent de ses semblables et que l’école ne fabrique pas des génies en éprouvette ? Aucun professeur ne détient la pierre philosophale, aucun n’a la formule pour changerle plomb en or. La rencontre avec un surdoué est toujours un choc, ce qui valide son faible pourcentage d’occurrences. Et cette situation est génératrice de bien des complications, elle n’est souhaitée que par des egos surdimensionnés, émerveillés de paraître moins stupides aux yeux de leurs voisins.
Non, monsieur, toute l’énergie que vous avez dépensée sous votre couette tandis que votre compagne constatait passivement qu’il était urgent de repeindre le plafond n’a pas abouti à la production d’un disciple d’Einstein ! Son ex-ovule est simplement plus extraverti, plus volubile, plus envahissant, plus enquiquinant, plus mal élevé que la moyenne et il me contraint, quand je l’ai subi, à vider plusieurs cachets de Nurofen dans une bouteille d’eau d’Évian. Ou directement dans un mojito quand mon imaginaire peccamineux se mêle de le métamorphoser en sac de frappes. Mais il est vrai que dans ce monde, tout revers étant couplé à son avers, me souvenir de lui décuplera mon plaisir de cloîtrer mon cartable dans un placard et de savourer mes croissants durant mes grasses matinées.
Dès mon premier lundi de liberté, une bronchite flingua mon enthousiasme en me clouant au lit avec un fort pic de fièvre. À une période où le thermomètre était coincé au-dessous de zéro, l’application du principe médical autant que médiéval visant à aérer pour renouveler l’air et envoyer ad patres les microbes n’eut d’autre effet que de me faire sévèrement rechuter. Entre deux quintes de toux à me décrocher les poumons, je m’efforçai quand mêmede lire les nouvelles déposées par mon porteur de journaux dans ma boîte aux lettres après l’avoir sadiquement écouté pester de longues minutes devantla résistance psychotique du ressort d’ouverture, le visage barré du large sourire du Joker :
La fermeture fonctionnant, quant à elle, remarquablement bien, le mécanisme happait régulièrement ses phalanges, lui arrachant des cris de douleur :
Le jeudi, emmitoufléedans mon peignoir en laine des Pyrénées, l’œil et le cheveu ternes, j’allaiappuyer sur la touche « on » de la cafetière. Dans la foulée, je m’affalai sur une chaise, m’astreignant à tournerles pages du quotidien fraîchement imprimé avec la tonicité d’une nouille géante, le cerveau branché sur courant alternatif, jusqu’àce qu’une succession de vertiges m’intiment de disparaître sous mon édredon. Seule survivait ma mauvaise humeur car, je dois le reconnaître, chaque immersion dans la plus infime bobologie, coupure, carie, migraine, ampoule au pied, coryza, crise de foie me clone immédiatement en Tatie Danielle. J’éteignis mon smartphone pour m’isoler de la civilisation, replongeai dans un demi-sommeil agité, peuplé de tripodes gigantesques, blafards, gluants, affublés d’un appendice nasal éléphantesque, assaillie de formes psychédéliques découvertes traditionnellement par ceux ayant confondu champignons hallucinogènes et girolles. Pendant quarante-huit heures, je m’obligeai à ingérer des litres de bouillons, à avaler ma provisionde vitamine C, à garnir ma poubelle de mouchoirs en papier, à maudire ces saletés de bactéries qui se lovaient contremoi, polluaient mes draps, chaque centimètre de mon appartement, souillaient mon oxygène, vampirisaient mon dynamisme, se reproduisaient dans des bacchanales dantesques, se roulaient dans des fous rires nerveux en contemplant l’amas d’antibiotiques inutilement entassés sur ma table de chevet.
Et puis, ce matin, alléluia, je vais mieux. Plus de température, un nez dégagé, une résurgence d’appétit, des séquelles limitées à une sensation de fatigue confuse, un kilo en moins et des cernes de chouette momifiée. Un déjeuner frugal, l’empilement en vrac dans mon armoire à pharmacie de gélules et sirops délivrés sur ordonnance, une rapide remise en ordre de la chambre dévastée, une douche chaude, un maquillage succinct et hop, direction le supermarché pour reconstituer les réserves d’un réfrigérateur réduites à un yaourt, une courgette et un fond de jus d’abricot. Croiser une congénère armée d’une liste de courses me fige dans un sentiment d’admiration béate associé à une ineffable angoisse. Préalablementà tout débarquement militaire dans une grande surface, l’une de mes voisines établit sur une feuille quadrillée divisée par sept multipliée par trois, l’intégralité des menus de sa semaine. Moi qui achète viandes, légumes, desserts dans une totale ignorance de leur organisation future dans mes assiettes, cette planification méthodique des repas, à une année-lumière du remplissageanarchique de mon caddie me traumatise car j’ai, depuis toujours, opté pour l’aléatoire. Telle pièce de bœuf est belle, tel fruit est mûr ? Bienvenue chez moi ! Comment prédiresi les concombres seront toniques ou flasques, si les poivrons seront brillants ou ridés et les oranges à un doigt de moisir ? Nantie de mes achats, après m’être fourvoyée dans l’unique caisse où un code-barre illisible pétrifie un quadragénaire, suscitant un SOS tonitruant, claironné dans le micro du magasin : « Romain ? Tu peux me communiquer le prix des préservatifs ?... Petite taille ! », je me retrouve sur le parking à charger mes emplettes dans le coffre, dans le plus parfait désordre. M’asseoir au volant m’arrache un soupir de soulagement. Celui-ci est pourtant de courte durée en découvrant que le niveau d’essence stagne dans le rouge.
Fidèle à mon parti pris de privilégier les contacts humains, je dédaigne la station libre-service pour filer vers celle, à une centaine de mètres, où le sourire de la gérante s’offre spontanément à ses clients, bien ou mal lunés. Me voyant complètement indifférente à l’instruction placardée sur les pompes indiquant qu’il faut régler avant de se servir, elle débloque gentiment la n°8 devantlaquelleje me suis résolument plantée, pistolet enfoncé dans le réservoir, les yeux rivés sur les zéros du compteur, en attendant le jaillissement du liquide comme les catholiques attendent à Naples le miracle de San Gennaro. Le brusque afflux du sans-plomb me surprend, un ronflement irrégulier rythme le débit, les chiffres affichés défilent précipitamment. Lassée de me voir promener un regard vague sur ce qui m’entoure, ma Corsa me balance un teigneux clic de fin, se désole lorsque je m’y reprends à plusieurs fois pour fermer son bouchon, s’agace en constatant que je m’obstine à le dévisser au lieu de le revisser. L’accueil dans la boutique est aimable, enjoué, l’échange affable tandis que je pianote sur le terminal de paiement.
Je saisis mon ticket, range mon portefeuille, rejoins ma voiture. Un splendide coupé sport grismétallisé est garé juste derrière moi, un Noir idéalement découplé est penché sur ses pneus pour s’assurer qu’ils sont suffisamment gonflés. Je déverrouille mes portières, pose mon sac sur le siège passager, démarre, avancejusqu’au bateau, stoppe face au flot ininterrompu qui déferle sur cette quatre voies bordelaise. Je patiente paisiblement, je ne suis pas pressée, je sais que le feu du carrefour va vider l’avenue, pas la peine de prendre le risque de froisser ma carrosserie dans ce flux incessant, vrombissant. Soudain, l’Alfa grise se colle à la mienne, une vitre s’abaisse, le conducteur s’incline, m’interpelle :
Qu’est-ce que tu veux ? Passe si tu veux passer ! Et dégage, tu me gênes, je n’ai plus aucunevisibilité sur les boulevards !
Il insiste.
Sitôt dit, sitôt fait. Peu soucieux de la densité du trafic, il enclenche une vitesse, contraint une Mini Cooper à piler sèchement, provoque un appel de phare rageur d’une Ford, un coup de klaxon assassin. L’espace d’une seconde, il ralentit pour vérifier si je le suis et, repérant mon réflexe de l’imiter, brandit à l’extérieur un pouce victorieux. Une accélération pied au plancher et le voilà disparu dans une artère adjacente.
CHAPITRE 2
Et allez ! Ma rue est encore encombrée par toutes sortes de véhicules. Warnings clignotants, un artisan décharge sa camionnette, le morveux d’une voisine a une fois de plus abandonné son deux-roues au milieu du trottoir. Je recule pour m’aligner sur sa pétrolette, coupe le contact, descends ouvrir ma porte. Un crissement de pneus déchirant me fait vivement tourner la tête en redoutant un choc d’anthologie tandis qu’une voix joyeuse retentit.
Allons bon, le revoilà ! Décontracté, il se gare sur un zébra, me rejoins avec un immense sourire. Mince, athlétique, c’est un superbe garçon, son polo vert amandeest siglé par une marque renommée, son jean et ses baskets également, une lourde chaîne en or brille à son cou, elle retient une breloque en forme de fer à cheval.
Un air compréhensif.
Il avise le coffre ouvert.
Un haussement d’épaules indifférent.
Il empoigne les poches en un tournemain, se fige devant les marches.
En traversant le séjour, il lance un coup d’œil circulaire.
J’extrais des cannettes des paquets vautrés sur le sol, des verres du buffet, verse les contenus dans les contenants, m’installe face à une mine réjouie.
Une légère hésitation.
Une expression ravie.
Une moue insouciante.
Il avale goulûment la moitié de son breuvage.
Il hoche la tête, enchaîne avec conviction.
Il reste un instant songeur.
Il se perd dans ses pensées, renoue subitement avec la réalité.
Son visage se ferme. Il vide son verre, le repose sur la table, m’interroge.
Il a quoi ? Vingt-quatre, vingt-cinq ans ? Il agit en parent alors qu’il n’est guère plus vieux que son cadet. Il perçoit mon hésitation, poursuit avec fougue sa plaidoirie.
Sa voix se casse, il évite de me fixer. Disparues l’aisance, la décontraction, il a ouvert la porte à quelque chose de plus profond, de plus intime. Mais très vite, il se reprend, questionne, incertain.
Il affiche un large sourire.
Il a changé physiquement mais pas dans sa façon d’être. Il est toujours aussi attachant, spontané et naturel que l’Idir brusquement ressuscité dans mes souvenirs. Si son frère est fondu dans un moule identique, je n’ai plus qu’à me résigner à bloquer un créneau hebdomadaire dans mon agenda. Et cette conclusion m’arrache un long soupir désolé.
Sèchement poussé en avant, Karim me décoche un coup d’œil de poulain ombrageux, me tend une main mollassonne. Une chiquenaude s’abat sur sa nuque accompagnée d’une injonction.
Les lèvres de Karim se pincent, une colère rentrée voûte son dos.





























