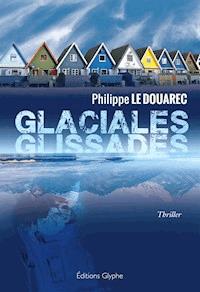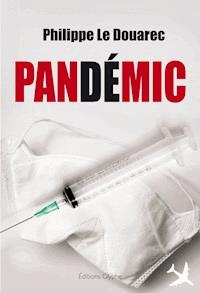
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions Glyphe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Quand les vacances tournent au cauchemar...
AFP, 18 juin : "GRAVE ÉPIDÉMIE VIRALE AU MEXIQUE - DES CENTAINES DE MORTS - TOUS LES AÉROPORTS FERMÉS".
Le docteur Paul Thuiller et sa femme Hélène, virologue réputée, rentrent des États-Unis. Dans l'avion qui les ramène en Europe, deux passagers s'écroulent, asphyxiés par une fulgurante affection respiratoire. Paul est appelé au chevet des malades. Ils portent tous les deux les signes d'une grave infection virale… Le médecin convainc le commandant d'atterrir en urgence, contraint de se poser en Islande, sur une piste trop petite… Malades, blessés et morts sont mis en quarantaine. Tandis que les décès se multiplient, la radio informe la population que les aéroports internationaux ferment les uns après les autres…
Un thriller apocalyptique à la fois angoissant et captivant !
EXTRAIT
La Peste. Quel sens donner à ce mot qui rappelle les horreurs moyenâgeuses, les crécelles, les séances de flagellation, les charniers à l’entrée des villes et des villages, la panique généralisée, l’ambiance de fin du monde et un clergé vengeur, attribuant ce cataclysme à la non-rémission des péchés de chacun. Un effluve « miasmatique », pénétrant, incontournable, irréversible, « pestilentiel », où se mêlent l’odeur salubre du bois brûlé et celle, épouvantable, de la chair humaine en décomposition, où seul le feu peut tenter d’effacer les suintements purulo-sanglants de ces corps entassés, amassés dans des fosses communes creusées à la pelle par des hommes épouvantés et peut-être déjà, eux-mêmes atteints.
CE QU’EN PENSE LA CRITIQUE
L’intrigue de ce thriller au parfum d’apocalypse virale est d’actualité. – Ouest France
À PROPOS DE L’AUTEUR
Philippe Le Douarec est chirurgien, fellow of the American College of Surgeons.
Il enseigne l’histoire de la médecine et l’anatomie. Il connaît bien l’Islande, qu’il a traversée du nord au sud… en courant.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À saint Sébastien, À saint Roch, À saint Charles Borromée
Tous les saints protecteurs de notre vieille ennemie… la Peste
VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2010
PRISONNIERS DU CIEL
DERNIER JOUR DE NOS VACANCES EN FLORIDE. Encore une fois, je profite de ce moment magique, le lever de soleil sur la mer immobile, comme apaisée, qui s’étale aux pieds de l’appartement. Je me glisse sur la terrasse dominant l’océan, refermant doucement la baie vitrée de la chambre où Hélène dort encore. Une douce chaleur, un peu moite m’enveloppe. Les reflets irisés du ciel, les silhouettes fuyantes, fantasmagoriques, des nuages me transportent. Puis la déchirure rougeoyante de l’horizon annonce l’irruption brutale du soleil. La mer est de la fête, passant, dans l’instant, d’un bleu de Prusse à un bleu cobalt. Ce bonheur fugace ne parvient pas, cependant, à atténuer ma déception : ces vacances sont un échec.
Des mois que j’attendais, que nous attendions, Hélène et moi, un peu de répit dans notre vie trépidante, découlant de l’activité, ô combien passionnante, de mon épouse. Six ans déjà qu’Hélène, virologue spécialisée dans la génétique « inverse1 », est ma femme. L’an passé, nous devions fêter notre cinquième anniversaire de mariage à Boca Raton, cet endroit très protégé de la côte floridienne. Mais l’actualité anéantit notre projet de vacances. Nous étions fin avril, le 28, quand, deux jours après notre arrivée, Hélène fut rappelée à Cambridge par son laboratoire. L’explosion virale au Mexique imposait sa présence en Angleterre. Quant à moi, jeune mari et fidèle compagnon, je n’avais qu’à taire ma colère et ravaler ma contrariété devant ce gâchis. Les quinze jours de bonheur prévus, effacés, reportés aux calendes grecques. Sans compter que loin de chagriner Hélène, cette brutale pandémie l’excitait au point d’en oublier les vacances et toutes les résolutions que nous avions prises. Le soir même, nous avions trouvé deux places sur un vol transatlantique. Je pouvais déjà m’estimer heureux de faire partie du voyage de retour. Vacances manquées en mai 2009. Aucun répit depuis, le virus étant prioritaire. Qu’il soit H1N1 ou H5N1, même combat, Hélène était sur le pont, et je n’avais qu’à obtempérer. L’hiver qui suivit, je ne l’ai pratiquement pas vue. Rappelée sans cesse à Bâle par Roche dont elle dépendait, elle passa son hiver dans l’avion, participant à des réunions continuelles, soit pour revoir les modalités du futur vaccin, soit pour contrer l’hostilité de plus en plus agressive des médias, envers les laboratoires et leur lobbying. N’avait-on pas amplifié de manière déraisonnable les risques de la pandémie du virus H1N1 ?
Les laboratoires, en difficulté après l’effondrement économique lié aux sub-primes, n’avaient-ils pas accentué leur pression sur les gouvernements pour profiter de l’aubaine, fabriquer et vendre larga manu des litres de vaccins dits « pré-pandémiques », des tonnes de masques ? Hélène se retrouvait au centre de ce maelström, relais incontournable entre Roche et les pays anglo-saxons. Elle me prenait à partie sur ses altercations quasi quotidiennes avec son supérieur hiérarchique qui lui imposait de noircir au maximum le tableau, à savoir son rapport d’expertise sur la pandémie de grippe A H1N1. Il fallait faire peur aux gouvernements, les contraindre à l’attitude la plus prudente, selon le traditionnel « principe de précaution » attitude, induisant bien entendu les meilleurs profits pour son employeur.
Dès que j’évoquais le sujet, Hélène, agacée, m’envoyait promener :
– Enfin, Paul, tu n’y connais rien !
L’hiver passa ainsi, quelques dizaines de morts tout au plus, patients souvent atteints de différentes pathologies dont le virus n’était que le facteur de trop. Les laboratoires avaient eu le temps de se frotter les mains et d’entrevoir des jours radieux. Si je calcule bien, je n’ai eu droit durant ces six derniers mois, qu’à deux week-ends entiers avec ma femme. À commencer par un réveillon de Noël triste et pluvieux, aux thermes de Saint-Malo, entamé par une sévère prise de bec avec Hélène au sujet de mon désir de… procréation.
– Écoute Paul, ce n’est pas le moment, je suis trop occupée.
Quant au second week-end, il fut encore plus pénible, plus froid et plus pluvieux… Bâle, triste ville et fief de Roche, me rappelait les pérégrinations d’un médecin jadis adulé, puis honni et rejeté… Paracelse ! Hélène, fatiguée, refusa même une journée de ski. Insidieusement, la lassitude me gagnait, en même temps qu’un besoin maladif de soleil et de chaleur. Aussi, ces vacances, constituant une rupture dans notre rythme infernal, me paraissaient indispensables. Elles devaient nous permettre de faire le point, de réfléchir à l’avenir de notre couple. Malgré la réticence d’Hélène, j’avais réussi à imposer la Floride et, par défi sans doute, les mêmes conditions de vacances que l’année précédente, puisque les Weinstein, nous laissaient de nouveau à disposition leur sublime appartement. Quoiqu’il advienne, cette fois, nous serions aux abonnés absents quinze jours durant. Intuitivement, je réalisais que ces deux semaines de repos, de réflexion et d’isolement devaient aboutir pour notre couple au maintien ou à la rupture. J’avais choisi encore une fois Boca Raton, car cet endroit convenait en tout point à notre art de vivre, un lieu confortable au soleil, loin de la foule, un parc magnifique où je comptais bien entraîner Hélène chaque matin, avant un bain réparateur dans les vagues chaudes de l’océan. Le jogging matinal n’était-il pas le moment idéal pour parler du seul sujet qui m’importait alors, l’avenir de notre ménage à trois, si je puis dire : Hélène, moi et… le virus. En fait, ces vacances furent un fiasco. Jamais je n’ai trouvé le courage d’entreprendre Hélène sur… notre avenir, notre couple. J’ai été en dessous de tout. Oh, ce fut parfait : sport à volonté, longues heures de lecture, soirées tranquilles avec une Hélène reposée. Pas de virus à l’horizon, pas d’amis importuns, mais rien concernant notre avenir à deux. En somme, notre couple se résumait à la cohabitation de deux êtres, sans symbiose, sans communion réelle. Une dernière fois, je chausse mes Asics, j’enfile mon short pour ma course matinale pendant qu’Hélène prépare nos bagages pour notre retour en Europe. J’ai absolument besoin de cette dernière course, de cet effort physique.
Puis-je ainsi cacher ma veulerie, ma lâcheté ? Avec un fond de tristesse, je foule une dernière fois ces chemins affectionnés, tracés dans une pseudo-forêt tropicale. Le mulsh qui les recouvre leur donne une souplesse, une douceur aux pieds que, de ma longue carrière de marathonien, je n’ai rencontrées qu’à Helsinki, en foulant la piste d’aiguilles de pins dans les bois qui jouxtent le stade Olympique. Dans la touffeur matinale du mois de septembre floridien, j’apprécie ce lieu, certes un peu artificiel, mais où la nature protégée me livre quotidiennement ses charmes, dans la solitude la plus totale, si ce n’est une faune variée. Par exemple, des écureuils bondissants, moins farouches que leurs fauves cousins européens, ou encore un raton laveur farfouillant le sentier devant moi. Parfois des hérons cendrés au port hiératique, indifférents à ma course, posément installés au bord de la mangrove, ou des pélicans majestueux s’élevant d’un vol lourd en formation d’escadrille. Plus exceptionnellement, la trace d’un alligator égaré imprimée dans le sable de l’inter-coastal, large canal d’eau de mer bordant notre chapelet d’îles. Enfin, moins agréable, la présence d’un long serpent noir, se chauffant au soleil au milieu du chemin, tout en surveillant le petit lézard dont il fera dans quelques secondes, son repas du jour ! Cette énième course, cette heure de réflexion, je ne la manquerais pour rien au monde, je la savoure avant de retrouver demain les brumes anglaises. Je me sens affûté, fit comme ils disent ici, ayant perdu mes quelques livres superflues. Troublé par l’incertitude de notre avenir, je ne peux m’empêcher de repenser à ces dernières années. Converti sur le tard à la virologie, j’ai suivi Hélène en Angleterre, où je prépare actuellement un livre sur l’histoire du virus H5N1. Après un internat, puis un clinicat en chirurgie et une carrière a priori toute tracée de chirurgien, l’arrivée d’Hélène a bouleversé mes plans. Faute de proposition intéressante dans le système sclérosé parisien, elle a accepté un poste passionnant à Cambridge. Après quelques mois d’incertitude, d’hésitation, j’ai pris la décision de la rejoindre et… de l’épouser. Il faut dire que l’évolution de mon métier de chirurgien, avec ses contraintes administratives de plus en plus lourdes, avec la « collectivisation » à outrance de la responsabilité et de la prise de décision de l’acte chirurgical, ne correspondait plus à mon tempérament, sans doute trop individualiste. Les charmes d’Hélène firent le reste. Installés provisoirement dans un ravissant cottage à dix minutes de nos bureaux, dans cette merveilleuse campagne anglaise, je suis devenu progressivement, un bon connaisseur de l’influenza dont je n’avais auparavant aucune connaissance sérieuse quant à son pouvoir de nuisance. Hélène flattée, à la fois heureuse, et surprise par mon choix un peu surprenant de quitter la France et la chirurgie, me servit de guide et de mentor pour ce nouveau départ, dans ce monde anglo-saxon si éloigné de mon univers parisien. Mon adaptation fut aisée et les collègues d’Hélène, d’origines très variées, m’accueillirent avec chaleur. La simplicité des relations, la décontraction, l’humilité des scientifiques de son entourage me rassurèrent très vite dans mon choix. N’ayant pas de difficultés majeures avec la langue, j’ai progressé rapidement et suis devenu plus un historien de la maladie virale qu’un véritable chercheur. Mon travail était en quelque sorte complémentaire de celui d’Hélène, cette entente faisant toujours l’étonnement de nos collègues dont les relations maritales – ou extra-maritales – étaient souvent chaotiques. Nous étions bien intégrés à la communauté scientifique de Cambridge. Une fois de retour en Europe, après une conférence à Monaco lors d’un symposium vétérinaire sur le virus H5N1, nous envisagions de partir quelques années à l’hôpital universitaire John Hopkins de Baltimore, où le laboratoire de virologie nous proposait une situation alléchante. Il faut dire que le John Hopkins est un peu La Mecque de la virologie, ou du moins, un des lieux mythiques où tout débuta, depuis sa création en 1917.
Après un bain exquis dans ces eaux chaudes, j’admire une dernière fois cette plage sans fin qui fait à la fois le charme et la monotonie de la côte floridienne. Puis je rejoins Hélène pour notre dernier déjeuner avant le départ. Déjà 10 heures ! Manifestement en retard, Hélène s’affaire et tente tant bien que mal de ranger mes affaires dans la valise : quelques shorts et chemises, deux pantalons, plus quelques bouquins.
– Toujours la même chose ! Monsieur court pendant que madame s’occupe de tout !
Soupesant un de mes livres, Les Bienveillantes de Littell, Hélène ajoute :
– Tu es venu à bout de ce pavé ? Chapeau !
– En fait, le côté historique du bouquin m’intéressait. Cela dit, Littell a fait de son héros, le docteur Aue, cultivé et mélomane, un torturé de l’arrière-train !
– Ah ! Je vois, un drame historique et du sexe pervers, tous les ingrédients pour obtenir un prix ! En somme, rien de nouveau sous le soleil.
– Si tu veux.
– Tu as raison, Chou, tu as toujours raison d’ailleurs. Va vite prendre ta douche, donne-moi tes affaires de course, que je les lave vite fait.
Notre avion était prévu à Fort Lauderdale vers 13 heures, avec escale à Philadelphie. Nous étions satisfaits d’éviter l’encombrement de l’aéroport voisin de Miami. J’avais encore en travers de la gorge le coût de mon billet de retour en catastrophe l’an passé, que le laboratoire d’Hélène refusa de me rembourser.
– Nous reviendrons c’est promis, dis-je d’un ton neutre à Hélène, en terminant saucisses, scramble-eggs, et pancakes arrosés de sirop d’érable.
J’admire une dernière fois l’éblouissant spectacle qui se déroule à nos pieds. Depuis la terrasse, écoutant le bruit assourdissant des vagues qui semblent saluer notre départ, je réalise à quel point, depuis ma rencontre avec Hélène, ma situation n’est pas une réussite. Ma bifurcation scientifique tout d’abord, puis notre installation en Angleterre, enfin, l’orientation nouvelle de notre carrière avec un séjour programmé aux États-Unis, tout cela me perturbe et m’inquiète. Tandis que je courais ce matin, chaque vague s’écrasant sur le rivage semblait me répéter indéfiniment « Paul, es-tu content de ton sort ? Es-tu réellement heureux ? ». Luttant contre ce flot lancinant de pensées, je sentais cependant mon inconscient de plus en plus perturbé. Cette musique inhabituelle peu à peu, érodait, fissurait ma résistance, ouvrait des pans entiers dans ma muraille mentale. Je refusais de voir la réalité en face, c’est-à-dire l’échec de notre couple. Les vacances que j’avais tant réclamées, s’achevaient dans la morosité.
En fait je n’avais rien osé. Aucune réflexion sérieuse durant ces quinze jours sur notre couple, sur ma déception profonde de ne plus être chirurgien, sur ma lassitude de vivre dans un monde anglo-saxon. Mon amour pour Hélène s’effritait. J’avais beau me convaincre que nous formions une belle équipe, je n’y croyais plus. Lassitude du couple, passant la quarantaine, sans enfant, égoïsme masculin, égoïsme partagé ? Déception personnelle de ne vivre « qu’à moitié », pseudo-scientifique vivant dans l’ombre d’Hélène, une sorte de prince consort en somme.
Après tout, peut-être que pour elle, tout va bien. Ma tiédeur, mon insatisfaction, mon rejet progressif de ce maudit virus et tout ce qui s’ensuit, les conférences, les voyages, les articles, les interviews, je ne supporte plus tout cela. Ce combat perpétuel ne me distrait plus. Dans ces réunions incessantes, je ne vois que propos répétitifs, ronronnements perpétuels de conférenciers, claironnant les dangers que nous courons, partageant leurs découvertes de laboratoire, passionnés à l’évidence par ce virus et sa mutation. Hélène fait partie de ce monde, pas moi. J’ai cru pouvoir en être, mais non. Si l’histoire du virus m’a amusé un temps, ce n’est plus le cas. Serait-ce tout simplement un amour en fin de course ? Ces vacances, sur lesquelles j’avais fondé tant d’espoirs, n’avaient apporté aucun changement. Loin de l’univers de la virologie, Hélène semblait s’ennuyer. Elle partageait mes courses, mon art de vivre, mes idées sur beaucoup de sujets. Aucun nuage entre nous, une entente physique parfaite, mais plus d’étincelle ! La bougie est en train de s’éteindre. Ces trente minutes de voiture jusqu’à l’aéroport s’écoulent dans un profond silence. L’un comme l’autre noyés dans nos pensées.
À quoi ressemblent les siennes ? Ce break de quinze jours n’a manifestement rien arrangé. Hélène est une énigme pour moi. Elle est belle certes, mais n’a qu’une passion, son virus ! Son ignoble H1 ou H5N1. Et moi dans tout cela ? Suis-je la pièce rapportée ? Le faire-valoir ? Pour ses beaux yeux, j’ai tout abandonné, Paris, la chirurgie, la France. J’essaye de rejeter au loin ces sombres pensées, mais elles reviennent, persistantes. Hélène est-elle consciente de mes états d’âme ? Son ton, son langage, son comportement à mon égard ne changent pas. Elle ne semble pas voir ma mauvaise humeur, mon insatisfaction, mon rejet progressif de ce maudit virus et tout ce qu’il entraîne.
Tout ce tapage qui entoure ce combat perpétuel contre ce serial killer d’un genre nouveau, ne me distrait plus. Après quinze jours de mer et de soleil, je réalise que je vais avoir à l’affronter à nouveau. Bref, ce virus me pèse. Tiens, pour commencer, Monaco la semaine prochaine. La énième conférence sur le sujet, ne débouchant sur rien de tangible. Peut-être encore une fois, Hélène va-t-elle m’annoncer un changement de programme de dernière heure. Par exemple, la découverte d’un nouveau foyer de grippe en Ouzbékistan, aviaire ou porcine, aviaire plus probablement, avec quelques décès dans la population locale, et son obligation d’aller immédiatement sur place pour en savoir plus. Désolée, chéri, je ne peux pas rentrer avec toi.
Je suis las, éreinté, détruit par ce ballet incessant. Si je pouvais l’étrangler, ce virus. À la maison, chaque appel téléphonique, nocturne la plupart du temps, est pour Hélène. Un correspondant lointain annonce un détail nouveau sur l’évolution de la maladie et, Hélène se lève, va prendre des notes, passe de longues minutes sur son ordinateur et m’oublie sur-le-champ. De guerre lasse, il m’arrive, excédé, de décrocher le téléphone. Jalousie, c’est cela, je suis jaloux du virus. Dans le fond, je n’ai rien à lui reprocher, elle aime son boulot et elle fait tout pour m’être agréable. Patiente, fidèle, bonne maîtresse de maison, presque docile, tant que le virus n’est pas en cause. Quand c’est le cas, là, c’est le cauchemar. Excitée, intransigeante, agressive, dominatrice, plus rien ne compte. À dire vrai, je n’existe plus. Tristesse de fin de vacances, cela explique sans doute cet accès inhabituel de « déprime ». Me tournant vers Hélène qui s’affaire auprès de nos bagages, j’admire sa silhouette. Cependant, tandis qu’elle s’agite à mes côtés, son genu valgum accentué me chagrine. Elle court en canard, cela m’agace. Elle n’a pas la foulée féline et souple de… Nancy, ma première femme. Lamentable, cette pensée, j’ai presque honte. Décidément, je ne suis jamais content. Sans aller jusqu’à dire « Dis-moi comment elle court, je te dirai qui elle est », c’est fou l’importance que je peux donner à la foulée féminine.
Nous arrivons à l’aéroport en temps voulu pour notre vol.
Nous sommes le vendredi 10 septembre 2010.
1. Génétique inverse : mise au point d’un germe associant un virus provenant de cas humains et un virus de laboratoire. À partir de ce virus non pathogène, on peut produire des vaccins expérimentaux.
13 heures
VOL UNITED FORT-LAUDERDALE – PHILADELPHIE
AVANT LE DÉPART, j’ai pris bien soin de laisser un mot aux Weinstein, nos si sympathiques hôtes, les invitant le 14 juillet prochain à passer quelques jours avec nous en France. Les formalités sont vite réglées dans cet immense aéroport où l’on ne retrouve, comme prévu, ni la pression, ni la foule du Miami International Airport voisin. Dans l’avion, je me saisis distraitement du Sun Sentinel pour lire les derniers potins de la côte. Maigre butin, il faut dire que nous sommes en basse saison actuellement en Floride. La situation est toujours délicate entre les îles Caraïbes et la côte américaine. Encore un canot surchargé d’Haïtiens transis, miraculeusement retrouvé par les garde-côtes au large. L’article évoque une carcasse de douze mètres de long transportant soixante-dix adultes et douze enfants, lesquels auront survécu à ce douloureux voyage et pour cette fois, ne serviront pas de repas aux requins, toujours en chasse. L’Amérique fait toujours rêver, du moins en Haïti et à Cuba ! Par ailleurs, le Nasdaq est en baisse de même que les bourses européennes. Madoff est déjà oublié. Au Moyen-Orient, la situation est stationnaire, pour employer un terme météorologique. Statu quo crispant entre Palestine et Israël, avec une bande de Gaza toujours soumise à la lutte permanente entre clans rivaux, se disputant la manne onusienne et européenne.
Un long article en revanche, me trouble un peu dans les pages locales :
« Disparition sur les quais : trois touristes d’origine chinoise ont disparu au petit matin, alors qu’ils s’apprêtaient à embarquer pour une croisière sur le Sovereign of the Seas ».
Le journaliste évoque un éventuel règlement de comptes entre triades. Ces trois Chinois, deux hommes et une femme, arrivés la veille en Floride en provenance de Los Angeles, envisageaient un séjour d’une semaine au Costa Rica après leur croisière.
Le Costa Rica me rappelait de délicieux souvenirs. Il semble toujours aussi attractif, même pour les Chinois. Ce petit pays surnommé avec une certaine justesse, la Suisse de l’Amérique Centrale, nous avait accueillis Hélène et moi pour notre voyage de noces. Avec nostalgie, je repensais aux grands moments de notre voyage de jeunes amoureux, aux plages désertes de Montezuma, aux eaux chaudes du « Tabaccon » au pied du volcan Arenal. Ironiquement, je me souvenais de notre déception d’avoir manqué la vision du volcan en éruption à la nuit tombante, tant le brouillard était épais. Bercé par le ronronnement des réacteurs et transporté par ces images de plages costaricaines, je m’assoupis. Je sens la main d’Hélène dans la mienne. Serait-ce un appel ? Comment traduire cette pression, ce contact ? Comme toujours, le courage me manque pour approfondir. Nous avions deux semaines pour évacuer ce malaise et nous en sommes au même point, échec total. Hélène plongée depuis le début du vol dans un rapport sur la mutation virale, établi par des scientifiques russes dont les conclusions ne semblent pas lui convenir, fait ses commentaires à haute voix à intervalles plus ou moins réguliers. L’un comme l’autre, nous tombons dans un état de torpeur plus ou moins profond. Nous sommes réveillés par les consignes de la chef hôtesse à l’atterrissage, nous entamons notre descente sur Philadelphie.
16 h 30
AÉROPORT DE PHILADELPHIE
L’AVION SE POSE À L’HEURE PRÉVUE, soit deux heures trente après notre départ de Fort Lauderdale. Excité par cette arrivée, je ne peux m’empêcher de souffler à Hélène : Philadelphie, l’un des tout premiers ports de l’Amérique avec Boston. Tu te souviens ce qu’ils ont vécu ici en 1918 ? Plus de 500 morts par jour pendant plusieurs semaines, pas une famille épargnée.
Peine perdue, Hélène acquiesce sans répondre.
– Quand même, c’est dur à avaler cette histoire, et on appelait cela, la grippe espagnole, c’est fou non ?
Toujours pas de réaction d’Hélène. Il faut dire qu’elle connaît mes réflexions sur le sujet. En effet, je suis intarissable et répète à l’envi ces anecdotes plus horribles les unes que les autres, hélas toutes aussi véridiques et laissées dans l’ombre durant des décennies. J’en rajoute même :
– Tu sais que cette pandémie a probablement joué un rôle dans la genèse de la Seconde Guerre mondiale ! Intéressant l’histoire, n’est-ce pas ?
Hélène hausse les épaules. Manifestement le sujet ne l’intéresse guère. J’enchaîne pourtant :
– J’ai fait quelques recherches supplémentaires à Cambridge. Je suis arrivé aux conditions du traité de Versailles, à l’état de santé de Woodrow Wilson1, tombé malade avant la signature du traité, tu t’en souviens ? Beaucoup pensent, et moi le premier, qu’il fut victime, lui aussi d’une great influenza et non d’un AVC. Mis hors de combat par le virus pendant dix jours, il ne put résister à la volonté implacable de Clemenceau de punir les « Boches ». Wilson, malgré le soutien des Anglais, ne put tempérer l’ardeur du « vieux lion », qui obtint finalement les conditions que l’on sait, faisant du coup, de tout Allemand de l’époque, un futur revanchard désirant effacer une certaine injustice dans le traitement réservé à son pays… Encourageant notamment les idées d’un certain Adolphe quelques décennies plus tard, n’est-ce pas Hélène ?
J’étais conscient de lui répéter pour la énième fois l’histoire de la maladie du président américain, mais c’était ma manière de combler nos silences, de remplir le vide affectif que je sentais grandir entre nous. Au moins ce virus servait-il à quelque chose, il maintenait une connivence intellectuelle et, par ricochet, cimentait artificiellement notre couple. En revanche, si passion il y avait eu entre Hélène et moi, celle-ci, avec le temps, s’effritait. Nous avions deux heures d’attente à Philadephie avant notre vol pour Heathrow, toujours avec United.
Hélène rouspète, déplorant un vol sans escale. La galerie marchande où nous nous trouvons est envahie par une cohorte de touristes japonais. Au milieu, un couple d’Amish totalement indifférent au tumulte général, à ces cris stridents, à la sono déchaînée d’un magasin de CD voisin, passe tranquillement son chemin. « Ils sont décidément impayables ces Amish », me dis-je. Ils vivent en autarcie comme au XVIIe siècle, sans électricité, sans radio, sans TV, fabriquant tout leur nécessaire de leurs mains. Ils traversent cet aéroport moderne comme si de rien n’était. Où vont-ils chercher un monde meilleur ? Soudain mon portable vibre dans ma poche de chemise, je sursaute.
C’est Margaret, ma secrétaire à Cambridge, qui m’appelle :
– Paul, bonjour, vous arrivez bientôt je crois, ça tombe bien. J’ai reçu plusieurs coups de fil pour vous et des mails venant d’Asie. D’abord, un mail bizarre de Hong Kong, puis un autre de Pékin d’un correspondant français travaillant à Maison-Alfort. J’ai le sentiment qu’ils sont importants. Voici le mail de Hong Kong :
« Au Docteur Thuillier Paul.
Venant au congrès vétérinaire de Monaco dans quelques jours, je voulais vous signaler la décision brutale du gouvernement chinois de fermer tous les élevages de volaille du Sud de la Chine dès ce jour. Il semblerait qu’il y ait des mouvements inhabituels dans les hôpitaux de Shanghaï et de Canton, aucune information officielle mais contact téléphonique d’un ami médecin à l’hôpital de Canton.
Chen Laï
(J’ai passé avec vous ma thèse de virologie à Cambridge, il y a cinq ans). »
Mail de Pékin cette fois :
« Salut Paul, heureux de te voir à Monaco dans quelques jours, j’espère que l’on pourra profiter du Larvotto et faire quelques emplettes boulevard Princesse Charlotte. Ici j’ai ouï dire qu’il se passe des choses dans la volaille locale, rien de bien clair mais beaucoup de remue-ménage. Une atmosphère plus lourde qu’habituellement, bizarre. On se voit très bientôt.
Georges B. » Un B pour Brisson, un vieux copain vétérinaire, spécialisé dans les maladies virales des bêtes à plumes.
Ces mails et ces coups de fil impromptus m’agacent un peu. Depuis quelque temps, j’ai pris l’habitude de ces turbulences, à propos de nouveaux foyers de grippe aviaire ou porcine, avec parfois, quelques victimes humaines. Là en Ouzbékistan, ici en Anatolie, là dans la proche banlieue de Moscou, ici en Macédoine ou dans un élevage de dindons dans le Staffordshire. Récemment, en Macédoine, trois enfants sont morts dans la même famille, les parents épargnés. Je me dis, là encore, que les gamins ont trop joué au foot avec les têtes des poulets malades. Quant aux parents, ils ont vite fait de nourrir la famille avec ces volailles affaiblies, économie oblige ! Donc, rien de bien nouveau. Toujours, cette angoissante interrogation, grippe aviaire ou porcine, mais quid de l’Homme ? Pas de transmission interhumaine, pas de mutation virale… pour l’instant. En permanence, ici ou là, un nouveau foyer explose. Heureusement à ce jour, il s’agit d’infections en général bénignes, comme l’an passé au Mexique, uniquement des virus à bas profil pathogénique, peu dangereux.
Tout comme Webster ou Navarro, les spécialistes mondiaux, Hélène reste alarmiste. Tous croient dur comme fer, que le big bang, la pandémie d’un virus hautement pathogène, est pour bientôt. Je peux encore soigner ma forme physique et nourrir mes neurones avant le… grand chambardement !
Pendant ce temps, exaspérée par la cohorte bruyante des Japonais, Hélène s’assied à son tour et se plonge dans le Sun Sentinel que j’avais gardé avec moi.
– Dis donc Paul, curieux cette disparition de Chinois à Port-Everglades. Décidément, on les voit partout ces nouveaux capitalistes ! Les triades ont l’air d’avoir les coudées franches dans le pays !
À la porte 19, l’hôtesse appelle les passagers pour Londres. Il est 19 heures à Philadelphie, arrivée demain à Heathrow vers 7 heures et demie du matin, heure locale.
– On ne sera pas frais après 15 heures de vol en classe économique, ajoute Hélène avec un air de reproche.
Je jette un œil distrait sur les passagers. Autour de moi, rien de nouveau, toujours le même public. Avec le terrorisme latent qui accompagne tout déplacement, chacun, par réflexe, étudie son voisin. Quelques Hindous enturbannés en transit pour Londres, quelques hommes d’affaire. Une bonne chose, le groupe de Japonais se dirige vers une autre porte et nous n’aurons pas à subir leurs cris stridents. En revanche, une bonne trentaine de jeunes anglais turbulents sont du voyage, un groupe scolaire, sans doute. Quant aux Amish ils ont disparu. Je me demande s’ils sont en quête d’un nouvel Eden sur terre… sans virus. À noter un couple d’obèses, format américain. En les voyant, Hélène me dit : « Tu vas voir qu’avec notre chance habituelle, on va se les farcir ». Gagné ! Je me retrouve en effet à côté du couple format XXXL. Je fulmine, constatant qu’à chaque fois que je prends l’avion, j’hérite soit du seul bébé qui hurle dans la cabine, soit de la personne la plus encombrante du vol. Hélène en rajoute, joue les devinettes :
– À ton avis, Paul, combien le BMI2 de cette dame, 50 ou plus ? me chuchote-t-elle à l’oreille.
– Probablement dans les 50, ce qui la situe tout de même dans la catégorie des super-obèses.
Hélène insiste lourdement, sans doute pour atténuer ma mauvaise humeur. Et tu lui proposerais quelle chirurgie à ce… pachyderme ?
– À propos, penses-tu qu’elle paie deux places ? Comme pour les bagages, ne serait-il pas logique de payer un tarif adapté au poids de chacun ? Je comprends pourquoi les compagnies américaines en faillite si elles ne peuvent augmenter le prix des billets avec une telle clientèle !
Toutes ces réflexions n’améliorent guère mon humeur, je reste renfrogné, prêt à mordre, peu enclin à plaisanter. Sa remarque ravive mes sombres pensées. Avant Hélène, j’étais chirurgien et le « gros » c’était mon truc. Quel plaisir de transformer le corps humain, de faire d’une masse gélatineuse, en quelques mois, un être normal, non handicapé, remis sur les rails. Quel bonheur de voir dans le regard de ces patients, une éternelle reconnaissance. Cette satisfaction du travail accompli, je ne l’avais plus. Hélène me l’avait retirée, du moins c’est ce que je pensais. Tout était sa faute en somme. Perdu dans mes pensées, je constate avec plaisir que le compagnon de l’énorme dame, change de place et suit l’hôtesse qui le conduit à une place sans doute plus adaptée à son espace vital, au premier rang de la classe économique. Cela fait déjà un de moins. Hélène, amusée par la situation, moins concernée directement, lit distraitement les titres d’un journal que l’Américaine, qu’elle a négligemment jeté sur le siège voisin du mien, désormais inoccupé.
– Tu as vu, Paul, ce qui se passe sur la côte Ouest ? Bizarre, non ? Un gros titre annonce en première page de USA Today : « Menace de grève totale sur tous les aéroports de la côte Ouest, dès ce jour à partir de 20 heures, heure locale. » Donc 23 heures, heure de Philadelphie.
– C’est curieux, les syndicats ne semblent pas avoir de motif bien clair. En revanche, le gouvernement fédéral annonce, en cas de grève effective, la fermeture ipso facto de tous les aéroports, côte Est incluse.
– Drôles de mesures de représailles. Étonnants tout de même ces Américains ! Ce n’est pas chez nous que les choses se passeraient ainsi ! ajouta-t-elle.
19 h 30 à ma montre, on devrait décoller vers 20 heures, heure locale.
Je m’efforce à la tolérance, mais décidément, cette grosse m’insupporte pour rester poli, pensais-je en contemplant le monstrueux coude informe, avachi sur le bras du fauteuil, séparant nos territoires respectifs.
Ça va être commode si je veux travailler un peu sur mon portable après le décollage ! Pour ma conférence à Monaco, je dois revoir mes articles. De retour à Cambridge, je n’aurai guère le temps de peaufiner mes diapos. J’ai par exemple, l’intention d’évoquer l’épidémie de 1911 qui s’abattit sur la Mandchourie, que peu de scientifiques connaissent. Et pour cause, les rares médecins russes présents ont tous disparu à l’époque, fauchés par cette fameuse peste noire ou trucidés quelques années plus tard, lors de la Révolution, sans avoir eu le temps d’éclaircir les raisons de l’explosion de cette épidémie mortelle ! Tout cela, quelques années avant the great influenza, qui frappa d’abord le Middle-West Américain en 1918. Curieusement, le virus communiste et le virus de l’influenza ont explosé dans la même année. Pour en revenir à l’épidémie de 1911 en Mandchourie, les journaux de l’époque parlèrent de peste noire, mais aucune étude scientifique sérieuse ne fut réalisée aux fins fonds de l’Empire russe.
Une idée bizarre me trotte dans la tête. 1911, Mandchourie ; 1918, grippe espagnole ; peut-on dire maintenant… 2009, grippe mexicaine ; et demain (ou après-demain) nouvelle grippe « espagnole » ? Ou pour parler scientifiquement, pandémie liée à un virus hautement pathogène ? Au cours de mes recherches, j’ai essayé de retrouver, notamment dans les travaux de Harry Welch, le grand scientifique américain de l’époque et le seul à avoir eu une vue planétaire du phénomène, des éléments pouvant étayer cette thèse. Peste noire, great influenza et grippe espagnole chez nous, tout cela ne fait qu’un, le responsable étant ici encore le fameux virus influenza H1N1 ou H5N1.
Sur l’empire du Milieu, peu de renseignements. Je me souviens en revanche des approches faites quelques années auparavant en 1900, par des médecins anglais sur la peste qui ravagea Bombay et sa région. Mais il s’agissait de peste bubonique, rien à voir avec ce qui nous intéresse.
Ces réflexions sur la terrible pandémie de 1918 me rappellent les difficultés, l’angoisse, voire la terreur des scientifiques de l’époque. Je me remémorai les travaux de Park qui mettait en évidence dans tous les cas, la présence du « bacillus influanzae », bacille découvert en premier par Pfeiffer sur les échantillons étudiés dans son laboratoire. Pour mettre en route une vaccination efficace, il fallait recréer la maladie chez un animal donné, après avoir isolé le germe pathogène. Après cette première étape, il fallait isoler à nouveau l’agent pathogène du sérum de l’animal et l’inoculer aux rats de laboratoire. À l’époque, les expériences révélaient que les rats mouraient certes, mais avec des symptômes que l’on ne retrouvait pas dans l’influenza. Bien que suggestifs, ces résultats n’étaient pas suffisants. En 1918, l’expérimentation avait lieu cette fois directement sur l’être humain, et les résultats devaient être établis dans l’extrême urgence ! Des marins volontaires servirent de cobayes. Las ! Aucun d’entre eux ne fut malade. En revanche, certains médecins participant à l’expérience, moururent de l’influenza ! Qu’aurais-je fait dans un tel contexte ?
1. Wilson, le président des États-Unis, était fermement opposé à Clémenceau durant les travaux conduisant au traité de Versailles. Malade pendant dix jours, il revint aux affaires, diminué. Il accepta les conditions imposées par Clémenceau au grand dam de ses conseillers. Dans le même temps, sa femme, sa fille ainsi qu’un jeune secrétaire furent atteints par l’épidémie grippale. Ce dernier en mourut. Nous sommes début avril 1919. Rappelons qu’en février 1919, rien qu’à Paris, l’épidémie grippale fit 2676 morts !
2. BMI : mesure de l’obésité (Body Mass Index). C’est le rapport du poids à la taille au carré.
19 h 45
VOL UNITED PHILADELPHIE – LONDRES
–BON SANG, QU’EST CE QUI SE PASSE ? Quarante minutes qu’on est à bord et toujours pas de décollage. Aucune annonce en cabine, on n’attend tout de même pas encore un passager !
– T’énerve pas, chou. Pense plutôt au travail qui t’attend à ton retour à Cambridge.
– Ça, tu peux le dire, mes recherches sur l’hémagglu-tinine sont au point mort et je désespère. Mais tout de même, quarante minutes ! Tu vois, j’avais raison de vouloir un vol direct et pourquoi pas chez Virgin ? ajoute Hélène, en m’envoyant un grand coup de coude dans le flanc.
Au même moment, les haut-parleurs de la cabine se mettent à grésiller : « We are sorry, so sorry, we have to wait thirty minutes more, the crew will give you an extra-drink of your choice. Thank you for your patience ».
Suivent quelques notes de musique.
– Alors là, c’est la première fois que je vois ça, s’exclame Hélène. Tu te rends compte, une compagnie américaine qui nous honore d’un drink gratuit, c’est pas beau ça !
Amusé, je souris.
– Tu vois, ils savent que notre virologue talentueuse est à bord, et ils ont décidé de nous gâter.
– Avec tout ça, il va être bientôt 20 heures, heure locale, on n’est pas près d’arriver. Mais qu’est ce qui se passe, on a un terroriste à bord ou quoi ? As-tu vu des barbus Paul ?
Dans un long soupir, je fais le tour de la cabine du regard :
– Non, pas de barbus à l’horizon. Rien de suspect ni d’original, à part ces sikhs enturbannés et le couple d’obèses, mais ce n’est pas parce qu’on est gros que l’on cache des bombes ! Relax !
Toutefois, d’enjouée, mon humeur tourne peu à peu à l’irritation. Décidément, j’ai eu tout faux dans l’organisation de ces vacances, un vol avec escale pour faire des économies, une fatigue supplémentaire, les tracas des attentes en zone de transit, les fouilles réitérées et maintenant ce retard au décollage inexpliqué. Pour passer ma nervosité, j’essaye deux trois mouvements d’extension-flexion des jambes et quelques contractions abdominales. Avec satisfaction, je constate que mes quinze jours de repos se sont avérés bénéfiques, tout du moins sur le plan musculaire. Enfin, le voyant lumineux « Fasten seat belt » s’allume. OK, c’est parti !
Les hôtesses, agglutinées en classe affaires depuis quelques minutes, semblent tout excitées. À voir leurs chuchotements précipités, leur conversation doit être passionnante. Elles gagnent progressivement leur place respective. Amusé par leur jeu, je m’étonne toutefois de leur mine sérieuse. Dur boulot tout de même, et peu gratifiant. Recherchant parmi elles l’hôtesse rêvée, je ne vois rien de mythique autour de moi, à savoir la belle hôtesse d’autrefois, qui prenait presque la main du passager angoissé. En bon connaisseur de la gent féminine, mon regard ne s’éternise sur aucune d’entre elles. Pourtant, à l’embarquement, j’avais remarqué une superbe blonde sanglée dans son uniforme bleu marine, elle a disparu. Dommage me dis-je, en glissant un œil amusé au profil de mon épouse, encore courroucée. Au moins Hélène ne sera pas jalouse si je me montre trop aimable avec les hôtesses ! L’avion s’ébranle doucement et gagne l’aire de décollage, prenant sa place dans la file d’attente des appareils en instance de départ. Les moteurs ronflent de façon rassurante, pas de bruit anormal, tout semble en ordre. Enfin nous décollons. Adieu Philadelphie, adieu Liberty Bell, adieu la ville de William Penn et de Benjamin Franklin. Le regard fixé sur les lumières de la ville défilant sous nos yeux, sur l’immense port qui se déroule le long des multiples canaux de la baie à l’embouchure de la rivière Delaware, je me remémore une fois de plus le drame de 1918 et la panique locale qui se prolongea des semaines. Je repense en particulier à cette fameuse parade de la Liberté, rituel qui rappelle les origines et l’ancienneté, le prestige de Philadelphie, première capitale des États-Unis. Cette parade exceptionnelle dans le contexte particulier de ce mois de septembre 1918, doit soutenir l’effort de guerre impressionnant du pays où, tous les hommes sans exception sont enrôlés dans les usines ou sous les drapeaux, de 18 à 45 ans. La parade est maintenue par les autorités, alors que sur la base navale voisine, l’épidémie explose, transmise par les marins.
Tous les hôpitaux de la ville débordent, mais les autorités, pour ne pas effrayer la population, refusent de suivre l’avis des médecins qui est d’interdire la parade. Cette foule rassemblée, chaleureuse, qu’on se rappelle le sens du mot Philadelphie1 (« aime ton frère »), cette foule de plusieurs centaines de milliers de personnes, fut le vivier idéal pour le virus mortel. Pour certains, il s’agissait de la fameuse peste noire, telle que décrite avec respect et appréhension dans les quelques articles de « l’Illustration » parus en 1911, lors de l’épidémie de Mandchourie.
La Peste. Quel sens donner à ce mot qui rappelle les horreurs moyenâgeuses, les crécelles, les séances de flagellation, les charniers à l’entrée des villes et des villages, la panique généralisée, l’ambiance de fin du monde et un clergé vengeur, attribuant ce cataclysme à la non-rémission des péchés de chacun. Un effluve « miasmatique », pénétrant, incontournable, irréversible, « pestilentiel », où se mêlent l’odeur salubre du bois brûlé et celle, épouvantable, de la chair humaine en décomposition, où seul le feu peut tenter d’effacer les suintements purulo-sanglants de ces corps entassés, amassés dans des fosses communes creusées à la pelle par des hommes épouvantés et peut-être déjà, eux-mêmes atteints. Odeur, gagnant peu à peu chaque maison ou chaumière, comme un incendie s’étend de toit en toit, attisé par un vent vengeur, poussant la population survivante vers les bois alentours. Sans remonter jusqu’à l’époque de Justinien au VIe siècle à Constantinople, c’est ce tableau sinistre de la Peste moyenâgeuse, que vécurent les habitants de Philadelphie en 1918… Ambiance de panique généralisée, comme en Mandchourie, quelques années plus tôt, où tout étranger, rapidement suspect, était abattu sans coup férir par la police, car possible agent vecteur de ce terrifiant fléau. Vivrons-nous à nouveau ce tableau d’épouvante, après la fausse alerte de l’an passé ?
À ce propos, je songeais à mes récentes conférences auprès de publics divers, sociétés de bienfaisance ou associations d’anciens combattants. Chacune était pour moi l’occasion de rappeler les événements qui se déroulèrent en Amérique à l’automne 1918, la population confrontée au processus fulgurant de l’atteinte virale, terrassant ses victimes en quelques jours, parfois en vingt-quatre heures. Les hommes jeunes surtout, alertes, en pleine force de l’âge, se voyaient condamnés dans un tableau de toux, crachats et vomissements sanglants.
Progressivement, le malade présente des difficultés respiratoires, devient rapidement cyanotique. Sa peau noircit, ses ongles bleuissent, le virus entraîne en effet une destruction tissulaire pulmonaire qui se manifeste par des saignements de nez, et des hémorragies variées parfois vaginales ou rectales, voire les deux. Corps foudroyés, dégageant très vite une odeur insupportable, pestilentielle. Comment contrer ce fléau ? Un seul remède, disposer d’un vaccin efficace et vacciner toute la population en cas de pandémie. Lors de ces conférences, cette phrase déclenchait un feu roulant de questions sur le comportement très contrasté des États, après l’explosion de la pandémie mexicaine l’an passé… Pourquoi tel État n’a-t-il rien fait ? pourquoi tel autre en fit trop ? pourquoi l’OMS fut-elle aussi pessimiste ? Autant de questions qui me mettaient dans l’embarras. Il est en effet impossible de prévoir le degré de nuisance (la pathogénicité) d’un virus mutant.
Parti loin dans mes rêveries, je suis rappelé soudain à la réalité par Hélène :
– Regarde cette hôtesse, elle tousse tout le temps, je la trouve bizarre, fatiguée, non ?
Jetant un œil distrait à l’hôtesse en question, je me fends d’un « Mouais » annihilant sur-le-champ tout commentaire supplémentaire.
– Eh bien j’insiste, je ne la trouve pas bien du tout, cette petite, ajoute Hélène vexée, avant de se replonger dans un précis d’immunologie qu’elle n’avait pas eu le courage d’ouvrir pendant ces vacances.
Cambridge approche et les cours, les conférences, les staffs, les congrès sur notre sinistre compagnon, le fameux virus, tout cela est de retour. L’un comme l’autre, agacés sans doute par notre incompréhension mutuelle, nous ne faisons guère attention à l’annonce au micro du chef de cabine, réclamant un médecin en classe affaires. L’annonce se répète avec un ton plus marqué, traduisant une certaine inquiétude. Devant l’absence de mouvement dans la cabine, l’appel me fait cette fois réagir :
– Chérie laisse moi passer, je vais voir si je peux faire quelque chose.