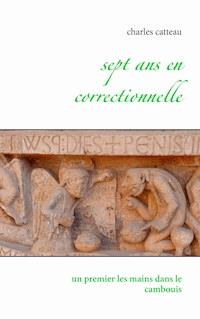Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
hommage de l'auteur à son frère, en souvenir d'une vie romanesque, depuis le nord et la franche comté jusqu'aux îles de l'océan indien
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
I
C’est sans doute dans les circonstances de sa naissance que le petit Pitje avait puisé l’énergie et l’allant dont il allait faire preuve toute sa vie.
Ses parents avaient joué avec l’histoire sans trop le savoir, avaient traversé celle-ci avec l’inconscience de jeunes amoureux qui n’avaient pu attendre d’être installés après avoir terminé leur évolution personnelle pour se donner l’un à l’autre. À l’époque il fallait choisir : ou on se mariait ou on se retenait ! Ils avaient choisi la première alternative et leur première fille avait été conçue dès le voyage de noces, avant accomplissement du service militaire qu’ils auraient dû deviner bien incertain puisqu’en Allemagne les juifs venaient de se voir retirer leur permis de conduire, ce qui voulait tout induire sur leur sort à venir et celui des démocraties. Ils avaient vécu séparés et inquiets la drôle de guerre puis la retraite de France à laquelle son père, jeune officier, avait mis fin en traversant au péril de sa vie les lignes allemandes en limite de la zone occupée puis en remontant dans le nord avec un convoi de la Wehrmacht grâce à une négociation en allemand qu’il parlait couramment. Ils avaient conçu la seconde fille après la négociation Darlan-Laval-Abetz engagée pour faire entrer la France dans « l’ordre nouveau ». Son frère aîné avait été conçu lors des premiers bombardements sur Hambourg, sur les usines Bosch de Stuttgart et sur Cologne pour voir le jour un mois tout juste avant la capitulation de Stalingrad. Pierre avait été conçu dans la joie causée par la connaissance parvenue en retard du débarquement de Normandie, avait frémi quand à quatre mois de vie intra-utérine Hazebrouck avait été libéré par l’armée canadienne du groupe Montgomery et était né quand les Américains enfonçaient la ligne Siegfried et les Russes atteignaient l’Oder : il y avait de quoi exulter toute sa vie ! Ses parents allaient continuer à croiser l’histoire, le frère suivant ayant été conçu à la naissance de la quatrième république, de l’abandon de la Chine par les américains, juste avant le plan Marshall, le suivant lors du procès du cardinal Mindzenty à Budapest et juste avant la création de l’Otan et allaient continuer, toujours sans qu’il y ait un quelconque lien de causalité, avec les deux petits derniers, la petite sœur ayant été conçue dans l’intense émotion de l’insurrection de Budapest et le petit frère lors de la première extraction de plutonium et de l’envoi d’Explorer dans l’espace, tous événements aux conséquences impressionnantes.
Pierre allait se construire et s’affirmer à travers ce que déclinaient les sociologues : une famille, une école, une société.
Pierre allait vivre son enfance au sein d’une famille nodale qui se suffisait à elle-même, qui s’élargissait à l’occasion aux deux branches et ce dans une implantation, la Flandre française, qui lui léguerait son prénom de Pietje, lequel resterait son appellation par les proches et serait même adoptée plus tard par ses enfants. Ses parents étaient très amoureux et consacraient, sans signe perceptible d’insuffisance, leur vie à leur descendance qui par le nombre et l’agitation suffisait à les occuper : Pierre et ses sœurs et frères les voyaient s’embrasser et multiplier les signes d’affection. Le bonheur était simple. On savait s’amuser entre sœurs et frères dans le vaste jardin, jouer aussi bien au papa et à la maman qu’à la princesse en faisant des cortèges décorés de chiffons, entre frères en jouant au foot sur la pelouse où son père avait bricolé un but ou en tournant dans les allées à vélo inlassablement ; déjà il marquait son caractère : dans son auto métallique rouge à pédales il était toujours le pilote de tête ; au foot il était l’avant centre et le capitaine, son frère aîné étant le goal et tous deux jouant avec des chaussures à crampons trop grandes parce qu’on ne pouvait les changer tous les ans ; dans les cortèges il était le roi avec la sœur reine de droit parce que l’aînée. A la maison il n’y avait pas de télé, peu d’écoute de radio, un peu de lecture du journal local ; avec les parents on faisait des jeux de société, on écoutait maman qui jouait du piano et faisait répéter papa qui devait chanter dans une opérette, on vivait comme une corvée les leçons de piano qu’on nous imposait et ce n’est pas à travers elles que Pietje et ses frères avaient trouvé leur grand amour de la musique qui ne naîtrait que plus tard. Tout cela dans une liberté assez fantastique : il pouvait avec son frère se balader dans les chéneaux de la maison sans que les parents ne s’affolent ; son père les emmenait sur son grand vélo récupéré juste après guerre dans un fossé, qui avait la particularité d’avoir une roue avant plus grande que la roue arrière avec trois garçons sur l’engin, un sut le guidon, un sur le cadre, un sur le porte-bagages auquel il accrochait une charrette en tubes soudés par un mécano où les filles s’asseyaient. Et hop c’était la joie !
L’école, c’était l’école privée bien entendu, chez les frères des écoles chrétiennes pour les garçons parce que ses parents étaient très marqués par leur éducation religieuse, que les Flamands revendiquaient leur catholicité. Pietje y était à l’aise au milieu de jeunes dont certains parlaient le français en roulant les « r » car issus de générations qui ne le parlaient pas au quotidien : son grand père et un oncle le parlaient, son père le comprenait et ne le parlait plus. La mémoire et l’orthographe étaient cultivés, entretenus tous les soirs par les répétitions avec son père ou sa mère. Cette atmosphère scolaire était prolongée par les fréquentations de ses parents : leurs invités étaient souvent des curés du petit séminaire ou de la paroisse qui aimaient se défouler, physiquement en jouant au foot en remontant leurs soutanes, en montrant leurs mollets au dessus de leurs grosses chaussettes noires, moralement en racontant des histoires drôles où il était souvent question sans le dire de sexe, voire en suscitant des histoires idiotes inventées par les enfants, telle celles du frère aîné qui se terminaient invariablement par un roi mage qui faisait un prout dans une poubelle, ce qui provoquait un éclat de rire général. A titre éducatif plusieurs fois par an on avait droit à une projection au moyen d’un appareil antique qui avait bien des ratés de films de Charlot, mais la chaîne de montage des Temps modernes nous inspirait peu, ou, ce qu’on aimait mieux, de Laurel et Hardy, qui provoquaient des fous rires. On allait très peu au cinéma et le premier que Pietje se rappellerait avoir vu était Voleur de bicyclette qui l’avait bien ému par tant d’injustice.
La société, c’était la famille au sens large et l’église. La famille, c’était l’affectueuse grand-mère maternelle chez qui Pitje allait prendre son bain rituel du samedi parce qu’elle avait une baignoire avec eau chaude courante alors qu’à la maison il n’y avait qu’une bassine installée sur table où les enfants étaient lavés en série, filles et garçons aussi nus les uns que les autres, en contradiction avec la rigidité de l’éducation qui interdisait de parler crûment de sexes qu’on pouvait voir à loisir de toilette. Les grands rassemblements familiaux se faisaient du côté paternel avec les mariages et les repas de l’an. Pitje allait y puiser son sens de la fête et de la rigolade. Il y avait une bande de tantes et d’oncles qui aimaient manger, boire et, il faut bien le dire, déconner, sous l’auspice des patriarches qui trônaient en bout de table. Pierre n’avait pas vu l’exploit qui était souvent rappelé de l’oncle qui avait trop bu et rentrait dans sa voiture par la fenêtre en disant « mais je croyais que la porte était ouverte », mais il les voyait chanter en français ou en flamand, se poursuivre autour de la table, se piquer avec du houx placé dans un bouquet, et rire et rire, ce qui ne les empêchait pas de repartir en voiture ! La domesticité, héritée du temps où le grand-père était entrepreneur, donc notable de village, était assimilée à la famille avec laquelle elle vivait et elle allait donner à Pietje le sens de la chaleur humaine : la vieille Hélène, dite « Lensche », toute fripée mais rigolote, qui tutoyait sa patronne, la grand-mère, qui racontait qu’elle allait chercher son incapable de mari au bistrot et le ramenait à la maison dans une brouette, ou Rachel qui à soixante ans faisait encore dans l’herbe une démonstration de « pirlouettes », la bonne enfin venue d’un village des environs et qui quitta vite la famille pour cause de mariage rendu urgent parce que son copain, un vrai « marouleux », avait trop « r’dressé s’norelle » !
Quant à l’église elle imposait encore son rythme si Pitje en prenait à son aise avec les rites : il avait été enfant de chœur comme tout le monde mais il chahutait bien, avait en parcourant les rues avec la charrette chargée d’une lessiveuse vendu l’eau bénite que les croyants achetaient pour deux sous pour bénir leur maison mais en déversait dans le caniveau pour aller plus vite ; il avait refusé de faire partie d’une chorale et s’était plus vite que les autres, sa sœur qui portait le monde, boule si lourde dans la procession du sacré cœur, son frère qui chantait en solo de sa voix de fausset, libéré de cette emprise. Le rite qu’il acceptait bien, c’était la messe de minuit de Noël parce qu’on mangeait bien et partait en famille à Saint Eloi dont le clocher était surmonté d’une grande étoile illuminée, qu’on chantait à tue-tête pour se réchauffer « Il est né le divin enfant » ou « Adeste Fideles, Venite adoremus, Natum videte » et qu’on vainquait le sommeil au retour parce qu’on allait filer à la cheminée de la chambre des parents découvrir les cadeaux dans les pantoufles placées en demi-cercle.
Ayant ainsi commencé à forger son caractère il aurait comme tous les membres de sa fratrie à poursuivre l’évolution amorcée par ses parents : pour ceux-ci le départ de Flandre avait été la première rupture avec leur base. Son père pour cause d’amour et de guerre s’était jusque là exclusivement attaché à sa femme et à ses six enfants et sentait bien qu’il était sous-employé. En accord avec sa femme il s’était décidé à passer un concours à Paris : toute la famille sentant le germe d’un devenir était venue lui faire un au revoir sur la passerelle au dessus du train crachant sa fumée qui l’emmenait à Paris ; il avait été reçu et avait obtenu un poste en avancement qui imposait un déménagement dans une autre ville où la famille s’était bien adaptée tout en sachant que la situation était provisoire ; il avait été après quelques années nommé à un poste de direction au niveau départemental. Il n’aimait pas son métier mais il l’exerçait brillamment. Le frère de Pierre avait eu accès à quelques rapports de redressement et lui qui faisait du droit mais n’était pas fiscaliste avait tout compris et avait admiré la clarté de l’exposé et la rigueur du raisonnement : c’était un modèle dont il se souviendrait. Si la maladie invalidante ne l’avait frappé il serait allé beaucoup plus loin ; ce serait à ses enfants de réaliser ce qu’il n’avait pu faire, il y contribuerait en enrichissant sa grande culture générale et en leur donnant la capacité de raisonner, en leur donnant l’exemple de la transition d’une base théologique à une philosophie personnelle basée sur sa réflexion à lui et fondée sur l’évolution des sciences fondamentales qu’il suivait avec passion. La séparation du milieu initial avait été une marche vers le chef lieu, siège des facultés : c’était la voie tracée de l’abandon d’une société patriarcale centrée sur sa spécificité et son héritage historique vers une société qui allait s’ouvrir de plus en plus et se mondialiser, c’était le passage du petit Pietje au Pierre qui allait aimer courir le monde.
On travaillait, on réfléchissait ; on se détendait aussi, on savait jouir pleinement des vacances.
II
C'était chaque année le voyage de vacances que la vie de chacun allait intégrer : ce petit village du Jura où était née notre mère par le jeu des circonstances mondiales, juste après la première guerre parce que grand père était affecté à la poste militaire dans la région et y avait connu grand-mère, n'était pas encore perçu comme un village gaulois au sens qu’on donnerait plus tard à cet adjectif mais il avait le charme d'un dépaysement complet, physique parce qu'il était très différent du lieu de vie habituel, et moral parce qu'il faisait évoluer dans une société autre, historique parce qu’on y vivait encore comme autrefois.
Au milieu de la période de guerre, la seconde, et pendant les quelques années suivantes, la famille y allait en train, en train à vapeur et en troisième classe dans un inconfort dont on ne souffrait nullement ; il suffisait de voir arriver sur le quai de la gare de notre ville la locomotive et son geyser de vapeur, aussi allante que si elle traversait le far-west, pour être parti. Lors du premier trajet on traversait des paysages connus des Flandres, on reconnaissait presque les arbres et les prés que l'on avait vus en faisant du vélo puis la nouveauté commençait avec la traversée des mines, de ces contrées noires du charbon qui en faisait la richesse en même temps que la dureté. On voyait les terrils et à leurs pieds les chevalets de puits et autour d'eux les courées, les petites églises si modestes, et papa nous expliquait la vie des mineurs, sa description valant celle de Germinal, nous parlait des Polonais regroupés par villages et de leurs habitudes tant religieuses que de consommation. Dès qu'on quittait cette zone, on apercevait le monument de Vimy et ses deux piliers s'élançant vers le ciel dont on ne savait pas qu'ils représentaient les portes de l'éternité et aussitôt après le beffroi d'Arras avec son lion. Papa avait à peine eu le temps de nous rappeler Jean Bodel et Adam de la Halle dont nous avions entendu parler en cours de français que le train dans un bruit impressionnant de ferraille freinait déjà passait sous la passerelle couverte et fermée de la gare au béton noirci et s'arrêtait. Il fallait descendre en portant chacun son bagage, et le quai était bien bas par rapport aux marches en bois du wagon pour attendre une bonne demi-heure sur le quai l'arrivée du « rapide » Lille-Paris pour reprendre le voyage. On traversait alors l'Artois, la Picardie, l’Île de France ; on se repérait à l'église d'Albert, la gare d'Amiens, les multiples voies de Creil, l'église de Survilliers et quand on voyait la basilique de Montmartre on se savait arrivé à Paris.
Paris c'était le métro qui faisait lui aussi un bruit d'enfer et les Parisiens qui couraient tous dans les couloirs comme s'ils étaient pressés pour on ne sait quoi ; nous, nous ne l'étions pas et ça valait mieux pour traîner les bagages, car nous savions que le départ du train de nuit nous laissait quelques heures. On mangeait un morceau, c'est-à-dire des frites et une saucisse, dans un restaurant près de la gare, rue de Lyon et on allait repérer d'où partait le train de nuit.
Commençait alors la partie la plus longue du voyage. On s'installait comme on pouvait pour passer la nuit : les parents restaient assis et nous nous essayions de nous allonger sur la banquette et les sacs posés par terre. On avait le droit de ne pas dormir jusqu'à la gare de Laroche-Migennes où la loco prendrait de l'eau mais on prenait un acompte de sommeil bien avant. Et puis on replongeait dans le sommeil et la chaleur enfin assurée après réclamation au contrôleur qui nous avait réveillés, jusqu'à Dijon où il faudrait changer de train.
A Dijon, fatigués et à moitié réveillés, qu'on avait froid sur le quai et que le train qui allait en Suisse se faisait attendre ! Mais il allait en Suisse qui n'était pas loin de notre destination. A Auxonne on passait au dessus de la Saône dont le Doubs était un affluent, ce qui nous rapprochait et puis on descendait du train « suisse » à Frasne pour prendre la Micheline qui nous emmènerait à Pontarlier.