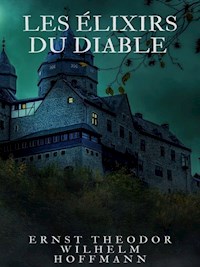Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Un caprice dans la manière de Jacques Callot» - 1820 - Préface de Stefan Zweig Le caprice (capriccio en italien) désigne à l'origine une forme picturale créée en 1617 par Jacques Callot pour Cosme II de Médicis, qu'il intitule Capriccii di varie figure: elle représente des éléments architecturaux disposés de manière très libre et fantaisiste. Le terme est également courant en musique pour évoquer une série d'improvisations et dans la critique littéraire pour exprimer la liberté prise par l'écrivain humoristique. Le roman se déroule à Rome au XVIIIe siècle pendant le carnaval, moment où l'ordre est temporairement suspendu et où les identités se confondent sous les masques. Dans le premier chapitre, Giglio Fava, un médiocre comédien, joue le rôle du prince Taer dans la pièce de Gozzi, Le Monstre turquin, et raconte un rêve dans lequel une princesse lui déclarait sa flamme. Sa fiancée, cependant, Giacinta Soarti, une jolie couturière, se lamente sur sa pauvreté, alors qu'elle est en train de mettre la main à une robe magnifique destinée à un client inconnu. Obsédés l'un et l'autre par des rêves romantiques, leur vive imagination les amène à confondre leurs fantaisies avec la réalité. Ils en viennent ainsi à assumer une seconde vie, sous la forme de la princesse Brambilla et de son amant le prince assyrien Cornelio Chiapperi, aidés en cela par la magie du charlatan Celionati, qui donne en outre à Giglio une leçon de comédie, corrigeant son jeu pompeux et déclamatoire, que sa vanité l'empêchait de voir. Sous son influence, de même, Giglio et Giacinta s'éprennent respectivement de la princesse Brambilla et du prince assyrien Cornelio..
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 239
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Princesse Brambilla
Princesse BrambillaPRÉFACECHAPITRE PREMIERCHAPITRE IICHAPITRE IIICHAPITRE IVCHAPITRE VCHAPITRE VICHAPITRE VIICHAPITRE VIIIPage de copyrightPrincesse Brambilla
Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann
PRÉFACE
Il faut beaucoup d’imagination pour se représenter tout le prosaïsme de l’existence extérieure à laquelle E. T. A. Hoffmann fut condamné durant sa vie.
Une jeunesse passée dans une petite ville prussienne, avec des heures strictement mesurées. À la seconde, il est obligé d’étudier le latin, puis les mathématiques, d’aller à la promenade ou de faire de la musique – cette chère musique. Ensuite, un bureau et, qui plus est, un bureau de fonctionnaire prussien, quelque part, sur la frontière polonaise. Puis, par désespoir, une femme, ennuyeuse, sotte, sans intelligence, qui lui rend la vie encore plus insipide. Et de nouveau des dossiers, des dossiers, noircir du papier administratif jusqu’à épuisement complet.
Une fois, un petit intermède : pendant deux ans, directeur de théâtre, avec la possibilité de vivre dans la musique, de côtoyer des femmes, et de sentir dans les sons et les paroles l’ivresse du supraterrestre. Mais cela ne dure que deux années, après quoi la guerre napoléonienne met en pièces le théâtre, et de nouveau l’administration, la ponctualité des heures, des paperasses, toujours des paperasses, et cet horrible prosaïsme !
Comment fuir ce monde où tout est tracé au compas ? Souvent le vin est une ressource. Il n’y a qu’à boire beaucoup, dans des caveaux bas et humides, pour qu’il vous enivre, et il faut qu’il y ait des amis, des hommes tout bouillonnants, comme l’acteur Devrient, dont la parole vous enthousiasme, ou d’autres, tout bonnement mornes et silencieux, qui se contentent d’écouter, lorsque soi-même on décharge son cœur.
Ou bien on fait de la musique, on s’assied dans la pièce obscure, et on laisse les mélodies se déchaîner comme l’orage. Ou bien on exprime toute sa colère en des caricatures incisives et mordantes sur la partie blanche des feuillets administratifs ; on invente des êtres qui ne sont pas de ce monde, ce monde méthodiquement ordonné, positif et gouverné par des paragraphes de loi, ce monde d’assesseurs et de lieutenants, de juges et de « conseillers intimes ». Ou bien l’on écrit, l’on écrit des livres, l’on rêve en écrivant, et, dans ce rêve, on métamorphose sa propre existence, étroite et perdue, en possibilités purement imaginaires : on voyage ainsi en Italie, on brûle pour de belles femmes et on vit des aventures extraordinaires.
Ou bien l’on décrit les rêves effrayants qui surviennent après une nuit d’ivresse et où des figures grotesques et des fantômes surgissent d’un cerveau noyé dans les ténèbres. L’on écrit pour fuir le monde et cette existence mesquine et banale ; on écrit pour gagner de l’argent, qui se mue en vin, et avec le vin on achète de la gaieté et des rêves clairs et colorés. C’est ainsi que l’on écrit et que l’on devient poète sans le savoir, sans ambition, sans aucune passion véritable, simplement pour pouvoir vivre enfin, une fois, de la vie de « l’autre homme »que l’on porte en soi, de cet homme du fantastique et de la magie que l’on était de naissance, en oubliant pour un instant le fonctionnaire auquel l’existence vous a réduit.
Un monde supraterrestre, fait de fumée et de rêve aux figures surnaturelles, tel est le monde de E. T. A. Hoffmann. Souvent il est doux et clément ; ses récits sont des rêves de pureté et de perfection ; mais souvent aussi, au milieu de ses rêves, il se rappelle la réalité et son propre sort, si peu conforme à ses désirs ; alors il devient mordant et méchant, il fait des hommes des caricatures et des horreurs ; il cloue railleusement au mur de sa haine l’image de ses supérieurs qui le font souffrir et le tourmentent, fantômes de la réalité, au milieu du tourbillon de fantômes.
La Princesse Brambilla est, elle aussi, une demi-réalité de ce genre transposée dans le fantastique, gaie et mordante, à la fois vraie et fabuleuse et pleine de cet amour singulier de la fioriture qu’il y a chez Hoffmann. Comme à chacun de ses dessins, comme à sa signature même, il ajoute toujours à ses créatures quelque petite queue ou appendice, quelque parafe qui les rend étranges et extraordinaires pour un esprit non préparé.
Edgar Poe a plus tard emprunté à Hoffmann ses fantômes, et plus d’un Français son romantisme, mais une chose est restée pour toujours propre à E. T. A. Hoffmann et inimitable : c’est cet étrange amour de la dissonance, des tons intermédiaires nets et aigus ; et celui qui sent la littérature comme une musique n’oubliera jamais ce ton particulier qui lui est spécial.
Il y a là-dedans quelque chose de douloureux, la transposition de la voix en raillerie et en souffrance, et même dans les récits qui veulent n’être que sérénité ou bien qui décrivent orgueilleusement d’étranges inventions passe soudain ce ton tranchant et inoubliable d’instrument brisé. En effet, E. T. A. Hoffmann a été sans cesse un instrument brisé, un instrument merveilleux avec une petite fêlure.
Créé pour une joie débordante et dionysiaque, pour être un génie étincelant et enivrant, un artiste typique, son cœur avait été avant le temps écrasé sous la pression de la quotidienneté. Jamais, pas une seule fois, il n’a pu se répandre, pendant des années, dans une œuvre lumineuse, étincelante de joie. Seuls de courts rêves lui furent permis, mais des rêves singulièrement inoubliables, qui engendrent à leur tour d’autres rêves, parce qu’ils sont teints de la rougeur du sang, du jaune de la bile et de la noirceur de l’épouvante. Après un siècle, ils sont toujours vivants dans toutes les langues, et les figures qui, comme des fantômes difformes, se sont présentées à lui dans la vapeur de l’ivresse ou la rouge nuée de l’imagination, traversent encore aujourd’hui, grâce à son art, notre univers intellectuel.
Qui subit victorieusement l’épreuve d’un siècle de survie a triomphé à jamais, et ainsi E. T. A. Hoffmann appartient – ce dont il ne s’est douté à aucun moment, lui le pauvre diable crucifié par le prosaïsme terrestre, – à la guilde éternelle des poètes et des fantaisistes, qui prennent sur l’existence qui les tourmente la plus belle des revanches, en lui révélant typiquement des formes plus colorées et plus variées que n’en a la réalité.
Salzbourg, mai 1927.
STEFAN ZWEIG.
CHAPITRE PREMIER
Magiques effets d’un riche vêtement sur une jeune modiste. – Définition du comédien qui joue les amoureux. – De la smorfia des jeunes filles italiennes. – Comment un petit homme vénérable s’occupe de sciences tout en étant assis dans une tulipe et comment d’honorables dames font du filet entre les oreilles de haquenées. – Le charlatan Celionati et la dent du prince assyrien. – Bleu de ciel et rose. – Le pantalon et la bouteille de vin au contenu merveilleux.
C’était le soir, le crépuscule tombait et dans les couvents sonnait l’angélus. Alors la jolie et charmante enfant appelée Giacinta Soardi mit de côté le riche costume de femme, en lourd satin rouge, à la garniture duquel elle avait travaillé avec application, et elle regarda d’un air mécontent, par la haute fenêtre, dans la rue étroite et triste où il n’y avait personne.
Cependant, la vieille Béatrice ramassait soigneusement les travestis bariolés, de toute espèce, qui étaient épars sur des tables et des chaises, dans la petite chambre, et elle les suspendait l’un après l’autre. Puis, les deux bras campés sur les hanches, elle se plaça devant l’armoire ouverte et dit joyeusement :
– Vraiment, Giacinta, cette fois-ci nous avons bien travaillé. Il me semble avoir ici devant les yeux la moitié de notre joyeux monde du Corso carnavalesque. Jamais encore, à vrai dire, messer Bescapi ne nous a fait d’aussi riches commandes. Il sait, sans doute, que notre belle ville de Rome, cette année, sera de nouveau toute éclatante de joie, de magnificence et de somptuosité. Tu verras, Giacinta, quel débordement d’allégresse il y aura demain, premier jour de notre Carnaval. Et demain, demain, messer Bescapi répandra sur nous toute une poignée de ducats, tu verras, Giacinta. Mais qu’as-tu, mon enfant ? Tu baisses la tête, tu es chagrine, boudeuse ! Et demain c’est le Carnaval !
Giacinta s’était remise sur sa chaise de travail et, la tête appuyée dans ses mains, elle regardait fixement vers le sol, sans faire attention aux paroles de la vieille femme. Mais, comme celle-ci ne cessait de papoter sur les plaisirs du Carnaval, à la veille duquel on était, Giacinta se mit à dire :
– Taisez-vous donc, la vieille ; ne parlez pas d’une époque qui a beau être belle pour d’autres, si elle ne m’apporte à moi que du chagrin et de l’ennui. À quoi me sert de travailler jour et nuit ? À quoi me servent les ducats de messer Bescapi ? Ne sommes-nous pas d’une pauvreté lamentable ? Ne devons-nous pas veiller à ce que le gain de ces jours-ci dure assez pour nous nourrir bien chichement pendant toute l’année ? Que nous reste-t-il pour notre amusement ?
– Notre pauvreté, – répliqua la vieille Béatrice, – qu’a-t-elle à voir avec le Carnaval ? L’année dernière, ne nous sommes-nous pas promenées depuis le matin jusque très tard dans la nuit, et n’avais-je pas bon air, un air très distingué, travestie en Dottore ? Et nous nous donnions le bras et tu étais ravissante en jardinière, – hi, hi ! et les plus beaux masques couraient après toi et te débitaient des paroles douces comme du sucre. Eh bien ! n’était-ce pas gai ? Qu’est-ce qui nous empêche de faire la même chose cette année ? Je n’ai qu’à brosser comme il faut mon Dottore et alors disparaîtront toutes les traces des méchants confetti dont il a été bombardé ; et ta jardinière est également suspendue là. Quelques rubans neufs, quelques fleurs fraîches, et il n’en faut pas plus pour que vous soyez jolie et pimpante ?
– Que dites-vous donc ? s’écria Giacinta. Je devrais revêtir ces misérables hardes ? Non. Un beau costume espagnol, moulant étroitement le buste et descendant en riches plis lourds, de larges manches à crevés avec un bouillonnement de dentelles magnifiques, un petit chapeau aux plumes flottant hardiment, une ceinture, un collier de diamants étincelants, voilà ce que Giacinta voudrait avoir pour prendre part au Corso et se placer devant le palais Rusponi. Comme les cavaliers se presseraient autour d’elle, disant : « Quelle est cette dame ? À coup sûr, une comtesse, une princesse. » Et même Pulcinella serait saisi de respect et en oublierait ses folles taquineries.
– Je vous écoute, fit Béatrice avec un grand étonnement. Dites-moi, depuis quand le maudit démon de l’orgueil est-il entré en vous ? Eh bien ! puisque vous avez une si haute ambition que vous voulez jouer à la comtesse ou à la princesse, ayez la complaisance de prendre un amoureux, qui, pour vos beaux yeux, soit en mesure de puiser gaillardement dans le sac de la fortune, et chassez le signor Giglio, ce sans-le-sou, qui, lorsqu’il lui arrive de sentir dans sa poche un couple de ducats, dépense tout en pommades parfumées et en friandises et qui me doit encore deux paoli pour le col de dentelle que je lui ai lavé.
Pendant ce discours, la vieille femme avait préparé la lampe et elle l’avait allumée. Lorsque la lumière tomba sur le visage de Giacinta, la vieille s’aperçut que des larmes amères brillaient dans ses yeux.
– Giacinta, par tous les saints, qu’as-tu, que t’est-il arrivé ? s’écria-t-elle. Eh ! mon enfant, je n’ai pas voulu te fâcher. Repose-toi ; ne travaille pas si intrépidement ; la robe sera, de toute façon, finie pour l’époque fixée.
– Ah ! – dit Giacinta sans lever les yeux de son travail, qu’elle avait repris – c’est précisément cette robe, cette maudite robe, qui, je le crois, m’a remplie de toutes sortes de folles pensées. Dites, la vieille, avez-vous jamais vu dans toute votre vie une robe comparable à celle-ci en beauté et en magnificence ? Messer Bescapi s’est vraiment surpassé lui-même. Un esprit tout particulier l’inspirait lorsqu’il taillait ce superbe satin. Et puis ces splendides dentelles, ces tresses éclatantes, ces pierres précieuses qu’il nous a confiées pour la garnir ! Pour tout au monde, je voudrais savoir quelle est l’heureuse femme qui va se parer de cette robe digne des dieux.
– Bah ! – fit la vieille Béatrice en interrompant la jeune fille – que nous importe cela ! nous faisons le travail et nous recevons notre argent. Mais il est vrai que messer Bescapi avait une allure si mystérieuse, si bizarre… Il faut que ce soit au moins une princesse qui porte cette robe, et, bien que je ne sois pas curieuse d’habitude, j’aimerais que messer Bescapi me dît son nom, et demain je l’entreprendrais jusqu’à ce qu’il me le fît connaître.
– Non, non, – dit Giacinta, – je ne veux pas le savoir ; je préfère me figurer que jamais une mortelle ne mettra cette robe et que je travaille à quelque mystérieuse parure destinée à une fée. Il me semble déjà, véritablement, que ces pierres éblouissantes sont toutes sortes de petits esprits qui me regardent en souriant et qui me murmurent : « Couds, couds vaillamment pour notre belle reine, nous t’aiderons, nous t’aiderons. » Et quand j’entrelace ainsi dentelles et tresses, il me semble que de charmants petits êtres sautillent pêle-mêle avec des gnomes cuirassés d’or… Aïe ! Aïe !
C’était Giacinta qui poussait ces cris, car en cousant le tour de gorge, elle s’était piquée fortement le doigt, si bien que le sang jaillissait comme d’une source vive.
– Ciel ! – s’écria la vieille, – que va devenir la belle robe ?
Elle prit la lampe, l’approcha du costume, pour mieux y voir, et d’abondantes gouttes d’huile s’y répandirent.
– Ciel ! Ciel ! Que va devenir la belle robe ? – s’écria Giacinta, à demi évanouie d’effroi.
Mais, bien que, à coup sûr, à la fois du sang et de l’huile fussent tombés sur la robe, ni la vieille femme ni Giacinta ne purent découvrir la moindre tache. Alors Giacinta continua de coudre vite, vite, jusqu’au moment où elle bondit de son siège en poussant un joyeux « fini ! fini ! » et en levant bien haut la robe.
– Ah ! comme c’est beau ! – s’exclama la vieille Béatrice. Comme c’est superbe ! Comme c’est magnifique. Non, Giacinta, jamais tes chères menottes n’ont fait quelque chose d’aussi bien. Et, sais-tu, Giacinta, il me semble que la robe a été faite exprès pour toi, comme si messer Bescapi n’avait pris des mesures sur personne autre que toi-même !
– Quelle idée ! – répliqua Giacinta, en devenant toute rouge. Tu rêves, la vieille, suis-je donc aussi grande et aussi svelte que la dame pour qui cette robe doit être destinée ? Prends-la, prends-la, et conserve-la soigneusement jusqu’à demain. Fasse le ciel qu’à la lumière du jour on ne découvre pas une méchante tache. Pauvres diablesses que nous sommes, que deviendrions-nous ? Prends-la.
La vieille Béatrice hésitait.
– Il est vrai – poursuivit Giacinta, en considérant la robe – que pendant que j’y travaillais, je me suis souvent figuré qu’elle devait m’aller. Pour la taille, je crois être assez svelte et en ce qui concerne la longueur…
– Giacinina – s’écria la vieille, les yeux brillants, – tu devines mes pensées et moi les tiennes. Portera la robe qui voudra, princesse, reine ou fée, peu importe ; c’est ma petite Giacinta qui doit d’abord l’essayer.
– Jamais ! – fit Giacinta.
Mais la vieille femme lui prit la robe des mains, la posa soigneusement sur le fauteuil et se mit à défaire les cheveux de la jeune fille, qu’ensuite elle natta entièrement. Puis elle alla chercher dans l’armoire le petit chapeau orné de fleurs et de plumes que Bescapi leur avait confié pour le garnir, comme la robe, et elle le fixa sur les boucles châtaines de Giacinta.
– Mon enfant, comme déjà le petit chapeau te va à ravir ! Mais maintenant, mais maintenant enlève ta blouse.
Ainsi parla la vieille Béatrice, et elle se mit à déshabiller Giacinta, qui, dans une pudeur charmante, ne fut plus capable de résister.
– Hum ! – murmura la vieille femme, – cette nuque doucement arrondie, ce sein de lis, ces bras d’albâtre, la Médicéenne n’en a pas de plus beaux ; Jules Romain n’en a pas peint de plus superbes. Je voudrais bien savoir quelle princesse ne les envierait pas à ma chère enfant.
Mais, lorsqu’elle habilla la jeune fille de cette splendide robe, on eût dit qu’elle était aidée par des esprits invisibles.
Tout s’ordonnait et se déployait parfaitement bien ; chaque épingle se plaçait immédiatement au bon endroit ; chaque pli s’arrangeait comme de lui-même ; il n’était pas possible de croire que la robe eût été faite pour une autre que Giacinta elle-même.
– Oh ! par tous les saints ! – s’écria la vieille Béatrice, lorsqu’elle vit devant elle Giacinta si magnifiquement parée – tu n’es, à coup sûr, pas ma Giacinta… Oh ! Oh ! Comme vous êtes belle, ma très gracieuse Princesse ! Mais, attends, attends ! Il faut faire de la lumière, beaucoup de lumière dans la petite chambre.
Et, ce disant, la vieille femme alla chercher toutes les chandelles bénites qu’elle avait conservées depuis les fêtes de la Vierge et elle les alluma, si bien que Giacinta fut entourée d’un rayonnement de splendeur.
Tout à fait étonnée de la haute beauté de Giacinta et encore plus de la façon gracieuse, et en même temps distinguée, avec laquelle celle-ci allait et venait dans la chambre, la vieille joignit les mains, en s’écriant :
– Oh ! si quelqu’un, si tout le Corso pouvait vous voir ainsi !
Au même instant, la porte s’ouvrit vivement ; Giacinta s’enfuit vers la fenêtre en poussant un cri. À peine l’arrivant, un jeune homme, eut-il fait deux pas dans la chambre, qu’il resta cloué au sol, figé comme une colonne.
Tu peux, mon très cher lecteur, considérer à loisir ce jeune homme, tandis qu’il est là muet et immobile. Tu verras qu’il a à peine vingt-quatre à vingt-cinq ans et que c’est un très beau garçon. Son costume peut être qualifié d’étrange parce que, bien que la couleur et la coupe de chacune de ses parties soient irréprochables, l’ensemble ne s’harmonise pas du tout et offre un jeu de couleurs violemment disparates. En outre, bien que tout soit proprement entretenu, on remarque une certaine pauvreté ; on s’aperçoit, au col de dentelle, que celui qui le porte n’en a qu’un autre de rechange et que les plumes dont est fantaisistement orné le chapeau, enfoncé de travers sur la tête, ne tiennent que péniblement grâce à des fils métalliques et à des épingles. Tu t’en rends bien compte, aimable lecteur, le jeune homme ainsi habillé ne peut être qu’un comédien un peu vain, dont les gains ne sont guère élevés ; et il en est véritablement ainsi. En un mot, c’est ce Giglio Fava qui doit à la vieille Béatrice encore deux paoli pour le lavage d’un col de dentelle.
– Ah ! que vois-je ? – dit enfin Giglio Fava, avec autant d’emphase que s’il eût été sur les planches du Théâtre Argentina – est-ce un rêve qui m’illusionne encore ? Non, c’est elle-même, la divine, et il m’est permis d’oser lui adresser de hardies paroles d’amour ? Princesse, ô princesse !
– Ne fais pas l’âne, – s’écria Giacinta, en se retournant vivement, – et garde tes farces pour les jours qui vont venir.
– Ne sais-je donc pas, – répliqua Giglio après avoir repris haleine et avec un sourire forcé, – que c’est toi, ma charmante Giacinta ? Mais, dis-moi, que signifie cette robe magnifique ? Vraiment, jamais tu ne m’as parue si ravissante et je ne voudrais plus te voir autrement.
– Quoi ? – dit Giacinta avec irritation. C’est donc à mon costume de satin et à mon chapeau à plumes que va ton amour ?
Et en même temps elle se glissa promptement dans la petite chambre voisine et elle en sortit bientôt, dépourvue de toute parure et ayant repris ses vêtements ordinaires. Sur ces entrefaites, la vieille Béatrice avait éteint les chandelles et sérieusement rabroué ce malavisé de Giglio qui venait ainsi troubler le plaisir que faisait à Giacinta l’essayage de la robe destinée à quelque grande dame et qui, par-dessus le marché, avait été assez peu galant pour donner à entendre qu’une telle parure accroissait les charmes de Giacinta et la faisait paraître plus aimable encore que d’ordinaire. Giacinta ne manqua pas d’ajouter du sien à cette verte semonce, jusqu’à ce que le pauvre Giglio, devenu tout humilité et tout repentir, finît par obtenir assez de calme pour faire écouter les assurances qu’il donnait que sa surprise avait été provoquée par une étrange coïncidence de circonstances toutes particulières.
– Je vais te raconter la chose, – commença-t-il – je vais te raconter, ma charmante enfant, ma douce vie, quel rêve fabuleux j’ai fait hier au soir lorsque, tout épuisé et harassé du rôle du prince Taer que, tu le sais aussi bien que tout le monde, je joue à la perfection, je me jetai sur mon lit. Il me sembla que j’étais encore sur la scène et que je me disputais vivement avec ce sordide avare d’impresario, qui me refusait opiniâtrement une avance de quelques misérables ducats. Il m’accablait de toute espèce de sots reproches. Alors, je voulus, pour mieux me défendre, faire un beau geste, mais ma main rencontra à l’improviste la joue droite de l’impresario, de sorte qu’il en résulta le son et la mélodie d’un soufflet bien appliqué. Aussitôt, l’impresario, saisissant un grand coutelas, s’élança sur moi ; je reculai et en même temps mon beau bonnet de prince, que toi-même, ma suave espérance, tu avais si gentiment paré des plus belles plumes qui aient jamais été arrachées à une autruche, tomba à terre. Furieux, le monstre, le barbare d’impresario se jeta sur lui et perça de son coutelas le pauvre mignon, qui, dans les affres de la mort, se tordait à mes pieds en gémissant. Je voulus, comme c’était mon devoir, venger l’infortuné. Mon manteau enroulé sur mon bras gauche et brandissant mon glaive princier, je m’élançai sur l’infâme meurtrier. Mais le voilà qui se réfugie dans une maison et qui, du haut du balcon, décharge sur moi le fusil de Truffaldino. Chose bizarre, l’éclair du coup de feu s’immobilisa et rayonna autour de moi comme des diamants étincelants. Et, lorsque la fumée se fut peu à peu dissipée, je m’aperçus que ce que j’avais pris pour l’éclair du fusil de Truffaldino n’était autre que l’exquise parure du petit chapeau d’une dame. Oh ! par les dieux et par tout le ciel ! Voici qu’une douce voix se mit à parler, – non, à chanter, – non, à exhaler, dans un accent mélodieux, un parfum d’amour : « Ô Giglio, mon Giglio ! » dit-elle. Et je vis alors un être d’un charme si divin, d’une grâce si suprême que le brûlant sirocco d’une ardente passion envahit toutes mes veines et tous mes nerfs et que ce fleuve de feu devint une lave jaillissant du volcan enflammé de mon cœur : « Je suis », dit la déesse, en s’approchant de moi, « je suis la princesse ».
– Comment – fit Giacinta en interrompant coléreusement l’acteur, qui était aux anges, – tu as l’impudence de rêver d’une autre personne que moi ? Tu as l’impudence de devenir amoureux rien qu’à l’aspect d’une sotte et stupide vision qu’a fait naître le fusil de Truffaldino ?
Et ce fut alors comme un déluge de reproches et de plaintes, d’injures et de malédictions ; et toutes les affirmations et toutes les assurances du pauvre Giglio, déclarant que justement la princesse de son rêve avait porté la même robe que celle qu’il venait de voir à sa Giacinta, ne servirent absolument à rien. La vieille Béatrice elle-même, qui d’habitude n’était pas disposée à prendre le parti du signor Sans-le-sou, comme elle appelait Giglio, se sentit prise de pitié et ne lâcha pas cette entêtée de Giacinta, jusqu’à ce que celle-ci eût pardonné à son amoureux le rêve qu’il avait fait, à la condition qu’il n’en parlerait jamais plus. La vieille Béatrice prépara un bon plat de macaroni, et Giglio, à qui, à l’opposé de son rêve, l’impresario avait avancé quelques ducats, alla chercher un cornet de dragées et sortit de la poche de son manteau une fiole remplie d’un vin qui, ma foi, était assez buvable.
– Je vois que tu penses à moi, mon Giglio, – dit Giacinta, en mettant dans sa bouchette un fruit confit.
Elle permit même à Giglio de baiser le doigt qu’avait blessé la méchante aiguille et tout fut de nouveau, pour eux, délices et béatitude. Mais quand le Diable se met à entrer dans la danse, les pas les plus gentils ne servent à rien. Ce fut sans doute le Malin lui-même qui inspira à Giglio, lorsque celui-ci eut bu quelques verres de vin, les paroles suivantes :
– Je n’aurais pas cru, que toi, ma douce vie, tu pusses être si jalouse de moi. Mais tu as raison, j’ai un physique fort joli, je suis doué par nature de toutes sortes de talents agréables, et, mieux encore, je suis comédien. Le jeune comédien qui, comme moi, joue divinement les princes amoureux, avec des « oh ! » et des « ah ! » bien congruents, est un roman ambulant, une intrigue sur deux jambes, une chanson d’amour avec des lèvres pour baiser et des bras pour embrasser, une aventure sortie d’un volume pour s’incarner dans la vie et qui prend figure devant les yeux de la lectrice la plus belle, lorsqu’elle ferme le livre. De là vient que nous exerçons un enchantement irrésistible sur les pauvres femmes qui sont folles de tout ce que nous sommes et de tout ce qu’il y a en nous, ou sur nous, folles de notre esprit, de nos yeux, de nos fausses pierres précieuses, de nos plumes et de nos rubans, – peu importe leur rang et leur situation ; lavandières ou princesses, c’est la même chose. Eh bien ! Je te dis, ma charmante enfant, que, si certains pressentiments secrets ne m’abusent et si un lutin malicieux ne se joue pas de moi, vraiment, le cœur de la plus belle des princesses brûle d’amour pour moi. S’il en est ainsi ou lorsqu’il en sera ainsi, tu ne m’en voudras pas, mon adorable espoir, si je ne laisse pas inexploitée cette mine d’or qui s’ouvre devant moi et si je te néglige un peu, car enfin une pauvre diablesse de modiste…
Giacinta avait écouté ce que disait Giglio avec une attention toujours croissante, tandis qu’elle se rapprochait sans cesse du comédien, dans les yeux brillants de qui se reflétait la vision nocturne. Et voici qu’elle bondit sur lui et qu’elle donna à l’infortuné amoureux de la belle princesse un tel soufflet que toutes les étincelles qu’avait fait jaillir le fatal fusil de Truffaldino dansèrent devant ses yeux ; après quoi Giacinta se retira dans sa chambre. Toutes les prières et les supplications furent inutiles pour la ramener.
– Rentrez chez vous, elle a sa smorfia et il n’y a rien à faire, – dit la vieille Béatrice. Et elle accompagna Giglio tout affligé en l’éclairant jusqu’au bas de l’étroit escalier.
La smorfia, cet étrange caprice des natures un peu farouches que sont les jeunes filles italiennes, doit avoir quelque chose de très particulier ; car les connaisseurs assurent unanimement que précisément de cet état d’esprit se dégage un charme merveilleux, d’un attrait si irrésistible que le prisonnier, au lieu de rompre ses liens avec colère, se laisse étreindre par eux encore plus étroitement et que l’amant qui est repoussé ainsi d’une manière brutale, au lieu de prononcer un éternel addio, n’en soupire et n’en supplie sa belle que plus passionnément, comme il est dit dans la chanson populaire : Vien quà, Donna, bella, non far la smorfiosella !
Celui qui te parle ainsi, cher lecteur, suppose bien que ce plaisir né du déplaisir ne peut fleurir que dans le joyeux Midi, et que cette belle floraison, fille de la mauvaise humeur, n’est pas capable de s’épanouir dans notre Septentrion. Tout au moins dans l’endroit où il vit, il ne peut nullement comparer l’état d’esprit qu’il a souvent remarqué chez des jeunes filles sortant de l’enfance à cette gentille « smorfiosité ». Ces jeunes filles, le ciel leur a-t-il donné un visage agréable : voici qu’aussitôt elles en crispent les traits de la manière la plus déplorable ; tout dans le monde est pour elles tantôt trop étroit, tantôt trop large ; il n’y a pas, ici-bas, de places qui conviennent pour leur petite personne ; elles supportent plutôt la torture d’une chaussure trop étroite qu’un mot aimable ou même spirituel et elles sont terriblement fâchées que tous les jeunes gens et tous les hommes de la banlieue et de la ville soient mortellement épris d’elles, – ce à quoi, pourtant, elles pensent en elles-mêmes sans déplaisir. Il n’existe aucune expression exacte pour désigner cet état d’âme du sexe faible. La notion d’insolence qui s’y trouve impliquée projette ses reflets, comme dans un miroir concave, chez les garçons à ce moment de leur existence que les grossiers maîtres d’école allemands appellent les années de gourme…
Et pourtant il ne fallait pas du tout en vouloir au pauvre Giglio si, dans l’étrange tension où se trouvait son esprit, il rêvait, même éveillé, à des princesses et à des aventures merveilleuses. En effet, ce jour-là, lorsqu’il allait à travers le Corso, portant déjà dans son extérieur pour une bonne moitié la personnalité du prince Taer, de même qu’il la portait tout entière dans son intérieur, il s’était produit beaucoup d’événements extraordinaires.
Près de l’église San Carlo, justement là où la rue Condotti croise le Corso, au milieu des boutiques des marchands de saucisses et des débitants de macaroni, le Ciarlatano connu de tout Rome, le Signer Celionati, avait établi ses tréteaux et débitait au peuple assemblé autour de lui un tas de propos follement fabuleux où il était question de chats ailés, de gnomes sauteurs, de racines de mandragore, etc., – en même temps qu’il vendait plus d’un moyen secret pour guérir l’amour inconsolable, les maux de dents et pour préserver des mauvais billets de loterie et de la goutte. Voici qu’au lointain se fit entendre une étrange musique de cimbales, de fifres et de tambours ; aussitôt, le peuple se dispersa et courut et se précipita à travers le Corso, vers la Porta del Popolo, en disant à grands cris : « Voyez, voyez, le Carnaval commence donc déjà ! Voyez, voyez ! »
Le peuple avait raison ; le cortège qui, par la Porta del Popolo, se dirigeait lentement vers le Corso, ne pouvait raisonnablement être considéré que comme la plus étrange mascarade que l’on eût jamais vue. Sur douze petites licornes blanches comme neige, portant aux pieds des fers dorés, étaient campés des êtres enveloppés de rouges simarres de satin, qui soufflaient gentiment dans des fifres d’argent et qui tapaient sur de petites cimbales et battaient du tambour. Presque à la manière des frères pénitents, leurs grandes robes ne laissaient visible que la place des yeux, et elles étaient garnies tout autour de galons d’or, ce qui avait un aspect singulier. Lorsque le vent soulevait un peu la simarre de l’un des petits cavaliers, apparaissait un pied d’oiseau dont les griffes portaient des anneaux de brillants. Derrière ces douze gracieux musiciens, deux puissantes autruches tiraient une tulipe brillante comme de l’or, fixée sur un train de roues, tulipe dans laquelle était assis un petit vieillard avec une longue barbe blanche, vêtu d’une simarre d’argent et portant, renversé sur sa tête vénérable, en guise de bonnet, un entonnoir d’argent. Le vieillard, qui avait sur son nez d’énormes lunettes, lisait très tranquillement dans un grand livre qu’il tenait ouvert devant lui. Il était suivi de douze nègres, richement habillés, armés de longues lances et de sabres courts, qui, chaque fois que le petit vieillard tournait une feuille du livre, en faisant entendre en même temps d’un ton fluet et très aigu les sons « Kurripire… hsi… lix… iii », chantaient avec des voix aux accents puissants, « Bram… bure… bil… bal… À la monsa Kikiburra… son… ton… »