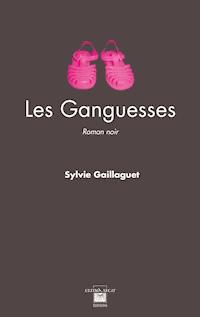Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Récemment, Marie-Jeanne est obsédée par une question : comment l’âme se sépare-t-elle du corps au moment de la mort ? Dans l’attente de son procès pour meurtre, la septuagénaire est internée dans une institution psychiatrique où son quotidien est tout sauf ennuyeux. Cependant, le chaos aura-t-il raison d’elle ?
Processionnaire explore les rapports familiaux, l’impact de la religion et la place de la psychiatrie dans un univers stéréotypé.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Sylvie Gaillaguet a exercé la profession de psychosociologue. C’est dans cette vie riche en informations sur la nature humaine qu’elle puise son inspiration. Pour elle, le meurtre n’est finalement que l’une des circonstances de la difficulté d’être. Vision qui lui inspire l’écriture de
Processionnaire, son premier roman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sylvie Gaillaguet
Processionnaire
Roman
© Lys Bleu Éditions – Sylvie Gaillaguet
ISBN :979-10-377-7294-7
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Introduction
Un jour, une amie m’a mise au défi d’écrire un véritable roman noir, ce qui m’obligerait à sortir de ma zone de confort.
Pour ma part, un roman noir c’est le reflet d’une certaine réalité, crue, saignante, terriblement tragique. C’est, de loin, ce qui ressemble le plus à ce que vivent les humains au quotidien, et ça fait mal.
De même que c’est douloureux d’écrire sur les turpitudes des femmes nées au siècle dernier, et qui n’avaient pas d’autres choix que de se conformer aux règles d’un monde qui exigeait qu’elles suivent fidèlement la route tracée par leurs mères.
Elles avancent en procession. Elles vont à l’église, se marient, font des enfants, guidées par un solide fil conducteur secrété par leurs mères, en plus d’être soumises, au bout du compte, à leurs maris. Elles ne peuvent pas s’éloigner des règles de leurs familles sans se mettre en danger.
L’histoire de cette femme est bouleversante. On se prend à la haïr par moment et rares sont les instants où elle nous inspire, si ce n’est de la tendresse, au moins, de la compassion.
Cependant, peut-on détester Marie-Jeanne, celle qui ne fait que suivre, avec une certaine universalité, sans jamais se répandre en lamentations, ce que le destin lui a offert comme cartes de vie ?
La question reste posée.
J’ai relevé le défi et j’ai commencé la rédaction de :
« Processionnaire ».
L’ombre glisse dans le couloir sans que l’air ne bouge d’un souffle et sans alerter la cible. En quelques pas, elle la rattrape, la ceinture, et se plaque contre le corps moite qui, sidéré, ne cherche même pas à se dégager de l’étreinte brutale. Une troisième personne, dont la silhouette se dessine en contre-jour sur la fenêtre du fond, se fige, en attente.
L’ombre s’adresse à elle et lui dit d’une voix sourde : « Regarde, il n’y aura pas d’autre occasion », elle lève le bras. Elle frappe la proie collée contre elle, incapable d’émettre le moindre son. Le geste est précis et puissant. La lame entre sans riper dans le cou gras, juste au bon endroit. Le sang gicle. Le visage se crispe de douleur. Les paupières s’agrandissent pour laisser passer un regard épouvanté se perdre dans l’instant où une vie s’en va. L’ombre tient dans ses bras Éros et Thanatos réunis dans l’orgasme expéditif, douloureux autant qu’informulé, qu’est l’instant de la mort. Après un ultime hoquet silencieux, le corps s’affale : sac de linge sanglant.
Ouvrant les bras, l’ombre lâche le paquet de chair humaine sans vie, qui s’écroule sur le sol brillant, et disparaît sans se retourner.
Au fond du couloir, la silhouette imprécise déploie ses bras, papillon sombre, avant de se fondre dans la nuit.
19 juin 1940, la longue marche
La colonne des fuyards avance le long du fossé où l’herbe fraîchement foulée commence à mouiller les vêtements comme s’ils marchaient sous la pluie. La petite, épuisée, titube et lâche la corde. Elle ne pleure même pas. Elle sait que personne ne la portera. Elle bute sur une pierre, se laisse tomber sur le sol. Les autres lui dégringolent dessus. La petite grimace. Quelque chose la pique atrocement au bras et aux jambes. Ça brûle exactement comme lorsqu’elle avait touché la bête, l’autre jour, lors d’une promenade. Elle se souvient bien de la douleur qui avait duré une semaine. Elle avait tellement gratté sa jambe que grand-maman avait dû lui attacher les bras le soir dans son lit afin qu’elle laisse la plaie cicatriser. Elle retient ses larmes pour ne pas attirer l’attention sur elle.
— Maman ! geint Yvette, on est tombé dans des orties à cause de Marie-Jeanne.
— Suffit ! morigène la mère. On se tait et l’on offre sa souffrance au Seigneur.
Marguerite, leur bonne, relève les enfants en rajustant leurs vêtements et attache la petite à la corde par la ceinture de sa robe.
Jules ricane : « On dirait Pataud ! »
Son frère continue d’un ton moqueur : « Oui, elle est comme lui, tenue en laisse… »
— Chut ! Soyez charitables, demande maman.
Puis elle explique :
— Nous allons marcher jusqu’à une maison que papa a louée pour nous. Là-bas, nous aurons des lits pour nous reposer et de quoi manger.
La nuit est claire. Ils ne sont pas tellement loin de Cherbourg. Tout au plus, à 15 km. Ils ont pourtant marché pendant 6 heures. Il ne leur reste que 5 km avant d’arriver aux abords de la ferme. Dans le ciel, des avions larguent à l’aveugle des paquets de bombes. Au loin, des lumières constellent les collines comme autant de grands feux de la Saint-Jean.
— Ce sont les Américains qui bombardent, dit un vieil homme en les dépassant.
— Les Américains ? Ce sont nos alliés pourtant… s’inquiète maman, surprise autant que choquée.
— J’ten foutrais des Alliés comme ça ! ronchonne l’homme. Ils sont en train de démolir la ville. Y’aura plus rien demain à c’train là…
Été 2022
Ma chambre est blanche sur les murs, et brunâtre aux endroits où des sans-soin ont posé leurs mains sales depuis des lustres. Je déteste la saleté !
Le lit n’est pas fait. Les draps froissés gisent dans la ruelle en attendant que la fille de salle vienne me les changer.
Je regarde par la fenêtre.
En bas, dans l’allée, mon psychiatre marche à pas lents. Il fait très chaud. Je suppose qu’il est en nage. Je le déteste et, surtout, je déteste son manque de tenue.
— On ne doit jamais transpirer, c’est sale, confirme ma voisine de lit à qui je demande son avis.
Je retourne à ma table pour écrire le « livre de ma vie ». J’ai décidé de coopérer, pas pour obéir aux médecins, mais parce que je veux maîtriser toute mon histoire. Ma vie m’appartient.
Je vais relire soigneusement les quelques lignes que je viens d’organiser en séquences, celles, bien revisitées, que je veux que l’on garde en mémoire pour plus tard, quand…
Je range mes feuillets dans une chemise cartonnée. Je suis contente de ce que j’ai écrit aujourd’hui. Je suis certaine que je n’ai pas fait de faute d’orthographe. Je n’en fais plus depuis ma classe de 4e.
J’aime le ton que je donne à mon récit.
C’est décidé, j’écrirai mon autobiographie comme un roman à épisodes où je consignerai dorénavant les périodes de ma vie.
Il devra s’en contenter.
J’aime le ton distant que donne le style narratif. J’aime aussi jouer avec les « fausses vérités » d’un moment de souvenirs puisés dans le passé. De toute façon, personne ne viendra se plaindre du fait qu’un détail a été ajouté, ou ôté…
C’est ma parole qui compte.
Il m’a dit que j’avais un beau style littéraire.
J’aime que l’on remarque mes qualités.
Je crois que j’ai bien cerné ce petit psy gras qui dit qu’il faut que je raconte mon enfance, que ça peut l’aider à comprendre.
Comprendre qui ? Moi ?
Il s’imagine quoi ?
C’est un fainéant. Je l’ai vu tout de suite.
Il est gros. Il pue, comme puent les gros, surtout les roux.
De ma fenêtre, je vois un chat qui se glisse sous une voiture dans le parking. Je souhaite que le véhicule démarre et que cette bête soit écrabouillée en laissant une tache sur le pavé, une tache rouge comme un dégueulis de pochard.
Je déteste les chats. Je ne les ai jamais aimés. Comme je n’ai jamais aimé mon père qui avait toujours préféré les chats à ses enfants. Je ne sais pas de quels appuis il a bénéficié pour être décoré de la Légion d’honneur.
J’ai accroché cette distinction dans les cabinets.
Lorsque les gens me demandent pourquoi j’ai fait ça, et qu’en plus ils disent, comme pour me faire la morale, que c’est un manque de respect, je leur réponds que je ne vois pas où est le problème. Il ne la méritait pas.
Mon psychiatre est arrivé, suant et soufflant comme d’habitude.
Sans me demander la permission, il s’est assis sur une chaise en face de moi. Il est déplaisant, impoli, grossier et moche.
Je reste silencieuse un long moment, juste pour l’énerver.
Il attend.
Il ne regarde même pas sa montre.
Il faut reconnaître qu’il est patient… Ou tellement paresseux qu’il préfère finalement passer notre entretien à ne rien dire, à ne rien faire.
Je ne vais pas encourager son laxisme.
Je finis par lui dire :
— Voilà ce que j’ai écrit cette nuit.
Je ne donne à Kantorovitch, à chacune de ses visites, qu’une narration revue et corrigée, c’est-à-dire romancée, de ma vie.
Il n’exprime rien. Ni réprobation ni approbation.
C’est un fainéant, un vrai.
Apparemment, aujourd’hui, Kantorovitch a lu des feuillets de mon manuscrit.
Il me demande de parler de cet exode qui a marqué ma petite enfance. Je soupire. Il insiste. Alors, je lui en donne pour son argent, en insistant sur les détails crades.
C’est à l’âge de 4 ans, dans un fossé, que j’ai vu que la vie n’était qu’un tas de merde. Ma mère était en train d’accoucher dans le fossé où nous étions tapis et j’ai tout vu. Elle s’est même faite dessus. Il y avait une femme qui l’aidait, mes frères et sœurs étaient assis contre la bonne qui nous accompagnait lors de cet épisode hors les murs de Cherbourg.
Tous avaient peur. Pas moi. J’ai aimé l’odeur de l’herbe broyée par les corps des réfugiés rampant vers les trous. Je n’ai pas aimé l’odeur de sueur de l’homme qui s’était laissé tomber à côté de moi.
Le fossé, c’était tout ce qu’on avait trouvé pour se protéger et se mettre à l’abri des mitrailleuses qui claquaient sur l’asphalte.
C’est quand même là que j’ai vu mon premier mourant.
On m’a raconté plus tard qu’on avait retrouvé un squelette dans la boue lorsqu’ils avaient nettoyé l’endroit, bien longtemps après la guerre.
Des cadavres, on peut en voir partout si on cherche bien.
À Buenos Aires, au cimetière des Récollets, j’ai vu, avec ma copine du moment, des quantités de squelettes. Il faut dire que les parois des tombeaux s’étant descellées avec le temps, les cercueils de bois pourris laissaient entrevoir les SOS des défunts. Souvenirs ineffables ! Demain, je vous expliquerais ces émotions-là.
— Demain ?
Il en redemande ? Pas question !
Je pense que je ne dois pas dévoiler « mon mystère » aussi facilement que l’intrigue d’un roman de gare.
Je dois savoir garder mes petits secrets. Alors, pour demain, je vais fignoler un épisode adapté aux oreilles de ce gros lard qui fait mine d’être intéressé, mais qui est indifférent au bout du compte.
On m’a dit le jour de mon arrivée : « C’est le docteur David Kantorovitch qui vous suivra ».
Le personnel l’appelle « Kanto », ce qui est à mes yeux un total manque de respect.
C’est donc à lui, MON psychiatre, que je réclame ce qui me manque pour bien travailler :
— Je n’ai que du papier et un stylo pour écrire. C’est du matériel de dinosaure ! Je veux mon ordinateur portable !
Il me promet, sans même me regarder, que j’en aurais un.
— Je veux le mien !
— Votre ordinateur est entre les mains d’un technicien qui doit analyser vos courriels et vos dossiers. C’est sur la demande d’un juge que nous avons pris la décision de procéder de la sorte.
— C’est un viol ! On n’a pas le droit de fouiller dans mes archives personnelles.
Il ne dit rien. Il se lève et s’en va.
Je tente une dernière manœuvre :
— Je n’écrirai rien de plus si je n’ai pas un ordinateur.
— Vous avez promis d’écrire votre histoire et vous êtes une femme de parole. Acceptez un prêt de notre part, votre ordinateur personnel vous sera rendu dès que possible…
J’ai demandé un magnétophone pour enregistrer mes souvenirs avant de les coucher par écrit. J’ai dit au gros que c’était un outil nécessaire pour faire du bon travail.
Il n’a pas cédé.
— Vous devez faire un effort pour vous souvenir de tout, sans matériel, même si c’est dans le désordre le plus complet.
Il m’a dit avant de s’esquiver :
— Vous êtes en parfaite possession de vos moyens pour faire marcher votre mémoire sans cette béquille qu’est un magnétophone. C’est bon pour vous de faire cet effort de mémorisation.
Pourquoi, alors, on en a donné un à ma voisine de chambre ? Pourquoi à elle et pas à moi ? L’autre larve est si nulle qu’elle ne sait pas se servir de l’outil. Cette abrutie n’enregistre rien puisqu’elle n’a même pas enclenché les boutons pour le faire.
C’est jouissif de la regarder baratiner sa misérable vie sans intérêt avec le micro contre sa bouche molle et de savoir que tout ce qu’elle dit n’est entendu que par moi, sa cothurne.
J’ai envie de lui parler aujourd’hui.
J’ai envie de discuter avec lui.
Depuis que je suis arrivée, personne d’autre que lui ne me parle, sauf les filles de salle pour me dire de sortir du lit afin qu’on le nettoie. Même ma cothurne ne m’adresse que quelques mots par jour et c’est toujours pour se plaindre de la chaleur et de la nourriture.
Alors que lui il est payé pour m’écouter et me parler.
C’est vrai qu’il ne dit pas grand-chose.
Quand même, il est là pour moi.
Il a chaud. Son visage brille de sueur. Il se gratte les avant-bras et finalement a l’air misérable, mais curieusement, je ne lui en tiens pas rigueur aujourd’hui. Je le plains.
Je lui dis : « J’ai mal dormi. Je me suis relevée pour écrire ».
Il ne bronche pas. Impassible, il reste hors de portée d’émotions.
J’insiste : « À remuer la boue, on finit par étouffer ».
J’entreprends de démarrer mon récit en chuchotant parce que j’ai envie qu’il se penche vers moi :
— Toute cette course folle qu’était notre exode m’est revenue lorsque j’ai visionné un film tourné pour l’ouverture du mémorial de Caen. C’était il y a quelque temps déjà… Je n’habitais plus la Normandie depuis un bail, pourtant on m’avait invitée à la projection parce que j’étais connue en tant que fille du Capitaine Dufour. Il fallait remplir la salle et la plupart des Cherbourgeois de plus de 60 ans refusaient de venir revivre leur calvaire en image. Tout le monde avait été frappé de stupeur et était au bord de la crise d’angoisse collective lors de ce visionnage. Pas moi ! Les échos du chaos m’ont exaltée. J’ai toujours eu un certain goût pour les rumeurs assimilées à celles de l’enfer. En fait, vous savez, je n’aime que le grinçant, le grandiose dans la terreur, la folie dans le bruit. J’adore l’harmonium, celui de l’église où j’allais quelquefois. J’avais, à Cherbourg, un clavecin que je n’ai jamais fait accorder. J’en jouais les soirs d’été, toutes fenêtres ouvertes, afin que les voisins en profitent.
Il m’écoute en se grattant les mains. Il m’agace. Pour une fois que je lui sers un vrai discours, avec des détails et des références, il pourrait faire au moins semblant d’être intéressé.
Je lui demande la permission de retourner dans ma chambre, je suis fatiguée d’avoir tant parlé.
Pendant mon absence, on a fermé les volets dans le vain espoir que l’ombre apporte un peu de fraîcheur. Dans le lit voisin, l’autre folle dort. Telle qu’elle est, sans son dentier, sa bouche molle s’enfonce selon l’intensité de son souffle. C’est d’un moche ! C’est d’un manque total de tenue. Dommage qu’on ait supprimé les appareils photo à tous les pensionnaires, sinon je me serais fait une joie de la prendre ainsi et de lui rabattre son caquet de bourgeoise prétentieuse.
Je me couche, je m’enroule dans mon drap en effectuant plusieurs tours.
Dans le couloir, l’aide-soignante que je déteste dit :
— … C’est l’étage de tous les dangers…
Une voix étonnée répond :
— Ah ? Ces dames sont pourtant au bout du rouleau…
On me conduit dans un bureau plus frais grâce à une petite clim mobile. Kantorovitch est déjà assis et, pour une fois, il ne dégouline pas…
Je ne le laisse pas décider du rythme à donner à notre entretien du jour. J’attaque avant qu’il ne me saoule avec son mielleux « qu’avez-vous à nous dire aujourd’hui » ?
— Notre exode nous avait menés à la ferme des Ormeaux chez « mémé Rainville », une veuve que mon père connaissait. Nous étions arrivés au pire moment du bombardement.
La ferme des Ormeaux était vaste et accueillante. Il faisait beau. Tous les Dufour de moins de 13 ans étaient dehors, sauf Victoire qui venait de naître et qui dormait dans une corbeille à linge devenue berceau, type Moïse, pour la circonstance.
Je nous revois…
Kantorovitch se penche sur moi parce que j’ai baissé la voix. Cela lui demande un effort qu’il devient rouge écrevisse, ce qui n’arrange pas son allure générale. Il dit : « Bien, continuez, madame Dufour… »
Il attend patiemment la suite. Après deux bonnes minutes de silence, je continue mon récit.
— Nous étions tous assis sur les marches d’un vaste perron, surplombant la cour pavée. Il y avait aussi Marie Gauthier et son frère Gilles qui faisaient eux aussi partie des évacués. Nous nous connaissions bien. Ils habitaient deux maisons plus loin dans la même rue et nos familles se fréquentaient. Marie avait 7 ans, le même âge que les jumelles. Nous étions tous arrivés au même moment.
« Au pire moment ! » avaient précisé mes frères encore sous le charme de la beauté et du fracas des bombes.
« C’est comme si le ciel avait pris feu… » racontaient-ils.
« Ça faisait comme des flammes dans la grande cheminée, ça venait des avions qui tombaient ».
Bien évidemment, ma sœur Paulette les traitait de menteurs…
Tous étaient contents, ils avaient un motif de discussion, donc de dispute. Les uns affirmaient que… Les autres niaient que… Les derniers étaient convaincus de…
Je ne voulais pas être en reste. Je ne me souvenais pas d’avoir vu des avions en flammes, mais j’avais un secret.
« Moi j’ai vu quelque chose que personne n’a vu ».
J’avais dit ça avec un tel aplomb que les autres s’étaient arrêtés de chicaner pour m’écouter. J’avais enfin réussi à capter leur attention. Même Gilles avait demandé ce que j’avais à dire de tellement intéressant. Pourtant, parce que c’était le fils Gauthier qui avait posé cette question, je n’avais pas répondu. Raconter mon histoire de dame qui avait demandé à maman d’écarter les jambes et le reste… pas question ! J’avais compris intuitivement que mon secret ne devait appartenir qu’à ma fratrie.
… « t’as rien à dire », avait ironisé Gilles.
Et les autres de se moquer de moi :
« La vérité c’est que t’as dormi, comme un vrai bébé que tu es, dans les bras de la bonne pendant la bataille. Donc t’as rien vu du tout… »
J’avais trépigné : « Si, j’ai vu quelque chose ».
Ils m’ont traitée de menteuse !
« Pas beau de raconter des histoires qui ne sont pas vraies… » disaient les jumelles toujours rosses avec moi. Mon grand frère, René, qui nous observait depuis la fenêtre de sa chambre avait dit : « T’as raison, ton nez va grandir comme celui de Pinocchio quand il mentait à Jiminy Cricket, et un nez plus long c’est exactement ce qu’il te faut pour ne plus avoir l’air d’un singe ».
Ils étaient tellement vexants.
Kantorovitch me demande d’une voix placide :
— Qu’auraient-ils appris ?
— Ils n’ont jamais su que, cette nuit-là, j’avais vu ma mère accoucher de ma sœur Victoire !
Kantorovitch est pressé aujourd’hui. Après seulement un quart d’heure d’entretien, il se lève pour y mettre fin. Je ne suis pas d’accord. Je lui racontais notre vie à la ferme pendant la guerre.
J’élève la voix jusqu’à crier :
— … Heureusement pour nous, les Dufour, que notre grande maison n’avait pas été touchée par les bombes ni réquisitionnée par les vainqueurs !
Il se tourne vers moi, maté. Il écoute de nouveau :
— Mon père, qui était resté à Cherbourg pendant tout le bombardement, avait finalement permis que toute sa petite troupe réintègre les lieux.
En fait, nous avions passé l’été aux Ormeaux pour ne pas avoir à penser au ravitaillement qui était, depuis le début de la guerre, un véritable casse-tête. Nourrir les 7 enfants Dufour et les deux Gauthier ainsi que leurs parents, plus leur mère et leur grand-mère avec en plus une bonne, qui n’avait pas lâché « Madame » dans la tourmente, aurait été extrêmement difficile en ville.
Aux Ormeaux, nous les petits, nous avons aidé à la cueillette des haricots verts, des salades, des fraises, des cassis, des groseilles. Pour la viande, on tuait des lapins, des poulets. La fermière n’ayant plus qu’une vache, cachée lors des réquisitions, son lait était en priorité pour les plus jeunes. Lorsqu’il caillait dans les pots en terre, grand-maman faisait du fromage frais. Parfois, un peu de crème était prélevée sur ce qui était réservé pour faire du beurre. Nous nous empiffrions au goûter de cette manne inconnue de la plupart d’entre nous, puisque 4 années de guerre nous en avaient privés. Pour nous, rien de plus doux, de plus gouleyant que ce caillé, recouvert de crème ivoire issue des prés qui entouraient les bâtiments. Les garçons, qui n’avaient pas peur des poules, allaient ramasser les œufs. Maman payait tout ça avec les tickets de rationnement que la fermière troquait, à son tour, avec d’autres, évacués, contre des pièces de tissu et des chaussures.
L’été 40, qui avait débuté dans l’horreur, s’était déroulé par la suite sans incident et avait été, de l’avis de tous les enfants, les plus belles grandes vacances de leur vie.
Tout le monde était retourné à Cherbourg, à pied. Oubliant les épreuves de l’aller, le trajet de retour s’était effectué dans la joie et la bonne humeur, chacun rêvant de retrouver sa chambre individuelle. À la ferme, nous étions entassés dans des cambuses, au grenier, et pire, pour nous qui jouissons d’un certain confort dans la grande maison en ville, nous dormions parfois à trois dans de grands lits, avec des matelas qui nous griffaient atrocement parce que le crin passait à travers la toile grossière du matelas. Je dormais avec les jumelles et, chaque matin, elles râlaient tout ce qu’elles savaient parce que je gigotais sans cesse et je parlais dans mon sommeil. Finalement, maman avait demandé à Marguerite, la bonne, de me prendre avec elle.
Les parents Gauthier n’étaient pas mieux lotis. Ils s’étaient isolés dans une chambre, faite en planches de peuplier, bois extrêmement sonore lorsqu’il est sec. C’était celle de l’ancien commis parti au STO en Allemagne. Les parents avaient un grand matelas sur un châlit de bois de récupération et Gilles dormait dans un lit-cage antique, séparé de sa sœur par un rideau de Rseps vert. Marie, elle, n’avait qu’une paillasse à même le sol. Elle avait pris ma place et rejoint ses « grandes amies » Yvette et Paulette dans leurs couches au grenier.
C’est là que les amitiés se nouaient et se dénouaient au gré des humeurs des enfants. Les Dufour, aguerris depuis le berceau à discuter sur tout, tenaient la dragée haute aux Gauthier qui jouaient beaucoup sur le langage diplomatique pour avoir le dernier mot. Marie pleurait parfois en constatant que Yvette et Paulette préféraient perdre son amitié plutôt que de rater un « bon mot », autrement dit, une méchanceté… Gilles, quant à lui, plus âgé que Jules, Adrien et Émile, gagnait souvent la dernière manche d’une joute verbale sauf lorsque les trois se liguaient contre lui. Alors, il allait voir René, qui maîtrisait la discussion sans jamais aller jusqu’à la dispute.
La colère étant « formellement interdite » par notre mère, c’est avec une parfaite maîtrise de la voix et du geste que nous communiquions. Nous ne nous battions jamais. « Trop vulgaire ! » affirmaient les adultes. Plus l’affront était sévère, plus la réplique venait avec force sourires vous faire du mal moralement.
J’étais de moins en moins souvent dans l’obédience vis-à-vis de mes sœurs. Rassurée par mon nouveau statut de « grande sœur », je commençais à bien maîtriser les rosseries que je lançais en riant, parfois terrorisée par le retour de manivelle qui pouvait s’avérer diablement cinglant.
Je me joignais aux grandes pour martyriser Marie…
C’est l’un des privilèges des familles nombreuses que de faire front contre l’adversaire. Marie n’avait que Gilles.
J’ai soif ! Je viens de parler sans reprendre mon souffle. Je demande un verre d’eau. Kantorovitch se lève pour appeler Jo et lui demander d’apporter une bouteille d’eau minérale. Je jubile. Cette grosse idiote trotte pour répondre au désir de son seigneur, de son dieu, qui lui demande un service. Elle revient avec une bouteille fraîche et montre un visage dépité lorsqu’elle comprend que l’eau est pour moi…
Je continue, décidément en verve ce matin :
— Vous savez, finalement… c’est le concept de famille qui est en cause… Ce sont ceux et celles que l’on est obligé de supporter tout au long de l’enfance et après, c’est de la perversité que de les fréquenter… J’ai failli éclater de rire lorsque votre idiote d’infirmière en chef m’a dit, le jour de mon admission, qu’ici c’était comme « une grande famille ». Je n’en veux pas. Je ne veux plus rien qui ait à voir avec un quelconque lien familial. J’avais demandé le jour de mon arrivée, une chambre seule, ma mutuelle pouvant couvrir les frais. On m’a refusé ce plaisir, avec des arguments stupides :
« Vous verrez, vous vous entendrez bien avec votre compagne de chambre, c’est une personne très comme il faut ! »
Je précise que je suis née dans la bourgeoisie cherbourgeoise et que je suis certainement bien plus « comme il faut » que cette vieille folle que l’on m’impose.
Il tourne la tête, jette un regard vers la fenêtre signifiant ainsi sa parfaite indifférence à mes propos.
Je retourne dans cette chambre que je partage avec une gâteuse.
C’est pire que d’être seule.
Scandale !
J’ai demandé que Kantorovitch vienne me voir.
Je suis franchement exaspérée. Je dénonce le fait que tout à l’heure la fille de salle est venue éteindre la lumière parce « qu’ON devait dormir maintenant ». Elle a dû être adjudante dans une autre vie, celle-là ! J’ai des droits. Je le dis :
— Les patients sont des adultes.
Je fais un tel foin qu’on me promet que cette « salope » ne viendrait plus faire la loi pour m’obliger à quoi que ce soit. D’autant plus que j’ai précisé que j’avais été battue par cette horrible personne et j’ai même montré deux jolis hématomes sur mes bras. J’ai eu beaucoup de mal à me retenir d’éclater de rire devant l’air contrit de mon psy.
En fait, j’ai des bleus dès qu’on me frôle, c’est à cause de l’anticoagulant qu’on me fait prendre depuis que j’ai fait un infarctus.
Je suis contente. J’ai trouvé une façon de faire payer la garce qui me tient tête. Je raconte à mon psy ma dernière trouvaille :
— J’ai chié dans mon lit.
— … exprès ?
— Bien sûr ! Je ne suis pas encore incontinente !
— Pourquoi ?
— Pour punir l’aide-soignante, que vous n’avez finalement pas renvoyée après le scandale de l’extinction arbitraire des lumières.
Il lève la tête et me regarde bien en face, sans ajouter un mot.
— Ensuite, j’ai sonné, juste après avoir tartiné sur mes draps le paquet merdeux.
Il ne semble pas ému par ma description. Il se contente de me demander.
— Quelqu’un est-il venu vous aider ?
— Oui… la même fille de salle qui m’avait bousculée l’autre jour.
Il baisse la tête et gribouille quelques mots sur son dossier.
Pour le faire rougir, voire réagir, je lui susurre :
— J’ai joui quand elle m’a torchée…
Il ne bronche pas. Ma jouissance et mes matières fécales n’ont aucun effet sur lui. Il reste impassible. Son teint reste rose comme celui d’un porcelet. Il n’exprime rien. Après tout, ce n’est pas lui qui met les mains dans la merde, alors, il s’en moque…
J’ai bien envie de lui dire que demain je ferais pareil, mais en plus je fourrerai mon drap souillé dans le lit de ma voisine. On va l’entendre… elle est tellement chochotte qu’elle braille dès qu’elle a envie de faire un simple petit pipi.
On va bien rigoler parce que, cerise sur le gâteau, demain c’est la grève des aides-soignantes qui disent qu’elles en ont marre d’être traitées comme des esclaves et de ne pas avoir assez d’alèses pour protéger les literies.
Ma voisine pourra hurler tout ce qu’elle sait, personne ne viendra la démerder.
Olga, ma cothurne, qui n’est pas si gâteuse que ça, ronfle. Elle n’a aucune tenue le jour et c’est pire la nuit. J’ai l’impression de partager mon espace vital avec un élevage de porcs. Le pire c’est que je ne peux pas me lever pour faire mon tour habituel. On m’a sanglé sur ma couche. Tout ça parce que je me suis endormie, la nuit dernière, dans une autre chambre que la mienne. On a décrété que j’étais somnambule et que j’étais en danger parce que je pourrais tomber…
Olga a cafté à Jo que je me levais toutes les nuits.
Alors Jo, qui me déteste autant que je la déteste, en a parlé à la surveillante en chef, qui en a parlé au médecin de garde, qui a transmis l’info à Kantorovitch, qui s’est empressé de me prescrire des somnifères plus puissants.
Mais Jo n’a pas trouvé mieux pour m’humilier que de m’attacher.
Elle n’en a pas le droit. Je me plaindrai.
En attendant cette nuit, je suis coincée.
Il fait de plus en plus chaud.
« C’est la canicule », constatent bêtement les aides-soignantes en se croisant dans les couloirs.
« C’est la canicule », serine la télé de la salle de « rencontre » mise à la disposition des patients.
« C’est la canicule », me dit le gros psy en s’épongeant le front.
Je sais qu’il n’a pas envie d’être là aujourd’hui.
C’est moi qui ai exigé qu’il vienne.
Il s’est assis en face de moi sur son gros « popotin ».
Je lui ai demandé de venir, mais je n’ouvre pas la bouche. Rien que pour l’agacer, je ne lui parle pas.
J’attends ainsi de longues minutes. Il finit par se lever.
Je le retiens d’un long soupir douloureux.
Il me demande :
— Vous avez mal quelque part ?
— Non ! Mais je dois vous dire que je vais porter plainte…
— … ?
— Contre cette clinique qui ne donne rien pour rafraîchir les chambres…
— Vous savez qu’il y a une salle climatisée, la salle de rencontre, en bas et que vous êtes invitée à y aller…
— Moi oui ! Mais cette pauvre madame Duroc, qui ne pouvait pas sortir de son lit, est morte cette nuit à cause de la chaleur.
Kantorovitch cherche à capter mon regard.
Je suis sans aucune compassion et il le constate en fronçant les sourcils, ce qui ne m’empêche pas de continuer sur ma lancée :
— … Et dois-je vous rappeler qu’il y a trois jours c’était mademoiselle Lassalle ?
— Je sais…
— Oui, vous le savez, vous savez aussi que depuis le début du mois, cette clinique déplore 4 décès… C’est pourquoi je vais porter plainte parce que je ne veux pas mourir dans les jours à venir… Je ne veux pas être la prochaine…
Il soupire en admettant :
— Nous n’avons pas anticipé cette canicule…
Il se lève, promet qu’il va envoyer un responsable pour prendre ma plainte en compte et s’esquive plus vite que sa corpulence peut le laisser supposer.
Une nouvelle fille de salle vient de nettoyer la chambre. Je ne l’avais jamais vue avant. C’est visiblement une tout fraîchement sortie de l’école. Elle a nettoyé avec un grand sourire comme si les excréments, dont j’ai tartiné les murs, ne la gênaient aucunement.
Marie Gauthier, mon amie d’enfance, était toujours tout sourire. Elle faisait en sorte qu’on l’aime. Mais on sait que ce n’est pas vrai. On n’aime pas une fille qui fait semblant d’être heureuse en permanence. On dit d’elle qu’elle est folle, ou bien qu’elle a une araignée dans le plafond. Ce n’est pas normal de sourire tout le temps.
Essuyer la merde, ça ne doit pas faire plaisir.
Il fait chaud, horriblement chaud.
Je reste allongée sur mon lit. Quelqu’un a baissé le store. La chambre est dans l’ombre, mais pour autant elle ne se rafraîchit pas. L’autre larve, son magnéto contre sa joue sur l’oreiller, susurre des bribes de phrase incohérentes.
Tout à l’heure, lorsqu’elle dormira, je le lui prendrai.
J’estime y avoir droit.
Kantorovitch, mis au courant, par mes soins, des brimades que me fait subir Jo, la fille de salle du deuxième étage, la contention de nuit entre autres, a exigé qu’on me laisse tranquille. Plus de liens pour me clouer au lit. Plus de somnifères puissants. Une simple tisane comme pour toutes les gentilles petites mamies du service.
Quand on sait plaider, on obtient gain de cause.
Jo est furieuse. Elle le fait savoir à grand renfort de soupirs déchirants. On a dû lui faire des remontrances. C’est moi qu’elle vise de ses méchancetés. Elle est tout sucre avec Olga et me répond mal lorsque je lui demande de m’apporter une bouteille d’eau. Elle hurle presque afin que tous l’entendent :
— Pas question ! Madame Dufour. Vous allez encore nous pisser au lit…
La guerre est déclarée.
Elle ne sait pas qui je suis.
Elle ne sait pas de quoi je suis capable.
Il fait quand même très chaud dans ma chambre. Pourtant, les stores sont baissés. Je joue à respirer si légèrement qu’on pourrait me croire morte. C’est une vieille habitude chez moi : faire semblant…
Le manque d’oxygène fait danser d’étranges nuages colorés dans ma tête. J’aime ça.
Jo, toujours à fouiner partout, a passé la tête par le bâillement de la porte pour constater que je dormais. Elle s’en est allée sans rien dire.
Aujourd’hui, on ne me forcera pas à parler au rouquin qui se dit psychiatre. Il n’est vraiment pas présentable tel qu’il se présente à nous. Les cheveux, surtout, sont affreusement emmêlés comme le buisson ardent de la bible. Jadis, les médecins étaient vêtus au moins en costume, chemise blanche et propre avec cravate, et les cheveux coupés très courts.
Ce docteur Kantorovitch, en plus d’avoir un nom à coucher dehors avec un billet de logement, ressemble à un ours obèse. Il n’a rien de présentable. Il fait honte à la profession médicale. Je ne veux pas le laisser croire qu’il me soigne. De quoi d’ailleurs ? Je ne suis pas malade. On m’oblige à « faire une cure » dans cette clinique. Ce n’est pas un choix de ma part.
Je n’ai pas choisi non plus ce psy.
Je ne l’aime pas.
Ce que j’aime c’est m’entortiller dans mon drap presque jusqu’à étouffer.
C’est comme ça que j’entends mon cœur battre, mon sang filer dans mes veines.
C’est comme ça que je me sens vivre.
Je raconte à Kantorovitch qui m’écoute attentivement pour une fois :