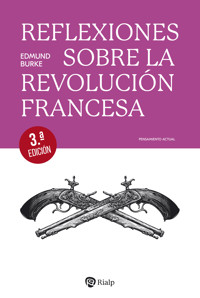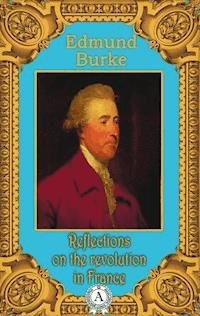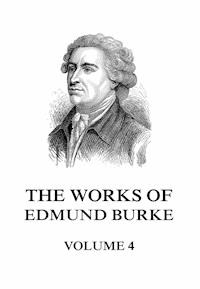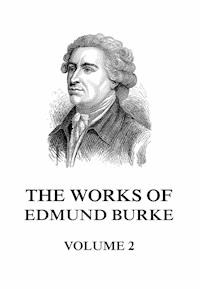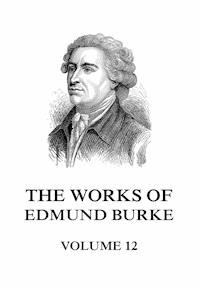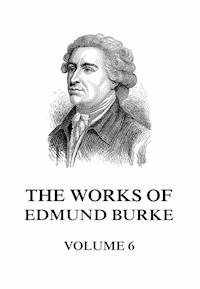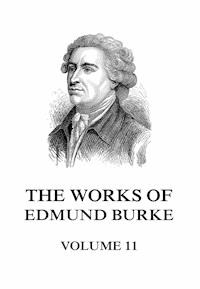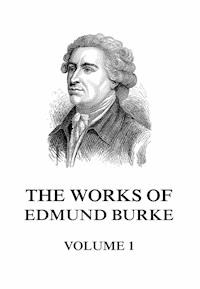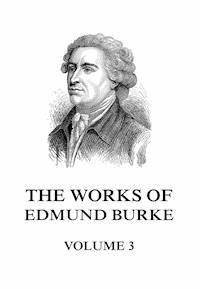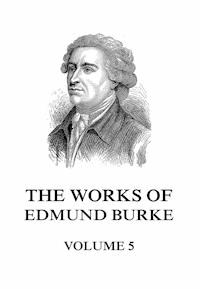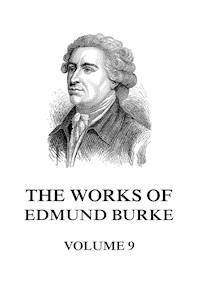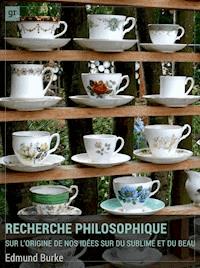
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: gravitons
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Étude sur les notions de beau et de sublime.
Edmund Burke nous emmène dans un méthodique examen, d'une ambition originale, qui s'attache à osciller entre beau et sublime. Sur nos appréciations et notre goût, l'auteur cherche à révéler, par une forme de psychophysiologie avant l'heure, notre rapport aux objets, à la beauté, à la nature, à l'art.
Plongez-vous dans la lecture de l'un des premiers traités d'esthétique.
EXTRAIT
Il n’y a personne, je crois, qui trouve une oie plus belle qu’un cygne, ou qui donne à ce qu’on appelle la poule d’Inde la préférence sur le paon.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Dublin, 12 janvier 1729 – Beaconsfield, 9 juillet 1797
Edmund Burke était un homme politique et philosophe irlandais. Il est l’auteur d’ouvrages de philosophie portant sur l’esthétique et le fondateur de la revue politique
Annual Register.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 296
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Recherche philosophique sur l'origine de nos idées du sublime et du beau
Edmund Burke
Traduction de E. Lagentie de Lavaïsse
2e édition ISBN 979-10-95667-05-6 Copyright © gravitons 2015 Tous droits réservés
La présente édition est basée sur Edmund Burke, Recherche philosophique sur l'origine de nos idées du sublime et du beau. Traduit de l'Anglais sur la septième édition, avec un Précis de la vie de l'auteur, par E. Lagentie de Lavaïsse, Paris : L'Imprimerie de Jussereaud, 1803.
Avertissement du traducteur
Je ne m’étendrai point ici en éloges sur l’ouvrage dont j’offre une traduction au public ; sept éditions qui en ont été faites à Londres parlent assez à sa faveur. Ce livre original, où une logique pressante et juste sert comme de lien à un style brillant et concis, est entre les mains de tous les Anglais qui cultivent les Lettres. Cela seul, indépendamment du plaisir qu’il m’a donné à la lecture, eût suffi pour m’engager à le faire passer dans notre langue. En subissant cette espèce de métamorphose, il a perdu beaucoup sans doute. Souvent j’ai été forcé de sacrifier l’élégance à la fidélité, et je pense que c’est une règle dont il n’est pas permis de s’écarter quand on traduit un ouvrage de raisonnement. Dans ce cas, l’imagination doit être enchaînée ; ses écarts jetteraient dans le chemin de l’erreur : un seul mot peut quelquefois dénaturer la pensée de l’auteur, et l’on est d’autant plus blâmable de ne pas la rendre avec exactitude que cet auteur a plus de célébrité et son ouvrage, plus d’importance. Un traducteur qui, pensant embellir son original, ment à l’auteur et au lecteur ne ressemble pas mal à l’interprète de deux souverains, qui, pour faire preuve d’éloquence, altère le sens de leurs discours dont il ne doit être que l’écho : il trahit à la fois deux puissances. Malgré les difficultés de l’ouvrage, difficultés telles qu’elles arrêtent des Anglais mêmes au premier moment, je crois m’être mis à l’abri d’un semblable reproche, et j’en ai particulièrement l’obligation à M. Littl…, jeune anglais rempli de mérite, qui dans un âge où la frivolité fait voler aux plaisirs, lui sait dérober des heures précieuses au profit du talent, et que j’achèverai de nommer pour le remercier publiquement d’avoir voulu m’expliquer certains passages obscurs sur lesquels je l’ai consulté, si je ne craignais de le charger par là des fautes qui peuvent se trouver dans le reste de ma version.
Mais si je me suis attaché à exprimer fidèlement tous les traits de mon modèle, ce n’est pas que je les aie tous trouvés dans une parfaite harmonie avec l’ensemble. En un petit nombre d’endroits (si toutefois je ne me suis pas trompé), j’ai cru voir que l’auteur tirait de ses principes des conséquences plutôt spécieuses que justes, et je me suis permis d’en faire l’observation dans quelques notes. À propos de ces notes, il n’est pas que l’auteur soit responsable de celles qui m’appartiennent ; je préviens donc qu’il n’y a que trois de M. Burke : ce sont [les notes 10, 26 et 49]. Pour les autres, c’est à moi que le critique doit s’en prendre.
Il me reste à parler de la vie de l’auteur, qu’on me saura gré sans doute d’avoir mise à la tête de son ouvrage, car tout ce qui se rattache aux hommes extraordinaires est un vif aiguillon pour la curiosité. Celui-ci surtout nous intéresse sous bien des rapports, mais particulièrement par le rôle qu’il a joué dans les grands événements de la fin du siècle, rôle si influant qu’il est probable que, sans sa malheureuse éloquence, ils auraient pris une toute autre direction. Je devrais m’excuser peut-être auprès de certaines personnes qui aiment les petites anecdotes de salon, de m’être principalement étendu sur la partie politique. En cela j’ai eu plusieurs raisons : la vie de M. Burke est presque entièrement politique ; d’ailleurs, un homme n’appartient à l’histoire que par les biens ou les maux qu’il a faits à la société. Si cela ne suffisait pas pour me disculper, je dirais que, malgré mes recherches et mes demandes, il ne m’a pas été possible de rassembler un grand nombre de détails sur sa vie privée. Ce qui pourrait paraître un dédommagement, c’est que je garantis la vérité de ceux que je donne : quelques-uns m’ont été fournis par des personnes dignes de foi, et j’ai puisé les autres dans des mémoires authentiques.
Vie d’Edmund Burke
De tous les dons de la nature, de tous les talents que l’art peut faire acquérir, il n’en est aucun d’aussi séduisant que l’éloquence : par elle on émeut, on détermine, on dirige les hommes ; c’est une véritable puissance : c’est aussi le premier objet que se propose une noble ambition. Mais cette puissance ne déploie toute l’énergie dont elle est susceptible que dans la bouche des orateurs des nations ; et tous les gouvernements ne lui dressent pas une tribune aux harangues. L’éloquence paraît n’être née en Angleterre qu’à l’époque de la mémorable contestation qui s’éleva entre Charles I et son parlement. C’est du sein des débats agités par le peuple et le trône, celui-ci pour soutenir ses prérogatives, celui-là pour défendre ses libertés, que jaillirent ses premières étincelles. Mais elle semble avoir réservé toute sa pompe pour ces derniers temps. En effet, l’éloquence anglaise n’offre de ces discours qui rappellent les harangues des Grecs et des Romains, que depuis le moment où la Grande-Bretagne alluma la guerre civile dans les colonies. Ce fut pendant cette guerre qu’Edmund Burke, déployant tous les pouvoirs d’un génie supérieur, épuisant toutes les richesses d’une imagination brillante, se fit remarquer parmi les orateurs qui fixaient l’attention de l’Europe.
L’Irlande s’honore d’avoir produit cet homme célèbre. Edmund Burke naquit à Dublin le premier de janvier 1730. Ses parents, d’abord catholiques, pour se soustraire aux persécutions de l’église anglicane, embrassèrent la religion protestante réformée : son père ne put trouver d’autre expédient pour conserver une charge de notaire, que par ce moyen il exerça paisiblement jusqu’à la fin de ses jours.
Le jeune Burke fut envoyé dans une maison d’éducation du voisinage, dirigée par un Quaker fort estimé et non moins instruit, où il se distingua par une assiduité extraordinaire à tout ce qu’il entreprenait. Son exemple prouve la fausseté de cette maxime, commune et bien dangereuse, que les enfants de génie sont toujours ennemis de l’application.
C’est dans cette école qu’il prit les premières connaissances des langues anciennes, qui lui fournirent des modèles où il puisa le goût élégant et les figures hardies de son éloquence. On peut croire que c’est de la même source qu’il reçut cet amour de l’indépendance qui, se développant à certaines époques, enflamma ses passions et les répandit en flots d’éloquence ; sentiment qui, dans ses plus beaux jours, lui acquit une réputation presque sans rivale et qui, dans le déclin de l’âge, après avoir consumé son esprit et son corps, fut moins éteint que comprimé.
De ce séminaire provincial, Edmund passa à l’Université de Dublin. Il ne paraît pas s’y être distingué, ni par une grande application, ni par des talents supérieurs. Il ne donna aucunes marques d’un génie précoce ; il ne ravit point de palmes dans les luttes académiques et il en sortit sans avoir reçu ses degrés. C’est cependant à cette époque qu’il débuta dans la carrière littéraire par des essais politiques. En 1749, Lucas, apothicaire démagogue, écrivit plusieurs pamphlets hardis contre le gouvernement, et par là s’acquit une grande popularité à Dublin. Burke, dont l’attention ne s’était pas bornée aux catégories d’Aristote, aperçut le danger de ces doctrines qui prêchent le nivellement des choses humaines : il publia plusieurs essais dans le style de Lucas, si parfaitement imité que le public s’y laissa tromper. De ses principes il déduisait des conséquences fort naturelles et non moins justes, mais si dangereuses qu’elles effrayèrent même les plus intrépides partisans de l’apothicaire.
Notre jeune politique s’occupait en même temps de la logique et de la métaphysique ; et l’on rapporte qu’il esquissa alors une réfutation des systèmes de Berkley et de Hume. Désirant aussi jouir d’un état indépendant, et ne voulant plus être un fardeau pour sa famille peu opulente, il se présenta comme candidat pour occuper une chaire vacante à l’université de Glasgow : sa jeunesse le fit rejeter, et non un manque de talents. Là-dessus il se rendit à Londres et fit quelques études au collège de jurisprudence appelé Inner Temple. Mais quand bien même sa vive imagination ne l’aurait pas éloigné du travail pesant et fastidieux que demande la connaissance des lois et des coutumes, le temps lui manquait : on sait qu’à cette époque le res angusta domus ne permettait à l’étudiant de se consacrer uniquement à cet objet. C’étaient des essais, des lettres, des paragraphes, pour les feuilles périodiques du jour, qui lui ravissaient des moments précieux et réparaient l’épuisement de ses finances. Mais ces occupations lui donnèrent une facilité de composition et une variété de style et de langage qui lui furent extrêmement utiles dans les diverses circonstances où il se trouva engagé par la suite.
Cependant les veilles nombreuses nécessitées par ces travaux affaiblirent sa santé et finirent par lui donner une maladie de nerfs. Le docteur Nugent en découvrit sans peine la cause et, pour l’éloigner des livres et des affaires, il l’emmena à sa propre maison. Mais sa guérison devait être l’œuvre d’un médecin plus agréable : la fille du docteur plut au malade, et il fut heureux de s’unir à cette personne aimable et douce, qui pendant de longues années, au milieu des vicissitudes d’une inconstante fortune, adoucit et calma son âme trop ardente.
Avec l’empressement d’un amant qui revient vers sa maîtresse après une longue absence, Burke se rejeta sur ses livres et dans ses travaux. Il composa plusieurs ouvrages qui lui acquirent une certaine réputation, mais pour devenir célèbre il lui fallait l’Essai sur le Sublime et le Beau. Cet ouvrage parut et fixa toutes les attentions. Ce fut une pomme de discorde jetée parmi les critiques, qui formèrent deux partis, comme il arrive toujours à l’apparition d’un ouvrage du génie. Celui de l’envie a cédé enfin à celui de l’approbation. Dès lors M. Burke, placé aux premiers rangs du monde littéraire, fut recherché par tout ce qu’il y avait d’hommes célèbres. À cet ouvrage il en fit succéder un autre qui portait le titre de Registre annuel. L’esprit avec lequel il était rédigé lui donna une grande vogue.
Des occupations plus sérieuses arrachèrent pour quelque temps notre auteur à la littérature. M. Hamilton, son ami, ayant été nommé secrétaire du Lord Lieutenant d’Irlande, l’invita à l’accompagner dans ce pays. La proposition fut acceptée, et Burke revint en Angleterre avec une pension de 300 livres, faible récompense pour les services qu’il avait rendus.
Quelques essais politiques qu’à cette époque il inséra dans les journaux firent beaucoup de bruit et fixèrent l’attention du marquis de Rockingham, qui voulu en voir l’auteur. Dès ce moment il fut décidé que M. Burke serait un homme public et que ses études, sa plume et son éloquence seraient consacrées à la politique. Lord Rockingham, ayant montré plus de complaisance que le comte de Chatham, fut investi de l’autorité et s’assit sur le banc du trésor. Il choisit M. Burke pour son secrétaire privé, emploi aussi peu important pour le pouvoir que pour le profit, mais qui mène naturellement à l’un et à l’autre. Maintenant il était indispensable que le secrétaire d’un premier lord de la trésorerie eût une place au parlement : il y fut élu par le bourg de Wendover, à la sollicitation du lord Verney qui en était le Seigneur.
Pourvu d’une place de confiance sous l’administration de Rockingham, il en soutint naturellement toutes les mesures et contribua beaucoup à faire rapporter le fameux acte du timbre, décrété sous le précédent ministère, et auquel les colonies qu’il frappait avaient résisté avec tant de courage. Mais cette démarche fut peu utile aux colonies et à l’Angleterre, car la direction des affaires fut enlevée au marquis de Rockingham pour être rendue au parti opposé, qui poursuivit avec chaleur ses premiers projets contre l’Amérique.
C’est ici l’époque la plus brillante de la vie de M. Burke. D’un côté nous le voyons s’opposer avec force, mais sans succès, à l’expulsion de M. Wilkes ; de l’autre, embrasser la cause des non-conformistes, qui avaient imploré la protection du parlement contre un gouvernement persécuteur : mais c’est peut-être dans son opposition forte et constante contre la guerre d’Amérique qu’il s’est montré avec le plus de noblesse. Le discours dont il combattit le Bill du port Boston est un des morceaux d’éloquence le plus beau, le plus achevé qui ait été prononcé dans le sénat anglais ; et le 19 avril 1774, dans une motion qu’il fit pour l’abolition du droit sur le thé, il déploya des talents si supérieurs, qu’un membre du parlement1, vieillard rempli de mérite, ne put se défendre de s’écrier : « Bon Dieu ! Quel homme avons-nous là ! Où puise-t-il cette éloquence irrésistible ? » Un autre membre ayant dit que les Américains étaient les enfants des Anglais, et que des enfants révoltés contre leurs pères ne mériteraient que l’exécration, Burke se lève et lui répond ces mots qui électrisèrent toute la chambre :
« Ils sont nos enfants, il est vrai, mais quand nos enfants nous demandent du pain, devons-nous leur donner une pierre ? Quand ces enfants désirent s’assimiler à leurs pères, quand ils se tournent avec respect vers la liberté anglaise, devons-nous leur offrir les parties honteuses de notre constitution ? Devons-nous leur donner notre faiblesse pour leur force, notre opprobre pour leur gloire, et le bourbier de notre esclavage, d’où nous ne pouvons nous tirer, pour leur fière indépendance ? »
C’est pendant ces fameux débats qu’on vit M. Fox abandonner le parti des ministres et joindre son éloquence à celle de Burke, après avoir rompu plus d’une lance avec lui dans la guerre des mots. Cette conformité de sentiments et, pour ainsi dire, d’intérêts fit naître entre eux une étroite intimité. Il eût été à souhaiter, pour leur tranquillité, comme pour celle de l’Europe, qu’elle ne fût jamais altérée.
À la dissolution d’un parlement qui avait attiré tant de maux sur l’Angleterre, M. Burke ne fut plus le représentant du bourg de Wendover ; mais celui de Malton, grâce à la protection du marquis de Rockingham, le remit dans un poste qu’il savait si bien remplir. Enfin il s’offrit une occasion qui lui donna l’espoir de sortir de cette dépendance fâcheuse.
Les marchands de Bristol, enrichis par leur commerce avec l’Amérique, ne pouvaient que perdre à une guerre qui devait l’interrompre. Très satisfaits de l’éloquence de M. Burke, favorable à la paix, ils ne l’étaient pas moins de ses violences sorties contre le ministère. En conséquence, voulant lui donner un témoignage de leur reconnaissance, et l’encourager en même temps à rester ferme dans leurs intérêts, ils lui firent savoir que pour être élu, il n’avait qu’à se présenter. Burke n’eut garde de dédaigner ces offres : il part, arrive, mais trouve trois concurrents qui l’avaient devancé. Il n’en est pas effrayé ; l’opinion était pour lui. Il ne se présente à l’assemblée qu’à la sixième séance, et c’est pour y débiter un discours parfaitement propre à la circonstance. Après avoir montré une grande défiance de ses lumières et relevé l’importance de l’emploi qui allait être confié, il se déclare hardiment contre la guerre avec l’Amérique, et assure que si l’Angleterre jouit de quelque splendeur, elle la doit principalement au commerce, dont il dit avoir fait lui-même une étude particulière2. La harangue devait plaire à une assemblée de marchands ; aussi emporta-t-il tous les suffrages.
Il quitta ses commettants en leur adressant un brillant discours, et courut prendre sa place au parlement avec un surcroît de vigueur, de réputation et de zèle. Le comte de Chatham ayant échoué, malgré sa réputation de sagesse, en présentant à la chambre des pairs un Bill conciliatoire pour faire cesser les troubles des colonies, personne ne douta plus de l’obstination du ministère. Un homme ordinaire en eût été effrayé, Burke ne craignit pas de hasarder une tentative semblable à celle du lord Chatham : le 22 mars 1775, il lut à la chambre ses fameuses treize propositions, qui devaient prévenir une rupture ouverte et réconcilier les colonies avec la mère patrie3.
Les treize propositions furent rejetées par une grande majorité dévouée au ministère. Là-dessus M. Burke, s’apercevant qu’il faisait d’inutiles efforts pour prévenir la fatale catastrophe, cessa de paraître à la chambre. Mais on le revit bientôt à la tête de l’opposition, quand la couronne demanda au parlement la décharge d’une dette sur la liste civile. Dans cette occasion, il parut excité par une indignation peu commune ; il ne craignit pas d’accuser les ministres de contracter eux-mêmes, et pour leur profit, les dettes qu’ils voulaient faire acquitter par la nation ; et l’on prétend que cette accusation n’était pas sans fondement. L’orateur ne se borna pas à débiter d’éloquences invectives. Ami de l’économie, effrayé pour l’état des prodigalités du gouvernement, il présenta un projet de Bill tendant à régler la maison du roi et à supprimer un grand nombre d’offices inutiles : ce plan de réforme fut vivement combattu par les intéressés, et il ne put passer qu’avec des modifications qui le rendirent de nul effet.
Enfin M. Burke entrevit le moment où il pourrait faire le bien par lui-même. L’administration changea ; il fut fait conseiller privé et payeur général des armées. Sa conduite dans ces postes importants est digne du plus grand éloge, et prouve une intégrité incorruptible. Mais cette intégrité sévère et les réformes qu’il opéra lui firent un grand nombre d’ennemis : aussi rentra-t-il bientôt au parlement comme simple membre.
Il y acquit bientôt une nouvelle gloire en écrasant de tous les foudres de son éloquence la scélératesse d’un gouverneur général des Indes orientales ; c’était M. Hastings. Jamais homme en effet ne fut plus coupable : toutes les injustices, toutes les vexations, tous les crimes ; en un mot, tous les abus de pouvoir que peut commettre un homme immoral, avide et cruel, M. Hastings les avait commis. Verrès était un fort honnête homme comparé à ce gouverneur, et Cicéron ne fut pas plus éloquent en combattant le premier, que Burke en terrassant celui-ci. Je vais essayer de traduire les endroits les plus forts de son discours, afin de donner une idée de l’administration tyrannique de la compagnie Anglaise dans les Indes orientales.
« Si M. Hastings, dit-il, avait dirigé la pyramide vers le ciel, conduit la charrue dans la vallée déserte, jeté l’arche orgueilleuse sur le fleuve écumant ; s’il avait réveillé le paresseux à l’industrie, s’il avait mis le brigand dans les fers, vous me verriez plus empressé encore à lui prodiguer une juste louange, que je ne le suis à l’accuser. Mais qu’a-t-il fait ? Il a étouffé la science dans son berceau natal ; il a entassé au fond de ses cachots les princes du pays comme des ballots de mousseline, ne leur donnant pour nourriture que les exhalaisons de ces lieux souterrains, leur refusant même de l’opium, qui eut endormi le sentiment de leurs maux ; il a arrêté la charrue au milieu des sillons ; il a partout marqué son passage par la dévastation et par le sang. »
Après une longue et épouvantable énumération des crimes de M. Hastings et de quelques-uns de ses agents, Burke vient enfin à Debi-Sing, autre tyran subalterne de ces malheureuses contrées.
« Ce monstre (dit-il) levait les subsides des habitants. Il encombrait les prisons de personnes de tout rang, de tout sexe, de tout âge ; il leur faisait acheter leur liberté par des obligations dont lui-même prescrivait la somme : ils ne pouvaient acquitter cette dette injuste, il faisait vendre leurs domaines au dernier cent. Ce n’est pas assez : il vend le lieu même consacré à leur sépulture ; fléau des vivants, il trouble encore la cendre des morts. Mais son avarice est déçue en entrant dans la cabane des indigents ; n’importe, il les enlève, ils serviront à sa cruauté. »
« Toutes les tortures sont accumulées sur cette classe innocente. On leur lie ensemble les doigts avec des cordons ; serrés avec violence, on les laisse dans cet état jusqu’à ce que les chairs se soient jointes, et qu’ils ne fassent plus qu’un corps : alors les bourreaux reviennent, ils enfoncent entre ces doigts réunis des coins de fer et les séparent, ou plutôt les déchirent. D’autres sont attachés deux à deux par les pieds, suspendus dans cet état à une barre de bois qui passe entre leurs jambes et battus sur la plante des pieds jusqu’à ce que les ongles des orteils soient tombés. Ce traitement barbare leur eût semblé doux encore, mais la férocité n’est pas assouvie : on les frappe sur la tête jusqu’à ce que le sang jaillisse de leur bouche, de leur nez et de leurs oreilles ; on les dépouille, on les fouette avec des cannes de bambou, avec des buissons épineux, enfin avec des herbes vénéneuses dont la causticité porte le feu dans chaque plaie. »
« Le monstre qui avait donné de pareils ordres était parvenu à déchirer l’âme aussi bien que le corps. Combien de fois n’a-t-il pas fait lier ensemble le père et le fils, pour les faire déchirer en même temps avec des faisceaux de verges ; pour jouir d’une volupté toute particulière, volupté qui serait inconcevable si cette âme de sang n’avait pas existé, la volupté de savoir que chaque coup portait une double atteinte, que celui qui tombait sur le fils déchirait le cœur du père, et que celui dont gémissait le père était un trait de mort pour le fils ! »
« Pourrais-je vous dire le supplice des femmes ? L’horreur ne me fermera-t-elle pas la bouche ? Arrachées de l’asile de leurs maisons, dont jusqu’alors la religion du pays avait autant de sanctuaires inviolables, elles sont exposées toutes nues aux regards d’un public insolent. Les vierges sont trainées au pied des tribunaux ; elles y implorent la protection, on leur répond par la brutalité : à la face des ministres de la justice, à la face des spectateurs, à la face du soleil, ces vierges désolées, ces vierges tendres et modestes reçoivent le dernier des outrages. »
« Si celles-ci sont déshonorées à la lumière du jour, leurs mères éprouvent le même sort dans les ombres du cachot. Il en est d’autres à qui l’on presse le sein dans un bambou fendu, pour l’arracher ensuite ; il en est d’autres encore… non, je n’irai pas plus loin. Tant d’infamie me défend de poursuivre : dois-je vous décrire le plus honteux des supplices ? Dois-je faire rougir vos fronts ? Dois-je vous montrer la mort introduite dans les sources de la vie ? »
Je m’arrête ainsi que l’orateur : si je voulais rapporter tout ce que j’ai trouvé d’admirable dans ce discours, il me faudrait traduire d’un bout à l’autre. Jamais Burke ne fut plus sublime ; jamais il ne développa avec plus de force toutes ses facultés oratoires. En décrivant les supplices ordonnés par ce ministre de cruauté, en peignant la nature angoissant sous les coups des bourreaux, en fulminant le dernier des forfaits, la mort introduite dans les sources de la vie, il alluma une fureur d’indignation dans le sein de ses auditeurs ; quelques-uns même furent émus au point de perdre le sentiment. Et lui, sa bouche était fermée que tous ses traits parlaient encore : comme le ciel après la tempête se couvre encore d’horribles nuages et menace par un aspect courroucé, ainsi son front retraçait toutes ses pensées et semblait méditer la vengeance.
Sans doute les coupables ne purent échapper au châtiment qu’ils avaient tant mérité ; le parlement, qu’on a vu si révolté de leurs crimes, n’a pu différer d’en faire justice : c’est ce qu’on s’imagine ; on se trompe : ils avaient de l’or, on les acquitta.
Le dernier événement dans lequel nous trouvons Burke vivement engagé, c’est la révolution française. Cette catastrophe qui fit craindre un moment que les peuples, comme le monde, n’eussent aussi leurs chaos, ne pouvait manquer de changer les intérêts des différents partis du parlement anglais. Ce fut le 2 du mois de mars de 1790, que Burke se prononça ouvertement contre nos innovations ; rompant entièrement avec M. Fox, il déclara que son honorable ami et lui étaient pour toujours séparés dans leur politique. Depuis ce moment, la France fut dans tous ces discours l’objet des plus mordantes satyres ; il n’épargna pas davantage les partisans qu’il lui supposait en Angleterre ; et jugeant sans doute trop faibles ses mouvements oratoires, il fit enfin usage d’un trope pratique, à la vérité plus convenable sur un théâtre que dans le sénat d’un grand peuple ; ce fut de tirer un poignard de sa poche, et de l’agiter en l’air, en s’écriant : « Voilà ce que vous devez attendre à une alliance avec la France. » Quelques jours après, M. Sheridan ayant proposé de créer un comité pour rechercher la cause des mouvements séditieux qu’on disait se manifester dans quelques provinces, Burke se lève précipitamment, court vers le banc du trésor et, jetant sur ses associés un regard d’indignation, il s’écrie : « Je quitte le camp, je quitte le camp4 ! » Là-dessus il va se ranger sous les drapeaux du ministère, que depuis il défendit constamment avec autant de courage qu’il en avait montré en les combattant.
Ainsi Burke abandonna ses anciens amis et ses premiers principes. Les opinions sont partagées sur les motifs de ce changement extraordinaire : quelques-uns en font honneur à la crainte qu’il eut de voir les principes révolutionnaires se propager dans son pays et en détruire le gouvernement. D’autres, et c’est la plus grande partie, l’attribuent à une ambition tardive et au désir de procurer un poste honorable à son fils, qu’il envoya à Coblentz. Quoi qu’il en soit, le ministère dut croire cette acquisition bien précieuse, puis qu’il la paya des plus grandes récompenses : Burke reçut de la couronne des pensions dont le capital aurait suffi pour acheter une principauté en Allemagne. Mais lorsque les richesses et les honneurs semblaient, pour ainsi dire, l’accabler, qu’il allait être anobli, que sa famille allait devenir une des grandes colonnes de la constitution d’Angleterre ; lorsqu’enfin on eût pu dire que la fortune s’était mise à ses ordres, cette cruelle déesse, qui se plaît à nous bercer un moment pour nous préparer un affreux réveil, fit disparaître soudain toutes les flatteuses illusions : Burke perdit son fils, et avec ce fils unique s’évanouirent tous les rêves de l’ambition du père, qui ne traîna plus que le poids de la vie, qui n’en goûta plus que l’amertume. Dévoré de regrets, appelant une mort qui ne tarda pas à l’atteindre, il quitta la scène du monde le 8 juillet 1797.
Ainsi mourut Edmund Burke, dans la soixante-huitième année de son âge : il a pris une des premières places parmi les auteurs de son temps ; il occupe le même rang parmi les orateurs et les hommes d’état. Comme littérateur, il réunissait les trois qualités qui créent les chefs-d’œuvre : une âme de feu, un savoir profond, une souplesse de style qui se prêtait à tous les tons. C’était le seul orateur de son temps dont la plume avait autant de volubilité que la langue et qui pouvait également briller à la tribune et dans le cabinet. Sa dissertation sur le sublime et le beau lui obtint des éloges de tous les hommes de goût et, ce qu’il trouva plus précieux sans doute, elle lui procura leur amitié. Ses essais politiques annoncent de vastes connaissances, des réflexions profondes et une sagacité peu commune. Ceux même qui condamnent ses opinions ne peuvent qu’admirer la variété de ses talents, le bonheur de ses allusions et la finesse de sa pénétration. Il n’y a point de genre qu’il n’ait essayé, point de sujet qu’il n’ait traité ; ses premiers et ses derniers jours furent consacrés aux travaux littéraires, et il n’en dédaigna aucun, depuis la colonne du journal qui fournissait un pain nécessaire à sa jeunesse, jusqu’aux écrits plus profonds qui chargèrent sa vieillesse d’une opulence superflue.
Comme orateur, malgré quelques défauts remarquables, il est presque sans rival. Si son geste était parfois trop prononcé ; si sa manière était dure et, pour ainsi dire, opprimante ; si ses épithètes étaient parfois peu ménagées5 ; d’autre part, aucun homme ne sut mieux réveiller les passions endormies, intéresser toutes les affections, harceler le cœur humain. La bassesse et la vénalité pâlissaient en sa présence ; celui qui était sourd aux reproches de sa propre conscience frémissait aux reproches de son éloquence accusatrice ; et la corruption fut quelque temps alarmée de ses courageuses vertus.
Les qualités de son cœur n’étaient pas moins estimables que ses talents : ardent dans ses amitiés, il était prêt à toute heure à sacrifier sa vie pour l’objet de son attachement : avec une hardiesse que quelques personnes prendront pour de la témérité, il se vanta d’entretenir des liaisons avec Franklin, tandis que la loi le déclarait rebelle. Époux et amant tout à la fois, père affectionné et indulgent sans faiblesse, maître bon et libéral, convive agréable, protecteur zélé, il savait s’entourer des images du bonheur. Bienveillant, juste, magnanime, ses principes étaient aussi sévères, ses habitudes aussi vertueuses que son caractère était aimable.
Introduction
Du goût
Il peut sembler, au premier coup d’œil, que nous différons beaucoup les uns des autres dans nos raisonnements, et non moins dans nos plaisirs. Mais malgré cette différence, que je crois plus apparente que réelle, il est probable que les types de la raison et du goût sont les mêmes pour tout le genre humain. Car, s’il n’existait pas quelques principes de jugement ainsi que de sentiments communs à tous les hommes, leur raison ni leurs passions ne présenteraient aucun lien assez fort pour maintenir le commerce ordinaire de la vie. Il paraît, il est vrai, que l’on convient généralement qu’il y a quelque chose de fixe à l’égard de la vérité et de la fausseté.
Nous voyons les hommes, dans leurs disputes, en appeler continuellement à certaines règles et à certains types, dont on convient de part et d’autre, et qu’on suppose établis dans notre commune nature. Mais il n’est pas reconnu aussi généralement que le goût ait des principes fixes ou uniformes. On suppose même communément que cette faculté délicate et aérienne, qui semble trop volatile pour souffrir les chaînes d’une définition, ne peut être proprement soumise à l’épreuve d’aucun creuset, ni réglée sur aucun modèle. La faculté raisonnable a une occasion si continuelle de s’exercer, elle se fortifie tellement par une perpétuelle contention, que certaines maximes de droite raison semblent être tacitement établies parmi les plus ignorants. Les savants ont perfectionné cette science grossière et réduit ces maximes en système.
Si le goût n’a pas été aussi heureusement cultivé, ce n’est pas que le sujet fût stérile, mais que les ouvriers étaient peu nombreux ou négligents ; car, à dire la vérité, les motifs qui nous portent à fixer l’un sont bien moins intéressants que ceux qui nous commandent de confirmer l’autre. D’ailleurs, si les hommes diffèrent d’opinion en matière de goût, cette différence n’est pas suivie de conséquences aussi importantes ; sans quoi je ne doute pas que la logique du goût, si l’expression m’est permise, ne fût aussi méthodiquement rédigée et qu’on ne pût discuter les matières de cette nature avec autant de certitude que celles qui semblent appartenir plus immédiatement à la pure raison. Il est très nécessaire, en entrant dans une recherche telle que celle-ci, que ce point soit éclairci autant qu’il est susceptible de l’être, car, si le goût n’a point de principes fixes, si l’imagination n’est pas affectée suivant des lois invariables et certaines, notre travail ne peut offrir que des résultats à peu près insignifiants. Et ce serait une entreprise inutile, sinon absurde, d’établir des règles par caprice et de s’ériger en législateur d’illusions et de chimères.
Le mot goût, comme tous les mots figurés, n’est pas extrêmement exact : il s’en faut de beaucoup que ce que nous entendons par là soit une idée simple et déterminée dans l’esprit de la plupart des hommes ; cette idée est donc sujette à l’incertitude et à la confusion. Je n’ai pas une opinion bien favorable d’une définition, remède célèbre qu’on oppose à ce désordre. Car, en définissant, nous courons le risque de circonscrire la nature dans les bornes de nos propres notions, que souvent nous prenons par hasard, embrassons sur parole ou formons d’après une considération limitée et partielle de l’objet qui nous occupe, au lieu d’étendre nos idées pour comprendre tout ce que la nature embrasse, suivant sa manière de combiner. Dans notre recherche, nous avons pour limites les lois sévères auxquelles nous nous sommes soumis au point de départ.
Circa vilem patulumque morabimur orbem, Undè pudor proferre pedem vetat aut operis lex.
Une définition peut être très exacte et cependant ne faire connaître que très imparfaitement la nature de la chose définie ; mais quelle que soit la vertu d’une définition, dans l’ordre des choses, elle semble suivre plutôt que précéder notre recherche dont elle doit être considérée comme le résultat. Il faut convenir que les méthodes de disquisition et d’enseignement peuvent différer quelquefois, et, sans doute, pour bonnes raisons. Mais, quant à moi, je suis convaincu que la méthode d’enseignement qui approche le plus de la méthode de disquisition est incomparablement la meilleure, puisqu’alors, ne se bornant pas à faire connaître quelques vérités stériles et sans vie, elle conduit à la source d’où elles découlent. Elle tend à mettre le lecteur dans la voie de l’invention et à le diriger dans ces sentiers où l’auteur a fait ses propres découvertes, s’il est assez heureux pour en avoir fait quelqu’une de précieuse.
Mais, pour ôter tout prétexte à la chicane, par le mot goût j’entends seulement cette faculté ou ces facultés de l’esprit qui sont affectées par les ouvrages de l’imagination et par les beaux-arts, ou qui en portent un jugement. C’est là, je pense, l’idée la plus générale de ce mot, et celle qui a le moins de connexion avec quelque théorie particulière que ce soit. Mon objet, dans cette recherche, est de savoir s’il y a des principes sur lesquels l’imagination soit affectée, si communs à tous les hommes, si bien fondés et si certains, qu’ils puissent fournir les moyens de raisonner sur eux d’une manière satisfaisante. Et, quoique certain d’être accusé de paradoxe par ceux qui, d’après un coup d’œil superficiel, imaginent que les goûts varient tellement en genre et en degré, que rien ne peut être plus indéterminé, je pense qu’il existe de tels principes de goût.