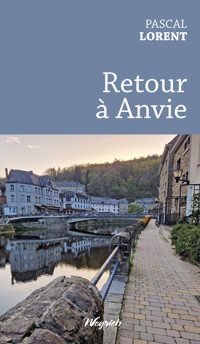
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Weyrich
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Pourquoi a-t-on défoncé le crâne du journaliste Philippe Bondieu ? Sur quoi enquêtait-il ? En ce mois d’août caniculaire, l’enquête est confiée à un policier détaché de la capitale, Hugues Ballinger. Solitaire, rigoureux et austère, cet homme dévasté va devoir affronter son passé qui l’engloutit peu à peu. Et pour cela, découvrir les sombres secrets qui étouffent Anvie, une innocente bourgade provinciale.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Licencié en Journalisme et Communication de l’ULB, Pascal Lorent est journaliste politique au Soir. Retour à Anvie est son premier roman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vie et mort de saint Tercorère le Maudit
À Hugo, Camille, Léo et Ingrid. À ma maman.
PROLOGUE
Sa main caressa la forme oblongue puis la dégagea de son lit avec précaution. Elle dissimulait son identité sous un voile grisâtre. Sa paume balaya cette fine pellicule de temps. Philippe Bondieu prenait plaisir à redécouvrir les crus qui sommeillaient dans son cellier. Tubulaires ou ventrues, les bouteilles s’alignaient sur les étagères, la bague et le col pointés dans sa direction. Légèrement inclinées, elles suggéraient les canons d’un navire parés pour une salve. Plus on se rapprochait du sol, plus les patronymes s’ennoblissaient. Lequel choisir ? Pas question de marier des raviolis frais aux truffes avec le premier cépage venu.
La sonnette de la porte d’entrée retentit. Philippe Bondieu consulta sa montre. Les aiguilles phosphorescentes indiquaient 17 heures 30. Déjà ! Il ne l’attendait que vers 19 heures. Il jeta son dévolu sur un Bolgheri puis remonta de la cave. Il était serein. Ce dîner ne serait pas simple. Il y aurait des cris. Mais il se devait de dévoiler la vérité. Finis les faux-semblants. C’était la seule solution. Il se dirigea vers la porte, qu’il ouvrit lentement.
* **
Le battant avait claqué. Philippe Bondieu sentait le sang lui marteler les tempes. Il tentait de retrouver son calme. Et de rassembler ses idées, comme on cherche ses vêtements au petit matin, après s’être déshabillé à la hâte la veille. Cette conversation avait été plus houleuse que prévu.
Il rouvrit la porte, sortant la tête du pêne dormant à l’aide de sa clé pour que celle-ci ne se referme pas derrière lui. Son regard suivait le pas nerveux de la silhouette se dissipant dans l’obscurité. Sous un ciel tacheté d’éphélides, la nuit était claire. Les insectes susurraient leur cantique, tapis dans les ombres du décor. La villa et son périmètre ordonné prélevaient quelques ares au désordre de la végétation. Au-delà des clôtures, les herbes folles s’élevaient, hirsutes. Une longue allée de gravier prolongeait le chemin carrossable menant à la propriété, fendant un gazon soigneusement entretenu. Les hortensias bordant la façade ployaient, implorant l’averse. En contrebas, la route départementale filait, cahin-caha, vers le Loiret. Là, au bord de cet affluent de la Loire, les quelques commerces d’Anvie s’étaient regroupés. Le reste de la localité se concentrait dans un hameau lové entre le château comtal et l’église. La maison de Philippe Bondieu le surplombait depuis l’autre versant de la départementale, esseulée sur le lieu-dit de la Larronnerie.
Philippe Bondieu entendit le bruit d’un moteur. Deux traits de lumière percèrent le crêpe sombre de la nuit. La voiture glissait vers la départementale. Après avoir jeté un dernier regard à l’horizon, il se retourna et rentra, laissant la porte pivoter lentement sur ses gonds. Dans le hall, il se pencha pour ramasser le cadre tombé au sol. Il contempla la photo, une vue prise depuis les remparts de Saint-Malo. Il posait, le pied sur l’affût d’un canon, le regard fixant l’horizon qui bornait la Manche. Il se redressa, tournant toujours le dos à la porte d’entrée. Il cherchait ses clés pour verrouiller la maison. Il les sentit au fond de la poche de son pantalon. Il entendit soudain le bruit de la poignée heurtant le mur intérieur. Philippe Bondieu n’eut pas le temps de se retourner. Du coin de l’œil, il n’aperçut qu’une masse sombre. Un premier coup sur le sommet du crâne le fit vaciller. Sonné puis décontenancé par la douleur, il ne comprit pas ce qui lui arrivait. Chancelant, il encaissa un second coup, toujours au même endroit. Son corps bascula et s’écrasa sur le sol. Et tandis que les feux de son âme s’éteignaient un à un, la maison, livrée à une folie destructrice, résonnait du saccage auquel se livrait l’agresseur.
Partie I
SUPPLICE
Lundi 11 août
Chapitre 1
La pluie griffait la vitre. Le tonnerre gronda puis l’obscurité se lézarda. Hugues Ballinger se tenait face à la fenêtre. Son regard flottait dans le néant. Son esprit remontait le fleuve du temps, où les souvenirs affleurent parfois de leurs arêtes tranchantes.
Ce lundi 11 août était pourtant promis à la routine. La canicule durait depuis plus de quinze jours. Le soleil transformait les rues en couloirs ombragés. Les immeubles découpaient l’azur en une bande étroite. Leurs sommets couronnés de clarté contrastaient avec leurs étages inférieurs, métaphore de l’ordre social. À cette heure matinale, celle où les êtres se précipitent vers leur asservissement tarifé, la chaleur déjà pesait. Et le mercure allait encore grimper. Les orages étaient annoncés pour la fin de l’après-midi dans la capitale, en soirée dans le centre du pays.
Soudain, la bouche du métro déversa les passagers de la dernière rame. Parmi eux, Hugues Ballinger. Sa chevelure châtain, à peine filée d’argent, trompait sur son âge. Il avait en réalité largement franchi le cap de la quarantaine. De taille moyenne, svelte, il affichait le profil d’un sportif régulier. Ses épaules, pourtant solides, semblaient se courber à l’extrémité de ses clavicules drapées dans son complet clair. Comme s’il trimballait à chaque bras ces valises que Brel prêtait aux timides.
Au milieu de cette cohorte, somme de destins indistincts, il cheminait en pénitent, les yeux rivés au sol. Son regard brun, fixe sans rien fixer, paraissait débranché. Ses foulées le menaient au siège de la police judiciaire, au cœur de Paris. Hugues Ballinger était flic. Dans son nom résonnait l’exotisme. Il le devait à un arrière-grand-père venu d’Australie combattre dans les tranchées de 1914 et qui n’était jamais reparti. La grippe espagnole lui avait tout au plus laissé le temps de concevoir une mâle progéniture avec une jeune fille connue lors d’une saillie de campagne et qu’il avait aimée comme on aimait en cette France rurale du début duXXe siècle. Avec rudesse et distance. Cette union avec un étranger et ce veuvage rapide avaient valu à cette dernière une répudiation feutrée, tissée de distance, de messes basses et de regards en coin. On ne snobait pas impunément les hommes d’ici ! Elle avait emporté dans son exil vers la Belgique son fils unique, lequel allait transmettre ce patronyme à consonance anglophone à sa descendance belge. À Charleroi, entre les charbonnages, la sidérurgie et la verrerie, elle allait travailler dans une épicerie, dont elle hériterait à la mort de son patron et amant. Adulte, son enfant unique avait, lui, réussi dans le négoce. Tout était alors possible dans cette Wallonie florissante, terre d’industrie et de luttes ouvrières. Parcourant la planète, celui-ci avait fait fructifier le maigre viatique hérité de sa mère. Il avait rêvé que son fils, engendré à la quarantaine avancée, lui succéderait. Mais s’il aimait l’argent, ce dernier était plus apte à le dépenser qu’à le gagner. Complexe de l’héritier. Cette généalogie exotique était à peu près tout ce qu’il avait laissé à son rejeton, préférant une existence d’aventurier au confort capitonné du foyer familial. Hugues Ballinger avait ainsi grandi auprès de sa mère, dans ce Pays de Charleroi où les usines fermaient et les terrils verdissaient. L’histoire familiale bégayait. Éprise de littérature française, celle-ci avait très tôt circoncis le prénom de sa progéniture en un diminutif aussi prestigieux qu’affectif : Hugo. « Le plus grand de tous les écrivains », soulignait-elle en le couvant du regard. Si bien que seuls les actes administratifs et autres documents officiels témoignaient encore de son prénom de baptême. Ce choix lui convenait bien. Il se sentait plus à l’aise avec les affinités francophiles de sa mère qu’avec le patronyme légué par son poilu d’aïeul. Et voici quelques années, il avait choisi d’effectuer le trajet inverse, retrouvant le sol de la République grâce à la double nationalité que sa famille avait conservée comme un sauve-conduit. Celui-là même qui lui avait permis d’intégrer la police judiciaire hexagonale, après un début de carrière au sein des effectifs belges.
Le policier avançait dans le sillage d’autres quidams. Sans plus d’enthousiasme que la plupart de ses congénères, il se rendait vers son lieu de travail et une occupation qui lui était devenue indispensable. Une assuétude assez forte pour monopoliser son esprit durant une journée entière. Une fuite en avant qui durait depuis près de trois ans. Pour lui, le lundi arrivait comme un répit. La semaine précédente, il avait achevé une enquête sensible : lors d’un cambriolage, un bijoutier avait ouvert le feu sur les malfrats, touchant l’un d’eux. Le braqueur était décédé lors de son transfert à l’hôpital. L’affaire avait donné lieu à une passe d’armes, relayée par les médias, entre les partisans de la légitime défense et ceux pour qui aucune richesse ne méritait une vie. Le débat public se doublait d’une dimension sociale : le jeune cambrioleur, seize ans à peine, s’appelait Saïd. Un gamin issu de la deuxième génération de l’immigration, produit d’une cité sociale aux allures de ghetto. Les politiques s’étaient rués sur ce fait divers avec un opportunisme charognard et certains de leurs commentaires flirtaient avec le racisme, avançant l’échec de « l’intégration », tandis que d’autres soulignaient les difficultés d’un foyer et d’un quartier sans horizon. Et si Ballinger avait hérité de ce dossier, c’était en raison d’un hermétisme qui, pour l’occasion, tenait lieu de qualité. Ce matin, il lui restait à relire le rapport final qu’il devait remettre à son supérieur.
Le dossier bouclé, il lui fallait trouver une nouvelle occupation. Au plus vite ! Et remplir de gestes anodins le vide abyssal de son existence. Cette nécessité de replonger, à chaque fois, dans une nouvelle enquête expliquait pourquoi, à la quarantaine bien entamée, il restait affecté à des tâches d’investigation et non de coordination. Les opportunités de promotion étaient venues, déclinées les unes après les autres. Il ne pouvait rester confiné dans un bureau, au risque d’étouffer. Il préférait enfoncer la tête dans le guidon et pédaler de toutes ses forces, de peur que le passé ne l’avale comme un peloton lancé vers l’échappée. Lundi l’avait donc remis en selle. Du moins le pensait-il, jusqu’à cet appel téléphonique.
Vers 12 heures 30, fidèle à ses habitudes, il acheta son sandwich dans le snack voisin de la DRPJ1. Il l’avala en déambulant dans la ville assommée de soleil. Il contemplait les rues pour ne pas voir les décombres de son existence. Il venait de regagner son poste quand son téléphone sonna.
* **
Francis Balint inspira profondément puis relâcha lentement sa respiration en contemplant la pointe griffée de ses chaussures posées sur le bureau. Il lui faudrait bientôt s’en acheter une nouvelle paire. Le son intermittent qui s’échappait du combiné cadençait la chute des secondes. Cette année, la DIPJ2 d’Orléans, dont il avait la charge, avait été le théâtre de quelques sordides faits divers. Une épouse avait empoisonné son mari puis l’avait découpé au couteau électrique, tel un rôti du dimanche, avant de le ranger au congélateur. Un adolescent avait abattu de sang-froid ses géniteurs parce que ceux-ci l’avaient privé de sortie, ses résultats scolaires n’étant pas à la hauteur de leurs attentes. Des affaires qui avaient mobilisé les policiers. Et accru prestations et heures supplémentaires. Si bien qu’en ce mois d’août, la DIPJ était confrontée à un gros problème d’effectifs. En temps normal, il manquait d’hommes. À présent, cette carence était devenue critique. Et à l’heure où ses effectifs étaient à marée basse, un nouveau meurtre lui tombait sur les bras. Celui-là n’était pas des plus ordinaires. Qui plus est, il avait été commis dans la municipalité dirigée par Hector Grandjoie, un intrigant aux relations aussi discrètes que tentaculaires. Il faudrait se montrer habile, discret, diplomate, rusé même. Et personne parmi les hommes encore disponibles n’affichait l’expérience et les qualités requises. Balint s’était résigné à solliciter des renforts. Soudain, la tonalité cessa, interrompue par le déclic classique de la communication qui s’enclenche. « Allô ? »
* **
Ballinger décrocha le téléphone. Lanoux. La voix grave du commissaire divisionnaire éveilla chez lui une crainte : son supérieur allait lui imposer de prendre des vacances, afin de réduire l’important stock de jours de congé accumulé durant l’année. Celui-ci avait feint jusqu’ici d’ignorer le problème, laissant Ballinger enchaîner les semaines de travail, les heures supplémentaires ainsi que quelques week-ends de garde.
— Inspecteur, j’espère que je ne vous dérange pas. Pouvez-vous me rejoindre dans mon bureau, s’il vous plaît ?
— Oui, Monsieur. Je monte tout de suite.
Dix ans les séparaient, mais ils étaient tous deux de la vieille école. Celle du vouvoiement et des formules de politesse. Et d’un langage qui ne concédait rien aux licences de l’oral. C’était mieux. Ballinger avait pris soin d’éviter toute familiarité avec ses collègues, pourtant enclins à se taper sur l’épaule et à prendre un verre ensemble après le boulot. Il pouvait paraître antipathique. Ce n’était que l’expression d’une solitude choisie par défense. On questionne rarement les gens taiseux et distants.
Devant la porte, il frappa. L’injonction sourde de son supérieur lui parvint à travers le battant. Lanoux trônait dans son fauteuil en cuir, le visage nimbé de volutes qui naissaient dans les traits charnus de sa bouche, où s’enfonçait la lentille de sa pipe d’écume. Derrière ce halo bleuté au parfum de caramel, deux prunelles le scrutaient, désignant en silence le siège qui lui faisait face.
Le cœur de Ballinger se serra. Il retenait son souffle.
— Inspecteur Ballinger, je tenais encore à vous féliciter. Vous avez brillamment mené l’enquête sur l’affaire Saïd. De l’excellent travail, comme à l’accoutumée.
Il marqua une pause. La fumée dansait dans un liseré de clarté. Chaque seconde martelait l’angoisse de Ballinger comme la peau d’un tambour.
— Vous méritez une récompense, poursuivit-il avec une pointe d’ironie. Je vous propose de sortir un peu de nos murs. De vous aérer. Un voyage, en quelque sorte. Qu’en dites-vous ?
— S’il ne tient qu’à moi, Monsieur, je préfère être affecté à une nouvelle enquête.
— Je sais que vous refusez pratiquement tout congé depuis plus de deux ans. La raison n’appartient qu’à vous. Je la devine et la comprends. Mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Ce que je vous propose, c’est une enquête en province, du côté d’Orléans.
La curiosité de Ballinger s’accentua. Et par son silence, il invitait son supérieur à poursuivre. Ce que fit Lanoux.
— La DIPJ d’Orléans est en déficit d’hommes depuis plusieurs années. Et les congés d’été n’ont rien arrangé. Or, un crime vient d’être commis sur son territoire. Je voudrais que vous vous chargiez de l’enquête.
— Vous m’envoyez en province juste pour un problème d’effectif ?
— Pas seulement. L’affaire est sensible et nécessite tact et discrétion. Or, vous n’êtes pas le genre à vous épancher. Et vos états de service plaident en votre faveur.
— Sensible ? répéta Ballinger en guise d’interrogation.
La victime était un journaliste, expliqua Lanoux. Le genre fouineur. On l’avait retrouvé chez lui le crâne défoncé. Or, en haut lieu, on souhaitait que l’affaire ne fasse pas trop de bruit. Le risque était sérieux, aux yeux du commissaire.
— L’été, les médias sont en manque de sujets et les journalistes sautent sur ce qui sort de l’ordinaire comme la vérole sur le bas clergé. Alors, pensez-vous, un des leurs assassiné ! Je vois déjà les titres. Ils n’hésiteront pas à faire le lien avec le travail d’investigation de la victime.
— Et ce n’est pas le cas ?
Lanoux marqua une pause avant de répondre, autant pour ménager son effet que pour exhaler son souffle de dragon bedonnant.
— Je l’ignore. Ce peut être le crime d’un rôdeur. Ou pas. C’est ce qu’il vous faudra découvrir. Du moins si vous acceptez…
— J’accepte, Monsieur, coupa Ballinger.
— Parfait ! Vous partez cet après-midi pour Sanlys. Prenez contact avec le brigadier Hoste, de la gendarmerie locale. Il vous fournira le dossier reprenant les premiers éléments de l’enquête et vous conduira à Anvie, sur la scène de crime. Je vous laisse régler les formalités d’hébergement. Et je vous le répète : discrétion ! Je compte sur vous.
Le commissaire poursuivait, pestant contre les coupes budgétaires qui avaient mené certaines directions de la police judiciaire en situation de sous-effectif. « L’austérité, nos élus n’ont plus que ce mot à la bouche. Tant qu’elle ne les affecte pas personnellement. » Mais Ballinger n’écoutait plus. « Anvie »… À l’évocation de ce nom, le sol s’était dérobé sous ses pieds.
Était-ce possible ?
Il se concentra. Il devait à tout prix masquer son émoi.
— Inspecteur, vous allez bien ? Vous semblez pâle.
— Oui, oui, ça va. Juste une idée qui me passait par la tête.
— Parfait, alors. Préparez-vous à partir pour Sanlys sans attendre.
Sans même entendre les salutations de son supérieur, le policier tourna les talons, groggy, comme on cherche à renouer avec le fil d’un songe après un réveil impromptu. Il referma la porte du bureau. Il avança de quelques pas puis chancela, s’appuyant de la paume sur le mur crayeux du couloir pour conserver l’équilibre. Il desserra son nœud de cravate, déboutonna le col de sa chemise et s’épongea d’un mouchoir le front et la nuque. Cette fois, ce n’était pas la chaleur qui l’accablait.
* **
Quand Ballinger eut quitté la pièce, Lanoux sortit un smartphone de la poche intérieure de son veston. Il parcourut lentement le répertoire puis appuya deux fois sur l’écran. Un appel s’enclencha.
Place Beauvau, à Paris, un autre téléphone portable vibra.
— Lanoux ?
— Bonjour. Dites au ministre que j’ai envoyé un inspecteur dans le Loiret, à Sanlys, chez M. Grandjoie.
— Qui avez-vous dépêché sur place ?
— L’inspecteur Ballinger.
— Sera-t-il de taille ? Grandjoie, c’est à la fois un rapace et une anguille.
— Ne vous inquiétez pas pour ça. Un squale ressent davantage d’émotions.
— Est-il corruptible ?
— La seule chose qui l’intéresse, c’est qu’on lui foute la paix. Cet homme-là n’attend plus rien de la vie.
— Pensez-vous qu’il peut le coincer ?
— S’il y a quelque chose à trouver, Ballinger le trouvera.
— L’autre est dangereux. Il est prêt à tout pour protéger son territoire.
— Nous verrons bien, sourit Lanoux. Nous verrons bien qui est le plus redoutable.
— Tenez-moi informé. Toujours sur ce numéro.
— À bientôt, Monsieur le Chef de cabinet.
* **
Les têtes assoupies dodelinaient avec le dandinement du train. Le compartiment était ancien, les banquettes recouvertes d’un vieux velours crasseux, élimé par endroit. La moiteur qui y régnait libérait les odeurs enfouies dans le tissu côtelé. Mal isolé, le wagon hoquetait sous les chocs réguliers des roues métalliques sur les voies. Le thermomètre dépassait les trente degrés à l’extérieur. Dans l’habitacle, c’était l’étuve ! Et seule la partie supérieure des vitres coulissait pour offrir un famélique filet d’air. Un souffle insuffisant pour rafraîchir les passagers du compartiment qui, à tour de rôle, s’épongeaient le front ou agitaient leur journal en éventail.
La chemise collée à l’échine, Ballinger laissait son esprit vagabonder. Jadis, son chemin l’avait mené à Anvie. C’était une autre vie, songea-t-il. Son quotidien, alors, n’était que bonheur. Mais le destin sourit parfois pour mieux dégager ses crocs. Et près de trois ans plus tard, cette morsure saignait encore. Le passage du contrôleur le ramena au présent. Les premiers éléments de l’enquête lui avaient été transmis via e-mail par Balint, patron de la DIPJ d’Orléans. Ballinger avait imprimé ce rapport préliminaire. Il venait de le parcourir. Comment allait-il aborder cette enquête ? Il lui fallait en apprendre plus sur ce journaliste. Philippe Bondieu avait trente-deux ans. Célibataire, il vivait son métier comme un sacerdoce. Ni enfant ni compagne légitime. Le facteur l’avait retrouvé ce lundi matin, chez lui, gisant dans le hall de sa villa. Il portait des blessures à la tête causées par un objet contondant. Les coups avaient probablement provoqué une hémorragie cérébrale qui lui avait été fatale dans les minutes suivant l’agression. L’autopsie, dont les résultats étaient attendus dans la journée de mardi, dirait si la victime portait des traces de lutte ou des contusions. Ce n’était pas tout ! Plusieurs pièces de l’habitation, dont le séjour, étaient sens dessus dessous. Tout ou presque y avait été retourné et le contenu des meubles avait été répandu sur le sol. À la recherche d’un objet précis ? Quel que soit le mobile de l’agression, il avait conduit à la mort d’un homme. Le crime et la fouille trahissaient la même sauvagerie.
Avant son départ, Ballinger avait également appelé la gendarmerie de Sanlys. Il avait demandé qu’on lui procure les éditions du « mook » dans lequel écrivait Bondieu. Il voulait lire ce que le journaliste avait publié au cours des six derniers mois. Il souhaitait « recréer » la psychologie de sa victime, l’écriture révélant l’individu aussi sûrement qu’une empreinte digitale. Une bonne manière de s’occuper dans ce lieu où le passé pouvait surgir en fauve à tout moment. À Anvie ! Ses mains étaient moites. Son front aussi. Son regard s’accrochait au paysage comme un naufragé. La végétation défilait sur l’écran de la vitre du train. Par endroit, la chaleur délavait le feuillage des arbres de vert en jaune.
Le convoi décéléra soudain. Les habitations le long de la voie, d’abord éparses, se groupaient en blocs de plus en plus compacts. Des immeubles mitoyens prolongés par de modestes jardins contigus s’exposaient aux regards impudiques des voyageurs essorés. Puis le train entra en gare de Sanlys, fendant de sa masse la chaleur qui, au loin, déformait le décor. Il était de retour à Anvie. Au risque d’y perdre la raison.
Chapitre 2
Franck Hoste n’était pas né de la dernière pluie. Le gris de ses tempes l’attestait autant que les pattes d’oie qui ravinaient un regard assorti à sa chemise de brigadier. Il était devenu quinquagénaire voici plus d’un an. Il avait franchi ce cap comme on part au combat : avec la ferme intention de lutter contre le déclin provoqué par les ans. Il soignait sa condition physique, au prix d’un jogging quotidien et évitait les excès de table et d’alcool. L’expérience lui avait enseigné que les kilos au ventre et les grammes dans le sang se payaient tôt ou tard.
Il n’était pas non plus de ceux qui se perdent en conjectures, en quête d’un détail anodin ou d’une improbable supposition qui remet en cause une enquête. Ses raisonnements reposaient sur une connaissance de la nature humaine acquise durant trois décennies au sein de la gendarmerie. La société se composait de strates sociales. Plus on descendait vers la base et plus il était nécessaire de rappeler la nécessité de la discipline. C’était son rôle, ici, à Sanlys.
Le brigadier n’était pas homme à s’inquiéter inutilement. Mais quelque chose le démangeait, comme le baiser de l’ortie sur la peau du mollet. Il n’appréciait pas qu’on marche sur ses plates-bandes. Et encore moins sur ses pieds. Pourquoi diable avait-on cru utile de faire appel à ce policier parisien pour enquêter sur la mort du Philippe Bondieu ? Sa brigade aurait pu s’en charger. Les statistiques plaidaient en sa faveur. Il exerçait à Sanlys depuis huit ans. Durant cette période, ses hommes n’avaient eu à intervenir que pour quelques broutilles : querelles entre fermiers, fêtes de la moisson trop arrosées, accidents de roulage sur la départementale. Ah oui, plus récemment, pour un cambriolage au siège de la régie municipale. À part cela, la localité coulait des jours paisibles. L’ordre y régnait. Jusqu’à ce lundi 11 août.
Pas superstitieux pour un sou, il n’accordait guère de crédit aux présages. Et si la mort de Philippe Bondieu succédait de quelques semaines à ce vol avec effraction dans les locaux municipaux, c’était là pure coïncidence. Mais le hasard lui amenait dans les pattes un policier de la capitale. Un curieux qui risquait de mettre son nez dans les affaires de la communauté. À retourner le fumier, on ramène toujours sur le dessus du tas la partie malodorante et putréfiée.
L’arrivée de ce chien dans le jeu de quilles local le contrariait. Il allait devoir le tenir à l’œil, à la demande du maire mais également dans son propre intérêt. La donne se compliquait. Il aurait été préférable qu’il puisse diriger l’enquête. Celle-ci représentait une telle opportunité pour lui ! Mais il avait reçu l’ordre de fournir aide et assistance à cet inspecteur. Il lui faudrait gagner sa confiance. Afin de l’orienter au mieux dans ses investigations. Lui indiquer quel placard ouvrir, pour mieux le détourner des autres.
Il n’était pas du genre à se fier aux apparences. Mais il aimait que la sienne, celle offerte aux autres, s’avère irréprochable. Alors, l’uniforme impeccable malgré la chaleur accablante qui emperlait son front, il patientait dans la gare, soliloquant in petto afin de nommer toute sa contrariété. Sa silhouette athlétique restait tendue, statique au milieu de la salle des pas perdus, dans la senteur citronnée des détergents bon marché. Le soleil y pénétrait par le sommet de la façade, où l’horloge de verre fixait l’horizon, dans le roucoulement de quelques pigeons.
Le gendarme appréciait également la ponctualité. Quand il vit Hugues Ballinger franchir la porte à double battant qui séparait les quais de la salle, il constata à sa montre que celui-ci arrivait à l’heure annoncée le matin même au téléphone. L’homme était semblable à la photo du fichier national. Il portait un complet gris ainsi qu’une chemise blanche barrée d’une cravate bleue dont le nœud était serré. Ce dernier détail lui plut. Le maintien de l’uniforme, fût-il civil, en toutes circonstances était un signe de rigueur. Malgré une tenue tirée à quatre épingles, le policier manquait de prestance, nota le gendarme. La silhouette était légèrement voûtée, chose étrange pour un homme qui paraissait en bonne forme physique. Hoste le vit s’approcher, tirant son trolley derrière lui.
— Bonjour, inspecteur. Avez-vous fait bon voyage ?
Le nouveau venu répondit d’un signe de la tête, avant de questionner : « Vous êtes-vous procuré les magazines ? » Visiblement, il ne voulait pas perdre de temps.
— Ils sont dans mon véhicule, répondit Hoste, un peu décontenancé par cette entrée en matière épurée de toute civilité. En route ?
Hoste ouvrit la marche. L’air était chargé d’humidité et le moindre effort essoufflait. Le policier déposa son bagage dans le coffre et rejoignit le gendarme dans la Renault de service stationnée devant la gare. L’habitacle était un four. Le pare-brise encadrait un ciel qui virait à l’anthracite. Sept kilomètres séparaient Sanlys du village d’Anvie. La circulation était fluide sur la départementale. À la sortie de la ville, la Clio croisa trois mobilhomes en enfilade, remontant de la vallée. Hoste en profita pour vanter l’essor économique de la région. Après le déclin des industries, la municipalité s’était tournée vers l’activité touristique : les sports nautiques et l’exploitation du château et de ses jardins à la française. « Cette reconversion a été menée par M. Grandjoie, notre maire, signala le gendarme, le regard rivé sur la route. Si, aujourd’hui, l’économie locale se porte bien, c’est à sa politique qu’elle le doit. » Taiseux, son passager contemplait le paysage.
Sanlys, comme toutes les cités de province, comptait son supermarché, sa pharmacie ainsi que quelques autres enseignes dispensant le nécessaire à la communauté d’à peine dix mille âmes. Sur le trajet, un large panneau publicitaire annonçait un centre commercial à trois kilomètres.
— Monsieur Grandjoie, notre maire, m’a chargé de vous dire qu’il vous offrait son entière collaboration… Et son hospitalité. Une chambre vous attend chez lui, afin d’éviter des frais inutiles. Vous y trouverez toute la logistique nécessaire à votre enquête. Et si vous le souhaitez…
— Je logerai à l’hôtel, coupa le policier sans regarder son interlocuteur.
Grandjoie n’allait pas apprécier, songea le brigadier.
— Bien. À quel hôtel descendrez-vous ?
— À l’Auberge des Deux Pins…
— Aux Deux Pins ! L’endroit est plutôt vétuste et n’attire plus grand monde. Il y a d’autres hôtels plus confortables dans le centre de Sanlys. Vous savez, grâce au château et à ses jardins à la française, le tourisme s’est fort développé ici, ces dernières années. Nous avons un port de plaisance. Tout cela grâce à l’arrivée de M. Grandjoie à la tête de la municipalité. Il a géré les affaires publiques comme une entreprise et…
— Les Deux Pins, ce sera parfait, interrompit son passager.
La départementale perçait l’agglomération en un ruban ondoyant sur lequel glissait le véhicule. La croûte calcinée du bitume expirait un souffle chaud. La température dans l’habitacle retombait, sous l’effet de l’air conditionné. Dehors, le paysage verdissait : des pâtures puis, au loin, la forêt. Un panneau annonça Anvie. Hoste crut apercevoir une grimace sur le visage du policier. Puis revint le masque inexpressif qu’il arborait depuis son arrivée.
— Je dois reconnaître que vous avez du flair, lança-t-il dans l’espoir de détendre l’atmosphère. Les Deux Pins est l’hôtel le plus proche du lieu du crime. D’ailleurs, si vous le souhaitez, je peux vous y emmener…
Son passager acquiesça. Au carrefour, un panneau presque effacé annonça la proximité de l’auberge, à droite. Hoste bifurqua dans l’autre direction. La voiture attaqua un chemin escarpé à flanc de coteau. Le conducteur rétrograda pour relancer le moteur. La chaussée était parsemée de nids-de-poule et il tentait de se mouvoir sans casse sur ce bitume en guenilles. Après cinq cents mètres d’ascension, il se rangea sur le bord de la route. Le brigadier désigna sur la gauche un chemin carrossable strié par deux sillons parallèles. Les traits se perdaient derrière un rideau de sapins. « Ce chemin conduit à la villa de Philippe Bondieu. C’est là qu’on l’a retrouvé, ce matin. Comme vous pouvez le constater, pour vous y rendre, vous n’aurez pas à marcher trop longtemps depuis l’auberge… Mais dites-moi, comment se fait-il qu’on vous ait si vite envoyé ici ? » La réponse du péjiste fut laconique. Le commissaire Balint était dans l’impossibilité d’affecter l’un de ses hommes à cette enquête en raison du manque d’effectif aggravé par les congés d’été. Or, il ne pouvait pas refiler une enquête aussi sensible à une jeune recrue. Plutôt que d’attendre qu’une procédure interne lui apporte un renfort tombé d’on ne sait où, il avait sollicité son vieil ami de promotion, le divisionnaire Lanoux.
Hoste entreprit de faire demi-tour, manœuvrant le volant d’une main ferme. Le ciel n’était plus qu’un voile sombre, lourd de grondements. Et par intermittence, l’horizon s’éclairait de flashes lointains. L’atmosphère était dense. Les températures méridionales de ces derniers jours avaient un prix. Ce soir, il faudrait payer en liquide les largesses du mercure. Les trombes d’eau risquaient à nouveau de charrier les terres agricoles et de déverser un torrent de boue dans les rues et les habitations. Dans la vallée, on s’était fait une raison : il fallait s’accommoder désormais de ces célestes caprices, signes probables des changements climatiques en cours.
La Renault rebroussa chemin. Les premières gouttes s’écrasaient sur le pare-brise en de larges éclats. La Clio traversa la départementale, entra d’une centaine de mètres dans le hameau puis stoppa sur un parking en gravier. Hoste tendit un épais dossier cartonné à son passager.
— Voici les publications et les premières constatations d’enquête. Le rapport du légiste n’y figure pas encore. Je vous le déposerai demain. Selon mes informations, le juge d’instruction tiendra une conférence de presse dans la matinée. Souhaitez-vous y assister ?
— Non. À chacun son job. Moi, je vais arpenter le terrain.
— Très bien. Si vous avez besoin de mes services…
— Je vous appelle demain matin.
Ballinger tira sur le loquet et la portière droite du véhicule s’ouvrit. Hoste ajouta :
— OK. Mais ne comptez pas trop sur votre téléphone mobile ici. Nous sommes dans une zone blanche.
— Une zone blanche ?
— Un bout de territoire non couvert par le réseau de téléphonie mobile. Mieux vaut user du téléphone classique. Vous voilà plongé dans le passé, inspecteur.
Le policier s’extirpa de l’auto et récupéra son bagage dans le coffre de la Renault. Il revint vers la portière du conducteur. Hoste baissa sa vitre.
— Une dernière question, brigadier : avez-vous trouvé l’ordinateur de la victime ?
— L’ordinateur ?
— Oui, l’ordinateur. Philippe Bondieu était journaliste. Il devait donc en posséder un.
— Non, il n’y en avait pas dans son bureau. Si c’est le crime d’un rôdeur, il l’a peut-être emporté comme butin, suggéra le gendarme.
— Possible.
Hoste regarda Ballinger s’éloigner vers l’auberge. Sous ce ciel d’Apocalypse, les fenêtres éclairées des Deux Pins perçaient la pénombre. Les éclairs, eux, jaillissaient des prunelles du gendarme.
Chapitre 3
Hugues Ballinger tourna les talons. La pluie trempait déjà son veston. Immobile, il contemplait la façade de l’auberge. Il était de retour à Anvie. Sept années s’étaient écoulées depuis son dernier séjour. Une éternité. Une autre vie. Cette époque et le présent formaient deux univers reliés par un trou de ver. Il était passé de l’un à l’autre voici trois ans, broyé puis recomposé mais différent. Éteint. Incomplet.
Le trajet vers Anvie lui avait paru très long. Le verbiage du gendarme était pénible. Et en particulier le couplet à la gloire du maire. Ce dithyrambe avait suscité sa méfiance et il avait préféré décliner l’invitation à loger d’Hector Grandjoie. Une offre trop aimable pour être honnête. Ou était-ce lui qui se montrait trop suspicieux ? Bien sûr, la rivalité entre police et gendarmerie n’était plus aussi vive que par le passé. Mais la venue d’un inspecteur de la police judiciaire sur le territoire d’une brigade restait un sujet de tension. Or, il n’avait rien ressenti de tel au contact de Franck Hoste. Pas même une remarque bileuse.
Lors de la descente vers le hameau, ses souvenirs avaient refait surface. Les trajets en voiture restaient propices à la rêverie. Les images de son dernier séjour ici lui remontaient en d’indésirables spasmes. Marie avait voulu revenir ici voici trois ans. Mais c’était compter sans le sort qui les avait foudroyés. Le bonheur peut s’éteindre si vite, tel un commutateur qu’on abaisse. Et ce soir, Ballinger était là, sous cette pluie tiède, silhouette aspirée par le halo des fenêtres.
Le tonnerre le sortit de ses pensées. Tête baissée, il pressa le pas. L’allée de gravier, large d’un mètre et demi, était bordée de part et d’autre par un gazon bien entretenu. Le parfum de l’herbe coupée montait dans le soir. Deux souches, moignons minuscules, rappelaient les conifères de l’auberge éponyme. La pluie empesait son veston. Au loin, le soir gargouillait d’humeurs sombres et méchantes, écho au crissement de ses pas vers l’auberge.
La réception était déserte. Il s’épongea le visage avec un mouchoir en tissu, le replia puis pressa sur le poussoir chapeautant la sonnette en demi-dôme argenté. Des pas répondirent bientôt au tintement familier et l’aubergiste apparut sur la gauche. Son visage émacié se creusait de rides profondes. Il prit place derrière un meuble au vernis décati. Sa silhouette dégageait une odeur de tabac. Ses lèvres diaphanes s’affinèrent plus encore en un sourire. Il ouvrit un registre et, sans même relever la tête, demanda :
— Monsieur ?
— Ballinger, Hugues Ballinger, répondit le policier en lui tendant un document d’identité.
— Je vois, la réservation de ce jour. Combien de temps resterez-vous chez nous ?
— Je l’ignore encore. Plusieurs jours, sans doute.
Après quelques formalités d’usage, ce corps de bois sec flottant dans sa chemise lignée se tourna vers un tableau garni de clés. Il en saisit une, suspendue sous le chiffre 9 qui ornait un ovale en étain, et la tendit à son client. « Vous serez tranquille à l’étage. Les prochains pensionnaires ne sont attendus qu’en fin de semaine. Je vous souhaite un excellent séjour aux Deux Pins. » Cette formule résonna en lui comme un écho du passé.
Avec lenteur, l’aubergiste contourna le comptoir et ouvrit le chemin jusqu’au pied de l’escalier en chêne épais. « Après deux volées de marches, vous arriverez sur le palier, indiqua-t-il. Prenez le couloir de droite. Votre chambre s’y trouve. » Ballinger le remercia tout en lui demandant s’il était possible de lui faire monter un repas dans sa chambre. L’aubergiste lui promit un sandwich. En soirée, l’auberge proposait une table d’hôtes uniquement sur réservation. Sous ses pas, les marches gémirent.
Arrivé à hauteur de sa chambre, il déverrouilla la porte. Il actionna l’interrupteur. Sans prêter attention à la salle de bain sur sa gauche, il s’avança et découvrit un lit double, deux tables de chevet munies de lampes assorties et un bureau. Il déposa son bagage, qu’il ouvrit. Sur les chemises et pantalons soigneusement pliés reposait un cadre, avec la photo en noir et blanc : une femme souriait, le regard plissé, les lèvres dévoilant une dentition régulière. Il le déposa sur la table de nuit. Puis il se dirigea vers la fenêtre. Elle donnait sur le parc et l’allée menant de la rue à l’hôtel. L’éclairage public jaunissait les murs des façades opposées. L’ombre des branches tourmentées par le vent s’y dessinait. L’orage fondait sur le hameau, les serres de ses éclairs agrippant les maisons. Les gouttes crépitaient aux vitres des fenêtres. Et la tempête sévissait tout autant au plus fort de son être.
Une dizaine de minutes plus tard, l’aubergiste frappa à la porte. Il lui montait un sandwich qu’il déposa sur le bureau. Ballinger le remercia et, dès qu’il fut sorti, verrouilla la porte. Puis retourna vers la fenêtre, la mâchoire serrée. Il planta son regard dans la nuit, cerf-volant sous les vents des tourments.
Direction régionale de la police judiciaire.
Direction interrégionale de la police judiciaire.
29 mois plus tôt, un dimanche de mars…
La nuit avait laissé des motifs glacés sur les fenêtres. C’est la première chose qu’il remarqua en pénétrant dans la cuisine. Puis ses narines humèrent l’odeur de café chaud mêlée à celle du pain grillé. Sur le four de la cuisine équipée, l’horloge numérique indiquait 8 heures 15.
Marie l’accueillit d’un sourire. Hugues Ballinger se demanda si c’était là l’expression de son amour ou l’effet provoqué par sa tignasse ébouriffée et ses paupières à peine ouvertes. Il s’avança et, à son approche, elle se leva afin de l’embrasser. Il l’enlaça et, sous sa robe, il perçut les contours de sa silhouette svelte et musclée. « Bonjour, mon amour », lui glissa-t-il dans le cou. Il n’aimait guère les baisers matinaux échangés au sortir du lit, ce qui était son cas à l’instant. Marie, elle, était déjà habillée et maquillée, comme tous les jours où elle travaillait. En ce dimanche de mars, elle assurait une garde à l’hôpital, au sein du service pédiatrique.
« Bien dormi ? » demanda-t-il. « Oui. Et toi ? » répondit-elle en lui glissant un baiser juste derrière l’oreille. Avant même qu’il ouvre la bouche, elle ajouta : « J’ai l’impression que tu t’es encore bagarré avec l’oreiller une partie de la nuit. » « Oui, j’ai fait un cauchemar. » « Encore, s’inquiéta-t-elle. Hugo, tu as un sommeil fort agité, ces derniers temps ». Il devait bien admettre qu’elle avait raison. « Sûrement l’approche du changement de saison », hasarda-t-il pour la rassurer. « Même si cela ne se voit pas », songea-t-il en regardant par la fenêtre. Le ciel était d’un bleu uniforme et le soleil dorait les arbres encore nus de sa lumière. Depuis plusieurs jours, un froid glacial marqué par des températures négatives de jour comme de nuit figeait la nature. Les gelées répétées menaçaient les premiers bourgeons de l’année.
— Que vas-tu faire, aujourd’hui ? questionna Marie.
— Je crois que je vais aller faire un jogging. J’ai besoin de me dépenser.
— Couvre-toi suffisamment !
— Bien sûr. Ne t’inquiète pas. Ensuite, je regarderai probablement le foot à la télé en t’attendant. Il y a une belle affiche programmée cet après-midi. Et je compte terminer le roman policier que je lis en ce moment.
— C’est bien ?
— Bof. Pas toujours très crédible. Les romanciers connaissent rarement le métier de flic. S’ils savaient… Mais c’est bien construit. Vers quelle heure penses-tu rentrer ?
— Je ne devrais pas terminer trop tard. Je quitterai l’hôpital vers 18 heures. On se ferait bien un resto, ce soir. Non ?
— Excellente idée. Je réserve notre italien favori ?
— Oui, ce serait chouette. Je t’appelle quand je quitte l’hôpital.
Marie se préparait à partir, mais se ravisa.
— Ah oui, Hugo, je me disais que le mois prochain, on retournerait bien dans cette petite auberge où l’on avait séjourné voici quatre ou cinq ans.
— Laquelle ?
— Celle avec les deux immenses sapins à l’entrée, dans ce village où il y avait un château entretenu vaille que vaille par ce châtelain désœuvré. Pas très loin d’Orléans. Tu t’en souviens ?
— Oui, mais je ne reviens plus sur le nom du patelin. C’était assez court…
— Anvie !
— Oui, c’est ça. Je ferai une recherche sur le Net cet après-midi, en regardant le match. Peut-être ont-ils un site Internet, désormais. Le progrès est peut-être arrivé jusque-là.
— Pas trop, j’espère. Cela lui donnait un charme particulier. Bon, j’y vais.
Mardi 12 août
Chapitre 4
Que reste-t-il des songes quand on s’extirpe de la nuit ? Tantôt un résidu fugace d’images et d’impressions. Tantôt rien. Ce néant sans reliquat était le lot d’Hugues Ballinger. Chaque matin. Il ouvrit les yeux, éveillé par le bégaiement strident du réveil. 7 heures. Depuis plus de deux ans, le début de la journée était un supplice. Celui de l’absence, goutte d’acide qui tombe sur le cœur et l’érode peu à peu. C’en était fini de l’attente qui précède le réveil de l’autre, des sourires quand les cils s’écartent, du baiser sur le front ou les lèvres, de la main glissant dans les cheveux ou caressant la nuque. L’irréversibilité dépasse l’entendement humain.
Ballinger se redressa à regret, la vue encore embrumée, puis posa ses pieds déchaussés sur les lames du vieux parquet pour gagner à tâtons la fenêtre. Il tira d’un coup sec les tentures boulochées. Il fut aussitôt fauché par une lumière aveuglante. L’orage de la veille n’avait été qu’un répit. Le soleil brillait de plus belle dans un ciel vierge de nuages.
* **
Le restaurant de l’auberge ressemblait à une cantine. La pièce était attenante au hall d’entrée. La décoration y était rudimentaire et les tables, recouvertes d’une nappe blanche, occupaient une salle qui, en l’absence d’autres convives, paraissait plus grande. Attablé, Ballinger recensait les premiers constats de l’enquête. L’aubergiste déposa devant lui une corbeille remplie de croissants et de pains au chocolat. Dans la tasse de faïence blanche ornée de fleurs bleues, le café fumait.
— J’espère que vous avez bien dormi, s’enquit l’aubergiste, d’une voix rocailleuse trahissant un tabagisme assidu.
— Oui, merci. Êtes-vous occupé, à l’instant ? questionna Ballinger.
— Vous l’aurez constaté, ce n’est pas vraiment la grande affluence, ironisa l’homme en bras de chemise.
— Alors vous prendrez bien un café avec moi ?
— Ma foi, ce n’est pas de refus.
Ses cheveux étaient cendrés mais deux traits charbonneux au-dessus des arcades sourcilières rappelaient leur teinte passée. Il s’installa en face de son pensionnaire. Ballinger saisit la petite cafetière et remplit une autre tasse, qu’il tendit à l’aubergiste. D’un signe discret de la tête, celui-ci le remercia et y glissa un carré de sucre. Le policier ne prêtait guère attention à son interlocuteur, éventrant un croissant pour le farcir de confiture. Il le referma et croqua la pointe de son encas. La pâte feuilletée nappée de sucre ne lui procura aucun plaisir. Il fallait pourtant manger. En face, l’aubergiste scrutait son commensal. Il finit par proposer :
— Si vous le souhaitez, je peux vous indiquer les attractions touristiques de la région. La plupart sont reprises sur un petit présentoir à l’accueil…
— Je ne suis pas là pour ça, trancha d’un ton neutre le policier, le regard posé sur le flanc du croissant, d’où suintait le surplus de gelée rouge.
— Un déplacement professionnel ? Vous êtes représentant ?
Ballinger saisit quelque chose dans la poche intérieure de son veston, qu’il déposa sur la nappe immaculée : son insigne. Il annonçait la couleur.
— Je viens enquêter sur l’assassinat du journaliste, Philippe Bondieu. Que pouvez-vous me dire à son propos, Monsieur…
— Conte, Bernard Conte. Que voulez-vous savoir ?
L’allure austère et un brin bougonne de l’aubergiste cachait un personnage prolixe, prompt à libérer cette quantité d’informations accumulées sur ses contemporains et trop longtemps conservées dans l’apparente solitude de son établissement. Sans que Ballinger eût à trop insister, il s’épancha. Si Philippe Bondieu était un personnage apprécié participant à la vie sociale de sa localité, il comptait peu d’amis proches. Il était très lié à Luca Ferri et à sa fille, Lisa. Il fréquentait également Éléonore Daum, la bibliothécaire d’Anvie.
— Où puis-je les trouver ?
— Pour les Ferri, c’est très simple. Luca, le père, tient la ferme du Plateau, dans le haut du village, à la sortie d’Anvie. Il y vit avec sa fille ainsi qu’une série de stagiaires, des ex-taulards qu’il tente de réinsérer. Mademoiselle Daum, elle, habite au-dessus de la bibliothèque, à deux pas d’ici, dans la petite rue qui longe l’église d’Anvie.
— Une liaison ?
— Avec Mademoiselle Daum ? Ce n’est pas impossible. Il se dit aussi que la fille Ferri en pinçait pour lui. Peut-être qu’ils ont eu une liaison à un moment ou que c’est une idylle fantasmée par la gamine. J’ai déjà entendu les deux versions circuler. Mais vous savez, les ragots…
Lorsqu’il se laissait entraîner dans la conversation, Conte perdait de sa réserve, releva Ballinger. La salle déserte lui avait fait oublier la retenue qu’il affectait devant les clients.
— Dois-je savoir autre chose sur les Ferri ?
— Le père est élu local. Il dirige l’opposition face à M. Grandjoie. Il a des idées, disons, assez carrées. Subversives, même.
— Des idées subversives ?
— Oui. Anarchistes, rebelles… Comme si on avait besoin de tout cela ici. Ces gens-là, ils refusent de consommer, ils rêvent d’autarcie. Ce n’est pas ça qui fait vivre les commerçants.
— C’est dans le cadre de ses activités politiques qu’il côtoyait Philippe Bondieu ?
— Non. Ils s’appréciaient de longue date. Et puis, M. Bondieu ne s’intéressait pas à la politique locale.
— Non ?
— Non. Enfin… C’est vrai que ces derniers temps, il passait de plus en plus de temps dans la commune. Il posait des questions, ici ou là. Peut-être qu’il préparait un livre ?
Conte souleva les avant-bras tout en haussant les épaules, signe manifeste qu’il ne pouvait en dire plus sur ce point. Ballinger n’insista pas. « C’était quelqu’un de fort discret, Philippe, crut bon de préciser l’aubergiste. Même quand il venait au stade supporter le Sporting, il parlait de tout sauf de son boulot. Le mieux serait de questionner ses amis, les Ferri. Leur ferme est à trois kilomètres d’ici, en suivant la route qui sort du village, après le vieux moulin. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et si vous vous perdez quand même, demandez le Toscan. C’est comme ça qu’on le surnomme, ici. »
— Le Toscan ?
— Oui, c’est de là qu’il vient, Ferri. Bon, si vous n’avez plus besoin de moi, je vais retourner à mes tâches.
— Encore une question : c’est le facteur qui a trouvé M. Bondieu, m’a-t-on dit. Où puis-je le rencontrer ?
— Charles Guet ? À cette heure, chez Rita, au café du village, à cinquante mètres d’ici. Il doit être en train de narrer ses exploits en se rinçant le gosier. Lui, il ne risque pas la déshydratation, même par ce temps.
— Je vous remercie.
— J’espère que vous trouverez le salaud qui a fait ça. Un meurtre, ici, c’est du jamais vu. Et Philippe, c’était un bon gars. Il ne méritait pas ça.
À ces mots, il se leva, retrouvant le masque de service, ridé et figé. Seule une petite étincelle dans le regard trahissait ses émotions. Bernard Conte avait éveillé la curiosité de Ballinger. Ainsi, il se pouvait que Philippe Bondieu ait mené une enquête dans sa propre municipalité. Cela entrait en résonnance avec le bref échange de la veille : avant de prendre son train, il avait pris le temps de contacter le rédacteur en chef du mook où publiait la victime. Il voulait savoir si le journaliste travaillait actuellement sur un sujet l’exposant à des représailles.
— Pas que je sache, avait répondu le rédacteur en chef. Il avait bouclé voici plus de deux mois un reportage sur les passeurs qui permettaient aux réfugiés de gagner les rivages de Lampedusa. Il était revenu très marqué d’avoir croisé ces familles embarquant sur des rafiots de fortune, avec de très jeunes enfants, pour un hypothétique Eldorado européen. Un voyage sans retour pour certains.
— Cela aurait pu l’exposer à des risques ?
— Quand il était là-bas, sûrement. Mais pas ici. À ma connaissance, il n’avait d’ailleurs reçu aucune menace.
L’inspecteur avait coincé le combiné entre sa joue et son épaule et prenait quelques notes pour conserver l’essentiel de l’échange.
— Et sur quoi travaillait-il, désormais ?
— Il m’avait demandé un peu de temps. Il voulait se reposer. Puis travailler sur un sujet plus personnel. Mais il m’assurait que cela pourrait intéresser nos pages.
— De quoi parlait-il ?
— Je l’ignore. Il avait quitté mon bureau en me lançant un clin d’œil, avant d’aller faire un brin de toilette puis de regagner Anvie. Il m’avait juste glissé qu’il allait, je le cite, s’occuper des mauvaises herbes de son jardin. Alors, s’il y a quelque chose à chercher, c’est à Anvie que vous le trouverez, inspecteur.
Chapitre 5
Le soleil surplombait désormais les toits. Le bitume sombre contrastait avec la façade en pierres grises du troquet. Par la porte grande ouverte s’échappait une voix masculine qui troublait le silence de la rue.
Ballinger entra. La pièce aux carrelages jaunâtres était meublée de tables et de chaises en bois foncé. À son arrivée, le silence revint. Une poignée de clients alignés au comptoir le dévisagèrent, tout comme la patronne trônant de l’autre côté du zinc. Un homme vêtu d’un uniforme de postier captait jusqu’alors leur attention. Il était 10 heures, mais les fronts luisaient déjà sous la chaleur. Ballinger salua le groupe d’un signe de la tête et s’installa à l’autre bout de la pièce, à la table la plus éloignée du comptoir. Après un moment d’hésitation, le facteur reprit le récit interrompu par l’intrus. « Je m’avançais tranquillement sur le chemin de terre quand j’ai vu la porte entrouverte. J’ai tout de suite compris que c’était pas normal. M’sieur Bondieu, il fermait toujours son





























