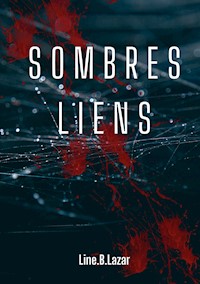
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Sarah semble perdre pied depuis le suicide de sa meilleure amie. La mémoire défaillante et brisée par la peine, elle doit faire face à ses propres démons tout en enquêtant sur la mort de son amie. Car oui, Sarah en certaine, Maria ne s'est pas suicidée. Mais la connaissait-elle vraiment? Qui était cette jeune femme pleine de secrets? A quel jeu Sarah devra-t-elle jouer pour connaître la vérité?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Avertissement de contenus
Certains sujets sont abordés tout au long de ce roman.
Ils peuvent être délicats pour certain-es. Des thèmes sombres sont abordés tels que le deuil, le suicide et l’automutilation.
Fermez vos fenêtres, surtout celles de vos écrans …
Sommaire
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
Chapitre 14
Chapitre 15
Chapitre 16
Chapitre 17
Chapitre 18
Chapitre 19
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 22
Chapitre 23
Épilogue
Chapitre 1
02/09/2007
Maria ne veut plus me parler. Enfin, c’est l’impression que j’ai. Cela fait déjà plusieurs jours que je n’ai plus trop de nouvelles, elle répond à peine à mes messages et ne cherche plus à ce qu’on se voie. C’est simple, elle m’évite. J’ai beau réfléchir à ce que j’ai bien pu lui faire ou dire, je ne sais toujours pas pourquoi elle a instauré cette distance soudaine entre nous. Je regarde encore une fois l’écran de mon téléphone, il est un peu plus de minuit, elle ne devrait plus tarder normalement. Je fais les cent pas pour me réchauffer et tenter de me changer les idées. Nous sommes au mois de septembre et déjà le vent menace de transpercer mes vêtements, annonçant un automne particulièrement frais. Je remonte le col de ma veste et frissonne ; une odeur d’urine accompagne le souffle du vent. Pourquoi autant d’idiots prennent-ils les parkings pour des toilettes publiques ? J’ajuste mon col au-dessus de mon nez, préservant ainsi mon odorat, et sautille sur place. La vue est belle d’ici, le parking du centre commercial est en hauteur et offre un sublime aperçu sur Talence. Tout est calme, comme si la nuit rendait toute la vie hors du temps. Le silence et l’obscurité dominent la ville. Seules de petites lumières résistent et délivrent une lueur apaisante, rassurante. Je frissonne encore.
T’es où, Maria ?
L’attente s’éternise, je ne suis même pas sûre qu’elle travaille aujourd’hui. Il est possible que son emploi du temps ait changé, ou qu’elle n’y soit pas allée. Un jeune couple traverse le parking et regagne sa voiture, ils sortent certainement du cinéma, la dernière séance doit être finie. La voiture démarre et se dirige vers la sortie. Je la vois s’éloigner de plus en plus, et disparaitre dans un virage. Mon regard s’attarde sur une silhouette plus loin. Un homme est appuyé contre une voiture, la tête baissée en direction de son téléphone portable. Je vois se refléter la lueur de son écran sur son visage à moitié caché sous une capuche. Je m’avance un peu plus vers l’escalator, en espérant qu’il est lui aussi en train d’attendre quelqu’un et qu’il n’a pas l’intention de se soulager. L’odeur du parking est assez atroce comme ça. Je regarde à nouveau mon téléphone. Devrais-je l’appeler ? Elle est censée avoir fini depuis quelques minutes déjà. J’ai juste le temps de ranger mon portable dans mon sac, j’entends des pas se précipiter. La voilà enfin. Elle remonte les dernières marches de l’escalator, trop occupée à arranger son écharpe pour voir que je suis juste devant elle.
— Salut Maria, dis-je en m’avançant à sa rencontre.
Elle sursaute, les mains jointes sur sa poitrine. Son expression est presque comique mais je m’abstiens de rire au vu de la situation.
— Punaise Sarah, tu m’as fait peur ! Mais qu’est-ce que tu fais là ? répond-elle.
Son air surpris a vite laissé place à un visage fermé, presque déçu. J’ai l’impression d’être une petite fille qui se fait gronder par sa mère.
— Ben… je sais pas trop, je voulais juste te voir.
— Tu aurais pu me prévenir quand même, non ?
J’accuse le coup et reste sans voix. Je regrette même d’être venue jusqu’ici.
— Excuse-moi, Sarah. Je suis claquée en ce moment.
— C’est pour ça que tu me boycottes ?
— Non Sarah, c’est pas pour ça.
— Ah bon ? Alors pourquoi ce silence radio depuis tout ce temps ?
— Je sais que j’ai pu me montrer distante, mais crois moi, ça n’a rien à voir avec toi.
— Tu ne réponds plus à mes appels ni aux messages, j’ai du mal à croire que ce n’est pas contre moi.
— J’avais l’intention de t’appeler, je t’assure. Mais en ce moment j’ai beaucoup de choses en tête, vraiment.
Voyant l’air perplexe se dessiner sur mon visage, elle sourit et m’attrape le bras.
— Allez Sarah, n’y pense plus. Ça fait longtemps que tu m’attends ? Tu dois être gelée.
— Oui ça fait un petit moment, mais comme d’habitude, j’ai envie de dire. Depuis quand tu es ponctuelle ?
Maria sourit et tout de suite je me sens un peu mieux. Je me sens même bête de m’être imaginé tant de choses. Elle ajuste son sac sur son épaule et commence à avancer, le son de ses talons résonne dans tout le parking. Elle porte le trench beige que je lui ai offert pour son anniversaire, avec une fine écharpe émeraude qui fait ressortir la couleur de ses yeux. Avant de la suivre, je me souviens de l’homme qui était là quelques minutes plus tôt. Je tourne le regard vers lui, il est toujours là, une cigarette à la main. Pourtant, cette fois-ci, ce n’est plus son téléphone mais nous qu’il fixe. Un nuage de nicotine l’enveloppe, le rendant encore plus mystérieux, presque irréel. Je ne discerne que son regard, froid et sombre comme ce parking. Des frissons parcourent le long de mon dos et hérissent les poils de ma nuque. Je m’empresse de rattraper Maria.
— Tu me crois si je te dis que Benoît veut me faire bosser plus ? commence-t-elle. Pour qui il me prend franchement ? C’est un job d’été, je ne veux pas faire carrière en tant que serveuse. J’ai vraiment hâte de reprendre les cours.
J’essaie de l’écouter mais malgré tous mes efforts je ne peux m’empêcher de penser à l’homme derrière nous. Je ne vois que les longs cheveux blonds de Maria bouger sur ses épaules au rythme de sa démarche droite et pleine d’assurance. C’est ce que j’aime chez elle : son assurance. Je me sens en sécurité.
— Il me sort quoi ? Tu dois être plus investie dans la vie du resto, tu devrais être là plus souvent, bla bla bla. Non mais comment c’est possible, il oublie que la semaine prochaine il ne me voit plus.
J’acquiesce en ne souriant qu’à moitié. Il n’y a pas un chat à l’horizon, juste un vaste terrain goudronné quadrillé de places de stationnement. Je presse le pas, hantée par un mauvais pressentiment, le pont qui mène à l’avenue principale n’est plus qu’à quelques mètres. Elle n’est pas très fréquentée à cette heure-ci, mais il y a déjà plus de lumière et de circulation. Je regarde par-dessus mon épaule. L’homme s’est avancé, il marche dans la même direction que nous à présent.
— Maria, il y a quelqu’un derrière nous.
— C’est normal non ? On est dans un parking.
Elle me regarde et sourit. Voyant mon air inquiet elle rit mais ses yeux trahissent un certain trouble.
— Arrête Sarah ! T’es toujours aussi parano ma parole !
Elle passe son bras autour de mes épaules et continue de marcher. Elle a sûrement raison, je me fais des films, j’en ai eu la preuve pas plus tard que tout à l’heure. Je souffle un grand coup et ris aussi.
Maria a ce don de toujours me rendre heureuse.
Chapitre 2
J’entends une porte grincer et s’ouvrir, des pas souples et feutrés se dirigent vers moi. Il y a beaucoup de lumière, trop de lumière, j’essaie d’ouvrir les yeux mais je n’y arrive pas. Mon corps lourd s’engouffre dans le matelas sur lequel je suis allongée. J’aimerais bouger mais c’est comme si aucun de mes membres ne m’obéissait, comme s’ils étaient là, enfoncés dans ce sable mouvant, refusant de s’y extraire. J’ai l’impression d’être une épave échouée depuis des siècles. Les pas s’arrêtent, ils sont tout près à présent.
— Mademoiselle, mademoiselle, vous m’entendez ?
J’ouvre les yeux avec peine, une femme est près de moi, elle se penche et ajuste mes coussins. Son parfum sucré et fruité embaume la pièce. Elle se redresse, se dirige vers le pied de mon lit et me sourit, des rides apparaissent au coin de ses yeux et des fossettes creusent ses joues. C’est une jolie femme et son air maternel lui donne encore plus de charme. Je mobilise toutes mes forces pour bouger mes membres, ne serait-ce que pour me redresser. Mais un puissant mal de crâne m’en empêche. J’examine la femme en face de moi, elle porte une blouse blanche et ses cheveux sont retenus en un chignon faussement négligé.
— J’suis où ? je demande d’une voix rauque.
— Vous êtes à l’hôpital mademoiselle Betley, je suis l’infirmière qui s’occupe de vous. Comment vous sentez-vous ?
— À l’hôpital ?
— Oui, le médecin ne va pas tarder à arriver, il vous expliquera tout, ne vous en faites pas. Pouvez-vous me donner votre prénom, votre date de naissance et votre adresse ?
J’essaie une fois de plus de me redresser, défiant ainsi mon mal de tête. L’infirmière s’approche de moi et attend, elle tient un bloc et un stylo et vérifie de temps à autre le moniteur près de moi. Je ne comprends pas, qu’est-ce que je peux bien faire ici ?
— Je dois m’assurer que vous n’avez pas de lésion cérébrale, vous pouvez répondre à mes questions ?
Je décline mon identité en essayant de réfléchir et me souvenir de ce qui aurait bien pu m’arriver. Mes pensées ont du mal à se frayer un chemin, comme si des barrages s’étaient formés, ne laissant filer aucune information. J’essaie de deviner sur le visage de l’infirmière ce que je n’arrive pas à comprendre en moi.
— Vos constantes sont bonnes, dit-elle en retirant ma perfusion. Après la visite du médecin il est fort probable que l’on vous garde en observation deux ou trois heures.
La femme reste à mon chevet quelques secondes, elle me sourit mais son regard dégage une profonde tristesse. Elle finit par se retourner et s’en va. Je connais ce sourire, c’est un sourire plein d’empathie que les médecins empruntent avant de dire à leurs patients qu’ils sont condamnés.
Mais qu’est-ce que j’ai ?
J’ai vraiment besoin de me rafraichir. Je retire le bracelet de mon bras ainsi que le capteur sur mon index et rassemble mes forces pour me lever. C’est comme si j’avais tout le poids du monde sur mes épaules. Je parviens quand même à poser un pied devant l’autre jusqu’à la salle de bains. L’infirmière n’étant plus là, l’odeur de la chambre commence peu à peu à couvrir celui de son parfum et me donne la nausée. Une forte odeur d’alcool mélangée à du détergent citron. Des tableaux fleuris rouges et orange tentent de réchauffer les murs d’un blanc polaire. Une chaleur vite consumée par des affiches médicales aussi froides que les ustensiles métalliques sur la table de chevet. J’ai besoin de me rafraichir. J’entre dans la salle de bains, un miroir est situé juste en face de la porte.
— Quelle horreur !
J’ai une mine de déterrée. Je m’approche du miroir et remarque des hématomes à l’œil gauche et sur ma pommette.
— Qu’est-ce qui m’est arrivé ?
Je m’approche de mon reflet et tente encore une fois de rassembler mes souvenirs, mais toujours rien. Je me fraye un chemin en me contorsionnant entre le lavabo et les W.-C. et entre dans la cabine de douche. Je me déshabille et ressens une autre douleur au niveau des côtes, j’inspecte rapidement mon corps, aucun bleu. C’est déjà ça. Une fois sous le jet d’eau chaude une sensation de bien-être s’empare de moi. La chaleur m’étreint, atténuant ainsi tous mes maux. Je reste un long moment sous l’eau et profite de ce moment réconfortant. Je me lave les cheveux et sens une bosse à l’arrière de ma tête. Ai-je perdu connaissance en tombant ? C’est peut-être pour ça que je suis là. Quelle gourde ! Et le pire, c’est que ça ne me surprend même pas plus que ça. Je souris en m’imaginant chuter des escaliers de chez moi. Je me rince rapidement à l’eau froide comme je le fais toujours, ça réduira les hématomes par la même occasion. Je me sèche et quitte avec regret ma bulle de bonheur. Je remarque avec joie que mes jambes ont retrouvé un peu de leur vigueur, j’enfile la blouse propre qui est sur mon lit et je m’assois, les pensées encore embrumées. Je ne suis pas à l’aise, la blouse est très courte et ouverte au dos, je m’efforce de l’arranger de sorte à bien couvrir mes arrières. En regardant autour de moi, j’aperçois au coin de la pièce mon sac posé sur un fauteuil en cuir marron. Je me précipite pour le récupérer et l’ouvre ; j’y retrouve mon portefeuille, des chewing-gums, mes écouteurs, différents papiers et tickets de caisse. J’ouvre la poche arrière et tombe sur mon téléphone, un BlackBerry noir pour l’achat duquel j’ai mis des mois à économiser. Tout le monde préférait les iPhone mais moi j’ai été séduite par l’originalité des BlackBerry. Je l’allume mais l’écran reste noir, la batterie doit être à plat. Je fouille un peu plus dans mon sac espérant y trouver mon chargeur mais visiblement je ne l’ai pas. Quelque chose m’interpelle, si mon sac est ici c’est que je l’avais avec moi. Ai-je eu un accident dehors ? Encore une fois, j’essaie de rassembler mes souvenirs mais c’est toujours le vide. Je range mon téléphone et retourne vers mon lit. Au moment où l’on frappe à la porte, je m’assois rapidement et ajuste cette foutue blouse sûrement conçue par des pervers. Au lieu d’une, ce sont trois personnes qui franchissent le seuil de la porte, dont le médecin, je le devine à sa blouse et au stéthoscope autour du cou. Il est accompagné de deux autres hommes qui n’ont pas l’air de faire partie du corps médical.
— Bonjour mademoiselle Betley, je suis le docteur Inarof, comment vous sentez-vous ?
C’est un homme d’une quarantaine d’années, avec un fort accent de l’Est. Je reste malgré tout perplexe en voyant ceux qui le suivent de près. Le plus imposant porte un jean et un blazer noir bien ajusté. Voyant que je ne réponds pas, le médecin me pose de nouveau la question.
— Comment vous sentez-vous ?
— Je vais bien, merci.
— Vous devez vous demander ce que vous faites ici, ajoute-t-il.
— Oui, j’ai eu un accident, c’est ça ?
— Effectivement. Vous êtes arrivée ici cette nuit à la suite d’un accident que vous avez eu tard dans la soirée. On a pratiqué plusieurs examens qui se sont révélés normaux mais qui nous montrent tout de même une légère commotion cérébrale, c’est ce qui explique votre état.
Le regard bleu du médecin est doux et bienveillant, mais ça ne suffit pas à masquer l’inquiétude qui monte en moi. Mes yeux ne cessent de fixer l’homme au blazer. Comme s’il devinait mes pensées, il s’avance au pied de mon lit.
— Mademoiselle Betley, je suis l’officier Lombard, de la police judiciaire. Voici mon coéquipier, l’officier Aubry. Si vous le voulez bien, nous aimerions vous poser quelques questions.
C’est un homme brun, très grand avec un physique imposant, on devine le poids de son expérience sur ses épaules.
— J’aimerais y répondre mais je ne sais pas ce que je ne fais là ni même en quoi je pourrais vous aider.
— Justement Mademoiselle, je vais vous expliquer. Puis-je vous appeler Sarah ?
— Oui.
— Très bien. Sarah, vous avez été retrouvée la nuit dernière dans le parking du centre commercial de Talence vers minuit trente. Vous étiez inconsciente et légèrement blessée.
Qu’est-ce que je faisais là-bas ? J’essaie de visualiser le parking en espérant y trouver des réponses, mais en vain.
— Quel genre d’accident j’ai eu ?
— Nous comptions sur vous pour nous le dire. Nous aimerions comprendre ce qui s’est passé hier soir. Quel est le dernier souvenir de votre soirée ? Qui était avec vous ? Toute information est la bienvenue.
Je le regarde, un peu déroutée, alors qu’il sort un calepin et un stylo de sa veste, prêt à recueillir mes souvenirs.
— Je me souviens de rien, lui dis-je.
— Juste un détail, peu importe lequel. Que faisiez-vous hier après-midi ?
— Le vendredi je ne travaille pas, je me souviens être restée chez moi tout l’après-midi…
Je ferme les yeux et me revois très clairement dans ma chambre, allongée sur mon lit, en train de grignoter des chocolats. J’avais mes écouteurs dans les oreilles et je faisais défiler les titres de mon iPod. Je vérifiais fréquemment l’heure sur mon téléphone comme si je devais bientôt sortir. Mon choix s’était finalement arrêté sur une chanson de Wallen, je me revois fredonner L’olivier. « Où sont passés les gens que j’ai aimés ? »
— Et puis ? demande l’inspecteur.
— Et puis rien, je sais seulement que je suis sortie après.
Lombard commence à griffonner sur son carnet mais je l’interromps.
— Si j’étais au parking du centre commercial dans la soirée, c’est peut-être pour retrouver une amie à moi qui travaille là-bas. Elle s’appelle Maria, elle pourrait nous renseigner.
Les deux policiers se regardent. Lombard, l’air grave, note mes propos sur son carnet. Une ride se creuse sur son front.
— Effectivement, Sarah, vous étiez au parking du centre commercial en compagnie de Maria Garcia, répond l’officier.
Lombard s’approche un peu plus du lit, je distingue de vilains cernes qui entourent ses yeux d’un vert peu commun. Je ne comprends pas, pourquoi sont-ils là à me poser toutes ces questions ?
— Il faut que vous sachiez que votre amie Maria a aussi été retrouvée dans le parking cette nuit, mais au niveau inférieur, elle a fait une chute de plusieurs mètres et n’y a malheureusement pas survécu. Nous sommes profondément désolés. Voilà pourquoi je suis là, vous êtes la dernière personne à l’avoir vue et toute information pourrait nous être utile pour comprendre ce qui s’est passé.
J’ai du mal à saisir toutes les informations, elles se bousculent dans ma tête et mon cerveau refuse de les traiter, je reste muette, incapable de parler ni même de penser. Je revois Maria, son grand sourire accroché aux lèvres, j’entends sa voix, une voix douce qui montait haut dans les aigus lorsqu’elle était surprise, je me souviens de son parfum ambré qu’elle ne quittait jamais. Maria, morte ? C’est impossible.
— Nous ne savons pas grand-chose pour le moment, reprend Lombard. Mon équipe suit certaines pistes et interroge son entourage. D’ailleurs, il se peut qu’on revienne vers vous quand ça ira mieux.
Je sens mon cœur s’accélérer et j’ai de plus en plus de mal à respirer. Lombard range son calepin dans sa veste et articule quelques mots que je n’entends pas, plus rien ne me parvient. Qu’est-ce qui a bien pu se passer ? De lourdes larmes coulent sur mes joues et j’ai l’impression que ma tête est sur le point d’exploser. Je me tiens le visage des deux mains, espérant que tout ça ne soit juste qu’un mauvais rêve. Mais tout est bien réel. J’entends Lombard prendre la carafe sur ma table de chevet et verser de l’eau dans un verre qu’il me tend. Sa main est posée sur mon épaule.
— Buvez un peu, ça vous fera du bien.
J’attrape le verre et bois sans ménagement. Cela doit faire des heures que je n’ai rien avalé. Je peine à reposer le verre sur la table de chevet, je n’ai plus la force pour quoi que ce soit. Je m’allonge sur les coussins, essayant de calmer les vertiges qui commencent à m’envahir. J’entends la voix réconfortante du médecin ; il dit aux policiers qu’il n’hésitera pas à les contacter s’il a du nouveau, et la porte de la chambre se ferme.
— Essayez de dormir un peu, Mademoiselle, dit le médecin. Je pense que vous allez pouvoir sortir dans l’aprèsmidi si toutefois vous vous sentez bien. À votre réveil, une infirmière vous apportera un plateau-repas.
Je le remercie de la tête, les joues encore humides.
— Et toutes mes condoléances pour votre amie.
Il tourne les talons et s’apprête à s’en aller également.
— Docteur ?
— Oui ?
— Est-ce que mon père est là ?
— Oui, il est venu quand vous étiez encore inconsciente, il nous a dit qu’il repasserait plus tard dans la journée.
— D’accord, merci.
Plus tard. Encore une fois, je passe au second plan. Pourquoi est-ce que ça m’étonne encore ?
***
L’ambiance est tendue dans la voiture, comme à chaque fois que je me retrouve avec mon père. Il roule doucement, je vois ses mains crispées sur le volant, les jointures de ses doigts blanchies sous la pression. Il regarde la route, concentré, l’air plus en colère qu’inquiet, ses yeux ridés, mais vifs vérifient chaque rétroviseur ; dans toutes les situations, il veille à garder le contrôle. Mon père a grandi avec un père militaire, l’horloge a guidé son enfance, la discipline et l’ordre ont toujours été son mode de fonctionnement. Ça lui a été d’une grande aide dans son métier, même s’il n’a pas suivi les pas cadencés de mon grand-père, son côté passionné a remporté la bataille et l’a dirigé vers la pâtisserie. Il est chef pâtissier dans un restaurant étoilé, il dirige une brigade, la rigueur et la précision font de lui un maître dans ce domaine. Il arrive même à faire preuve d’émotion dans ses réalisations, en tout cas c’est ce que décrivent les critiques qui jugent ses desserts. Il faut croire qu’il n’a pas assez de sentiments en stock, que son aspect doux et mielleux n’est consacré qu’à son travail nous obligeant, mon frère Lucas et moi, à nous contenter de miettes. Avec nous, il véhicule uniquement de l’amertume.
À l’hôpital, j’avais l’impression d’avoir affaire à un troisième policier plutôt qu’à mon père : il me posait des tas de questions et voulait absolument comprendre ce qui s’était passé. Je veux bien le comprendre, mais était-ce le bon moment ? J’aurais tellement aimé recevoir une étreinte, un sourire, entendre que tout ira bien, mais bon, se montrer rassurant et compatissant n’est pas son fort.
L’hôpital Saint-André se trouve à quelques kilomètres de Talence, nous serons rentrés dans peu de temps, mais la route me paraît interminable. J’ouvre la fenêtre, l’ambiance qui règne dans la voiture commence à m’étouffer. Je remonte ma capuche sur la tête pour m’isoler, j’ai l’impression d’être moins vulnérable ainsi. Un vent frais caresse mon visage et me fait le plus grand bien, je ferme les yeux et inspire profondément. Il y a du monde dehors, j’entends les gens se promener, je peux deviner d’ici leur bonheur. Ils s’apprêtent sûrement à passer une soirée entre amis ou en famille, généralement c’est ce que l’on fait un samedi soir. C’est du moins ce que je faisais avec Maria. Elle venait chez moi et moi chez elle, on se retrouvait au restaurant ou au café du centre-ville. On était comme toutes ces personnes, heureuses et insouciantes. On partageait des ragots, des projets, comme toutes les amies on refaisait le monde. Des souvenirs qui étaient jusqu’ici heureux deviennent de plus en plus douloureux, car oui, tout cela ne sera plus possible, plus rien ne sera comme avant sans elle dans ma vie. C’est quand on perd ce à quoi on tient qu’on réalise à quel point ça nous est indispensable : cette phrase prend tout son sens quand on le vit. J’ai hâte de rentrer chez moi, retrouver ma chambre et mes repères, m’éloigner de cette réalité qui m’échappe.
On arrive au niveau de notre rue, puis mon père se gare devant chez nous, toujours aussi silencieux, et je m’apprête à sortir quand il me retient par le bras.
— Sarah, tu n’as rien dit depuis l’hôpital, il faut vraiment que tu m’expliques ce qui s’est passé. Je me doute que ça n’est pas simple pour toi, mais je suis ton père, tu peux tout me dire.
J’en ai assez, assez de répéter, répéter et encore répéter à la police, aux médecins et à moi-même que JE NE SAIS PAS.
— Si je savais quoi que ce soit, je l’aurais déjà dit à l’inspecteur.
— Je sais bien, hésite-t-il. Mais… tu ne penses pas que c’est le moment de prendre rendez-vous ?
— Prendre rendez-vous pour quoi ? je m’emporte.
— On en a déjà parlé. Ce n’est pas la première fois que…
— Que je suis en état de choc ? Chez la plupart des gens, c’est ce qui arrive dans cette situation ! Tu peux pas le savoir toi, tu ne ressens jamais rien ! Pourquoi j’irais consulter ?
Il soupire en se frottant le visage.
— C’est déjà assez difficile pour moi d’avoir perdu ma meilleure amie, d’avoir été présente et de n’avoir rien pu faire à ce moment-là, d’être impuissante maintenant ! Et ce n’est pas en me répétant « qu’est-ce qui s’est passé ? » ou en insinuant que j’ai un problème que ça va m’aider. Mais sinon je vais bien, hein, dis-je en montrant mes hématomes. Ne t’en fais surtout pas, encore merci de t’en soucier !
Je claque la porte de la voiture et entre en trombe dans la maison. Je ressens un grand soulagement en franchissant la porte de ma chambre, d’une part parce que c’est l’endroit où je me sens le mieux, et d’autre part parce que j’ai pu exprimer ma colère face à mon père, et ça ne m’était jamais arrivé auparavant. C’est toujours dur de s’affirmer face à une personne comme lui, mais c’était nécessaire. Je ferme la porte de ma chambre et reste adossée à elle un moment ; je ferme les yeux le temps de me remettre de cette dispute, la bosse à l’arrière de ma tête est toujours sensible, je passe ma main dessus et la même question me revient : comment c’est arrivé ? La boule qui sort de mon crâne n’étant pas en cristal, je doute de trouver une réponse facilement. Je rouvre les yeux et me dirige vers mon lit. Je ne me sens pas particulièrement fatiguée, mais j’éprouve le besoin de m’allonger, de laisser mes pensées s’envoler hors de l’espace et du temps. Une fois allongée, je sens un câble dépasser de sous l’oreiller.
— Mon chargeur !
Je me lève brusquement pour ramasser mon sac. Je l’avais négligemment abandonné à l’entrée de ma chambre. Je sors le téléphone puis m’empresse de le brancher à la prise. Je me change en attendant que l’écran s’allume. En refermant la porte du placard, je m’attarde devant le miroir collé à celle-ci.
Mon visage a repris des couleurs depuis ce matin, mais mes yeux ont perdu de leur lumière. On dit que les yeux sont le miroir de l’âme, donc une âme endeuillée ne doit pas refléter grand-chose. Je retourne m’asseoir sur mon lit et allume mon téléphone, mon cœur se serre lorsque le fond d’écran apparaît, c’est une photo de Maria et moi. Ses yeux attirent tout de suite l’attention, ils sont bleus, très bleus. Un bleu qui ne passe pas inaperçu. Ils sont parsemés de petits losanges jaunes, comme des particules d’or sur un ciel azur. Cette photo a été prise cet été pendant un week-end à Hendaye, on voit derrière nous l’océan rejoint par les rochers jumeaux.
Plusieurs notifications viennent masquer la photo, des appels manqués, des messages vocaux et des SMS. Je les ouvre et y trouve des messages de mon père, de mon directeur, et un appel provenant du domicile de Maria. J’écoute le message de mon directeur, il me souhaite un bon rétablissement et espère me voir aux prochaines vacances, mon père a dû le prévenir que je n’allais pas venir travailler aujourd’hui. Mon téléphone se met à sonner, c’est Lucas. Avant même de décrocher, je me sens déjà un peu mieux.
— Allô ?
— Salut Sarah, comment tu vas ?
— Ça peut aller, et toi ?
— Ça va, ça va, j’ai appris ce qui s’est passé, comment tu te sens ?
Sa voix est enrouée, il a dû se faire un sang d’encre et ne pas dormir de la nuit. Gênée, je fais comme si je n’avais pas remarqué.
— Oui, ça va, j’ai pu récupérer un petit peu à l’hôpital, là je suis à la maison.
— Papa est venu te chercher ?
— Oui, et comme tu peux t’en douter c’était très joyeux.
— Je m’en doute. Qu’est-ce qu’ils t’ont dit, les médecins ?
— Mon médecin m’a parlé de légère commotion cérébrale, mais je me sens déjà mieux. C’est juste que j’ai aucune idée de ce qui s’est passé, Lucas.
— Te prends pas la tête. C’est peut-être pas plus mal que tu t’en souviennes pas.
Je l’entends renifler et prendre une grande inspiration.
— Je suis désolé pour Maria.
— J’arrive toujours pas à réaliser.
— Tu as pu avoir ses parents au téléphone ?
— Non pas encore, je viens à peine d’allumer mon téléphone, mais je préfère aller les voir directement.
Mon estomac se noue, je n’avais pas pensé à ses parents. Je vais me retrouver face à eux sans pouvoir leur donner la moindre explication ni les aider à faire leur deuil.
— Oui tu as raison. Et t’inquiète pas Sarah, c’est pas de ta faute OK ? Je te connais trop bien, je sais que tu culpabilises.
— Je sais, mais…
— Arrête. Ça sert à rien de te faire du mal. On en saura plus sur ce qui est arrivé dans les prochains jours. Pour le moment, pense à te reposer.
Il s’éclaircit la gorge et renifle à nouveau.
— Ça va toi ? je demande.
— Oui ça va, j’ai juste chopé un petit rhume, ça s’est super refroidi à Paris.
Le froid… Je me souviens d’un vent frais qui me faisait frissonner. Je me vois remonter le col de ma veste et sautiller sur place pour me réchauffer. Il faisait sombre et j’étais seule.
— Allez, je te laisse te reposer, dit Lucas.
Je ne réponds pas et ferme les yeux pour essayer d’y voir un peu plus, mais tout s’échappe.
— Sarah ?
— Oui Lucas, excuse-moi, j’étais dans mes pensées.
— Tu es sûre que ça va ? s’inquiète-t-il.
— Oui, t’en fais pas.
— OK, allez repose-toi, je te rappellerai plus tard.
***
Le parking est vide et une forte odeur me donne la nausée. Maria est devant moi, elle me parle, mais je n’arrive pas à entendre le son de sa voix. Elle a l’air fatiguée, ses traits sont tirés et des cernes rouges entourent ses yeux. Qu’est-ce qui se passe ? Nous avançons toutes les deux vers le pont qui mène à la sortie. Tout est calme, seuls les battements de mon cœur résonnent et rompent le silence du parking. Pourtant une présence m’oppresse, rendant l’air étouffant et lourd. Quelqu’un est là, je le sens s’approcher. Je sens sa main frôler ma tête, toucher mon front, mais je ne parviens pas à le voir. Le sol se dérobe sous mes pieds, me laissant tomber dans le vide de plus en plus vite. J’essaie de crier, mais mon souffle est coupé. Mon cœur bat à tout rompre, je ferme les yeux, redoutant l’impact du sol, mais je me réveille en sursaut.
J’inspire à fond et essaie de reprendre mes esprits, m’agrippant à mes draps.
— Calme-toi Sarah, tout va bien.
Mon père est là, sa main posée sur mon front. Je dégage ma tête.
— Je venais voir comment tu allais et j’ai vu que tu transpirais des litres. Je craignais que tu aies de la fièvre.
— J’ai rien.
— Tu as fait un cauchemar ?
— Non, je t’ai dit que j’ai rien.
Il soupire et se dirige vers le couloir.
— Si tu veux manger, je t’ai laissé une assiette dans le micro-ondes.
J’attends qu’il soit descendu et me rue dans la salle de bains. Je passe de l’eau froide sur mon visage et m’appuie sur le lavabo. Qu’est-ce qui m’arrive ? Ça avait l’air tellement réel. Je reste un moment face à mon reflet, je suis aussi blanche qu’un linge. Je retourne dans ma chambre et encore tremblante, j’ouvre grand la fenêtre. Il faut que je pense à autre chose. Je récupère mon ordinateur sur mon bureau et m’allonge sur mon lit. Je tombe directement sur la page Facebook et me connecte. Au bout de cinq minutes à faire défiler mon fil d’actualité, je ne peux m’empêcher d’aller sur le profil de Maria. Ses photos apparaissent sous mes yeux. Elle n’en a pas beaucoup, elle postait surtout des articles en lien avec le droit. Je m’attarde sur les photos de Hendaye. Je ne l’avais pas laissée poster de photos ou j’apparaissais, j’avais du mal avec l’idée de m’exposer sur Internet. Même sur mon profil, je n’ai mis qu’un pseudonyme et une image de coucher de soleil. Mon cœur se serre, ma meilleure amie est morte et voilà ce qu’il me reste d’elle, des photos numériques pixélisées plates et froides. Je ferme mon ordinateur et le pose à même le sol. Je ne me suis jamais sentie aussi seule, mais je n’ai aucunement envie d’être consolée ni prise en pitié. Je veux juste Maria. Pourquoi goûter au bonheur si c’est pour le voir m’être retiré aussi brutalement ? Peut-être que la douleur est finalement mon remède.
Chapitre 3
La nuit a encore été difficile, je n’ai pratiquement pas dormi, dès que je trouvais le sommeil, il se débrouillait pour m’échapper. Les rares fois où je réussissais à le saisir, je me retrouvais dans ce fichu parking. Je sentais le vent frais sur ma nuque, les relents d’essence et d’urine qui me donnaient des haut-le-cœur, je revoyais les néons jaunes qui diffusaient une lumière fantomatique, rendant lugubre tout ce qui m’entourait. L’obscurité devenait de plus en plus dense, ne laissant aucune lueur l’atténuer, on aurait dit que la terre m’aspirait au plus profond d’elle-même et se refermait derrière moi, me laissant ainsi seule. À chaque fois je me suis réveillée en sursautant, à bout de souffle, le cœur battant à tout rompre.
Je regarde l’écran de mon téléphone, il est bientôt 6 heures, il vaudrait mieux que je me lève ; à quoi bon courir après quelque chose qui me fuit ? Je sors de mon lit, m’étire longuement et me dirige vers la fenêtre. Je l’ouvre en grand et regarde le soleil qui pointe timidement le bout de son nez, sa lumière orangée dissipe doucement la noirceur de la nuit. Cet air matinal me fait beaucoup de bien. Je me sens libérée de l’étau qui me comprimait cette nuit. Je respire un grand coup, admirant la beauté de l’aube, et me laisse porter par son calme. J’entends la porte de chez moi s’ouvrir, mon père, aussi réglé qu’une horloge suisse, est déjà en train de se diriger vers sa Nevada. Je crois bien que cette voiture est aussi vieille que moi si ce n’est plus, les portières ne se verrouillent même plus et elle démarre une fois sur quatre. Je ne sais pas pourquoi il la garde encore. Je profite de son départ pour descendre me préparer un petit déjeuner.
Notre maison n’est pas très grande, mais elle a su nous donner tout l’espace nécessaire à mon frère, mon père et moi. Je traverse le salon et entre dans la cuisine pour me préparer un café au lait et quelques tartines que j’avale difficilement. C’est la première fois depuis mon accident que je mange un vrai repas. Hier j’ai simplement mangé des gâteaux qui traînaient dans ma chambre et j’ai somnolé sur mon lit. Capuche sur la tête et écouteurs aux oreilles, je me réfugie dans les titres de la playlist Mode blues de mon iPod en finissant mon café. Le mode blues est un terme qu’on avait inventé avec Maria pour les moments où on n’avait pas trop le moral. Je sens mon portable vibrer dans ma poche, il est à peine 7 heures, qui peut m’envoyer un message à cette heure-ci ? Ce que je redoutais est arrivé, la pensée que je fuyais depuis hier revient me hanter de plein fouet. C’est un texto de la mère de Maria qui m’annonce la date de l’enterrement. J’aurais dû l’appeler hier, au moins pour lui présenter mes condoléances et lui apporter mon soutien. Je retardais l’échéance au maximum, prétendant que je préférais la voir directement, mais inutile de se voiler la face, j’ai juste honte. Honte de me retrouver face à elle sans pouvoir lui donner la moindre explication. L’enterrement aura lieu demain après-midi, au cimetière de Talence, et sera suivi d’une cérémonie chez eux. Je relis le message encore une fois, j’ai beaucoup de mal à réaliser qu’il s’agit de l’enterrement de ma meilleure amie. Je n’ai jamais connu de deuil, à part celui de ma mère, mais j’étais bien trop petite pour comprendre ce qu’il se passait.
Que dois-je faire ? L’appeler ? Lui demander s’ils ont besoin d’aide, besoin de quelque chose ? Je ne sais pas. Je fourre mon téléphone dans ma poche et termine ma tasse de café. Je verrai plus tard.
***
Ne jamais remettre les choses à plus tard, c’est ce que mon père me disait tout le temps, mais je ne l’ai jamais écouté. Pourtant je veux bien admettre que pour ça, il a raison. L’enterrement est dans quelques heures et je n’ai pas osé répondre à madame Garcia. Je voulais juste oublier tout ça, enfermer mes soucis dans la même cellule que celle de mes souvenirs et ne plus en entendre parler. Mais voilà qu’à trop fuir, je me retrouve à devoir justifier ma distance en plus de l’accident. Surtout que je ne sais toujours pas ce qui s’est passé et je n’ai aucune nouvelle de la police. Lombard m’a laissé sa carte au cas où j’aurais du nouveau, mais elle est toujours dans mon sac. En réalité, je ne suis pas sûre de vouloir savoir, mais je ne peux pas fuir plus longtemps. Je dois me préparer pour voir ma meilleure amie une dernière fois.
Je n’ai aucune tenue pour ce genre d’événement. J’ai beau fouiller dans mon armoire, je ne trouve rien d’adéquat. Je sais que mon père a gardé toutes les affaires de ma mère, souvent j’ai voulu y jeter un coup d’œil, mais je trouvais ça quand même bizarre. Je crois que je n’ai plus trop le choix. Je me dirige nerveusement vers la chambre de mes parents, enfin, l’ancienne chambre. Mon père n’y dort plus depuis aussi longtemps que je m’en souvienne. Il passe tout son temps dans son bureau où il a installé un clic-clac. Une sensation étrange me parcourt l’échine en franchissant le seuil de la porte. Je n’y suis pas retournée depuis mon enfance et j’ai l’impression que tout y est encore à l’identique. Comme dans un sanctuaire, l’obscurité règne, obligeant mes yeux à s’y habituer, et seule une petite ouverture laisse glisser un faible faisceau de lumière où la poussière danse comme sous un projecteur. L’odeur de renfermé est accompagnée d’une légère touche vanillée, ma mère avait beaucoup de bougies parfumées et je sais que les senteurs de vanille et de coco étaient ses favorites. J’allume la lumière et avance jusqu’à son armoire ; ses vêtements sont toujours là, suspendus sur des cintres, tous protégés par une housse en plastique. Je regarde de plus près sa garde-robe, cherchant une tenue foncée et sobre. Une robe noire attire mon attention, elle est toute simple, manches trois-quarts, longue jusqu’en dessous des genoux. Je la sors du plastique, elle n’est finalement pas noire mais bleu marine, un ruban très discret entoure la taille et trois boutons argentés referment le col, elle fera l’affaire.
Il est déjà 13 heures ; après avoir enfilé à la hâte la robe de ma mère, je m’attarde un petit moment devant le miroir. Avec le temps, je trouve que je lui ressemble de plus en plus, j’ai les mêmes cheveux châtains qui ondulent jusqu’aux épaules et ses grands yeux marron. Je n’ai cependant pas hérité de son joli teint hâlé, les gènes de cachet d’aspirine de mon père ont pris le dessus. Il est presque temps d’y aller, une drôle de sensation commence à m’envahir comme si j’avais la nausée, je presse un peu de citron dans un verre d’eau sucré et le bois pour me faire passer l’envie de vomir, ce n’est pas le moment de flancher.
Le cimetière municipal se trouve au centre-ville, près de la mairie et du château de Peixoto. Il est entouré d’un joli parc, de belles fleurs bordent une pelouse parfaitement taillée, je sens l’odeur de l’herbe fraichement coupée mélangée à celle de la terre mouillée. Des oiseaux se disputent des miettes de pain près des bancs en fer forgé de l’allée qui mène à l’entrée du cimetière. Un long muret en béton entoure le cimetière, laissant seulement apparaître le haut des tombes blanches et certaines sculptures funéraires. J’arrive devant l’entrée, un grand portail noir est épaulé de deux piliers colossaux s’assurant que la frontière entre le monde des morts et celui des vivants est bien gardée. Je remarque que quelqu’un est assis sur un banc un peu à l’écart, il se tient la tête dans les mains, les coudes sur les genoux. Il lève la tête en entendant mes pas crisser sur le gravier. Il se lève d’un bond et se dirige vers moi, la démarche mal assurée. Je me retourne, croyant qu’il s’avance vers quelqu’un d’autre, mais je comprends que c’est moi qu’il vient voir.
— Sarah ? C’est bien toi ?
— On se connait ?
Il sourit d’un air triste. Je ne l’ai jamais vu, je ne sais même pas comment il connait mon prénom.
— Non, pas vraiment, c’est juste que Maria m’a tellement parlé de toi, répond-il.
— Tu connaissais Maria ?
Ses yeux se mettent à briller et je le vois tirer sur les manches de son pull, les mains tremblantes. Son jean a l’air bien trop grand et trop lourd pour lui. Une averse pourrait le terrasser.
— Oui, je la connaissais bien, répond-il.
Je reste perplexe, je connais Maria depuis la maternelle, on était tout le temps ensemble et je n’ai aucune idée de qui ça peut être. Peut-être un ami de la fac, mais le voir aussi dévasté me perturbe.





























