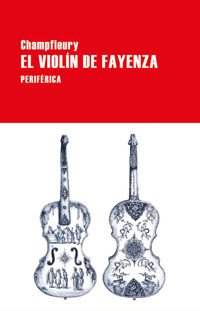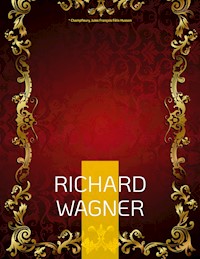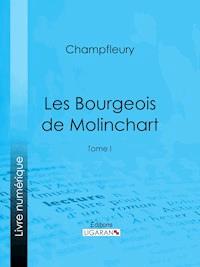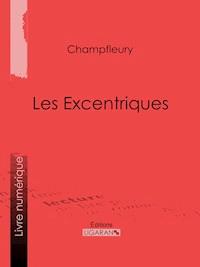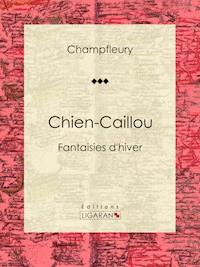Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Extrait : "À l'âge de cinq ans, je me vois au milieu d'un magasin de jouets et de confiserie qui me faisaient ouvrir de grands yeux et promener une langue de convoitise sur mes lèvres. À cette époque seulement les souvenirs des premières années prennent corps et se profilent dans mon cerveau."À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARANLes éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes. LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants : • Livres rares• Livres libertins• Livres d'Histoire• Poésies• Première guerre mondiale• Jeunesse• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 313
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335050721
©Ligaran 2015
Certains peintres se sont plu à se représenter entourés de leurs parents, de leurs amis, de leurs voisins ; en évoquant ces sensations intimes, des artistes même médiocres ont laissé des toiles intéressantes ; ils travaillaient pour leur propre jouissance, sans se préoccuper, du public. La même pensée m’a guidé en écrivant ces souvenirs. À une époque fatale où il fallait oublier, vers le milieu de l’Empire si prospère, disait-on, au commerce et à l’industrie, j’essayai, en inventoriant mon propre fonds, d’échapper aux soucis qui emplissaient l’esprit de ceux qui, ne s’étant pas rattachés à la littérature de cour, devaient faire de vifs efforts pour échapper aux lourds assoupissements, chasser l’amère mélancolie des oiseaux en cage et ne pas transformer leurs aspirations en sifflets.
Que de soucis emplissaient alors la plupart des esprits ! Combien d’ombres voilaient de rayons ! Quels épais brouillards s’opposaient à toute tentative intellectuelle ! Aucun des hommes de cette génération n’a oublié la suppression de la Revue de Paris, la condamnation qui atteignit le poème des Fleurs du mal, les poursuites exercées contre le roman de Madame Bovary, le dommage causé à la librairie par les injustes arrêts de la Société de colportage du Ministère de l’intérieur, la pression exercée sur de timides directeurs de journaux par des censeurs sans mandat officiel, le développement et les encouragements accordés à de scandaleuses chroniques et l’abaissement intellectuel qui s’en suivit. Non, il n’est pas possible de l’oublier.
Il était facile à cette époque de se croire dangereux : il suffisait d’avoir une opinion artistique qui ne fût pas d’accord avec celle de la foule. « Tu penses comme toi, me disait un sceptique de mes amis, prends garde au préfet de police. »
Aussi, craignant d’être injuste et juge dans ma propre cause, hésitai-je longtemps à publier ce livre, malgré les encouragements d’esprits distingués qui avaient bien voulu en prendre connaissance.
Écrits du vivant des personnages, ces souvenirs pouvaient gêner le développement de quelques-uns qui avaient été si longtemps gênés et paralysés.
Il n’en est plus de même aujourd’hui. La plupart de mes compagnons de jeunesse ont terminé leur mission ; et il m’a semblé que l’heure était venue de donner l’historique d’un petit groupe d’hommes pour qui l’art était un but et non un moyen, gens désintéressés et sans ambitions mauvaises (sauf une seule et fatale exception). Aucun d’eux ne fut détourné de sa route par l’appât du tribut considérable qu’un public blasé payait à ceux qui flattaient ses goûts ; quelques-uns acceptèrent de vivre à l’aventure pour garder leur indépendance ; vaillants lutteurs qui s’efforçaient de rendre difficile cette littérature appelée trop facilement facile, tous portant le fardeau de leurs croyances et en étant récompensés par des joies solitaires.
Sèvres, Juin 1872.
À l’âge de cinq ans, je me vois au milieu d’un magasin de jouets et de confiserie qui me faisaient ouvrir de grands yeux et promener une langue de convoitise sur mes lèvres. À cette époque seulement les souvenirs des premières années prennent corps et se profilent dans mon cerveau.
Mes parents avaient à élever deux fils et une fille ; la modeste dot de ma mère et les appointements de mon père ne suffisaient pas à l’éducation qu’on rêvait pour les enfants : ma mère entreprit d’augmenter les revenus du ménage en se mettant à la tête d’une boutique d’objets divers, quoiqu’en 1826, une petite ville de province, située sur une montagne d’un abord difficile, n’offrît pas des chances considérables de commerce. Il faudrait aller aujourd’hui au fond de la Bretagne pour retrouver la physionomie d’une boutique de Laon à cette époque, et peut-être ne serait-elle pas restée si vivace dans ma mémoire sans la fantastique entrée d’un chevreuil, poursuivi par des chasseurs, qui fut reçu à bras ouverts par les poupées et les pantins ignorant les dommages que les bois de l’animal allaient causer à leurs riches vêtements.
Les conséquences de cette visite bizarre ont été contées avec trop de détails dans les Bourgeois de Molinchard pour que je m’y arrête plus longuement.
Les enfants sont fureteurs comme les chats. Mon premier soin fut de parcourir du bas en haut la boutique et ses dépendances ; cette curiosité fut récompensée par la découverte de singuliers habits bariolés, garnis sur toutes les coutures de paillettes, de franges d’or et d’argent. Après avoir regardé ces habits avec timidité, je les touchai et fus assez audacieux pour me couler dans une longue culotte et une large veste à losanges bigarrées ; leur ampleur, ne m’empêchant pas de descendre triomphalement par le petit escalier de la boutique. On s’imagine l’effet produit par ce costume d’Arlequin dont la veste me tombait sur les talons, tandis que mon menton disparaissait dans le petit pont de la culotte.
Des gens du dehors s’étant collés aux vitres pour me voir en cet équipage, j’en conclus que rien n’était plus magnifique !
Pendant quelque temps je me donnai le plaisir d’apparaître à la fenêtre du grenier, habillé tantôt en moine, tantôt en bergère, un autre jour en Turc. Ces costumes excitaient tellement l’enthousiasme des galopins ameutés sur la place que, pour y mettre ordre, ma mère s’en débarrassa ; j’ai revu, trente ans plus tard, à la montre d’un perruquier, ces mêmes défroques, que peut-être les élégants du pays portent aujourd’hui encore, à l’époque du carnaval, la fraîcheur de ces déguisements n’étant pas le point essentiel.
Des rangées de masques de carton, accrochés dans le grenier, et l’intérieur des coulisses du théâtre sont les souvenirs les plus précis de ma vie d’enfant. Ce fut alors qu’un accident eut pour résultat de loger dans ma cervelle un fragment de poésie, le seul qui se soit accroché sérieusement à ma mémoire.
Mon père, en qualité de secrétaire de la mairie, jouissait de ses grandes et petites entrées au théâtre ; il correspondait avec les directeurs des troupes en tournée qui avaient pour mission de répandre dans la province les chefs-d’œuvre de la littérature dramatique de l’époque ; comme mon père était d’une humeur qui n’avait rien de bourgeois, qu’il aimait le théâtre et au besoin complimentait les actrices, son entrée dans les coulisses était vue d’un bon œil. Il me mena donc tout jeune « à la comédie » où, tout d’abord, un immense rideau bleu relevé par des torsades d’or me remplit d’admiration. Je ne saurais oublier cette toile imposante et le respect qu’elle m’inspira. Tout ce public impatient assis devant le magnifique rideau, démontrait suffisamment l’importance des scènes qui allaient se dérouler tout à l’heure.
Comme on tardait à commencer, mon père me fit monter sur le théâtre par un petit escalier noir. Quel effet me produisirent les femmes fardées, le mouvement des machinistes dans les coulisses et les brillants costumes militaires des hommes, car les comédiens allaient jouer le fameux mélodrame : L’assassinat du maréchal Brune.
Blotti dans le manteau d’arlequin, n’osant souffler, les yeux grands ouverts, tirés par les ficelles de la curiosité, je vis entrer de sinistres personnages à bonnets poilus enfoncés sur les yeux, la bouche perdue dans d’épaisses barbes noires, et des pistolets à la ceinture. Ces coquins chantaient d’une voix menaçante :
Ce sont, ai-je dit, les deux seuls vers que j’aie pu retenir de ma vie, non pas précisément à cause de leur lyrisme ; mais il en arriva comme pour la salamandre qu’aperçut tout jeune Benvenuto Cellini, et qui lui valut un si rude soufflet de son père avec cette admonestation : « Tu te souviendras de la salamandre. »
Obéissant à leur chef, les affidés de Trestaillon cherchaient à attirer dans une embuscade, pour l’assassiner, un jeune et élégant aide de camp en culottes collantes et en bottes à l’écuyère. Les pistolets des bandits braqués du côté de la coulisse où je me tenais tremblant, la vue du meurtre qui allait s’accomplir sous mes yeux, autant que la peur de la détonation ; firent que je reculai : derrière moi se trouvait l’escalier du dessous du théâtre, où je roulai de marche en marche, en poussant un cri. Heureusement la souplesse de mes membres fit que je m’en tirai sans autre mal qu’une vive émotion : au bout de quelques instants, ayant rouvert les yeux, je me trouvai étendu sur un banc de gazon peint, au bas duquel se tenait une sorte de fée aux joues roses et aux lèvres de cerise, qui semblait une aimable figure de cire.
La fée me caressait, me couvrait de baisers et emplissait mes mains de dragées. Avec les yeux de la jeunesse, l’aimable comédienne m’apparaît encore aujourd’hui. L’émoi que lui avait causé ma chute soulevait sa poitrine et cette agréable vue me faisait oublier les affreux scélérats de la bande de Trestaillon.
À quelques années de là mon père me conduisit plus souvent au théâtre ; les pièces patriotiques de 1830 où des jésuites se cachaient dans des tonneaux de barricades quelques vaudevilles de Scribe, Trente ans ou la vie d’un joueur, les tirades d’Antony et les mélodies de la Dame blanche m’initièrent au drame, à la comédie et au lyrisme ; mais les acteurs m’intéressaient plus encore que les pièces
Même les ouvriers qui touchaient au théâtre m’apparaissaient entourés d’une sorte d’auréole. Il n’est pas jusqu’au garçon d’accessoires, le menuisier Danguillaume, chargé de manœuvrer les décors, qui ne me semblât surnaturel. Près, de la toile, à l’intérieur des coulisses, je ne saurais oublier le machiniste, un vieux garçon bossu, dévorant des yeux tout ce peuple de comédiens se démenant sur les planches, et qu’en dehors de ses fonctions on surprenait sous les ormes des promenades, creusant depuis plus de vingt ans le rôle de Tartuffe.
Que sont devenus, après trente ans, ces gais comédiens, râpés, maigres, pâles, qui communiquaient à l’intérieur des coulisses, si noires en plein jour, les reflets de leur insouciance ?
La jeunesse aime les gens de théâtre parce qu’ils restent toujours jeunes, contents de peu, se grisant d’applaudissements, la bourse vide, le cœur plein d’illusions. C’étaient des acteurs de vaudevilles, des chanteurs de petits opéras-comiques ; la chanson ne les quittait pas : ils chantaient en attendant la répétition, assis sur les marches qui conduisent au théâtre ; ils recevaient leurs créanciers en chantant.
Dans les études de notaires, les clercs baissaient tristement la tête en songeant au départ des actrices qui, sans s’inquiéter de ces tristesses, remplissaient de roulades joyeuses la rotonde de la voiture.
Au bas de la montagne une grisette trempait son mouchoir de larmes à la vue du séduisant jeune premier qui rêvait déjà à d’autres conquêtes, et sous les marronniers un sous-lieutenant tordait de dépit ses moustaches en entendant la chanson de la grande coquette.
Les ingrats chantaient en quittant Laon ; dix lieues plus loin, ils annonçaient leur arrivée à Soissons par des chansons.
La volonté de sourire des lèvres amène le sourire au cœur. Il en est de même de la chanson ; chanter mécaniquement provoque la gaîté intérieure. Tous ces ragotins étaient gais et triomphants, certains du prestige que donnent les planches et le fard. Les femmes pouvaient être impunément maigres et grêlées, les forts premiers rôles cagneux et bancroches. Une robe de velours fané, du strass sur la tête, du paillon à la ceinture, des bottes jaunes en entonnoir, des pourpoints couleur abricot, des toques crénelées, faisaient aussitôt de ces comédiens d’héroïques personnages pour lesquels le parterre et les secondes n’avaient pas assez d’yeux et d’oreilles.
C’étaient réellement des êtres surnaturels. On comptait dans la bande quelques vieux brûleurs de planches qui avaient certainement enthousiasmé les quatre-vingt-six départements. Le théâtre semblait leur communiquer une vie nouvelle ; on n’entendait jamais parler de leurs maladies, et discrets comme les animaux, ils attristaient rarement les humains par le spectacle de leur mort.
J’ai vécu avec eux jusqu’à vingt ans et quelquefois je pense, en souriant ; aux Trial et aux Dugazon-corset du théâtre de Laon.
Certains quartiers anciens de Rouen peuvent donner une idée des rues de Laon avant la révolution de Juillet. C’étaient de vieilles bâtisses à pignons, sillonnées de poutres revêtues d’ardoises ; si des auvents abritaient les passants contre la pluie, ils empêchaient le jour d’entrer dans de petites boutiques où toutes sortes de merceries étaient entassées. La plupart de ces masures, semblables à des vieillards voûtés dont les jambes commencent à refuser le service, se groupaient serrées au bas de la tour colossale de Louis d’Outremer dont elles faisaient encore valoir la hauteur.
On a pour système actuellement de détruire les cadres des anciens monuments pour les entourer de vastes places. Ce sont des empereurs sans sujets. L’espace les amoindrit et les rapetisse. Les échoppes qui y étaient adossées formaient une échelle de proportions.
À Laon, on ne se contenta pas de détruire le cadre, on démolit le tableau du même coup. Cette tour imposante, située au milieu du vieux bourg, tomba, et avec elle les souvenirs de l’affranchissement des communes parti du plateau de la montagne. L’iconoclaste sans le savoir est quelquefois aussi dangereux que l’iconoclaste emporté par le courant révolutionnaire. En 1793, le peuple avait voulu abattre la tour, en haine des souvenirs féodaux ; il ne réussit qu’à détacher quelques pierres du couronnement : en 1830, un conseil municipal bourgeois, pour construire un hôtel-de-ville régulier, décréta la démolition du monument. En voyant la platitude architecturale qui orne la place actuelle de la mairie, on comprend l’indignation que causa à Victor Hugo ce vandalisme d’une si médiocre utilité.
Sans doute, les peintres et les poètes ont abusé du pittoresque, des anciennes maisons de bois, des ruelles tortueuses, des fouillis de constructions bizarres. Une vieille ville ne saurait être prise pour un de ces objets de curiosité conservés dans les musées avec la sacramentelle pancarte : Ne touchez pas. C’est pourquoi un utilitaire aurait raison de dire que les larges voies, les constructions aérées, le soleil et l’air qui traversent les grands espaces font oublier la pauvreté de lignes des habitations modernes : il pourrait ajouter également que c’est un signe de décrépitude que de pleurer sur le passé, si on met en regard les bienfaits du présent, l’accroissement de la durée moyenne de la vie et du bien-être. De telles raisons ont leur poids ; mais je parle de ce que je voyais dans ma jeunesse avec des yeux d’enfant, sans préoccupation d’utilitarisme.
Une ancienne église dont les délicates trouées ogivales étaient remplies de plâtre, servait de boutique à un marchand de vaisselle ; dans les meneaux brillait l’émail des faïences au fond desquelles picoraient des coqs rouges triomphants. C’était un des côtés du décor. Une boutique d’épicerie, couleur vert-pomme, faisait l’angle de la rue Châtelaine, avec un cœur pour enseigne et d’immenses cartes à jouer peintes au centre. Les armuriers, les marchands de bonneterie, les chapeliers ornaient leurs devantures de symboles de leur industrie : arquebuses hautes comme la maison, bas qui auraient pu servir à Gargantua, chapeaux de « larbins » peints en rouge, le tout d’une dimension excessive et stupéfiante.
Sur une montée escarpée plantée d’arbres, s’étageait la mairie, flanquée de la tour Louis d’Outremer, qui semblait un factionnaire-géant pour la garder. D’anciens bâtiments faisant face, étaient percés de voûtes qui communiquaient à une petite place appelée placette : là se voyait la vieille maison d’un maître de danse dont le pignon, peint à fresque, représentait une balustrade de jardin d’où un gros chat noir s’élançait sur des souris.
Aujourd’hui, plus de traversées, plus de placette, plus d’arbres ! Une médiocre statue de général, un monument municipal d’une forme sans formes remplacent la prison de Louis d’Outremer. J’aime mieux me rappeler les masures, la vieille tour, les enseignes monumentales, les faïences à coq et le chat noir de la maison du maître de danse.
Il reste d’ailleurs à la ville un décor que rien ne peut modifier.
De quelque côté que vienne le voyageur, de Paris, du Soissonnais, de la Flandre française ou des Ardennes, la montagne de Laon et sa gothique cathédrale apparaissent à l’extrémité de longues avenues de peupliers. La montagne semble inséparable de la cathédrale comme la cathédrale l’est de la montagne : l’une ne saurait se passer de l’autre. L’architecte a trouvé dans la nature un majestueux piédestal qui donne du relief aux principales lignes de la statue.
Du Nord, qui est la principale voie ouverte aux voyageurs, Laon semble un hameau situé sur une montagne, avec un monument hors de proportions pour le peu de maisons qu’il abrite. La ville se blottit derrière de vieilles murailles et des charmilles d’ormes : comme un lézard, elle s’étale au soleil du côté du Midi et préfère regarder les coteaux accidentés de Bruyères, de Vorges, de Presles, de Nouvion-le-Vineux, plutôt que le plat territoire qui conduit d’un côté à Saint-Quentin, de l’autre à la Champagne pouilleuse.
Mais la cathédrale n’a pas tout dit dans sa première rencontre avec le touriste. À mesure qu’il approche, des profils étranges d’animaux à cornes se détachent, posés sur la dernière marche des escaliers à jour des hautes tourelles de l’église. Ces grands bœufs impassibles sont-ils la symbolisation du concours qu’ils prêtèrent à l’érection de la cathédrale ou témoignent-ils que déjà au XIe siècle le pays fût consacré à la culture ? Fantastiques dans leur immobilité et regardant l’horizon à dix lieues à la ronde, ces bœufs arrêtent longuement les yeux du voyageur qui ne se reportent que plus tard sur les jardins accrochés aux flancs de la montagne, les méandres d’une longue route blanche se détachant sur la verdure des gazons, les grimpettes escarpées semblables à des chemins de chèvres et les vieilles murailles qui enserrent la ville. Tout est verdure et tranquillité sur le plateau. La jolie situation ! On croirait que La Bruyère l’a voulu peindre : « J’approche d’une petite ville et je la vois dans un jour si favorable que je compte ses tours et ses clochers. Elle me paraît peinte sur le penchant de la colline. Je me récrie et je dis : Quel plaisir de vivre sous un beau ciel et dans un séjour si délicieux ! Je descends dans la ville, où je n’ai pas couché deux nuits que je ressemble à ceux qui l’habitent : j’en veux sortir… Il y a une chose qu’on n’a point vue sous le ciel et que selon toutes les apparences on ne verra jamais : c’est une petite ville qui n’est divisée en aucun parti ; où les familles sont unies et où les cousins se voient avec confiance ; où un mariage n’engendre point une guerre civile ; où la querelle des rangs ne se réveille pas à tout moment pour l’offrande, l’encens et le pain bénit, pour les processions et pour les obsèques ; d’où l’on a banni les caquets, le mensonge et la médisance. »
Ces misères de la vie de société qui s’appliquent à toutes les villes, aux grandes aussi bien qu’aux petites, ne sauraient gâter la vue du paysage. En face de ces beautés naturelles, l’esprit oublie vite et s’élargît avec l’horizon. Plus de souvenirs de mesquineries bourgeoises ! Tout est bon pour les yeux : le nuage qui passe, le rayon de soleil, l’ombre transparente s’allongeant sur le gazon. Plus de ces laideurs dont la civilisation marque le masque de l’homme ! Tout dans la nature offre de belles lignes : les bouquets d’arbre, les vallons, les collines.
Au bas de ces coteaux fécondés par le travail, la vie doit être facile : la verdure claire et légère pousse sans les efforts que demande la lourde et compacte verdure de contrées moins favorisées.
On a plus d’attachement, je le crois, pour la montagne que pour la plaine : cette mère grave et affectueuse n’offre-t-elle pas plus de beautés variées et n’appelle-t-elle pas des yeux plus respectueux ?
Je songe à un peintre de paysage qui vivrait sans cesse avec la montagne et ne se lasserait pas d’en noter les divers aspects. Une vie bien remplie y suffirait à peine. La montagne fournirait des motifs toujours nouveaux, car ombres et lumières sont inépuisables dans leurs jeux.
Plus d’une fois, j’ai oublié les fatigues de la vie parisienne, en faisant, solitaire, le tour de la ville, sous les vieux ormes, dont un air vif agite le feuillage : verdures salutaires à l’esprit aussi bien qu’à la vue, bains de fraîcheur et de lumière pour le corps et le cerveau. À l’horizon, tout est riant, vivace et plantureux : le frisson des peupliers encadrant de grands prés, de gais villages adossés à la lisière de petits bois, des blés jaunissants s’inclinant et se relevant suivant le souffle du vent, des hameaux aux toits d’ardoises étincelantes et, dans la zone qui regarde le Soissonnais, un assemblage de verts de toutes nuances que la nature s’est plu à prodiguer, comme une symphonie harmonieuse.
Il est une autre partie du plateau qui forme davantage tableau pour ceux qu’éblouiraient ces luxuriants massifs d’arbres et de prairies. Du côté de la promenade Saint-Jean, la montagne ouvre ses flancs à des vignes que baigne le soleil. C’est la cuve qui forme fauteuil avec deux ondulations de terrains pour bras. D’un côté se pressent les maisons de la ville, de l’autre une ancienne abbaye, qui regardent cette bienheureuse vigne assise comme dans le giron de sa nourrice ; au pied s’étale la petite propriété morcelée, offrant mille combinaisons de couleurs et de formes, certains terrains allongés, certains autres trapus, ceux-ci taillés en languettes, ceux-là en pointes et s’insinuant dans une prairie voisine, quelques-uns ondulés, coupés par des fossés, bordés de longs peupliers ou de saules rabougris, d’autres encadrés dans des haies de sureaux ; l’ensemble faisant penser à un lavis d’architecte aux tendres nuances qui se confondent doucement avec l’horizon.
Dans l’été, alors que la floraison s’épanouit, il faut voir, du haut de la montagne, ces vastes terrains où le seigle succède à l’avoine et au blé. Tout pousse à la fois dans les clos, tout pousse à l’aventure. De grandes nappes jaunissantes tranchent sur les verdures voisines : le sené prend ses ébats dans les champs où pointe la jeune avoine ; à côté, le rose sainfoin lance une note gaie à laquelle succèdent les tons discrets et mélancoliques des pavots en fleurs.
Pour cadre à ce panorama : des collines boisées, les clochers des villages situés sur des coteaux, des moulins à l’horizon, des massifs de verdures succédant à d’autres verdures et toujours la note verte dominant, profonde, immense et lointaine.
À l’opposé de ce beau panorama, se trouve la promenade Saint-Just qui en forme l’antithèse. Saint-Jean est une petite Provence, Saint-Just l’hiver semble une Sibérie. La lumière, le soleil, ont fait élection du côté de la « Cuve » ; l’humidité, la tristesse, règnent en souveraines dans le voisinage du cimetière. Là souffle la bise dans toute sa rigueur : à la fin de l’automne, quand viennent les froids noirs, la neige amassée y fond difficilement et je ne sais quelle flamme parcourt les veines des amoureux qui, le soir, s’y donnent rendez-vous.
Peut-être le cimetière, qui du plateau se déroule en étages sur le versant accidenté de la montagne, communique-t-il à la promenade Saint-Just une couleur mélancolique ? Ce n’est point toutefois l’imagination qui fait que les rochers sur lesquels s’appuient les remparts sont plus sauvages, les murs plus ébréchés qu’ailleurs, qui empêche les oiseaux de chanter sous l’épaisse verdure des ormes !
On y rencontre rarement les petits rentiers, qui un parapluie sous le bras, sont les seuls êtres animés des promenades voisines.
Pour ceux qui n’ont pas abusé des passions, la vie se prolonge sur la montagne de Laon, si escarpée que les épidémies semblent ne pouvoir y grimper. À chacun de mes voyages, je retrouve de petits vieillards proprets, en houppelande, la tête couverte d’une perruque, que déjà en 1830 je voyais avec les mêmes allures, les mêmes habits, et portant sous le bras le même grand parapluie et sur la tête la même perruque. D’habitude ils se promènent seuls, arpentant la montagne, la jambe sèche, le teint coloré : quelquefois on les rencontre deux sur un banc de pierre, faisant des trous en terre avec la pointe de leurs grands parapluies et coupant ce travail par des conversations sur le beau temps.
La province a marqué de son cachet ces petits rentiers, ces anciens officiers, ces marchands retirés qui trouvent le bonheur dans l’habitude et se sentent vivre quand tant de gens inquiets s’agitent et se jettent dans le tourbillon des vains plaisirs. Que sont les spectacles et les toiles d’Opéra en regard des décors sans cesse renouvelés que la nature déroule pour ces vieillards ?
Je pense à mon père, qui, lui aussi, fut longtemps l’hôte de ces promenades ; mais il ne ressemblait en rien à ces bonshommes si tranquilles. Une flamme active était son partage. Sans cesse pensant et monologuant, cherchant à calmer la pensée par l’agitation du corps, n’ayant pas trouvé dans la petite ville carrière à son imagination, trop sincère pour vivre au milieu des hommes, mon père, vers l’âge de quarante ans, s’était jeté dans les bras de la nature.
– Viens voir ma salle de spectacle, disait-il, en m’entraînant au bas de la montagne. La salle de spectacle était un grand pré vert entouré de peupliers.
Jules César, dans ses Commentaires, parle de Gaulois curieux, avides de savoir ce qui se passe à l’étranger, interrogeant chacun. – Quelles nouvelles ? – Que se passe-t-il dans le monde ? – Quoi, vous arrivez du dehors et vous ne savez rien ! – À quoi êtes-vous bon ?
Mon père ressemblait à ces anciens Gaulois : curieux, questionneur, il voulait tout savoir, tout connaître. À peine assis pendant cinq minutes dans un wagon, il eût certainement connu l’histoire de tous les voyageurs.
Un archéologue de mes amis était veau un jour à Laon pour étudier la cathédrale.
– J’ai rencontré au pied de la montagne, me dit-il, un vieillard à qui je demandai la route la plus courte, et qui en échange a voulu savoir quels motifs m’appelaient dans la ville, qui j’étais, le lieu de ma naissance, le nombre de mes enfants… Est-ce que tous vos gens de Laon sont aussi curieux ?… Mais voilà l’homme ! s’écrie l’érudit, en apercevant mon père qui, d’un pas alerte, rentrait chez lui avec sa provision de nouvelles.
Une sorte d’occupation pour cette nature condamnée à broyer à vide ses pensées.
Discuteur politique intrépide, mon père tenait pour l’ordre sous tous les gouvernements. Il chanta le règne de Charles X, prêta son concours aux d’Orléans ; seule la République de 1848 ne le comptait pas parmi ses enthousiastes. Mais que la bourgeoisie est variable !
Comme la plupart des enfants d’un pays qui subit l’invasion de 1814, mon père, sans professer un culte excessif pour Napoléon, n’en était pas moins bonapartiste. Vers la fin de sa vie, fort occupé à rimer, quoique le signe brûlant de la poésie n’apparaisse pas dans ses brochures, mon père célébrait en vers l’élection du Président, s’insurgeait contre les partisans de Cavaignac et s’emportait contre ceux qu’il soupçonnait d’être hostiles à l’Empire. Un jour que la politique était sur le tapis : – Je deviens vieux, me dit mon père ; avant de mourir je voudrais voir autre chose.
Tel est le bourgeois, tels sont la plupart des conservateurs et défenseurs des dynasties, qu’ils soient légitimistes, orléanistes ou napoléoniens. Une moyenne de dix ans écoulée, le bourgeois « ami de l’ordre » se fatigue de la forme gouvernementale : il désire voir autre chose !
Je voudrais peindre mieux encore mon père et sa mobile humeur. Curieux de tout savoir, avide de lectures, clignant d’un œil sceptique à chaque évènement, méprisant l’opinion des masses, absolu dans ses jugements, dominé par les nerfs, la parole brève, se plaisant dans la société des femmes, ayant conservé dans la vieillesse la verdeur de l’âge mûr, affichant nettement son opinion sur toutes choses sans s’inquiéter du rang de son interlocuteur, et son humeur capricieuse éclatait d’autant plus qu’elle se sentait comprimée, nature vivace à laquelle il fallait l’air de la montagne, s’emportant à la moindre contradiction, fier de sa personnalité et ne prenant pas à tâche de la déguiser, mon père, dans d’autres milieux, fût devenu un homme remarquable ; la province l’étouffa.
Malgré une certaine insouciance paternelle, dont j’ai porté la peine, je me rappelle avec émotion cet honnête homme, laborieux, ami du bien, que l’injustice mit hors d’état de rattacher les fils d’une vie brisée.
Philosophe bourgeois, n’aspirant ni aux biens ni aux honneurs, regardant de tout temps la mort avec assurance, le vieux Picard (ce fut son pseudonyme de poète), repose aujourd’hui dans le cimetière Saint-Just, dont il visitait volontiers les versants, trouvant, disait-il, la place bonne pour voir passer, du fond de sa tombe, le chemin de fer !
Toute la vie l’imprévu fut à peu près mon seul maître ; il joua surtout un grand rôle dans ma jeunesse en ce qui touche particulièrement à l’éducation : encore enfant, je fus affamé de lectures à la diable, sans ordre ni méthode, attiré par toute chose imprimée. N’ayant guère appris régulièrement que la lecture, l’orthographe et la musique, le reste entra par aventure dans mon cerveau et s’y logea Dieu sait comme.
Si j’excepte ma mère d’une douce, mélancolique et affectueuse physionomie, tous mes parents étaient âgés, bizarres, ne quittant pas leurs fauteuils et appartenant par leurs costumes à d’autres époques. Des chambres de ces vieillards s’échappaient de singuliers parfums des quatre-fleurs, tièdes et pharmaceutiques ; tout bruit à l’intérieur étant exclus, j’en profitais pour courir dans de grands jardins dont les arbres et les plantes poussaient à leur fantaisie, pour arpenter du haut en bas de vastes maisons dont les corridors n’étaient animés que par des profils en pastel de dames et de messieurs d’anciennes générations qui se regardaient sans rire, avec des perruques monumentales et des chignons traversés par de longues aiguilles à tricoter. Après avoir donné un coup d’œil aux lèvres pincées de ces grands-parents majestueux, j’avais soif de fréquenter des êtres moins imposants et on me trouvait plus souvent à la cuisine qu’au salon.
Ce qui m’attirait particulièrement près de la cuisinière était deux volumes dépareillés d’un Gil Blas crasseux, mais orné de barbares figures. Dans quelle émotion me plongeaient la caverne, le capitaine Rolando et la vieille Barbara !
Singulière révélation d’un beau livre ! Je ne peux relire ; aujourd’hui Gil Blas sans les émotions du passé ; mais il me faut les décors du temps, c’est-à-dire la même édition, la même reliure et les mêmes abominables gravures.
En furetant dans la bibliothèque de mon père, je tombai sur un Molière que vers l’âge de sept ans, je lus et relus et que j’allai réciter à ma mère avec des joies sans pareilles. Les Fourberies de Scapin, la cérémonie du Malade imaginaire me transportaient dans un monde idéal de coups de bâton, aussi merveilleux pour moi que le paradis. – Allons, fou ! disait ma mère, dont la gravité maladive ne pourrait être rendue que par certains portraits ascétiques de Philippe de Champagne ; mais je n’en continuais pas moins ma lecture et je donnais sans doute un accent si particulièrement grotesque à l’interprétation de ces « divertissements », que mon entrain amenait un pâle sourire sur les lèvres de ma mère.
Aux comédies de Molière il faut joindre les Contes de Perrault, les Mille et une nuits, Robinson, les Voyages de Gulliver, Don Quichotte, qui formèrent le fonds de mes lectures d’enfance. Ce fut le plus clair de mon éducation.
Il se glissa bien au milieu de ces chefs-d’œuvre une certaine quantité de romans médiocres ; mais les mauvais livres n’ont pas sur le cerveau l’action malsaine que chaque année, à la Chambre, de graves orateurs se plaisent à leur attribuer.
Deux cabinets de lecture tout entiers s’engouffrèrent en moi sans étouffer les sensations produites par Molière, Cervantes, Perrault, Swift et de Foë.
Aux rares heures où les soins de son ménage lui laissaient quelques loisirs, ma mère feuilletait volontiers les pages d’un La Bruyère qui ne quittait guère son panier à ouvrage ; je reculai longtemps devant ce livre dont l’enfant ne peut comprendre le sens. Il faut avoir souffert pour goûter le misanthrope qui a recouvert les froissements de son cœur d’une phrase étoffée, semblable aux portraits du temps.
Mon père me donna l’hiver quelques leçons : j’écrivais sous sa dictée divers passages des bons auteurs. Si cet enseignement avait continué, j’aurais pu tout apprendre. Ces exercices furent abandonnés, je ne sais pourquoi, et mon instruction fut enrayée.
Il est présumable qu’un mauvais enseignement de mes professeurs développa au collège une indiscipline que ni menaces, ni pensums, ni corrections ne pouvaient vaincre. Mathématiques, latin, grec, autant d’objets de terreur ! Un condamné à mort qui aperçoit l’échafaud n’offre pas un état de prostration plus complet que celui où je tombais quand, appelé par le professeur devant un sinistre tableau noir, je me trouvais en face d’une formule algébrique.
La musique prit la place de l’instruction classique : familiarisé tout jeune avec les aridités du solfège, je chantais dans les églises ; au dehors je soufflais dans toute sorte d’instruments. C’en fut assez pour m’enlever les nombreuses punitions que mon inaptitude en grec, en latin et en mathématiques m’attirait journellement.
À combien d’embarras dans la vie est exposé un être timide ! Mes études furent arrêtées en outre, dès la classe de sixième, par la disparition de mes grammaires et de mes dictionnaires dont un de mes camarades, qui garda constamment l’anonyme, se chargea de me débarrasser : je n’osai avouer cette perte à mon père et je me trouvai dans la situation d’un menuisier chargé de raboter une planche sans outils.
Privé des livres indispensables à la confection des thèmes et des versions, j’en étais réduit à feuilleter à la hâte les dictionnaires de mes voisins ; mais le besoin incessant qu’ils avaient de s’en servir fit que l’impossibilité d’accomplir ma tâche m’enfonça dans une paresse extrême.
J’avais un compagnon, externe comme moi, et presque aussi insouciant que moi. Plus ouvert toutefois aux aridités mathématiques, il me venait en aide, arrivait d’habitude un quart-d’heure avant l’ouverture des classes, sur la promenade, vers un gros arbre dans les branches duquel il me trouvait juché, et il m’expliquait d’une façon quelconque les problèmes de la composition du jour, afin que je pusse présenter au professeur une page écrite.
Virgile détermina la catastrophe : Tityre, tu patulœ recubans fut ma ruine. En vertu de quelle loi il fallait scander les vers latins d’une certaine manière, c’est ce que mon cerveau se refusait à concevoir. Brèves, longues, césure, élisions, autant de mots de cabale. Les ×, les =, les ∷ les sinus et les cosinus géométriques ne me semblaient pas plus rébarbatifs que les églogues dont la douceur était cachée par cette damnée prosodie !
Certainement, le pédant ne savait pas présenter dépouillé de sa cire le miel virgilien que je regrette aujourd’hui de ne pas avoir savouré dans ma jeunesse.
Cette forteresse que la guerre de 1870 a rendue célèbre ne ressemblait en rien, au commencement du règne de Louis-Philippe, à l’ouvrage régulier que le génie éleva plus tard en vue de former une pointe menaçante sur la vallée, de commander les Ardennes à dix lieues et de défendre Paris en même temps que Laon.
La citadelle, en 1830, se composait de murailles démantelées contre lesquelles de pauvres gens avaient adossé des toits et divers matériaux de démolition pour y loger leurs familles. À quelques pas de la porte de la Plaine promenade qui longe les anciens murs des fortifications, deux choses étaient remarquables : une sorte de bastion élevé avec une unique petite fenêtre protégée contre le soleil par des persiennes vertes, et un personnage habillé d’une grande robe de molleton blanc qui, accoudé à la fenêtre du bastion situé au milieu de son jardin, ne se doutait guère que la couleur blanche de son vêtement servît de signal aux collégiens, car l’étoffe s’apercevant de loin avertissait les maraudeurs de ne pas escalader à cette heure les murs d’un endroit réputé par ses plantureux mûriers.
Une promenade, plantée de plusieurs rangées d’ormes, s’étendait parallèlement à la porte de la citadelle, à laquelle on arrivait par une chaussée bordée de murs formant pont au-dessus d’un fossé profond appelé le Jeu-de-Paume ; mais le gazon épais qui tapissait cet endroit indiquait que depuis longtemps les amateurs de la paume avaient renoncé à cet exercice.
Il n’en était pas de même d’un autre jeu, qui faisait les délices des collégiens assez favorisés de la fortune pour s’y livrer.
Près de la porte d’entrée de l’ancienne citadelle s’élevait un long bâtiment dont les fondations, plongeant dans le fossé du Jeu-de-Paume, portaient des murs qui pouvaient remonter à la fin du dernier siècle.