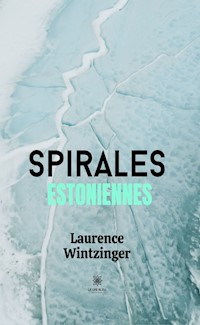
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Spirales estoniennes plonge le lecteur dans deux vies parallèles. Celle de Mikhel, jeune Estonien, ne sachant se positionner dans la nouvelle indépendance acquise par son pays en 1991 et celle de Kristina, une femme engagée auprès des héros oubliés, les Frères de la Forêt, dans les terribles combats menés contre les Russes lors du glacial hiver 1944. A priori, rien ne saurait les relier, si ce n’est un mystérieux carnet découvert par Mikhel dans la poche d’un vieux manteau russe…
Le jeune homme trouvera-t-il son salut en acceptant d’entrouvrir la porte du passé ?
À PROPOS DE L'AUTEURE
Laurence Wintzinger, auteure des romans
Azad et Marian et
Ruptures, l’ouvrier des grèves, nous propose de suivre ici l'une de ses petites histoires ancrées dans la grande Histoire.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Laurence Wintzinger
Spirales estoniennes
Roman
© Lys Bleu Éditions – Laurence Wintzinger
ISBN : 979-10-377-2886-9
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Pour A B M
Écrire, c’est instituer un monde imaginaire qui double au plus près le monde de la réalité, comme les doublures de soie appliquées à l’intérieur des vêtements. Si le travail est bien exécuté, la doublure se superpose de l’intérieur, sans tirer, sans dépasser.
Madeleine Chapsal
Un poète doit laisser des traces de son passage, non des preuves. Seules les traces font rêver. Le réel, quelquefois désaltère l’espérance. C’est pourquoi, contre toute attente, l’espérance survit.
René Char
Chapitre 1
Mikhel
Mikhel marche dans la neige. Il s’amuse à tracer une ligne discontinue le long de la vieille voie ferrée qui relie la gare routière de Tallinn au quartier Telliskivi. Il hésite entre aller répéter un dernier morceau de métal avec ses potes dans l’un des docks désaffectés ou bifurquer vers le bâtiment « Antik Baltik » pour acheter un manteau d’hiver de l’époque soviétique. Il aime ce genre de vêtement chaud, peu coûteux, symbole d’un temps pour lequel il n’a aucune nostalgie mais qu’il porte parce que ça fait style.
Mikhel a vingt ans, les cheveux blonds relevés en un chignon qu’il cache sous un bonnet noir. Ses études d’écologie à l’université sont en berne. Il se dit No future. Le monde est parti pour se scratcher. Il l’a vite compris, au bout de quatre mois sur les bancs de la fac, en dépit de l’optimisme affiché par son professeur, un chercheur qui arpente le monde entier pour apporter son savoir en matière d’écotourisme. Les défis du XXIe siècle sont aussi béants que le trou d’ozone qui s’agrandit, quoi que l’on fasse. Mikhel les évacue de sa vie en jouant des heures avec son groupe, en beuglant tout ce qu’ils peuvent, pour chasser la peur du lendemain, la folie de ce monde qui va les avaler sans les laisser vivre leurs rêves. C’est un hypersensible, un être à fleur de peau qui ne montre jamais cette part-là de lui. Il n’aimerait pas qu’on se moque de ce qu’il considère être une faiblesse. Mikhel est celui qui donne le plus dans le groupe. Toujours en quête de sons purs et durs, il n’est réellement bien que lorsqu’il se donne à fond. Sasha, son meilleur ami, est le seul à avoir percé l’armure. Quand il le voit jouer, tendu comme les cordes de sa guitare électrique, il sait que Mikhel cherche à étouffer son mal-être, son amertume, dans une musique qui fait trembler les vitres. Pourquoi ne pas partir d’ici ? Dans le froid des docks non insonorisés, où les murs sont lézardés, les jeunes gens évoquent parfois cette possibilité, en réchauffant leurs doigts engourdis près de radiateurs récupérés dans les bazars. Mais, de manière étonnante, aucun n’est prêt à faire le grand saut car dans ces docks qui font partie de leur horizon depuis toujours, ils se sentent libres, loin des tracas du monde et cela leur suffit. C’est leur refuge, leur rempart. Peut-être aussi leur lâcheté. L’union de leur groupe leur ôte toute culpabilité. Ils peuvent évoquer leurs désirs, leurs joies, leurs histoires de filles, qu’ils ramènent de temps en temps, pour faire l’amour sur des matelas vieux comme leurs pères. Tous ont grandi dans les rues du quartier Telliviski, où le toit des maisons en bois se couvre de neige dès la fin de novembre, où les stalactites perlent, menaçantes avec leur pointe aiguisée et que, gosses, ils cassaient pour les lécher comme des glaces à la vanille. Maintenant, il fait encore froid : -10°, -15°, mais cela n’a plus rien à voir avec le froid de leur enfance, où le thermomètre descendait sous les -25° en pleine nuit. Mikhel adorait regarder le thermomètre à mercure que son père accrochait près de la fenêtre. On le retrouvait couvert de stalactites au petit matin, témoins uniques des vagues de froid venues de Sibérie ou de l’Oural. Le jeune garçon, alors, aimait l’idée que le froid était apporté par un Dieu démiurge, même si ce Dieu était encore de nationalité russe.
Depuis un an, les cartes ont néanmoins changé de main. L’Estonie a obtenu son indépendance.
Mikhel jure. Il a manqué de s’affaler, son pied a heurté le rail. Il a bu plus que de coutume, la veille dans les docks désertés par les Russes. C’est là où se rejoint la jeunesse alternative. Là où l’on rencontre des blousons noirs, des mecs comme lui avec quelques tatouages sur les bras et des cheveux blonds. Ils ne sont pas des Freddy Mercury, mais des hommes forts, fougueux, voulant exploser en plein vol, car l’avenir n’a plus d’étoiles. Avec ses copains de comptoir, il a sifflé deux ou trois bouteilles de vodka, fumé plus que de raison. Il ne sait pas comment il a réussi à rentrer chez lui. Sans doute grâce à Sasha qui veille sur lui comme une mère.
Finalement, Mikhel décide de bifurquer vers le hangar. Il est midi. Quelques touristes y affluent. Le jeune homme grommelle. Non pas qu’il ne les aime pas – car ils aident à faire tourner l’économie du pays, mais aujourd’hui, il a envie d’être tranquille, ne pas être obligé de jouer des coudes pour regarder les articles. La plupart sont des fringues, accrochées sur des cintres en hauteur et vendues à des prix dérisoires. Des vestes en fourrure, en daim, en peau de zibeline, pour les visiteurs les plus chanceux. Des pull-overs vintage tricotés à la main, héritiers des années 80, attendent sous des bâches de plastique à côté de vieux postes de radio et des jeux de cartes usés jusqu’à la corde. Mikhel connaît bien les marchands, parfois des voisins qui vivent très mal la transition du communisme au capitalisme. Il se dirige vers son vieux préféré, Féodor. L’homme l’a vu arriver et le dévisage d’un air bienveillant.
L’homme sait bien que Mikhel ne grandit plus, mais il se prête au jeu.
Il lui tend un manteau blanc militaire, aux insignes russes. Tout en fourrure et doublé. Mikhel ne prend même pas la peine de l’essayer.
Mikhel s’empresse d’accepter. Le vieux n’a pas trop conscience du prix qu’il vient de lui proposer. Une telle pièce, il pourrait la vendre sans faute le triple à un touriste. Mais là, il n’y a pas de marchandage possible. Ils sont entre eux. Alors Mikhel paie comptant, avec une petite pointe de remords, toutefois, au moment de remettre les billets dans la main revêtue d’un méchant gant de laine. Il se promet de lui ramener une bouteille de vodka pour se racheter de sa couardise. Il s’éloigne rapidement sous le regard, en apparence, inexpressif, de Féodor. Mais le vieux a bien compris que ce gamin-là avait quelque chose de plus que les autres. Ses yeux sont certes fatigués, mais ils ont capté le mélange de tristesse et de rébellion, de colère et de poésie qui se dégage de Mikhel. Tel qu’il était lui-même, soixante-dix ans plus tôt… Il soupire, puis reprend sa conversation avec son voisin.
« Alors, tu as vu combien nos pensions ont diminué avec ce nouveau gouvernement qui nous dirige… »
L’autre renchérit mais Mikhel ne les entend plus. Il s’est éloigné, le manteau plié dans un immense sac plastique. Il sort du hangar, happé par le vent froid qui fait soulever la neige. Il grelotte. Sa vieille gabardine ne vaut plus rien. Alors il se hâte de l’enlever pour enfiler le manteau russe. Il lui va parfaitement. Mikhel rapproche son nez de la fourrure. Elle a charrié avec elle tous les combats de l’homme qui la portait, mais aussi, et surtout… sa transpiration. Mikhel se rend compte qu’elle n’a pas été lavée depuis des lustres. Il sourit malgré lui.
Mikhel se hâte maintenant, pressé de retrouver le groupe. Il a en tête quelques accords.
Toute l’après-midi, une musique plus que jamais destroy retentit dans les docks. Le groupe se déchaîne. Fuck le monde, fuck le communisme, fuck la police qui menace de condamner les docks, « pour des raisons de sécurité ». La jeunesse s’oublie dans le métal. Ils sont libres.
Vers 18 h, Sasha annonce qu’il doit filer. Il est épuisé. Le bassiste et le batteur le suivent. La tête leur tourne un peu. Ils ont bien envoyé. Les accords de Mikhel étaient bons.
Les gars s’éloignent en rigolant. La bonne blague. Les docks sont une vraie passoire. La nuit est ici plus longue qu’ailleurs. Mikhel n’a pas trop envie de s’éterniser. Il se hâte d’uriner, revient dans la pièce pour récupérer ses affaires. Il commence à faire froid, malgré la chaleur de fauve qui règne dans le lieu. Il endosse le lourd manteau en grelottant.
« J’ai bien fait d’acheter ce truc »…
Par réflexe, il enfouit ses mains dans les poches, s’aperçoit que le manteau comporte en plus deux poches intérieures. Quel luxe ! Il plonge d’abord sa main dans celle de gauche, s’apprête à la retirer quand il sent quelque chose de souple à travers la fourrure intérieure, juste au-dessus de la manche gauche. Intrigué, il enlève la veste, la retourne. Tout excité par sa découverte, il s’assied sur le matelas face à la fenêtre. Il ne sent plus le froid. Au premier regard, personne ne peut détecter qu’un objet est caché dans la manche. Mikhel regarde autour de lui à la recherche d’un couteau. Il en trouve un, rouillé, près de la fenêtre. Il déchire rapidement la fourrure. Un carnet tombe de sa cachette. Mikhel se penche vers l’objet, le cœur battant.
Une photo de femme d’une vingtaine d’années portant une robe d’une autre époque le dévisage. La photo est de couleur sépia, encadrée dans un bel ovale. Mikhel sent un rouge inexplicable lui monter aux joues. La beauté du visage de la jeune femme le transperce, plus que la pointe acérée de la stalactite de son enfance. Un simple prénom est inscrit sur le carnet : Kristina.
Chapitre 2
Kristina
Février 44
(L’écriture de Kristina est comme abîmée, ses rondeurs effacées, la date est à peine lisible)
Je m’appelle K. Drôle de nom de code pour une femme, K. C’est peu féminin, mais ici on ne pense plus à être une femme ou un homme. Nous ne sommes plus que des combattants.
Les Frères de la Forêt.
Je vis avec eux depuis trois ans.
Nous venons de mener notre dernière bataille, je le crains. La prochaine attaque sera fatale. Le froid est sidérant, glaçant, terrifiant. Le silence plus encore.
Oh j’ai peur, si peur maintenant… F., où es-tu ? Presque trois semaines que tu es parti… Pourquoi n’es-tu pas resté près de moi ? Tu m’aurais protégée. Je ne dors plus, je rêve que je suis dépecée vivante par des loups affamés, aussi affamés que nous. Oh ! Il y a bien longtemps que les paysans ne nous donnent plus de vivres, par peur des représailles des Russes qui se font passer pour des Frères et nous égorgent avec nos petits à l’intérieur de nos ventres… Comment ne pas vouloir les chasser de nos terres, ces monstres qui nous haïssent plus que tout, parce que nous avons osé tenter notre indépendance ? Eux qui ne sont encore que les serfs de leurs bourreaux ?
J’écris ces mots pour que vous n’oubliiez pas, Estoniens, combien il faut être fier de votre pays, combien il faut l’aimer jusqu’à en mourir.
Vite ! Qu’on en finisse… Oh… Ce silence… Il est si terrifiant dans cette forêt. Le fracas à venir me délivrera de tout… Je n’en peux plus. Sans toi, F., je ne suis plus rien. Mais je mourrai les armes à la main, faisant feu de mes dernières cartouches contre ces hommes qui ont remplacé leur cœur par une idéologie ignoble, plus bestiale encore que celle des nazis. Même si ceux-là brûleront également en enfer pour tout ce qu’ils ont commis.
Et pourtant, tout avait une autre clarté, il y a 20 ans… Oh… mon Dieu… Je n’ai plus qu’une bougie, il faut vite écrire ces lignes, avant qu’elles ne s’éteignent à jamais dans la nuit :
« Cher F., si jamais tu reviens, sache que ma vie n’a eu qu’un but : servir mon pays. Je ne l’aime pas plus que toi. Je l’aime autant. Et toi seul sais combien je t’ai aimé et chéri. Adieu, cher amour. »
(l’écriture est ici très peu claire, tâchée)
*********
(L’écriture de K. est régulière et sans spirales.)
Septembre 39
J’ai eu 25 ans, 12 ans, 6 ans.
En 1901, j’étais une petite fille blonde aux tresses bien en équilibre autour de la raie qui séparait ma tête en deux corps parfaits. Je crois que ma mère me disait que j’avais les cheveux aussi épais que la mélasse de miel qu’elle mettait en pot au printemps. Mais, de sa bouche, c’était un compliment que je notais avec ravissement dans un coin de ma tête. Ses mots chantaient, quand elle les prononçait de cette langue, l’estonien, qu’elle nous apprenait le soir, après avoir fait toutes les corvées d’une femme de pêcheur.
J’avais six ans, nous vivions à cinq enfants et mes parents dans une ruelle près des tours qui encerclent Tallinn, notre ville, depuis plus de quatre siècles. Notre rue était étroite, constamment recouverte de verglas et de neige dès octobre, jusque fin mars. Nous partagions le même lit pour nous tenir chaud, mes deux frères et mes deux sœurs. Enfin, si on peut appeler ça un lit. C’était plutôt une couche faite avec de la paille, recouverte d’un tissu de laine, posée sur le sol de terre battue. Le poêle, s’il crachotait des vapeurs noires qui nous faisaient tousser, était le Dieu de la maison. Nous lui offrions tout ce dont il avait besoin, en matière de bois. Il aimait en particulier le pin. Notre maison embaumait tout l’hiver. Je m’en souviens encore. Nous le retrouvions avec tant de plaisir, après avoir passé nos journées à dévaler les pentes enneigées de la Tompea, la « colline » qui avait ceint et créé la ville de Tallinn. Notre père levait ses sourcils broussailleux quand nous revenions transis, car, tout de même, par -20°, même quand on court, on finit par cracher aussi vert que le poêle.
L’histoire de ce poêle est assez singulière, j’y reviendrai plus tard.
Ma mère avait décidé de venir s’installer à Tallinn, des années plus tôt, pour tenter sa chance à la ville. Elle venait de Haapsalu, une petite station côtière à cent kilomètres de la capitale. Elle avait été élevée sans chaleur par une mère dure à la tâche, dans l’une de ces vieilles maisons du village à côté de la datcha de la famille impériale. Ma grand-mère, Magda, se targuait d’y avoir travaillé, en était fière même si, reléguée à la cuisine dix heures par jour, elle n’avait jamais vu le visage des derniers Roumanov. Mais, au moins, elle n’avait pas de mari ivrogne sur le dos qui devenait guilleret, touche-à-tout-partout dès qu’il avait achevé la deuxième bouteille. Là, à l’abri de cette cuisine, il ne pouvait pas la blesser avec ses mots grivois, ses mains trop dures quand il lui labourait les seins, et tout le reste, dont elle n’aimait pas se souvenir. Aucun des deux ne savait lire. À quoi cela aurait-il servi ? Ils n’avaient pas l’usage de l’écriture ni de la lecture. Seule comptait la langue estonienne, que les générations se transmettaient, par les légendes comme celle d’Eelemüste.
Je comprends pourquoi ma mère avait voulu vivre autre chose.
Et pourtant, elle aussi avait trouvé un homme qui lui en mettait une de temps en temps ça n’a jamais fait de mal à personne, disait-il pour se dédouaner. Certes, elle avait bien les poissons pour se défendre mais elle préférait les réserver aux vrais malotrus. Ils étaient légion, au port, où elle avait commencé à travailler dès l’âge de quinze ans. Elle avait vite appris à éconduire les esseulés et n’avait pas son pareil pour leur flanquer un coup de hareng dans l’entrejambe, sans qu’ils voient le coup venir. Peu à peu, elle s’était fait une réputation de meneuse d’hommes. Mais, devant son mari, de façon très étrange, elle ne parvenait pas à trouver la bonne parade. Il la déstabilisait, l’aimait, mais ne pouvait pas s’empêcher de la cogner, de temps en temps. Il reproduisait ce qu’il avait vu faire. Elle subissait cette violence soudaine en silence. Sans pouvoir rien y faire. Ah l’amour ! Comme il provoque des réactions étranges, parfois… À vrai dire, mon père était trop amoureux, trop jaloux. Et ma mère avait le malheur d’être bien faite de sa personne. Le mariage luthérien avait été célébré dans l’église Sainte Mary gorgée d’un soleil, qui, ce jour-là, rendit les blasons des familles de pêcheurs accrochés aux murs aussi étincelants que les boucliers d’Alexandre le Grand lors de sa conquête de la Perse. Les cloches russes avaient résonné jusqu’au golfe de Finlande.
Ils vivaient de la pêche. Il avait acheté une barque qu’il remontait chaque soir, remplie de milliers de harengs, de saumons, de poissons frétillants qui abondaient dans cette mer calme, à l’époque. Ils auraient pu faire fortune, mais les négociants, les marchands allemands veillaient à ce que la populace ne s’enrichisse pas. La noblesse allemande – les Barons germano-baltes qui appartenaient à la Guilde de la Hanse Sail baltique négociaient tout, du cours du poisson, des céréales, à celui de l’or, en passant par le sel, le calcaire et la laine.
Nous étions donc plutôt heureux dans cette maison étroite. Le poêle faisait souvent l’objet de remontrances de la part de ma mère envers notre père.
« Il nous causera des soucis, un jour, prédisait-elle. »
Il cherchait à la rassurer :
« Personne ne m’a vu, ne t’inquiète pas. Et puis c’était en pleine nuit, il y a six ans. »…
Quand elle insistait trop, il levait le ton. Nous nous hâtions de lui demander de nous raconter son histoire, pour éviter d’autres éclats de voix. « Jamais je ne m’en séparerais de Godin. Oui Kristina, c’est ainsi qu’il s’appelle. Il appartenait au tsar Nicolas II… Ah ! Ce diable de tsar. Il voulait s’en faire livrer un autre de France, même si Godin marchait encore. Il l’avait abandonné dans un coin, où Magda l’avait retrouvé. La brave femme l’avait chargé sur son diable en bois, traîné jusque chez elle, puis elle avait profité d’un de mes passages pour nous le donner. Elle savait qu’il nous sauverait du froid. Malgré tout, c’était une brave femme, Magda, quoiqu’en dise votre mère ».





























