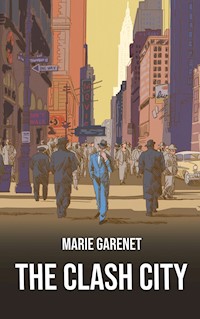
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
New York, 1958. À Manhattan, une modeste boutique de pressing dissimule depuis des années une société de tueurs à gage. Theodore Woodrow, employé exemplaire de son Entreprise de chasse à l'homme, se voue entièrement à son travail et à sa hiérarchie. Une routine sanglante menacée par un acte passé, fait resurgir les cadavres du placard et remet en question tout une vie d'obéissance envers cette organisation du crime.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 628
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À ma mère, pour ta patience et ton soutien immense.
Table des matières
CHAPITRE I Les deux hommes en costume
CHAPITRE II La sixième chaise
CHAPITRE III L’Entreprise
CHAPITRE IV Le stagiaire
CHAPITRE V Porte-à-porte
CHAPITRE VI Tenue correcte exigée
CHAPITRE VII Renégat
CHAPITRE VIII Maître-chanteur
CHAPITRE IX Valse mortelle
CHAPITRE X Baptême par le feu
CHAPITRE XI Des cadavres dans le placard
CHAPITRE XII Marécage
CHAPITRE XIII Jour de paye
CHAPITRE XIV Disgrâce
CHAPITRE XV Le verre d’adieu
CHAPITRE ILes deux hommes en costume
Chicago, décembre 1939.
Vingt-deux heures neuf. Deux paires de chaussures de ville masculines patientaient sur un trottoir enseveli sous un épais tapis de neige. Leurs propriétaires, deux hommes proches de la quarantaine, se tenaient côte à côte, tournés en direction d’un bâtiment prestigieux. À leurs pieds, quelques mégots souillaient la couverture de glace virginale, un indice témoignant de leur longue présence dans cette rue dépeuplée. Un pied s’impatienta. Il battit la mesure. Sans doute celle d’une chanson entendue la veille dans un bar populaire du centre-ville. L’un des hommes portait un costume gris, assez chic mais dépourvu de détails superflus, ainsi qu’un long manteau brun en laine, des gants en cuir et un chapeau feutre havane cousu d’un liseré de la même couleur, bien que plus clair pour distinguer les deux parties. Un ensemble tout à fait commun pour tout homme de cette époque où la convenance et l’élégance primaient. L’autre était vêtu d’un costume trois pièces dans les tons bleu foncé. Sans pour autant être spécialiste, on pouvait identifier l’estampille d’une marque britannique reconnue pour son excellence et son savoir-faire incomparable. L’homme portait des gants et un pardessus d’hiver, couleur bleu marine. Il possédait aussi un couvre-chef, mais assorti à son costume et plus large que celui de son confrère. L’impatience le gagna. Une envie subite de griller une cigarette le submergea. D’un geste maîtrisé, il sortit un paquet de cigarettes de la poche intérieure de sa veste, réservée aux objets de première nécessité. Il était rouge et frappé d’une tête de chat noir en figure de mascotte. Le signe probable d’un mauvais présage pour prévenir ses consommateurs de son usage à sens unique. D’un côté de la tête du félin, il était noté « Cork » et de l’autre « Tipped ». Les cigarettes étaient sans filtre, mais leur bout était entouré d’une fine bande de liège. Au centre, la mention « Craven A » était inscrite en lettres noires, et un peu plus bas, en lettres blanches, « Virginia Cigarettes ». Tout comme son costume, son paquet était originaire du pays de la Reine mère. Il extirpa une cigarette, la plaça entre ses lèvres fines et invita silencieusement son associé à partager sa douceur amère. Il échangea ensuite son paquet contre un Zippo métallique gravé des initiales « T. W. ». Il ôta le capuchon et activa la pierre du briquet en glissant son pouce sur la petite roulette. Une gerbe d’étincelles, suivie d’une flamme, jaillit du réservoir. Il l’écrasa contre le bout du bâtonnet qui rougit à son baiser incendiaire, et tendit son briquet à son collègue. Une brise s’éleva. L’homme au costume gris approcha son visage de la flamme dansante dans le froid hivernal et l’enveloppa de ses mains prenant la forme d’une coupe pour la protéger du souffle du vent. Cigarettes allumées, ils se redressèrent et tirèrent en même temps une bouffée. L’homme au costume bleu releva la manche de son manteau et dévoila le cadran d’une montre en argent à son poignet : vingt-deux heures quatorze. Encore trop tôt. La trotteuse entama un nouveau tour. Ils continuèrent de se repaître de leur plaisir éphémère. Quand la fine aiguille atteignit le chiffre douze, l’homme au costume gris donna un coup de coude à son voisin pour lui désigner le grand immeuble d’en face. C’était un hôtel, plus précisément un palace, dont les portes étaient férocement défendues par deux portiers. Le genre d’établissement qui vous offrait tout ce dont vous rêviez, même si le soleil était couché. D’énormes lettres lumineuses rouges rayonnaient sur le toit pour composer les mots : « Congress Hotel ».
Les deux hommes en uniforme hôtelier quittèrent leur poste et se retirèrent à l’intérieur du palace. Un signal à destination des deux complices. Ceux-ci s’élancèrent d’un même pas et marchèrent à un rythme soutenu. Au bord de la chaussée, l’homme au costume gris agrippa l’avant-bras de son collègue pour l’empêcher de traverser. Ce dernier lui jeta un regard interrogateur. D’un hochement de tête, l’autre lui indiqua le feu tricolore autorisant les voitures à circuler. La voie pourtant dégagée, l’homme au costume bleu, docile, se ravisa et patienta avec son collègue. Ils jouissaient de leurs sucettes d’hommes mûrs. Une seule voiture était passée sous leurs yeux rivés sur le dispositif lumineux. C’est seulement après son passage que le feu permit enfin leur traversée. Ils rejoignirent sans tarder le trottoir d’en face. À deux pas de l’entrée principale, ils jetèrent leurs mégots et poussèrent les grandes portes battantes du luxueux bâtiment.
Une fois à l’intérieur, ils s’immobilisèrent. Ils observèrent le grand hall, appréciant sa chaleur réconfortante. Des lustres dorés faisaient ressortir les peintures des arches et les veines des murs en marbre. Le mobilier coûteux était de bon goût, les objets décoratifs l’étaient tout autant. Un style volontairement pompeux, au vu de l’atmosphère élitiste que l’hôtel revendiquait. Le personnel et la clientèle opulente allaient et venaient dans une euphorie conventionnelle. Des embrassades et de grands sourires feints s’échangeaient comme dans une réaction en chaîne. Dès que l’on croisait un congénère fortuné, on le saluait, même si on le désapprouvait. Un savoir-vivre non négociable, si vous souhaitiez que votre réputation ne termine pas sa trajectoire comme la courbe du krach de 1929.
Tout se passa très vite. En un éclair, le tandem traversa la grande salle pour gagner les ascenseurs. Les portiers aperçus plus tôt s’éclipsèrent par une porte de service. Au même moment, le réceptionniste de jour passa le relais à son collègue de nuit. Les deux hommes en costume déjouèrent leur vigilance, se payant même le luxe de défiler devant un agent de sécurité, dont l’attention fut détournée par un paquet de cigarettes glissant à ses pieds, qu’il ramassa pour sa prochaine pause. Ils atteignirent leur objectif avec un air d’indifférence et appelèrent un ascenseur. Un ding ! retentit. Les portes s’ouvrirent, ils entrèrent. L’homme au costume gris appuya sans hésitation sur le bouton du onzième étage, l’appareil initia son ascension. Une douce musique jazzy, instrumentale, avait envahi le petit espace. Les deux hommes fixèrent les portes closes de la boîte de métal. Le plus nerveux d’entre eux, l’homme au costume bleu, tapota convulsivement de son index contre ses mains jointes. Soudain, l’ascenseur s’arrêta brusquement. Au cinquième étage, un jeune groom chargé de bagages apparut derrière les portes automatiques. Il salua respectueusement les usagers, entra et leur tourna le dos. Les passagers clandestins se jetèrent un regard entendu, puis les portes se refermèrent.
Au onzième étage, les portes s’ouvrirent de nouveau. Mais il ne restait plus que deux voyageurs dans l’habitacle. Le groom avait apparemment disparu sans laisser de trace… L’homme au costume gris quitta l’ascenseur. Celui en bleu l’imita, mais se figea lorsqu’un bras glissa avec paresse du plafond de la cabine pour venir chatouiller son nez sensible. Avec une grande aisance, il attrapa le membre inanimé, le remit précautionneusement à sa place le long du corps du groom et suivit les pas hâtifs de son collègue. Ils enchaînèrent plusieurs couloirs au sol revêtu d’une moquette bleue qui assourdissait chacun de leurs pas déterminés. Ils ne rencontrèrent aucun client ni employé sur leur chemin jusqu’à la prochaine intersection. Le grincement des roues d’un chariot de linge, poussé par une femme de chambre, aiguillonna leurs oreilles vigilantes. Sans se concerter, ils se séparèrent et se plaquèrent simultanément contre un mur adjacent. L’employée surmenée traversa le couloir sans les voir. Ils attendirent sagement sa retraite définitive avant de poursuivre leur progression. Vingt-deux heures vingt-six. Faute impardonnable. Ils venaient de perdre une minute sur leur programme. Il fallait maintenant rattraper leur retard.
À trois chambres de là, un client important profitait de sa suite présidentielle. George Clayton, la cinquantaine passée, une calvitie naissante sur le haut du crâne, était un politicien dans l’âme, considéré comme un fin opportuniste, mais pas comme un brillant stratège. Il se révélait un peu abrupt. Ses opposants ne le craignaient pas et se souciaient peu de sa personne ou de ses ambitions diplomatiques. Une image dont il usait pour évoluer dans l’ombre. Il avait appris que l’obscurité pouvait devenir sa plus fidèle alliée si l’on savait la dompter. Clayton soignait depuis toujours ses relations avec le monde de l’argent. L’homme avait fait fortune dans une entreprise de métallurgie. Pas épargné par la crise, il s’était lancé dans la politique après avoir investi dans l’import-export. Un véritable serpent, empoisonnant ses victimes à coups de promesses et de paroles vaines. À force de serrer des mains, il avait conquis son électorat et grimpé les échelons du pouvoir dans le but de devenir le maire de Chicago. Un titre qu’il s’apprêtait à remettre en jeu après quatre ans de bons et loyaux services.
Après une soirée éprouvante, Clayton avait dénoué sa cravate, ouvert le col de sa chemise, puis s’était écroulé sur un canapé du salon de la suite. Dans peu de jours seraient annoncés les résultats des élections. La victoire était proche. Les documents éparpillés sur une table basse lui confirmaient, entre diagrammes, chiffres et statistiques, cette belle prévision. La gorge sèche du fait d’interminables allocutions publiques, il étancha sa soif avec un verre de whisky additionné d’un glaçon et arbora un sourire prétentieux.
— Hannah, écoute ça.
Il parlait à une femme vêtue d’une robe de chambre qui dissimulait sa sublime plastique. En arrière-plan, elle se déplaça d’un bout à l’autre de la pièce et dévoila par mégarde le galbe ferme de ses jambes parfaites entre les pans de son déshabillé en soie. Elle s’assit devant une coiffeuse et démaquilla chaque partie de son visage, révélant progressivement les traits d’une femme mature. Elle ôta sa paire de boucles d’oreilles ainsi que sa parure de diamants portées à l’occasion d’un dîner mondain. Elle les rangea précieusement dans le coffret en velours pourpre d’un éminent joaillier et dit :
— Je suis tout ouïe, mon amour.
— Ma chérie, sers-nous des coupes de notre meilleur champagne ! La population de Chicago va devoir me supporter quatre ans de plus : d’après mon chef de cabinet, je suis en bonne voie pour voir mon mandat renouvelé.
— Les élections ne sont-elles pas dans une semaine ?
George s’affala paresseusement entre les coussins capitonnés.
— Exact, mais au vu des derniers sondages, il y a peu de chances pour que mon adversaire me rattrape.
— En ce cas, je ne connais qu’une seule manière de fêter dignement cette victoire, susurra Hannah à son oreille.
Elle avait surgi, sans faire de bruit, contre le dossier du canapé. Elle entoura amoureusement le cou de George et embrassa sa joue.
— Je vais prendre une douche. Tu te joins à moi ?
Une indécente proposition qui curieusement ne motiva pas le politicien. L’homme vantard était bien trop absorbé par sa future victoire.
— Accorde-moi encore un petit instant et je serai tout à toi.
Elle se détacha de lui et souffla avec désir :
— Ne tardez pas trop, monsieur le maire, ou il risque de ne plus y avoir d’eau chaude…
Hannah s’éloigna langoureusement. En cours de route, son négligé glissa mollement le long de sa fine taille. Plus rien ne cachait ses courbes féminines. Clayton ne daigna toutefois pas détourner son regard de ses résultats. À croire que ses chiffres avaient plus de force que ses pulsions primaires. La tentatrice ne réclama pas son dû et s’enferma dans la salle de bains.
On frappa à la porte de la chambre. Clayton ne bougea pas. On insista. Il consulta, exaspéré, une pendule de cheminée : vingt-deux heures vingt-neuf. Qui pouvait le déranger à une heure pareille ? Rien n’avait été commandé au room service, et aucun invité n’était attendu. La grande aiguille passa à trente. On frappa encore. Il poussa un soupir et délaissa ses documents.
— Voilà, du calme, j’arrive ! Bon Dieu, y a pas lieu de s’énerver comme ça.
Il retira un cigare cubain refroidi, étiqueté d’une fleur de lys, du bord d’un cendrier et le plaça dans sa bouche aux effluves de liqueur.
— C’est plus ce que c’était, le service d’étage. Il pourra se le mettre là où je pense, son pourboire.
Clayton se redressa du canapé, difficilement en raison de sa longue position assise. Il prit d’abord le soin de faire craquer son dos endolori et alla ouvrir la porte de sa suite. Devant lui se tenaient deux hommes en costume : l’un en gris, l’autre en bleu foncé.
— Oui, c’est pour quoi ?
Pas de réponse. Clayton afficha une expression de perplexité, qui se transforma en terreur lorsque l’homme au costume bleu présenta l’embout d’un pistolet muni d’un silencieux. Deux balles furent tirées dans son thorax. Entre la vie et la mort, le politicien ne vit pas sa vie défiler devant ses yeux, ni le visage de la charmante Hannah pour dernière représentation de son existence, mais le trop gros pourboire offert au groom pour que la blanchisserie repasse sa chemise maintenant tachée d’hémoglobine. Il se pétrifia momentanément, une main cramponnée sur sa poitrine en sang. Ses lèvres remuèrent. Quelque chose semblait vouloir sortir de sa bouche en manque d’air. En s’attardant sur celles-ci, on pouvait entendre un léger souffle, ou plutôt une supplique : « Nettoyage à sec… » Puis il s’effondra lourdement en arrière, comme une armoire qu’on aurait balancée dans un escalier.
Sous la douche, Hannah se délectait de l’eau chaude qui coulait délicieusement sur ses épaules. Pas une seule seconde elle ne suspecta ce qu’il se tramait dans la pièce attenante. Le bruit continu du jet d’eau tapant contre les parois de la douche couvrait son audition. Elle avait même dû élever la voix pour tenter de se faire entendre de son amant, insensible à ses multiples invitations provocatrices.
— George ! Que fais-tu ? J’ai presque fini et je commence déjà à avoir froid sans toi.
À côté, les deux hommes rassemblaient méthodiquement toutes les affaires personnelles du défunt : chapeau, porte-documents, dossiers… L’homme au costume bleu, prévenant, récupéra sur un fauteuil la veste du politicien pour recouvrir sa dépouille. Hannah ferma l’eau, enroula son corps dans une serviette et héla une nouvelle fois George. Cette exclamation n’affola pas les compères, qui continuèrent leur tâche avec une singulière sérénité et une rare efficacité. Lors de la phase finale, ils emmaillotèrent Clayton et ses affaires dans un tapis du salon qu’ils transportèrent par les deux bouts en dehors de la suite. La porte claqua. Hannah revint dans le salon, appela George. Personne ne souffla mot.
Les deux hommes en costume descendirent le corps avec adresse par une cage d’escalier impratiquée. Au rez-de-chaussée, ils tombèrent sur une porte de service verrouillée. Ils posèrent le cadavre au sol. L’homme au costume gris sortit une clé appartenant au groom de l’ascenseur, et l’inséra dans la serrure. L’obstacle franchi, ils déplacèrent leur charge jusqu’à une voiture anglaise qui les attendait au parc de stationnement des employés. C’était une Riley Kestrel 1½ de 1938. Sa carrosserie, à la fois rectiligne et arrondie par endroits, était d’un beau vert nuancé de reflets sombres. L’intérieur cuir était couvert d’un toit noir. Les lignes symétriques de son capot se rejoignaient en une parfaite adéquation sur son imposante calandre, constituée d’une grille de radiateur en lamelles. Un ensemble qui faisait d’elle une vraie splendeur mécanique, une diva sur quatre roues que son propriétaire cajolait été comme hiver.
L’éclairage du parking était presque inexistant, mais cela suffisait pour leur affaire. Le temps que l’homme au costume bleu puisse ouvrir le coffre, le second fut sollicité pour retenir le corps. Ils se délestèrent lourdement de leur fardeau à l’intérieur. Les suspensions de la Riley rebondirent à cette macabre offrande, comme si elle refusait de transporter cette chose répugnante, de peur de salir sa ravissante robe olive. L’homme au costume gris s’installa sur le siège passager, son collègue au costume bleu ferma le coffre. Il s’apprêtait à rejoindre son collègue quand un détail l’arrêta. Une petite tache de sang s’étalait sur le capot. Son poing se serra. Tel un magicien, il tira un mouchoir de sa poche et effaça d’un geste la trace disgracieuse. Il contourna l’automobile et prit place derrière le volant. La voiture démarra. Elle remonta une avenue et passa de justesse un feu vert pour s’éloigner derrière un écran de neige.
Après un périple éreintant de plusieurs heures, la neige s’était volatilisée et avec elle les basses températures. Les deux hommes avaient délaissé leur manteau pour leur veste de costume. La voiture roulait à vitesse constante sur la route la plus célèbre des États-Unis d’Amérique, la route 66. Un long corridor traversant plusieurs États du pays et offrant de multiples décors aux voyageurs qui l’empruntaient. Le Missouri avait été atteint depuis un moment déjà. Ils étaient seuls. Il n’y avait que les phares allumés et le vrombissement du moteur de leur voiture pour manifester leur présence dans cette nuit funèbre. Puis, comme sur un coup de tête, la voiture bifurqua sur un parking d’une vingtaine de places peu rempli. Cinq voitures y étaient stationnées. Les deux hommes y abandonnèrent leur véhicule et marchèrent en direction d’un motel dédié aux courts séjours où ils passèrent la nuit.
À l’aube, l’homme au costume bleu, adossé contre le flanc de la Riley, sortit son paquet de Craven A. Avec un jeu de mains routinier, il alluma une cigarette et tira une bouffée. Son regard se tourna vers la porte du motel, poussée par l’homme au costume gris. Celui-ci rangea dans sa veste son portefeuille, qui avait servi à régler la note, et retrouva sa place près de son collègue, sur le siège passager. L’aiguille de la jauge d’essence indiquait que le réservoir était presque vide. Un arrêt à une station-service s’imposait. La voiture démarra et reprit la route.
Plus tard, ils dépassèrent un panneau indicatif : « ARIZONA ». Le bitume usé ondulait sous leurs roues. Une illusion d’optique créée de toutes pièces par la forte chaleur qui tapait fiévreusement sur l’asphalte, atteignant les soixante-dix degrés. Tandis qu’il conduisait, l’homme au costume bleu eut l’étrange sensation d’être suivi. Il jeta un œil dans son rétroviseur et repéra une voiture de police. Elle roulait à la même allure, mais restait soigneusement en retrait. Elle continua ainsi sur cinq kilomètres, puis effectua un appel de phares. La voiture anglaise se déporta sans délai sur le bas-côté. L’homme au costume bleu coupa le contact de son véhicule. Dans le reflet, il étudia le policier solitaire quittant sa voiture de fonction et mettant son chapeau sur sa tête dangereusement exposée au soleil brûlant du désert. Il portait des lunettes de pilote, un uniforme de shérif avec une arme à feu rangée dans son holster en cuir, prête à servir. Tout l’attirail du parfait flic natif de l’État. L’air peu engageant, il s’avança posément jusqu’à la voiture étrangère. Le cliquetis des menottes et du trousseau de clés à son ceinturon appuyait l’alternance de ses pas dans la poussière. L’homme au costume bleu commença à tapoter nerveusement de son index sur le volant. Le policier longea la Riley. Il l’inspecta brièvement, s’arrêta au niveau de la portière conducteur et frappa à celle-ci à deux reprises avec le cartilage de son index replié. Le conducteur abaissa lentement sa vitre, à la limite de l’exaspération. Le policier inclina légèrement son couvre-chef et dit avec un accent des environs :
— ’Jour, messieurs.
Ils ne répondirent pas. Un mutisme qui n’affecta pas le fonctionnaire.
— Eh bien, dites-moi, c’est un bel engin que vous avez là.
Un fort enthousiasme se percevait dans sa voix. Les mains sur les hanches, il se cambra légèrement en arrière afin d’observer le devant de la voiture clouée sur place.
— C’est une Riley, c’est ça ?
Il n’obtint aucune réponse. Le policier recula d’un pas et contempla la voiture dans son ensemble. Il la scruta sous toutes ses coutures avec le même respect que pour le tableau d’un grand maître.
— C’est pas commun de voir des bagnoles de ce genre dans l’coin.
Il se déplaça ensuite vers l’arrière et effleura le coffre de sa main.
— C’est la première fois de ma vie que j’pose mes mirettes sur une anglaise.
Dans son rétroviseur, l’homme au costume gris regarda anxieusement le policier se tenant à proximité du coffre. Mauvais signe. Sa main attrapa instinctivement la crosse de son pistolet fixé à sa taille, alors que le tic de son acolyte s’était machinalement amplifié. Le policier revint sur ses pas. Étrangement, la puanteur du corps, qui macérait depuis plusieurs kilomètres dans l’espace confiné, n’était pas parvenue à son piètre odorat. Ou bien l’avaitil confondue avec celle des voyageurs ?
— Pour tout vous dire, commença-t-il, amusé, quand j’l’ai aperçue, j’ai bien cru avoir pris un coup d’soleil sur la caboche.
Avec un aplomb peu ordinaire, il s’accouda à la vitre du conducteur pas vraiment ravi de cette audace.
— Eh ben, j’dois avouer que vous avez un sacré bon goût.
Une étincelle jaillit derrière ses verres teintés dans ses yeux baladeurs qui venaient de cibler sur le tableau de bord un paquet de cigarettes posé sur une brochure touristique de l’Arizona.
— Dites, ce sont des Craven A ? J’en ai jamais fumé.
L’homme au costume bleu fixa son paquet. Il le prit et s’aperçut en l’ouvrant qu’il ne restait plus qu’une cigarette. La route avait été longue. Dommage, il aurait bien voulu la garder pour plus tard. Il passa son bras par la vitre et tendit sa drogue en papier au policier.
— Oh, non. J’vous la laisse, elle est à vous.
L’homme au costume bleu réitéra son offre.
— Bon… Si vous insistez.
Le policier prit la dernière cigarette avec un large sourire.
— Vous savez, ma mère m’a toujours dit de n’jamais refuser les cadeaux qui nous sont offerts. Le meilleur conseil que j’aie pu recevoir dans ma vie. Pour sûr, les bouteilles de vin maison qu’on lui refilait sous le manteau du temps de la prohibition ne l’ont pas aidée à vivre longtemps, mais Dieu sait qu’elle en a bien profité. Paix à son âme…
L’homme au costume bleu replia son bras pour le faire réapparaître avec un briquet actionné.
— Merci, le mien est resté au poste.
Le policier approcha son visage de la flamme. Il embrasa sa cigarette en se redressant pour l’évaluer. L’homme au costume bleu referma brusquement son briquet et retira son bras. Du genre connaisseur, le flic pinça le bâtonnet fumant entre son pouce et son index. Il expira une traînée grise et dit :
— Pas mal, pour des anglaises.
Un bras posé sur le toit, il s’appuya distraitement contre la portière.
— Alors ? Que font des British dans c’trou perdu de notre grand pays ?
L’homme au costume bleu tapota la brochure touristique.
— Du tourisme, hein ?
Il reprit une autre bouffée.
— Si vous voulez voir d’aut’ choses dans l’coin, y a l’Arizona State Museum. Ou si vous êtes du genre à pas trop rester sur place, y a le Slide Rock State Park. Vous verrez, c’est un endroit magnifique. Des kilomètres de roche comme vous en avez jamais vu de vot’ vie. Mère Nature fait de belles choses. Ouais ! De splendides rochers…
Les deux hommes restèrent muets. Le soleil était à son zénith et frappait durement les protagonistes. De la sueur dégoulinait du front de l’homme de loi, mais pas des voyageurs au comportement incroyablement stoïque. Le policier les regarda attentivement. La main de l’homme au costume gris se resserra sur la crosse de son arme. L’instant s’était figé comme la bobine d’un film qu’on aurait mis sur pause. Ils étaient parés à toute éventualité. Avec un peu d’organisation et d’imagination, le coffre pouvait accueillir un chargement supplémentaire. Rien de bien méchant, quelques incisions par-ci par-là. Comme pour un puzzle, il suffisait de faire coïncider les pièces dans le bon ordre et le tour était joué.
L’agent de police interrompit leur rêverie en donnant un coup sec sur le toit de la voiture avec la paume de sa main. Les deux hommes ne tressaillirent pas.
— Bon, c’est pas tout, mais faut que j’vous laisse. J’ai des voyous à flanquer sous les verrous.
Il se détacha de la voiture et épongea son front transpirant avec un vieux mouchoir.
— En tout cas, ça m’a fait plaisir d’avoir pu causer avec vous, les gars.
Il inclina une fois de plus son chapeau.
— Soyez prudents sur la route. Y a des coyotes dans les parages.
L’homme au costume gris desserra la pression sur son arme, alors que l’homme au costume bleu suivait du regard le policier qui rentra dans son véhicule pour faire un demi-tour complet. Il leur fit un signe de la main à travers la vitre et fila vers le fin fond du décor aride. Dans la foulée, la Riley redémarra et s’engagea sur la route ardente. Elle roula à peine cent mètres pour s’arrêter à une station-service perdue au milieu de nulle part. Il n’y avait pas l’ombre d’un client, seulement le responsable du commerce qui, affalé derrière sa caisse, feuilletait lentement les pages d’un magazine illustré. L’homme au costume bleu entra dans la station et posa lourdement son portefeuille sur le comptoir pour se faire remarquer du patron fasciné par sa lecture. Le pompiste, pris sur le fait, tressauta et flanqua sa revue dans un tiroir. À son teint cramoisi, on devinait que l’ouvrage n’était sans doute pas consacré aux dernières nouvelles économiques du pays, mais plutôt à de plantureuses jeunes femmes dans des poses suggestives. Les rencontres amoureuses devaient être restreintes, par ici. Sans faire le moindre commentaire, le client acheta un paquet de Craven A et demanda un plein d’essence ainsi que le remplissage d’un petit bidon d’acier.
En présence des deux hommes attentifs, le pompiste embarrassé introduisit le pistolet de la pompe à essence dans le réservoir de la Riley. Lorsqu’il pressa la gâchette, les chiffres du compteur de la machine s’accélérèrent puis s’arrêtèrent dès qu’il atteignit la quantité de carburant désirée. Il passa ensuite au remplissage du bidon et annonça d’une petite voix le coût final de la prestation.
La facture réglée, l’homme au costume bleu s’installa derrière le volant, tandis que l’homme au costume gris posait le bidon rempli d’essence sur la banquette arrière. Le pompiste les regarda attentivement s’en aller, puis il attendit une bonne minute après leur départ pour reprendre le cours de sa lecture coupable.
En toute quiétude, les deux hommes retrouvèrent leur itinéraire. Ils roulèrent avec monotonie, pendant plusieurs minutes, à travers un grand reg sous un large ciel bleu. Ils quittèrent subitement la route goudronnée pour emprunter un chemin de traverse caillouteux sans marquage. Le véhicule s’ébranla au contact des pierres sous ses roues et s’arrêta à quelques mètres d’un interminable gouffre. Ils étaient enfin arrivés… Le Grand Canyon. Le lieu le plus touristique d’Arizona, mais abandonné par les visiteurs sur cette partie du site.
Les portières avant claquèrent à l’unisson. Les deux hommes déchargèrent du coffre le cadavre enveloppé dans le tapis qu’ils acheminèrent jusqu’à la lisière du précipice. Ils le déposèrent sur ce belvédère naturel de manière à ce qu’il soit exactement parallèle avec la ligne d’horizon. L’homme au costume gris resta sur place, allumant une nouvelle cigarette. L’autre était reparti au véhicule pour apporter le bidon d’essence. Il s’apprêtait à verser tout son contenu sur le cadavre quand son collègue l’interrompit d’un geste de la main, s’accroupissant à hauteur du corps. Il fouilla les poches de sa veste, trouva un portefeuille avec vingt dollars dont il s’empara. Il se redressa et autorisa d’un signe de tête l’homme au costume bleu à verser toute l’essence sur le cadavre. L’association originale de carburant et de putréfaction créa un relent indescriptible. Pas de quoi toutefois les faire dégobiller, ils avaient le cœur bien accroché.
Les deux hommes se placèrent à chaque extrémité du corps, puis savourèrent leur cigarette face au vide et au paysage désertique. C’était une nature si vaste et si harmonieuse qu’un seul mot risquait de l’enlaidir. Les lits d’anciennes rivières, aujourd’hui asséchées et remplacées par une miraculeuse végétation capable de s’adapter aux climats les plus extrêmes et jaillissant du sol poussiéreux, formaient des cavités sinueuses. Un long silence s’installa. On entendait uniquement le sifflement du vent s’engouffrant entre les dunes rocheuses ocre de ce lieu sauvage. Il reproduisait les notes d’une ballade mélancolique, interprétée par un vagabond solitaire, racontant les blessures et les espoirs d’une vie meilleure. Leur cigarette à moitié fumée, ils s’en débarrassèrent d’une chiquenaude sur le tapis qui s’embrasa à ce contact. Le tissu s’enflamma vivement, et ils s’imposèrent une distance de sécurité en reculant d’un pas pour faire face au corps en proie aux flammes. Spectateurs de la première heure, ils restèrent captivés par ce morbide tableau. Les habits d’abord dévorés, la chair rongée puis les os apparents du squelette grignotés dans un doux crépitement.
L’homme au costume bleu revint à la raison. Pas le temps de s’éterniser. Il était l’heure de reprendre la route. Il posa son pied sur un morceau de chair calciné et poussa d’une pression le cadavre dans le précipice. Le corps en feu roula et entama une chute sans fin, virevoltant dans l’air comme un avion de chasse en piqué. Les deux hommes n’attendirent pas la conclusion de la scène finale pour revenir à leur voiture et rebrousser chemin jusqu’à leur point de départ…
CHAPITRE IILa sixième chaise
New York, novembre 1958.
Il était plus de onze heures et demie du soir. Cinq hommes demeuraient reclus dans une pièce de douze mètres carrés depuis plus de trois heures. Ces messieurs jouaient au poker autour d’une table ronde, laissant une sixième chaise vacante. Derrière elle, un tableau était accroché, Waterloo, signé de Coolidge, une peinture qui rappelait étrangement la scène qui se déroulait en ce moment même. L’endroit était enfumé par les cigares et les cigarettes des joueurs. Une fenêtre à guillotine donnant côté rue était ouverte à mi-parcours pour leur éviter une asphyxie accidentelle. Les bruits ambiants de la ville s’insinuaient à travers elle pour s’accorder avec la musique jazz qui s’échappait du bar-restaurant adjacent.
La tension entre les joueurs était palpable. Ils se jaugeaient du regard, leurs cartes en main, alors qu’une mise importante était au centre de la table. Plus de mille dollars avaient été amassés lors des diverses parties. Cette somme avait été récoltée en grande majorité par un joueur chanceux qui avait empilé tous ses jetons en colonne pour afficher son ostensible triomphe.
Cigare en bouche, cet homme aux cheveux gris, la soixantaine, portant des lunettes noires à monture browline, jubilait de garder le suspense. Tous attendaient fébrilement qu’il étale enfin son jeu. À sa gauche, un homme noir, quadragénaire, le regardait tout en faisant glisser une pièce en argent, estampée de la tête d’un aigle sur l’avers, entre les articulations de ses doigts. Un chapeau melon noir ballottait sur le dossier de sa chaise. Un homme du même âge, brun et trapu, fixait avec hargne l’homme aux lunettes. Plus jeune de dix ans, ce joueur au visage angélique attendait lui aussi le résultat final, une cigarette entre ses doigts. Le dernier, frôlant la cinquantaine, était brun, grand et athlétique. Il fumait un cigare en dévisageant impassiblement le maître du jeu qui tardait à dévoiler sa stratégie. Le doyen regarda un à un ses adversaires. Un fin sourire se dessina sur ses lèvres dissimulées derrière ses cartes en éventail. Il cessa de les faire languir plus longtemps. D’un seul coup, il abattit son jeu sur le tapis vert où était déjà disposée une river, et révéla à la vue de tous sa main gagnante. Les quatre autres joueurs se penchèrent pour examiner les cartes et, stupéfaits, découvrirent une paire. L’homme aux lunettes venait, contre toute attente, de remporter la partie. À ce coup de théâtre, l’homme trapu se renversa, complètement désabusé, dans sa chaise.
— Merde, putain, mais c’est pas vrai ! s’écria-t-il.
Des cartes s’envolèrent du plateau de jeu sous son accès de rage. Ravi, le gagnant ramassa tous ses gains.
— Tu apprendras, Clyde, qu’il faut toujours se méfier de l’eau qui dort, plaisanta le vainqueur.
Clyde Lyon. Rustre et opiniâtre étaient les deux mots qui définissaient le mieux l’individu. Il était brun, ramassé et râblé. Il avait le visage d’un homme suscitant à la fois confiance et réticence. Tout dépendait de qui et de la manière dont on l’abordait. Un Écossais pur malt, comme il aimait à se décrire. Fier de ses racines, il ne manquait jamais d’en vanter les mérites. Un peu bourru sur les bords, la délicatesse n’était pas son fort. Il avait le sang chaud et ne faisait rien dans la finesse. Riche ou pauvre, éduqué ou simple d’esprit, il vous traitait de la même manière, quelles que soient vos origines. D’un naturel impatient, il n’aimait pas gaspiller son temps avec des broutilles. Telles les formules de politesse : « Bonjour, comment allez-vous ? », ou bien : « Quel beau temps aujourd’hui, madame Robinson. » C’était sûrement une des raisons pour lesquelles son banquier repoussait son prêt depuis plusieurs mois. Il va sans dire que commencer un entretien par : « Signez-moi ce foutu papelard pour que j’puisse bouffer aut’ chose que de la pâtée pour chien » n’était pas la meilleure des entrées en matière. Son franc-parler lui avait causé pas mal d’ennuis par le passé, ainsi que plusieurs séjours dans une miteuse cellule avec un pot de chambre malodorant pour lui tenir compagnie. Malgré ses défauts, ou qualités pour certains, il avait ce quelque chose en plus, ce je-ne-sais-quoi qui le rendait attachant aux yeux des gens.
Clyde n’en revenait toujours pas de s’être fait avoir de la sorte. Agacé, il s’indigna, avec un geste las de la main :
— Fait chier, putain ! J’y crois pas, t’avais qu’une paire.
— Un peu de classe, mon cher, s’empressa de le rappeler à l’ordre son adversaire. Nous sommes entre gentlemen. Et puis, tu sais ce que l’on dit, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières.
Clyde fusilla du regard l’homme aux lunettes.
— En tout cas, intervint l’homme noir, parler de toute cette eau me donne soif. Jim, sers-m’en un autre, s’te plaît.
Il agita son verre vide vers le grand homme brun.
Jim Nash. Discrétion et force tranquille. Grand, costaud, des cheveux de jais parfaitement coiffés. Ses joues étaient creuses et ses sourcils, plus bas qu’à l’ordinaire, renforçaient son regard sérieux et distant. Des tatouages décoraient la peau de son torse et de ses bras camouflés par ses habits, à l’exception de la pointe d’une dague qui dépassait sur son cou où une ancienne cicatrice marquait une partie de son larynx. Joli garçon, on le confondait souvent avec un jeune acteur de cinéma. Il présentait constamment cette même expression, celle de l’impassibilité, parfois confondue avec de l’indifférence. Ceux qui ne voyaient pas la différence étaient nûment ignorés. Jim était un homme réservé qui savait parfaitement cacher ses émotions à ses semblables. Il était l’ami loyal sur lequel on pouvait compter dans les moments difficiles. Le genre de personne dont vous n’aviez pas peur de composer le numéro à trois heures du matin pour une fuite d’eau inondant tout votre appartement. En comparaison, celui de Clyde était en fin de liste du répertoire de Lloyd pour ce type de services. Il était grand mélomane et la musique lui tenait lieu de mots, communiquait en notes ses pensées. Tous aimaient sa qualité d’écoute, mais surtout sa capacité à ne pas répondre.
Jim prit son verre ainsi que celui de son voisin. Il se dirigea vers une table sur laquelle étaient alignées des bouteilles d’alcool, puis arrosa généreusement les deux verres de scotch.
Le plus jeune joueur en profita pour étirer ses bras et congratuler au passage le vainqueur de la soirée :
— Troisième partie et troisième fois que tu gagnes, Lloyd. Je sais pas si tu as corrompu ton ange gardien, mais ce soir, tu es un homme béni des dieux. La chance semble avoir été de ton côté, j’te tire mon chapeau.
L’intéressé posa une main sur sa poitrine pour signifier que ce compliment lui allait droit au cœur.
Lloyd Steadworthy. Intelligence et élégance résumaient l’homme aux lunettes. Il avait une figure rayonnante, un nez long, une large bouche et de grands yeux pétillants. Il possédait une haute stature longiligne qui, remarquable et remarquée, dépassait le mètre quatre-vingt-dix, et dominait toutes les personnes qui se trouvaient autour. Il était né dans une ville appelée Norwich située dans l’est de l’Angleterre, non loin des côtes de la mer du Nord qui léchait les plages et les falaises rocheuses bordant le territoire insulaire. Une autre partie de lui, par sa mère, était française. Entre rébellion et retenue, il n’était pas en reste pour exprimer ses opinions. Il avait une voix chantante et chaque mot prononcé devait être une note exécutée à la perfection. Un intellectuel qui pouvait dévorer une dizaine de livres par semaine. Poésie, théâtre, littérature… tout y passait. Sa curiosité, comme ses discours, était infinie. L’art vestimentaire n’avait pour lui aucun secret. Un vrai dandy qui connaissait par cœur toutes les règles du parfait gentleman. Aux antipodes, Clyde n’aimait pas ses manières sophistiquées et s’empressait, dès qu’il en avait l’occasion, de se moquer de l’esthète. Les deux hommes étaient comme chien et chat. Ils s’envoyaient des piques perpétuelles dans l’espoir qu’un jour, l’un d’eux déclarerait forfait sur son lit de mort. Les paris étaient lancés.
Lloyd sourit et dit :
— La chance n’a rien à voir avec ça, mon cher Antonin. Je suis tout simplement un maître du camouflage.
Antonin North. Jeunesse et inventivité. Surnommé « Tony » par ses amis, il était le plus jeune de la bande. Celui qu’on aimait préserver des contraintes de la vie, mais à qui on aimait aussi faire observer sa beauté derrière sa perversité. De taille moyenne et pas très musclé, le jeune homme à la tignasse blonde et aux yeux bleus usait plus de son imagination pour se dépêtrer des pires situations que de son physique bien trop vulnérable pour un violent combat. Plein de fougue, il ne s’avouait pas facilement vaincu. Chaque jour représentait un nouveau défi, une nouvelle occasion de prouver ses capacités à faire partie de ce monde.
Clyde ingurgita une grande lampée d’alcool puis, d’un revers de la main, il essuya les résidus du liquide sur sa bouche.
— Camouflage mon cul, protesta-t-il en reposant son verre avec force.
Jim rendit le verre rempli à son propriétaire et retourna s’asseoir pour assister, fatigué, à l’absurde conflit.
— Vous devez appeler un chat un chat, cita Lloyd avec une pointe de suffisance. Et ce soir, on peut dire que vous êtes faits comme des rats.
— Moi, j’dis que ce soir, tout c’que t’as eu, c’est une putain de veine de cocu.
— Pour l’amour du Ciel, Clyde ! C’est avec cette bouche-là que tu embrasses ta femme ?
— Moi au moins, j’en ai une.
— Mieux vaut être seul que mal accompagné.
Clyde foudroya le dandy du regard à cette nouvelle agacerie.
— D’un autre côté, Clyde n’a pas tout à fait tort, soutint l’homme noir.
— Aaah, bah voilà ! Qu’est-ce que j’viens de dire ? Même Archibald est d’accord avec moi, dit Clyde en désignant son voisin de table d’un geste désinvolte.
Archibald Day, dit « Archie ». Réfléchi et farceur. Assez grand, Archie était un homme séduisant qui bénéficiait d’une bonne musculature. Un physique avantageux dont il usait parfois pour charmer celles qu’il ne laissait pas indifférentes. Et lorsqu’il arborait son sourire ravageur, qui faisait craquer bon nombre de demoiselles, des fossettes apparaissaient au creux de ses joues et le rendaient encore plus irrésistible. Même arrivé à l’âge adulte, il avait gardé l’air mutin du gamin prompt à faire une bêtise, notamment du fait de ses grands yeux noirs expressifs. Archie aimait faire rire et cultivait souvent son goût pour la comédie afin de se faire accepter là où il n’avait pas pied. Il était un Afro-Américain originaire de la Louisiane, un État du Sud entre le Texas et le Mississippi. L’enfant chéri du bayou n’avait pas peur de prendre des coups et avait appris très tôt à se défendre si nécessaire. Quoi qu’il en soit, il faisait profil bas et évitait les frappes inutiles, au-delà de certaines limites. Clyde était devenu, au fil des ans, son meilleur ami. Ils n’étaient pourtant pas destinés à une longue amitié, mais ils avaient vécu ensemble plusieurs aventures, dont leur première rencontre, qui les avait à jamais liés, pour ne plus se quitter. Ils veillaient l’un sur l’autre comme des frères. Pudiques, ils évitaient toujours néanmoins de parler de ce lien indéfectible.
— Je dis juste que sans Teddy à la table, tu as eu une chance en plus de gagner, dit Archie. Et toi, appelle-moi encore une fois par mon prénom et j’te fais avaler tous ces billets et pas par l’endroit le plus agréable, ajouta-t-il sévèrement en pointant Clyde du doigt et en esquissant un rictus.
Archie détestait être appelé par son prénom complet et préférait l’utilisation de son diminutif. Une erreur que l’Écossais s’abstiendrait de répéter.
— Il est vrai que Ted est le meilleur d’entre nous pour manier les cartes, renchérit Lloyd en aspirant une autre bouffée de son cigare. Peut-être aurais-je eu le loisir de le battre, s’il avait eu la décence de nous faire l’honneur de sa présence.
— Conneries ! rugit Clyde. Il t’aurait éjecté de la table dès le second tour.
— Je n’ai qu’une seule chose à dire : la critique est aisée, mais l’art difficile.
— C’est qu’il continue, ce p’tit con ! Arrête tes cantiques, le ratichon, ou j’te fais un exorcisme maison que même une bonne sœur aurait du mal à déguster.
Au rendu puissant de son alcool ambré, Archie grimaça légèrement.
— Au fait, pourquoi Teddy n’est pas là ce soir ? demanda-t-il en indiquant la place vide avec son verre.
— Demain, il est en passeri, répondit Antonin. Il préférait rentrer chez lui pour être en forme.
— Ah, le chœur de l’aube ! s’exclama Lloyd tout sourire. N’existe-t-il pas de plus beau chant au monde que celui…
— De ces oiseaux du soleil levant ? terminèrent Archie et Clyde, railleurs.
— Quelle belle harmonie, messieurs, à quand un quartette ?
Antonin eut un rire en écrasant sa cigarette dans le cendrier, puis Clyde rassembla toutes les cartes pour en faire un tas. Il divisa le paquet en deux et les mélangea en les intercalant. Malgré ses défaites répétées, il n’avait pas dit son dernier mot et se jura de ne pas rentrer chez lui les poches vides. Plus que son argent, sa dignité était en jeu.
— Bon, prêt pour une autre partie ? C’te fois, j’vais tous vous liquider jusqu’aux dernières de vos primes. Oh ! et Archie, j’veux voir tes billets dépliés sur la table. Pas question que tu nous fasses encore le coup du billet de dix en cent dollars.
Archie eut un air fâché et s’exécuta sans grand enthousiasme.
— Ça sera sans moi les gars, annonça Antonin.
— Pourquoi ? Ta matrone t’attend ? plaisanta Archie.
— Très drôle… Le patron veut que je m’occupe d’un nouveau, demain.
— Tu vas devoir jouer les instructeurs ?
— Ouais, le pire, c’est qu’avant, j’ai une migration à faire.
Le jeune homme se leva et enfila paresseusement son manteau.
— J’ai enchaîné des contrats toute la semaine. Je sais même pas si je vais réussir à lui apprendre quelque chose.
— Pour c’que tu sais… le taquina Clyde.
Antonin réprimanda son ami, fier de sa boutade, par une petite tape derrière la tête. Archie rit de cet échange et enchaîna sur un ton narquois :
— C’est vrai que ce mois-ci, tu n’es pas sur le podium. Continue de trébucher et tu finiras dernier. Ou pire, comme Gary…
— Comparé à vous, je suis plutôt bien placé, répliqua Antonin.
— Le mois n’est pas encore fini, dit Archie avec une œillade furtive.
Clyde distribua les cartes, mais Lloyd les refusa.
— Navré, dit-il en se levant à son tour, mais il est aussi l’heure pour moi de quitter la table et d’aller rejoindre les bras de Morphée. J’ai l’impression que plus je vieillis, plus il m’est difficile de tenir le rythme. Profitez bien de votre soirée, les enfants, car le jour viendra où vous finirez comme moi. Comme le disait ma chère mère, tôt ou tard, la vie vous fera payer l’impudence de notre jeunesse.
Le dandy se prépara à partir devant un Clyde médusé.
— Quoi ? Tu te fiches de moi ! s’indigna-t-il. Repose immédiatement tes miches sur cette chaise. Tu crois que j’vais te laisser te défiler sans prendre de revanche ?
— Je préfère me retirer en vainqueur, répondit Lloyd d’une voix ensommeillée.
— Dis plutôt que t’as les jetons que j’puisse te mettre la raclée de ta vie.
— L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt.
— T’en veux une, d’expression ?
Clyde leva effrontément son majeur droit. Lloyd lâcha une longue plainte à cet odieux affront.
— Charmant… fit-il en plaçant son chapeau sur sa tête.
Par tous les temps, Lloyd portait un feutre qu’il enjolivait d’une petite plume sur le côté. Il s’amusait à la changer selon son humeur et sa tenue, une excentricité qui lui faisait parfois perdre de précieuses minutes lorsqu’il devait se préparer pour sortir.
— Sur ce, bonsoir messieurs, et évitez de rejoindre les vignes du Seigneur, déclara Lloyd en couvrant sa bouche de sa main pour masquer un bâillement disgracieux.
— J’fais que suivre ses préceptes, répliqua Clyde d’un haussement d’épaules.
L’Écossais leva théâtralement son verre de vin.
— Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l’alliance, nouvelle et éternelle, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés.
Il avala cul sec son breuvage biblique et scanda :
— Eeeet amen !
Lloyd secoua la tête. Cet homme était irrécupérable. Il quitta l’arrière-salle avec Antonin et ils traversèrent ensemble un couloir débouchant sur un bar-restaurant rempli d’hommes et de quelques femmes buvant et fumant dans une ambiance festive. Un juke-box passait en boucle des chansons de jazz et de blues. Des groupes de musiciens venaient parfois remplacer la machine et jouaient un large catalogue pour la plus grande joie des clients en mal de sensations. Un grand comptoir rectangulaire fermé comme un enclos, sculpté en bois de chêne et équipé d’une main courante avec des repose-pieds en laiton, trônait au centre de la salle. Une étagère à alcools ainsi qu’un percolateur se trouvaient au milieu. Tout autour du bar, des tables avec des banquettes en cuir étaient dispersées. D’immenses baies vitrées faisaient office de papier peint et offraient une vision parfaite sur le croisement de deux rues. La comparaison avec une vitrine de magasin était pertinente. Une publicité ingénieuse pour le propriétaire des lieux contre ses concurrents conformistes. Le jour, elles procuraient un gain de lumière supplémentaire, mais permettaient aussi aux badauds d’avoir une vue prenante sur l’intérieur et d’oser pousser la porte d’entrée. Le soir, elles donnaient envie de participer au tourbillon tapageur entre danse, chant et musique. C’était le même principe que pour l’attirance d’un papillon de nuit par la chaleureuse lumière d’un réverbère, les êtres humains n’étaient pas si différents des insectes : ils grouillaient de partout en espérant ne pas se faire écraser par plus grand qu’eux. En fin de compte, une semelle de chaussure valait autant que le regard censeur de Dieu. C’était une simple question de point de vue. La devanture était en bois peint d’un vert mêlé de bleu. Une enseigne placardée au sommet spécifiait en lettres d’or : « The Devil’s Pack ». Contrairement à ce que l’on pouvait croire, aucun démon ou esprit malfaisant ne venait y prendre le thé, une certaine joie de vivre y était même omniprésente. On pouvait venir boire un verre ou bien un café en lisant son journal, et encore déguster la spécialité : l’omelette aux champignons. Réputée dans toute la ville, celle-ci était servie légèrement baveuse, avec quelques épices pour rehausser le goût, à l’origine un peu trop commun pour le palais de ses admirateurs. Elle fondait sur votre langue comme du beurre sur une pile de crêpes encore chaudes. La rumeur disait que la recette avait traversé plusieurs pays et océans pour directement atterrir entre les vieilles casseroles et les plaques de cuisson graisseuses de l’arrière-cuisine de l’établissement. Et personne n’avait à cœur de percer le secret de ce plat descendu tout droit des fourneaux du paradis. Ici, la clientèle se révélait différente le jour et la nuit. Lorsque le soleil était levé, c’étaient les travailleurs des environs : commerciaux, ouvriers et même artistes. Et à son déclin, quelques hommes esseulés en quête de bonne compagnie ou venus se noyer les tripes au tord-boyaux. La bande aimait s’y réunir après le travail. Ils partageaient habituellement un verre ou deux autour d’une partie de poker, puis relançaient les dés pour renouveler l’expérience la semaine d’après.
Les deux amis s’approchèrent du robuste comptoir. Antonin y déposa l’argent de leurs consommations de la soirée. Un barman blond vint à leur rencontre et empocha la somme sans vérification préalable. C’était le tenancier du Devil’s Pack, Neal pour les intimes et « Hé toi, le blondinet, ramène tes miches par ici » pour les soûlards. Il portait un uniforme blanc avec un calot en papier sur la tête. Armé d’un vieux torchon, il astiqua la surface du bar, maculée d’une trace liquide faite par un verre de whisky un peu plus tôt servi.
— Alors, qui est le grand gagnant ? leur demanda-t-il joyeusement.
— Le plus bavard, répondit Antonin en désignant son ami d’un signe de tête.
Neal tourna son regard étonné sur le dandy pour le féliciter. Lloyd l’en remercia chaleureusement.
— Qu’est-ce que tu vas faire de tes gains ? l’interrogea Neal sur le ton de la curiosité.
— Je ne le sais pas encore, répondit Lloyd pensivement, mais comme le disait notre estimé Benjamin Franklin : « La richesse, ce qui compte, ce n’est pas d’en disposer mais bien d’en profiter. » Et je compte bien suivre ce conseil à la lettre.
Neal eut un petit rire. L’espièglerie du dandy l’avait toujours amusé.
— Vous voulez boire autre chose ?
— Non, on va rentrer, déclina Antonin.
— Pas de problème. Bonne soirée, messieurs.
Ses deux clients lui souhaitèrent la même chose et ils s’éloignèrent vers la sortie. Alors que son ami poussait la porte de l’établissement, Lloyd en profita pour se retourner et scander :
— Neal ! Prends garde aux chapardeurs de comptoir. À cette heure, ils profitent des inconscients.
— Comme d’habitude !
Ils lui firent un signe de la main puis troquèrent la chaleur conviviale du bar contre la fraîcheur mordante de la nuit. Un couple d’amoureux un peu chancelant les suivit. L’homme retenait difficilement la femme, rieuse et quelque peu ivre, pour l’entraîner sur le chemin de leur domicile. Lloyd et Antonin se lancèrent un regard rieur. Certains avaient grandement surestimé leur résistance. Un vent âpre les frappa. Face à la devanture du bar, Lloyd enroula son écharpe autour de son cou sensible.
— Quelle nuit ! fit-il en frissonnant.
Antonin sortit un paquet de cigarettes, plaça l’une d’elles dans sa bouche et tendit le reste au dandy.
— Sans façon, refusa-t-il, je refrène ma consommation.
Antonin rangea son paquet avec stupéfaction.
— Toi ? Tu plaisantes ?
— Jamais avec la santé.
— T’as fumé des cigares toute la soirée, répliqua Antonin en allumant sa cigarette.
Lloyd haussa les épaules.
— Ce ne sont que des petits plaisirs de la vie dans une courte parenthèse de loisir. Rien de mal à ça.
— Si tu l’dis. J’peux savoir ce qui t’a fait changer d’avis ?
Ils entamèrent leur balade dans les rues de Manhattan. Un trafic continu perturbait le silence de la nuit. Sur leur route, ils croisèrent des habitants insomniaques. Les plus fêtards cherchaient encore un dernier bouge pour terminer leur soirée au creux des bras de la déesse des rêves, et avec un peu d’espoir avec le comptoir d’un bar comme oreiller. Lloyd tira profit de cette promenade pour exposer au jeune homme les dangers de la cigarette encore méconnus de la population.
— Je viens de lire un récent article affirmant que la consommation excessive de cigarettes serait nuisible à notre santé. Elle pourrait créer des cancers du poumon et nous entraîner vers une mort certaine.
Lloyd avait toujours eu le sens des mots, mais certainement pas celui du réconfort. Ne lui demandez surtout pas de vous remonter le moral après une dure rupture. En plus de vous accabler avec les vers les plus tristes de Walt Whitman, il vous citait inévitablement Flaubert et sa fin tragique de Madame Bovary pour vous expliquer la condition de la femme dans la société.
— C’est ça qui t’inquiète ? s’étonna Antonin. Franchement, avec c’qu’on fait, t’as plus de chance d’y passer à cause d’un fusil à pompe qu’en grillant une cigarette.
— Mourir par une balle ou par une cigarette, c’est la même chose, en ce qui me concerne.
— Alors, pourquoi tu veux arrêter ?
— En fait, j’ai surtout peur d’abîmer ma voix.
— Ta voix ?
— Eh bien oui, répondit-il, visiblement blessé. Comment veux-tu que je chantonne mes poèmes avec une voix de baryton comme celle de Clyde ? Ce serait d’une horreur incommensurable.
— Tu oublies qu’avec cette voix de crooner, tu pourrais toujours te reconvertir dans le jazz.
— Je te l’accorde. Bien que je ne possède pas le talent d’un Sinatra ou d’un Calloway pour interpréter ce genre musical. J’ai toujours considéré qu’il fallait avoir un vécu, ou du moins une forme de mélancolie naturelle, pour chanter du jazz ou du blues.
— Ce genre de musique peut être festif.
Lloyd freina ses pas pour solennellement réciter :
— La mélancolie, c’est le bonheur d’être triste.
Antonin jeta un regard lourd de sens au dandy.
— Merci, Confucius…
— Détrompe-toi, il s’agit de Victor Hugo, mais je peux comprendre ton erreur. Ils ont tous les deux voulu offrir leur vision du monde et résoudre les problèmes de leur temps.
Ils prolongèrent leur virée pour s’arrêter quelques mètres plus loin sur le pont George-Washington, un pont suspendu immense qui reliait le quartier de Washington Heights et celui de Fort Lee dans l’État du New Jersey. Voitures et piétons s’y côtoyaient sans risque sur deux routes différentes. Ils s’accoudèrent à une rambarde et contemplèrent silencieusement le panorama nocturne de la ville, avec sa splendide vue sur l’Hudson River et ses tours illuminées à rendre jalouses les étoiles. L’écho des sirènes d’urgence associé au va-et-vient des véhicules créait une harmonie unique. Un océan de sons et de lumières qui s’étalait à perte de vue. Certains s’y baignaient les yeux fermés, tandis que d’autres s’y noyaient sans parvenir à remonter à la surface. Lloyd observa avec un sentiment de bien-être le fleuve somnolent et dit :
— Tout comme eux, nous participons à l’écriture de notre monde.
— Du moins, on n’écrit pas l’histoire sur du papier.
— Je préfère dire qu’un homme avec une plume et quelques gouttes d’encre a autant d’influence dans ce monde qu’un autre avec un « Tommy Gun » et des balles sans fin. La liberté est la même, mais la manière dont on défend sa cause reste aussi dangereuse pour chacune des parties qui s’opposent.
Il s’autorisa une pause, comme pour méditer sur ses propres mots. Antonin perdit son regard meurtri dans l’horizon paisible. Quelque chose le tracassait en son for intérieur. Lloyd ne se rendait pas toujours compte de l’impact de ses discours sur les autres. Il avait ce pouvoir d’éveiller n’importe quel esprit et même de l’influencer. Pour lui, les phrases s’enchaînaient pour produire une belle mélodie. Un don de la rhétorique que beaucoup enviaient. Quand d’autres baissaient la tête, lui la relevait et dissertait jusqu’à obtenir ce qu’il revendiquait. C’était comme ça, il était né avec ce talent.
— Dis… Tu ne t’es jamais demandé comment tout ça finirait ? demanda Antonin d’un air interrogateur.
Lloyd étudia sérieusement la question du jeune homme.
— Je pense que l’être humain s’anéantira du seul fait de sa cupidité.
— Je voulais dire… pour nous ? répliqua Antonin en tournant son regard perplexe sur son ami.
— Bien, nous sommes les pionniers de cette démarche. Nous aidons le monde à faire le travail plus rapidement et plus proprement en chatouillant notre belle planète bleue.
Sa cigarette entre ses dents, Antonin étouffa un rire. Un silence confortable s’installa. Ils chérissaient tous deux cette halte, pendant laquelle le monde continuait à vivre sans eux. Cela était si rare. Les lumières des buildings aux alentours se miroitaient sagement dans l’eau calme de l’Hudson, alors qu’un léger vent venait battre contre leurs oreilles engourdies. Lloyd loua cet air frais vivifiant. Un soupir d’apaisement se libéra de sa bouche et se matérialisa dans l’air froid par une fuyante nuée blanche.
— J’aime me promener la nuit dans New York, dit-il, le nez levé au ciel. Avec ses passants divaguant, ses voitures, ses rivières et ses étoiles berçant nos songes d’une nuit. Une réalité si belle que nous pourrions presque nous croire dans une peinture de Rockwell.
— Il ne peint qu’un idéal. La vie est bien plus compliquée qu’un dîner de famille dominical.
— C’est juste, mais derrière tous ces sourires, il peut se cacher de bien sombres secrets.
— Et quoi ? Ça n’est pas un peu moralisateur de peindre les mensonges de la vie autour d’une dinde ?
— Nous sommes très mal placés pour l’en blâmer, rétorqua Lloyd avec un sourire malicieux.
En regardant l’eau du fleuve onduler, Antonin approuva, amusé, les paroles de son ami. Le philosophe lunaire fourra ses mains dans les poches de son paletot puis récita en affichant un air serein :
— Comme le dit Shakespeare, le monde entier est un théâtre. Et les hommes et les femmes ne sont que des acteurs, ils ont leurs entrées et leurs sorties.
— Dire que tu as le premier rôle.
— J’espère seulement qu’on me jettera des roses en fin de scène.
Antonin lâcha un nouveau rire. Les noctambules se détachèrent du pont et rebroussèrent chemin pour atteindre un point stratégique du trafic routier. Ils marchèrent le long d’un trottoir, puis Lloyd brandit sa main pour intercepter un taxi sur la chaussée. Il retint la portière et proposa à son ami de partager la course.
Antonin rejeta l’offre :
— Pas la peine, je vais rentrer à pied. Le grand air me fera du bien avec tout ce que j’ai bu ce soir. Je dois garder les idées claires pour demain.
— Sage décision, mon jeune ami.
Lloyd glissa sur la banquette arrière. La vitre abaissée, il ajouta :
— Oh ! et si tu as besoin d’aide pour ton… (il jeta un coup d’œil furtif au chauffeur) petit entretien, appelle-moi.
Antonin s’amusa de ces précautions.
— Compte sur moi.
Lloyd souhaita une bonne soirée au jeune homme et transmit son adresse au chauffeur. Antonin resta un instant sur place pour regarder la légendaire automobile jaune s’effacer dans le flux de la circulation. Soudain, une rafale glaciale, se faufilant entre deux bâtiments, lui brûla la peau. Encore une minute planté ici, et il finirait par attraper la crève. Passer toute une journée sous les couvertures le tenta, mais imaginer la tête que ferait son employeur en apprenant sa désertion le découragea. Les jours de repos, même en cas de maladie, n’étaient pas tolérés ces temps-ci. Fièvre ou pas,il allait devoir se pointer au travail, alors autant être en forme. Il releva résolument le col de son manteau et reprit sa valeureuse errance dans la métropole ronflante.
CHAPITRE IIIL’Entreprise
New York, novembre 1958.





























