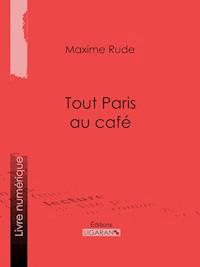
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Il me semble que, l'autre semaine, au plus loin, je voyais encore Henri Mürger entrer au café des Variétés. Quand le souvenir reste un peu vif, la distance des années est moins longue que celle d'une semaine. Voilà bientôt vingt ans, en effet ; le café des Variétés, un ancêtre parmi ceux du boulevard Montmartre, avait déjà vu blanchir toute une génération, qui avait mis du temps rien qu'à grisonner."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335097245
©Ligaran 2015
AU MAÎTRE DE LA CHRONIQUEÀEDMOND TEXIER
Souvenir et témoignage respectueux.
M. R.
SIMPLE AVIS
Depuis six mois, des amis, des confrères, des Parisiens, des provinciaux même me demandaient souvent :
– Quand allez-vous réunir en volume et compléter ces Études sur Paris au café, dont vous nous avez donné une partie dans le journal ?
C’est fait.
Voici un côté du Tableau de Paris pendant vingt ans. Je l’ai pris sur le vif ; je l’ai reproduit tel que je l’ai vu, fourmillant, houleux, capricieux, plein de migrations de tout un monde, d’un café à l’autre, qui restaient inexpliquées à plus d’un habitué du boulevard, saisissant d’oppositions, heurté des contrastes qu’on surprend surtout dans la Ville multiple qui a cent villes, comme Thèbes avait cent portes.
Figures et silhouettes y passent et y défilent : les unes célèbres, les autres au moins très connues ; toutes curieuses à regarder.
Au lecteur qui me demanderait pourquoi je ne me suis pas arrêté plus longtemps avec celles-ci ou avec celles-là ; pourquoi je n’ai pas montré, dans toute la bizarrerie de leur existence, les Pelloquet, les Delvau, les Desnoyers, pour ne citer que ces types de cafés et de brasseries ; pourquoi je n’ai pas un peu déshabillé, en traversant Madrid, les Gambetta, les Spuller et autres politiques d’actualité, je répondrai simplement :
– Lecteur, vous avez un grand tort : vous ne connaissez pas les Confidences d’un journaliste, que j’ai eu la courageuse fantaisie de publier il y a un an et demi déjà. Et pour moi, lorsque j’ai commencé à écrire le Tout-Paris au café, nul n’était censé les ignorer.
Je ne pouvais revenir, en effet, pour l’amusement et l’instruction de personne, aux portraits en pied et aux biographies. Cela existe ; cherchez-le ! Ici c’est la mêlée où un trait suffit, où un bout de nez dit beaucoup de choses. N’est-ce pas, ombre violette du nez de Guichardet ?
Voilà qui est entendu.
Qu’on se le répète.
M. R.
Paris, avril 1877.
Il me semble que, l’autre semaine, au plus loin, je voyais encore Henri Mürger entrer au café des Variétés. Quand le souvenir reste un peu vif, la distance des années est moins longue que celle d’une semaine.
Voilà bientôt vingt ans, en effet ; le café des Variétés, un ancêtre parmi ceux du boulevard Montmartre, avait déjà vu blanchir toute une génération, qui avait mis du temps rien qu’à grisonner. Il avait sa légende gaie et folle comme un vaudeville, ou même comme une parade, bariolée d’aventures d’un autre temps, bigarrée de personnages presque fantastiques, dont les noms paraissaient quelquefois sur des affiches de théâtres, comme ceux de revenants. Des anecdotes couraient, qui étaient, dès cette époque, les anas de chroniqueurs en retard et de compilateurs joyeux. Je n’ai rien à en répéter pour ne pas compiler à mon tour. Je reviens à Mürger.
La Vie de Bohème, au théâtre, l’avait en apparence tiré de la bohème depuis plusieurs années. Il avait traversé la Revue des Deux Mondes ; avec quels remaniements de manuscrit ? Peu importe ; mais on s’en souvient. Il écrivait, ou il était près d’écrire au Moniteur ; il allait être, ou il était décoré. Il s’habillait de noir, comme un avoué, l’ancien locataire de l’hôtel Jules-César, et la calvitie prêtait à sa tête un air officiel, malgré la larme élégiaque qui lui pendait toujours au coin de l’œil.
C’est ce Mürger, arrivé où il n’avait pas toujours espéré parvenir, qui écrivait à sa dernière Musette, sur une table du café des Variétés : « Je retournerai à Marlotte dès que j’aurai trouvé un louis. »
Marlotte, c’est là qu’il habitait, à deux pas de la forêt de Fontainebleau.
Il disait autrefois qu’il y avait des années où l’on ne travaille pas ; il y avait, en ce temps, des semaines où il ne partait jamais. Était-ce seulement le louis à trouver qui l’arrêtait ? Il comptait tant d’amis ! Et quand on le croyait à Marlotte depuis la veille, il reparaissait aux Variétés.
Brun, plus que brun, comme s’il eût reçu les coups de feu du soleil d’Afrique, des charbons pour prunelles, les moustaches noires épaisses, les narines au vent, sec, nerveux, redingote et pantalon de coupe militaire, vous prendrez celui qui s’assied à côté de Murger pour un officier de zouaves ? Détrompez-vous : c’est Théodore Barrière qui, lui, ne rêve pas trop longtemps sur le velours. Il achève un cigare, il en allume un autre ; et le voilà parti.
Autour de qui s’empresse-t-on à la terrasse (nous sommes en 1859-60) ? On dirait encore une moustache militaire. Autour d’un heureux, qui vient d’inaugurer sa réputation avec les naïvetés du 101eRégiment, et celles de la Bêtise humaine, le roman de Candide refait et accommodé aux mœurs et au goût du demi-monde parisien. J’ai nommé Jules Noriac, le boulevardier qui, à ma connaissance, a fait le succès du premier veston, et qui porte le dernier, à l’heure qu’il est.
Les poignées de mains distribuées, Noriac, le cigare aux lèvres (qui a vu Noriac sans cigare ?), traversait le rez-de-chaussée du café, de cette lanterne bourdonnante comme une ruche, et montait l’escalier tournant, où Paul Avenel avait déjà grimpé pour choisir sa queue de billard.
C’était entre cinq et sept heures du soir ; les autres habitués arrivaient. La plupart se tenaient en bas.
Ah ! le joyeux garçon, toujours riant, toujours causant, toujours remuant, très brun aussi, avec une moustache de lieutenant qui va passer capitaine. C’est Lambert Thiboust qui parle à Jules Moineaux, dont les moustaches cirées et aiguisées, le petit œil aigu, les lèvres minces, l’air froid, ne révèlent guère l’auteur des Deux Aveugles.
Et ce grand diable, à figure en lame de couteau, à mine patibulaire, on cravate blanche et en habit noir, avec un brin de feuillage à la boutonnière, ce fantôme qui a un tailleur et qui ne sait où fourrer ses longues jambes, que conte-t-il de si gai, sur un ton funèbre, au petit cercle d’auditeurs qui s’esclaffent de rire autour de lui ?
Ne vous étonnez pas trop : c’est Bache, l’acteur Bache, qui a fait subir au directeur de théâtre Ancelot tous les supplices de la mystification. Si nous l’écoutions, nous n’en aurions jamais fini.
Il ne manquait plus que Roger de Beauvoir : le voici qui entre, avec son éclatante gaieté brochant sur le tout. – Il revient de voir peut-être une paire d’avoués, une demi-douzaine d’huissiers, un juge, un procureur, toute la basoche dont il est la proie ; mais ne craignez rien : il ne vous assombrira pas de ses soucis. Interrogez-le, même, sur son dernier procès : il vous répondra par des couplets. Demandez-lui, par exemple, une monographie du café des Variétés, et vous dînerez, et vous souperez, et le lendemain, à la fin du déjeuner, après un fourmillement de portraits et d’anecdotes, il n’aura pas encore vidé sa mémoire et son esprit.
C’est aux Variétés que Roger improvisa, avec Thiboust, les amusants couplets sur Milon Thibaudeau, le directeur du Vaudeville :
Roger de Beauvoir, Lambert Thiboust, Murger, Bache… J’ai l’air de faire un tour de cimetière en compagnie de quelques survivants, et j’en passe, des morts ! Renard, qui, déjà malade, allait quitter l’Opéra et se traîner au café-concert avec de lamentables chansons. Et ce jeune homme, qui, en descendant du cabinet directorial de son père et de son oncle, était là comme chez lui et passait, le rire aux dents, les mains tendues à tous, léger, vif, pétulant : Léon Cogniard.
D’autres ont été plus heureux, dont je n’ai pas parlé, que l’on ne voit plus aux Variétés, mais que je retrouverai sans doute au courant de ces souvenirs : les rédacteurs du Diogène, qui eut son heure de succès vers 1858, et Carjat qui menait la bande. Un provincial égaré là, pendant ses vacances, devait en rêver au moins six mois. Je me rappelle un brave bonhomme qui, entendant sonner le dîner à l’hôtel d’en face, demanda quelle était cette cloche.
– Monsieur, lui répondit son plus proche voisin, c’est le bateau à vapeur qui part.
Les yeux du pauvre provincial roulèrent d’une façon inquiétante dans leurs orbites ; il prit son chapeau et s’enfuit du côté du passage Jouffroy. Il devenait fou, ou il croyait avoir été mêlé, un instant, à des pensionnaires de Charenton en congé.
N’allais-je pas oublier les frères Lionnet, ces Siamois de la romance, que, dans la suite, vous pourrez placer, sans que je les nomme, partout où il vous plaira ?
C’est plus tard qu’on voyait, après dîner, debout plutôt qu’assis, tout au fond, à la table de gauche, auprès du comptoir, tête blafarde aux cheveux crépus, visage grêlé aux pommettes saillantes, moustaches poussant ras, œil étrange, brillant sous l’arcade sourcilière, un vaudevilliste à ses débuts, un journaliste d’échos du Charivari, qu’on eût bien étonné, alors, en lui annonçant qu’il avait le souffle assez vigoureux pour jeter bas le château de cartes biseautées de l’édifice impérial. Rochefort – est-il besoin de le nommer ? – continuait une conversation peu politique avec le glabre Albert Wolff, ce Prussien officiellement réhabilité, comme citoyen neutre, dans les cercles de Paris.
Les patrons de cafés sont des rois absolus, mais qui ont une qualité. Quand ils ont fait fortune, ils ne tiennent pas à fonder une dynastie. Le sec Albouy, qui gouvernait les Variétés, passa le comptoir à un ventru, du nom de Lallemant, excellent compère, du reste, qui, au bout de peu temps, trouva son affaire. Un banquier de province lui achetait le café des Variétés.
Roger de Beauvoir, qui sortait du théâtre, Noriac, qui descendait, vers minuit, du premier étage, Denizet, si j’ai bonne mémoire, qui, malgré la gravité de la barbe, plaisantait, alors, l’Académie des sciences au Charivari, deux ou trois autres, et moi, avons assisté par hasard à la conclusion du marché, scellé par autant de verres de chartreuse. Le nouveau propriétaire, Hamelin, ouvrait, entre deux toasts, des perspectives d’Eldorado inconnu à ses habitués littéraires.
Il ne s’agissait de rien moins que de transformer le second étage en salle de correspondance et de rédaction, avec pupitres bourrés de plumes et de papiers variés.
Ce ne fut qu’un rêve, que promesse d’homme qui avait bien dîné et buvait d’autant. On ne lui en voulut pas. Le café des Variétés devint plus littéraire que jamais. Cette confrérie de rimeurs sans idées, qui s’appelle le Parnasse, y eut son berceau. On y voyait, avant dîner, le jeune Catulle Μendès, en nourrice entre Banville, revenu à ces Variétés qu’il avait tant fréquentées autrefois, et Baudelaire, qu’on n’y avait guère rencontré jusqu’alors. Baudelaire ? C’est là qu’il me contait ses visites de la journée, comme candidat à l’Académie : amusante équipée qu’il n’a pas eu le temps d’écrire et qui serait bonne à lire pour les gobe-mouches de la solennité.
Le bénédictin Charles Asselineau lui-même avait sa place dans ce milieu bruyant, et causait avec Hippolyte Babou du dix-huitième siècle, pendant que Monselet, qui écrivait son Fréron, souriait sous ses claires lunettes. Tout autour, papillonnaient, avec Catulle, des jeunes de la Revue fantaisiste : Villiers de l’Isle-Adam, Cladel, d’autres que je ne suis pas seul sans doute à avoir oubliés.
En même temps, arrivaient, de la brasserie des Martyrs, Charles Bataille, Amédée Rolland, Du Boys, l’ancienne trinité du café Racine, au quartier Latin, et de l’Odéon. Carjat fondait le Boulevard. La Revue fantaisiste était morte, vive le Boulevard ! Durandeau apportait ses charges et une composition assez amusante : un rêve de Baudelaire.
Puis, un jour, tout ce monde se dispersa. Hamelin, qui avait promis tant d’égards à ses clients, ne tenait point parole. Ce malheureux, que l’on soigne depuis deux ou trois ans, dans une maison de santé de Vanves, manquait souvent de la plus simple politesse quand il remontait de sa cave.
Canuche même, le type anti-apollonien si connu au boulevard Montmartre, se décida à quitter la place. Le café des Variétés n’eût plus été qu’une station de passants fatigués ou assoiffés, si la soupe aux choux ne lui avait fait une clientèle d’habitués de minuit.
Les bandes bariolées et bisexuelles du Rat-Mort, et autres établissements des boulevards extérieurs, y descendaient à cette heure-là. La pipe et la cravate blanche de Pelloquet y surnageaient dans une orgie de châles rouges, et la chevelure léonine de Coligny y accompagnait le crâne luisant de Fernand Desnoyers. C’était la première halte des noctambules.
Mais la soupe aux choux ne suffit pas à la prospérité d’un café. Il y a un an, à cette même époque, la pauvre madame Hamelin nous contait, à un ami et à moi, son malheur, presque sa ruine. Deux mois après, elle n’y était plus : le propriétaire du café de la Porte-Montmartre avait acheté les Variétés.
Ce n’était pas seulement un café à relever, mais un café à refaire. On y déjeunait peu autrefois ; on n’y dînait presque jamais. Le nouveau propriétaire, Poyé, a commencé par changer toutes les habitudes. On y déjeune beaucoup, on y dîne en corps, six heures sonnant, artistes des Variétés et des autres théâtres mêlés.
À peine le régisseur Chavannes, un habitué fervent, a-t-il achevé son vermouth et déposé sa pipe avant de partir, qu’on met le couvert sur toute la ligne du côté gauche, qui ressemble à une longue table d’hôte.
Lassouche y tient son coin ; on croirait toujours que la grosse voix de Baron va scander l’air des Carabiniers des Brigands ; Christian y essaye quelquefois les pétards qu’il fera partir dans la soirée au milieu de son rôle.
Voici Dupuis, le soldat bel homme qui fait tourner la tête aux grandes-duchesses, – tout un état-major, enfin, des artistes qui n’ont pas toujours le temps de dîner chez eux, panaché de jeunes femmes, leurs camarades de théâtre, qui sont plus sûres, en étant plus près, de ne pas manquer l’heure de l’entrée en scène. Ajoutez à cela quelques journalistes légers, parmi eux, Alfred Delilia et le Giboyer du Nain-Jaune.
Le café des Variétés, comme on voit, a repris un caractère qui a bien son pittoresque, s’il n’est pas tout à fait celui d’autrefois. Si tous les curieux, toutes les curieuses surtout de Paris et de la province, qui grillent naïvement d’envie de surprendre des artistes à la ville, de voir comment ils boivent et comment ils mangent, quand ils n’ont plus de bouteilles peintes et de pâtés en carton, me lisaient par hasard, le café des Variétés ne serait plus assez grand, et le propriétaire pourrait enlever l’écriteau du second étage : Cercle à louer.
Si Hamelin, l’ancien propriétaire des Variétés, avait eu quelque politesse, Madrid n’eût pas ou d’histoire. Car ce café a, en effet, son histoire dans la grande, si mouvementée et si tourmentée, de ces derniers quinze ans politiques ; ce qui ne veut point dire qu’il faille le voir exactement à travers la légende, composée à plaisir par les échotiers à tant l’injure de la réaction, et les puritains de l’ordre immoral. Le plus drôle, au milieu des hypocrisies qui font leur jeu, en ce cas comme en d’autres, c’est que les pudibonds et les indignés d’aujourd’hui se sont tous assis aux tables de Bouvet, et ne s’y accoudaient pas pour se boucher les oreilles.
Vers 1862, le café Bouvet, ou café de Madrid, n’était guère célèbre, au boulevard Montmartre, que pour avoir été le voisin du Lingot d’or. La salle que la clientèle émigrée des Variétés allait remplir, était un long boyau qui se tordait, à sa moitié, au tournant d’un escalier par lequel on descendait au sous-sol, aux billards. J’ai entendu conter que des juifs, brocanteurs ou agioteurs, se réunissaient dans ce sous-sol chaque après-midi ; mais, pour pénétrer dans ce monde sans l’effaroucher, il fallait peut-être quelque mot hébreu que je ne possédais pas.
Au reste, le plus grand nombre des habitués de Madrid appartenait à la classe laborieuse et riche des entrepreneurs, auxquels se mêlaient des négociants. Parmi les gens qui touchaient, d’un côté, à la littérature, le chansonnier Gustave Mathieu, qui, de l’autre, versait dans le commerce des vins de Champagne, eût été le seul à le fréquenter à cette époque, si son élève Fernand Desnoyers n’y était allé lui faire visite.
Quelques mois après, tout était changé. On sait comment le monde littéraire et artistique de la terrasse des Variétés avait traversé la chaussée ; ce fut l’affaire de quarante-huit heures. Le café est pour les hommes de lettres, les artistes, les journalistes, plus que pour personne, le lieu de rendez-vous, à heure fixe, où l’on s’échange par besoin, autant que par plaisir. L’endroit importe peu ; le milieu est tout ; aussi, quand la débâcle a commencé quelque part, elle emporte jusqu’au plus ancien habitué. Il suit ses amis ou ses pairs : c’est une loi de solidarité doublée d’une question de nécessité.
Le Boulevard, – excellent titre, en ce temps, – que Carjat avait témérairement lancé avec un lest considérable de littérature sans scandales et de poésie sans badinages grivois, attirait en outre les débutants de la veille ou du lendemain, jaloux de coudoyer Baudelaire et Banville et de s’asseoir entre Catulle Mendès et Villiers de l’Isle-d’Adam. Malgré leurs airs empanachés, les débutants se contentent de peu.
La première société, qui a fondé le Madrid de la légende, était donc purement littéraire, et un mot politique y eût éclaté comme une grenade à laquelle on n’avait aucune raison de s’attendre. Les républicains militants n’étaient représentés dans cette salle qu’à l’écart, tout au fond, par un chapeau à larges bords retroussés, pendu à la patère, sous lequel une barbe grise pontifiait assez discrètement, malgré la grosse voix qui parfois en sortait. C’était le père G***, comme on l’appelait sans façon, homme de fougue innocente, que j’ai retrouvé ailleurs, en ces dernières années, très cassé par les évènements.
C’est bien après que Delescluze, dont je vois encore la tête anguleuse et résolue, est venu présider le groupe des vieux birbes, avec son lieutenant Charles Quentin.
En 1863, je n’y avais rencontré Gambetta que par hasard, à une table de la terrasse, et avec un compagnon passionné pour les discussions de tous genres, s’accrochant à tout adversaire pour calmer sa propre fièvre, assez sceptique pour tout écouter sans indignation sincère, mais assez intéressé à la durée de l’Empire et de sa cassette pour ne vouloir rien jeter bas : Théophile Silvestre.
Deux ans plus tard seulement, ce salon de gauche du café de Madrid prend une vraie couleur politique. Et encore faut-il savoir comment, et par quelle suite de relations.
Alphonse Duchesne était le secrétaire du Figaro, le Figaro de Rochefort à cette époque, et Castagnary, le rédacteur en chef, de fait, du Nain Jaune de Ganesco. Tous les deux avaient l’habitude, peu subversive et très bourgeoise, on en conviendra, de faire leur partie de jacquet, au premier moment de loisir. Ranc et Spuller, qui tenaient le Nain Jaune, avec Castagnary, suivaient celui-ci entre cinq et six heures, des bureaux du boulevard des Italiens au café du boulevard Montmartre. Gambetta, qui était, non seulement leur ami, mais leur collaborateur à l’Europe de Francfort, se joignait à eux.
Voilà le noyau du Madrid politique. D’un Madrid absolument républicain ? Non. Et la preuve, c’est que M. Weiss, qui devait figurer, en 1870, dans le ministère Ollivier, – M. Hervé, qui dirigeait naguère encore les destinées de l’orléanisme dans le Journal de Paris, ne trouvaient ni leur modération, ni leur opinion compromises en prenant place à ces tables, où, par-dessus les deux Empires et la monarchie orléaniste, on évoquait le souvenir des hommes et des actes de la Révolution française.
La ruine du Boulevard, le souffle de la politique avaient dispersé la littérature égoïste. Hommes de lettres et poètes ne manquaient pas, néanmoins. C’est à Madrid que j’ai vu, pour la première fois, Frédéric Mistral, le félibre bonapartiste, qui n’appelait pas alors Paris « la cité rebelle », accompagné d’Alphonse Daudet, un des meilleurs guides en ce lieu, qu’il a peut-être maudit depuis. Trop de bonheur rend ingrat.
Quelqu’un a écrit, dans une énumération rapide des cafés du boulevard, qu’on eût trouvé à Madrid les cinq sixièmes de la Commune. On ne s’en serait guère douté. – Je crois voir encore Paschal Grousset, tête sans caractère, d’un joli banal, la raie coupant la chevelure par moitié, arriver à Madrid, vers 1867. Si quelqu’un avait dit que cet efféminé devait être, n’importe où et dans quelles conditions, ministre des affaires étrangères, tout le monde eût répondu à peu près par le mot de Rochefort, plus tard : – Ministre étranger à toutes les affaires.
Razoua, qui écrivait les souvenirs d’un zouave à la Vie parisienne, ne montrait point, malgré ses cheveux rasés et ses épaisses moustaches pendantes, le fond d’un meneur féroce d’insurrection. Quant à ce colonel de la Commune, Massenet de Marancour, qui n’avait jamais eu d’opinion qu’au jeu, sur la rouge et la noire, qui avait signé au Figaro les portraits orthodoxes des cardinaux romains, quel observateur lui eût soupçonné, je ne dirai même pas un sentiment, mais une velléité politique ? Marancour, qui avait eu l’occasion d’admirer, tout jeune, l’élégance de M. de Morny, visait à l’élégance jusque dans ses mauvais jours de bohème : le brillant de l’uniforme l’a perdu.
Vallès fréquentait le café depuis longtemps ; mais la politique ne lui avait sérieusement troublé la cervelle que depuis qu’il était passé, comme successeur de Rochefort, au journal de M. de Villemessant. Si nous comptions bien, nous verrions que le Figaro, qui a eu aussi Grousset, a produit plus de communards que le café de Madrid. Avec Vallès, qui s’étudiait à froncer son sourcil de nègre, à allumer des charbons sous ses yeux, à grossir sa voix en tonnerre roulant, je n’eusse répondu de lien ; et il m’eût annoncé, sans m’étonner, qu’il voulait faire flambler le vieux Louvre, de même qu’il demandait de brûler Homère.
C’était l’enragé à froid de l’effet à produire, et toujours le comique funèbre, qui, se vantant, quelques années auparavant, de n’avoir pas dîné, ajoutait : « Qu’est-ce que ça me fait ? J’appartiens à l’histoire ! »
J’ai aperçu à Madrid, tout à fait dans les dernières années de l’Empire, le lorgnon de Raoul Rigault ; mais cette tête chevelue de vieil étudiant bavard m’eût plutôt fait sourire que trembler.
Un autre, dont je me serais défié davantage, était une espèce de Quasimodo, à l’œil torve, aux cheveux d’un roux sale, braillard, indiscret et gluant, qui a rempli je ne sais plus quelles hautes fonctions de justice sous la Commune ; il se nommait Andrieu.
Il est peut-être un menu fretin que j’oublie ou que j’ignore. Cette salle n’était pas composée de la même société, alignée sur deux rangs de tables ; les limiers de police avaient même la leur, et des visages nouveaux passaient par là, sur lesquels on ne s’inquiétait guère de mettre un nom. La célébrité du Café de Madrid avait ses insectes bourdonnants, comme toutes les célébrités.
Vous savez le tapage qu’elle fit après la guerre et la Commune. Un jour, on trouva fermés les portes et les volets de la fameuse salle de gauche « pour cause de réparations ».
Bouvet, le propriétaire de Madrid, fut soupçonné par ses plus anciens habitués de complaisance réactionnaire : on s’en alla chez Frontin. De Frontin, on revint sur ses pas jusqu’au Pont-de-Fer, et, finalement, nombre d’émigrés retournèrent au café de Madrid. Parmi eux, de nouvelles figures : le fluet général Cremer, par exemple, maigre, avec les pommettes rosées, l’œil bleu, mélancolique et noyé des hommes qui meurent jeunes, et l’ex-major de Garibaldi, Bordone, un sanguin, celui-là, qu’on y voit encore régulièrement.
Les habitués de Madrid sont politiques et littéraires sans solennité, ce qui, dans la conversation, vif échange d’idées, ne gâte rien à la littérature et à la politique. La peinture, cette Majesté élyséenne des mois de mai et de juin, a là des représentants, de même que le train parlementaire de Versailles y amène des députés.
Voyez plutôt : voici le comte d’Osmoy, qui ruinerait le budget en subventions artistiques, causant, avec Babou, de ses dernières luttes au sein de la commission ; plus loin, c’est Ordinaire, qui permet à Carjat de le soumettre à toutes les épreuves photographiques et de prendre dix fois sa tête ; à Richardet, de publier sa charge à volonté.
Le matin, déjeuner d’habitués aussi dans cette salle de Madrid ; deux ou trois déjà nommés, puis Poupart-Davyl, l’auteur de la Maîtresse légitime et des Vieux Amis, bien plus haut en couleur que ses pièces ; – Gustave Mathieu, un revenant qu’on ne voit plus guère qu’à cette heure : – tous deux arrivant de Bois-le-Roi, de la forêt de Fontainebleau.
Dans la journée, l’ancienne clientèle des gros entrepreneurs reprend la place. Mais n’allez pas croire que cette salle soit tout le café Bouvet. Madrid a eu, depuis au moins douze ans, le besoin et les moyens de se transformer et de s’agrandir. Madrid a sa salle de droite bourrée de boursiers, négociants et gens d’affaires de toute sorte, et, quand vient le soir, son petit salon du milieu parfumé de cocotterie. Disposition heureuse, qui permet à tous les mondes d’y passer sans se rencontrer.
Les appointements d’un ministre sont encore assez loin d’atteindre le gain annuel de Bouvet. Ce n’est pas lui qui aurait l’ambition de lâcher, pour le portefeuille de M. Decazes, la serviette qu’il porte toujours modestement sur le bras.
Je ne veux pas que la rive gauche soit jalouse. Nous l’oublions trop vite, quand nous avons touché barre au boulevard Montmartre. Combien d’entre nous, pourtant, ont une moitié de leur jeunesse sous les décombres que vont balayer les manœuvres du boulevard Saint-Germain !
Donc, d’une enjambée, je passe les ponts ; je souris à l’air morne de l’Institut, et j’arrive rue de l’Αncienne-Comédie, à ce café, déjà célèbre au dix-huitième siècle, très fréquenté au commencement du nôtre, fourmillant d’habitués, il y a vingt ans encore, ressuscité de deux ou trois faillites, et vivant aujourd’hui, par miracle, dans un quartier dont le boulevard Saint-Michel a déplacé le centre et tari les anciennes artères : le café Procope.
On disait simplement Procope, autrefois, et tout le monde comprenait. Mais il est d’autres gloires, qui ont passé depuis cent ans, que celles des fondateurs de cafés.
Hier, j’étais entré dans la salle où causaient, jadis, les Diderot, les d’Alembert, les d’Holbach, les Jean-Jacques, tous les philosophes, tous les beaux esprits, du plus brillant au plus risqué, de l’auteur de Candide à Piron. Au grand étonnement du garçon de service, je m’assis à cette longue et large table que les journaux encombrent seuls, le plus souvent, et qu’on appelle la table de Voltaire : marbre de couleur café au lait, couché sur quatre légers pieds de bois recourbés, où la peinture a lutté contre le travail des vers.
Voltaire ? Il est là, sur ce panneau, peint par je ne sais quel décorateur qui a éteint le masque traditionnel sous une gravité rêveuse, et il semble me dire depuis un moment :
– Tu cherches, n’est-ce pas ? ce que le poète de ta jeunesse appelait mon « hideux sourire ». Que n’en avait-il quelque chose ? Il eût été plus sain, et de moins pernicieuse influence. J’ai vu Musset, tout jeune, à ta place même, battre ses bottes, avec impertinence, du jonc qu’il tenait entre deux doigts. Jamais blond plus élégant, aux cheveux mieux peignés, ne s’est élancé, plus leste et plus ardent, à la conquête de la vie. Mais il avait les sens aiguisés plutôt que le cœur sensible, et, même à l’âge ordinaire de la tendresse, une Bernerette ne l’eût pas longtemps charmé. Il avait l’esprit français et prêt à tout, dans les choses de la fantaisie et de la grâce, comme dans celles de la passion ; mais il se montrait singulièrement égoïste aussi, cet enfant gâté, habitué à ne voir et à ne sentir que ses propres souffrances, et voulant en faire comme un miroir à ses contemporains et à ses cadets. Tel je le devinais, à dix-neuf ans, à travers les premières insolences de l’orgueil : incorrigible par nature et par éducation, méprisant le commun des hommes, comme s’ils n’étaient pas ses égaux dans la vie publique, et ne devant rien comprendre, en dehors de l’amour, aux aspirations et aux douleurs de l’humanité.
Le visage de Voltaire me parut s’éclairer, et j’entendis :
– Au fond, cet enfant terrible m’aimait… J’ai vu ici, jusqu’en ces derniers temps, des gens moins célèbres, mais que j’eusse cru plus redoutables, d’après les petits écrits qu’on en lisait sous mes yeux. Connais-tu un des défenseurs de l’Arche sainte et de la Papauté, qui porte le nom plaisant de Coquille ? Mais, c’est le plus doux des buveurs de café et d’eau sucrée ! Pendant des années, – et il y a quatre ou cinq ans encore, – je l’attendais, tous les soirs, plus régulier que la pendule, à la même minute de l’heure. Il s’asseyait en face de moi, sur la gauche, entre Piron et Rousseau. Sa figure rasée souriait béatement sur sa cravate blanche ; adossé au mur, les mains croisées sur l’estomac, il tricotait des pouces, pendant que ses lèvres brochaient l’article catholique du lendemain. Il n’était pas jusqu’au sucre du café et du verre d’eau qu’il ne remuât avec une touchante componction. Un soir, il est parti. Procope se fermait. Procope s’est ouvert de nouveau ; mais le rédacteur ultramontain du Monde, qui me raccommodait avec les gens d’église, le bon Coquille n’est pas revenu. Ah ! si Patouillet lui eût ressemblé !
– En revanche, ô Voltaire ! si vous aviez vu ici Veuillot !
J’avais tourné la tête, et je regardais Jean-Jacques, dont s’était voilé le sourire que le décorateur de Procope a eu la fantaisie de lui prêter.
– Eh quoi ! disait-il, elle est morte, celle qu’on appelait la petite-fille de Rousseau ! Elle a souvent passé devant moi, il y a vingt-neuf ans, au sortir de dîner d’un de ces endroits que vous nommez aujourd’hui des restaurants : le restaurant Pinson, ici près, lequel a, du reste, disparu, à ce que j’ai entendu conter. Elle était George Sand, avec toutes les fougues de l’âme que les années même sont lentes à calmer.
« Te rappelles-tu madame d’Houdetot et sa première visite à l’Ermitage ? “Elle était en homme, ai-je écrit dans les Confessions. Quoi que je n’aime guère ces sortes de mascarades, je fus pris à l’air romanesque de celle-là. ”
Eh bien ! je fus pris de même, à l’air de cette femme, en costume d’homme aussi, qui avait, de quatre ans, dépassé la quarantaine, et portait, comme l’autre, encadrant son visage plus mâle et d’une singulière beauté, “une forêt de grands cheveux noirs qui lui tombaient au jarret. ” Quant à ses yeux, d’un feu sombre et profond, je les ai encore moins oubliés.
Elle dépensait partout une âme ardente et, comme je disais de moi, “un tempérament combustible”, qui s’était alors enflammé pour la politique. C’était en votre année de révolution 1848. Un homme à la chevelure emmêlée et drue, comme un chêne, accompagnait parfois madame Sand : un philosophe de votre temps, qui se nommait, je crois, Pierre Leroux. Désormais, c’est avec moi surtout qu’elle causera dans le monde les esprits immortels. »
À ce moment, l’éclat de rire d’un ivrogne, qui n’écoute personne, retentit dans la salle. Piron n’y tenait plus.
– Et moi, disait-il, et moi, qui avais si gaiement composé mon épitaphe !
N’ai-je pas eu mes surprises ? J’ai perpétuellement plongé sur des crânes blancs ou dénudés, qui appartenaient à ce que vous appelez pompeusement l’Institut de France. Étaient-ils assez ternes et ennuyeux, ces bonhommes, en lisant leur Revue des Deux Mondes





























