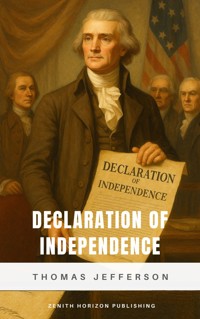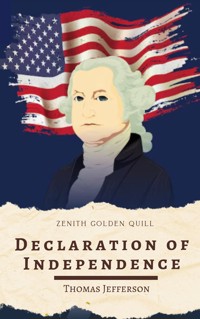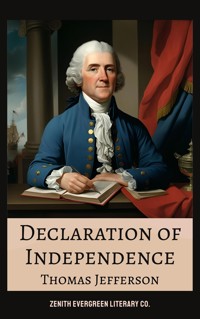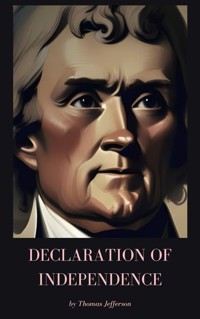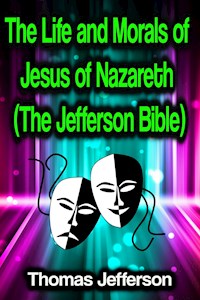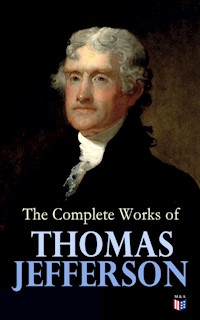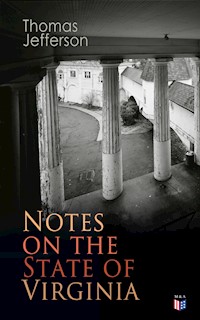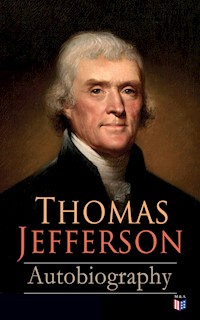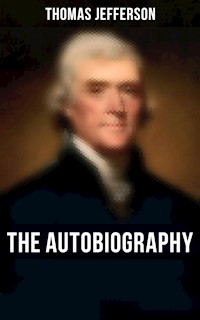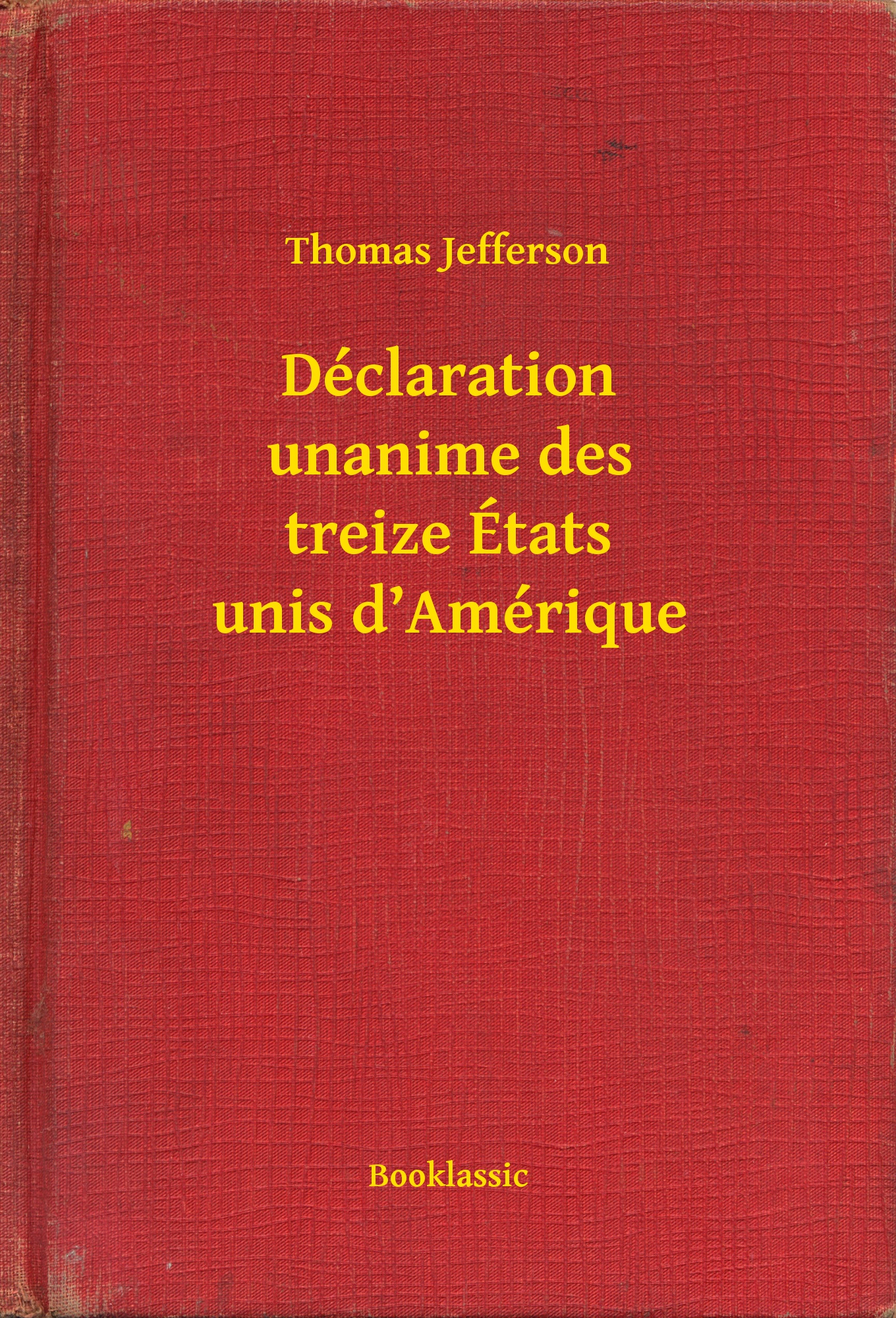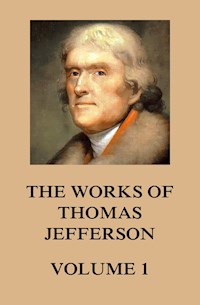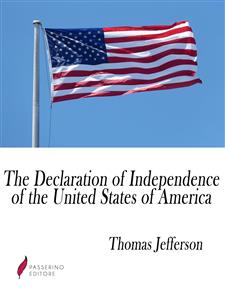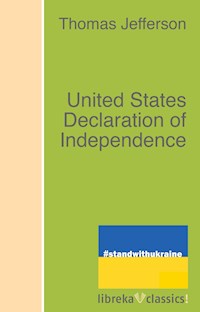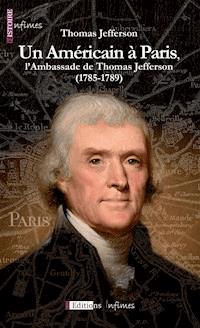
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions Infimes
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Une plongée inédite dans les écrits d'un futur président américain !
Rédacteur de la déclaration d’indépendance et troisième président des États-Unis d’Amérique, Thomas Jefferson (1743-1826) reste une figure majeure de la première démocratie moderne de l’Histoire. Défenseur acharné de la justice et écrivain de talent, il nota ses impressions lors de son séjour à Paris comme ambassadeur des USA (1785-1789) avec un regard critique et plein d’intelligence qui nous restitue la France des dernières années de l’ancien régime.
Une traduction originale de Claire Deney pour ce texte enfin disponible en français.
Thomas Jefferson nous révèle avec force détails et une grande clairvoyance les dessous de la diplomatie américano-européenne de l'époque.
EXTRAIT
Le vieux Frédéric de Prusse nous rencontra avec amabilité et sans hésitation, et désigna le baron de Thulemeier, son ministre à La Haye, pour négocier avec nous. Nous lui communiquâmes notre projet, qui, après de légères modifications par le Roi Frédéric II, fut vite conclu.
Le Danemark et la Toscane entrèrent également en négociation avec nous. D’autres puissances apparaissant indifférentes, il ne nous parut pas nécessaire de les presser. Ils semblaient en effet savoir peu de choses de nous, si ce n’est que nous étions des rebelles qui avaient réussi à rejeter le joug de la mère-patrie. Ils étaient ignorants de notre commerce, qui avait toujours été monopolisé par l’Angleterre, ainsi que des échanges de marchandises qui pourraient être avantageux pour les deux parties. Par conséquent, ils étaient enclins à se tenir à l’écart, jusqu’à ce qu’ils voient mieux quelles relations pourraient être utilement nouées avec nous.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Rédacteur de la déclaration d’indépendance, ambassadeur des États-Unis à Paris entre 1785 et 1789,
Thomas Jefferson fut le troisième président des États-Unis d'Amérique de 1801 à 1809.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 114
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Remerciements :
Un grand merci tout d’abord à mon éditeur,Vincent Dumas, pour sa réactivité, sonenthousiasme et… sa patience.
Merci à Juliane Miot, sans qui je n’aurais pasrencontré les Éditions Infimes, et ne me seraisdonc pas lancée dans cette aventure qui nousemmène au cœur de la Révolution Française.
Merci à Claire Flüry-Hérard, grande amie, dontles talents de traductrice juridique ont été bienutiles à plusieurs reprises.
Et enfin, je tiens à remercier mon frère,Benoît Deney, pour son soutien, sa relectureprécieuse, son souci du détail et sa réactivité,même à l’autre bout du monde.
Claire Deney
L’AMBASSADE À PARIS
- 1 -1781Départ pour l’Europe1
Avant que je ne quitte l’Amérique, c’est-à-dire en l’année 1781, j’avais reçu une lettre de M. de Marbois, de la légation française à Philadelphie, m’informant qu’il avait été instruit par son gouvernement d’obtenir des statistiques sur les différents États de notre Union, autant que cela leur serait utile, et cette lettre m’adressait aussi de nombreuses questions relatives à l’État de Virginie. J’avais toujours eu l’habitude, à chaque fois qu’une opportunité s’annonçait d’obtenir des renseignements sur notre pays, qui pourraient m’être utiles, que ce soit en public ou en privé, de les mettre par écrit. Ces mémorandums étaient sur des feuilles libres, ils constituaient une liasse sans ordre, et il m’était difficile d’en retrouver un en particulier quand je le désirais. J’ai pensé que cela serait une bonne occasion d’y mettre de l’ordre, ce que je fis en suivant l’ordre des requêtes de M. de Marbois, afin de répondre à sa demande et de les ordonner pour mon usage personnel. Certains amis, à qui j’avais parfois transmis ces notes, m’en demandèrent des copies ; mais le volume de ces notes rendant cela trop laborieux à recopier à la main, je me proposai d’en faire imprimer quelques exemplaires, pour leur satisfaction. Cependant, on m’en demanda un prix exorbitant par rapport à l’importance du sujet. À mon arrivée à Paris, je découvris qu’il était possible d’imprimer mon ouvrage pour une somme quatre fois moindre que ce qu’on me demandait ici. Je les corrigeai et les complétai donc, et j’en fis imprimer deux cents exemplaires, avec le titre de Notes sur l’État de Virginie. J’en donnai quelques exemplaires à quelques personnes en Europe, et j’envoyai le reste à mes amis d’Amérique. Une copie européenne tomba entre les mains d’un libraire, à la mort de son propriétaire ; celui-ci se lança dans une traduction, et quand elle fut prête à imprimer, me communiqua ses intentions et le manuscrit, sans aucune autre forme de permission que celle de suggérer des corrections. Je n’avais jamais vu une si misérable tentative de traduction. Des paragraphes étaient intervertis, abrégés ou coupés, et la traduction disait souvent le contraire de l’original, enfin c’était un amoncellement d’erreurs du début à la fin. Je corrigeai la majeure partie du manuscrit, et il fut imprimé en français sous cette forme. Un libraire londonien, voyant la traduction, me demanda la permission d’imprimer le manuscrit anglais originel. Je pensai qu’il serait bien d’accéder à cette requête, pour que le monde voie que cette œuvre n’était pas si mauvaise que la traduction française le laissait paraître. Voilà donc la vraie histoire de cette publication.
1. Les chapitres et les titres ne sont pas de Jefferson (ndt).
- 2 -1784 - 1786Entre Londres et Paris
M. John Adams1 nous rejoignit bientôt à Paris, et notre première mission fut de préparer un formulaire général à proposer aux nations disposées à négocier avec nous. Durant les discussions de paix avec le commissaire britannique David Hartley2, nos membres de la Commission avaient proposé, sur une suggestion du Dr Franklin3, d’insérer un article interdisant la capture de tous les vaisseaux de commerce et de leur cargaison, vaisseaux employés seulement dans le commerce entre les nations, que ce soit par des vaisseaux armés publics ou privés de chaque belligérant, en temps de guerre. Cela avait été refusé par l’Angleterre, décision peu sage selon moi. En effet, en cas de guerre contre nous, le nombre supérieur de leurs vaisseaux de commerce la plaçait infiniment plus en danger sur l’océan que nous, et comme les faucons se concentrent là où le gibier abonde, ainsi nos corsaires prospéreraient en fonction du butin exposé à leur portée, tandis que leurs corsaires seraient moins nombreux, faute de proies à capturer.
Nous insérâmes cet article dans notre formulaire, ainsi qu’une clause contre les brutalités envers les pêcheurs, fermiers ou citoyens non armés, suivant leur occupation dans des villes non fortifiées, une clause pour le traitement humain des prisonniers de guerre, une clause pour l’abolition de la contrebande de guerre, qui expose les navires de commerce à des détentions et des mauvais traitements si ruineux et vexants ; et enfin, une clause pour le principe de liberté de navigation : « bateaux libres, marchandises libres ».
Lors d’une réunion avec le comte de Vergennes4, nous avons pensé qu’il serait mieux de laisser au pouvoir législatif des deux parties le soin de modifier ainsi nos relations commerciales, ce qui arriverait spontanément grâce à des dispositions amicales. Sans presser qui que ce soit, nous sondâmes les ministres des différentes nations européennes présents à la Cour de Versailles, sur leurs dispositions envers les échanges commerciaux avec nous, et sur l’opportunité de les encourager grâce à la protection d’un traité.
Le vieux Frédéric de Prusse5 nous rencontra avec amabilité et sans hésitation, et désigna le baron de Thulemeier6, son ministre à La Haye, pour négocier avec nous. Nous lui communiquâmes notre projet, qui, après de légères modifications par le Roi Frédéric II, fut vite conclu. Le Danemark et la Toscane entrèrent également en négociation avec nous. D’autres puissances apparaissant indifférentes, il ne nous parut pas nécessaire de les presser. Ils semblaient en effet savoir peu de choses de nous, si ce n’est que nous étions des rebelles qui avaient réussi à rejeter le joug de la mère-patrie. Ils étaient ignorants de notre commerce, qui avait toujours été monopolisé par l’Angleterre, ainsi que des échanges de marchandises qui pourraient être avantageux pour les deux parties. Par conséquent, ils étaient enclins à se tenir à l’écart, jusqu’à ce qu’ils voient mieux quelles relations pourraient être utilement nouées avec nous. À dessein, nous prolongeâmes les négociations ainsi commencées avec le Danemark et la Toscane, jusqu’à ce que nos pouvoirs aient expiré. Nous nous abstînmes de faire de nouvelles propositions aux autres royaumes et états n’ayant pas de colonies ; puisque notre commerce, étant fondé sur un échange de matières premières contre des matières travaillées, propose un prix approprié à la douane pour l’entrée dans les colonies de ceux qui en possèdent, mais si nous devions accorder ce commerce sans droit de douane aux autres, ils réclameraient tous l’absence de droit de douane, en se fondant sur la clause de la nation la plus favorisée, ou gentis amicissimae7.
M. Adams, ayant été nommé ministre plénipotentiaire des États-Unis à Londres, nous quitta en juin 1785, et en juillet 1785, le Dr Franklin retourna en Amérique, et je fus nommé son successeur à Paris. En février 1786, M. Adams m’écrivit pour me prier avec instance de le rejoindre à Londres immédiatement, puisqu’il pensait avoir décelé là-bas des signes de meilleure disposition envers nous.
Le Colonel Smith8, le secrétaire de la légation de Londres, était le messager de sa requête urgente qui demandait ma présence immédiate. Selon son souhait, je quittai Paris le 1er mars. À mon arrivée à Londres, nous nous sommes mis d’accord sur une forme très sommaire du traité, qui proposait un changement de citoyenneté pour nos citoyens, nos bateaux et nos produits en général, sauf pour les positions officielles.
Quand je fus présenté au Roi et à la Reine, comme de coutume, à leur lever, il fut impossible d’être plus désagréable envers quiconque que le Roi le fut envers M. Adams et moi-même. Je compris immédiatement que les ulcères dans l’esprit étroit de cet être entêté ne laissaient rien de bon à espérer de ma présence à Londres. Et lors de la première conférence avec le marquis de Carmarthen, son ministre des affaires étrangères, la distance et la mauvaise volonté qu’il montrait dans la conversation, les réponses évasives et floues qu’il nous donnait, me confirmèrent dans mon opinion qu’il avait de l’aversion envers tout ce qui nous concernait. Nous lui montrâmes néanmoins notre projet, M. Adams ne désespérant pas de l’effet qu’il produirait, contrairement à moi.
Après cela, nous réclamâmes, par plusieurs messages, un rendez-vous pour une entrevue et une conférence, ce qu’il déclina vaguement, sans le faire directement, au prétexte d’autres pressantes occupations qu’il avait en ce moment. Après être resté là-bas sept semaines, quelques jours avant la fin de notre commission, j’informai le ministre par message que mon devoir m’appelait à Paris, et que je serais avec plaisir le messager de quelque instruction pour son ambassadeur à Paris. Il me répondit qu’il n’en avait pas et me souhaita un bon voyage. Je quittai donc Londres le 26 avril et j’arrivai à Paris le 30 avril.
Alors que nous étions à Londres, nous entrâmes en négociation avec le Chevalier Pinto, ambassadeur du Portugal à Londres. Le seul article où nous étions en difficulté était une clause selon laquelle notre blé (pour faire du pain) devait arriver au Portugal sous forme de farine et de grains. Il approuvait lui-même cette clause, mais il observa que plusieurs nobles, de grande influence à leur cour, étaient propriétaires de moulins dans la région de Lisbonne, et qu’ils dépendaient beaucoup, pour leur profit, de la transformation de nos céréales, et que cette clause allait mettre en péril tout le traité. Il le signa néanmoins, et le destin du traité fut ce qu’il avait prédit avec honnêteté.
1. John Adams (1735 - 1826) fut ambassadeur des USA auprès de la Grande Bretagne de 1785 à 1788. Il fut ensuite élu à la vice-présidence des États-Unis en janvier 1788 puis devint le 2e président des États-Unis en mars 1797.
2. David Hartley (1732 - 1813) est le fils du philosophe anglais David Hartley (1705 - 1757).
3. Benjamin Franklin (1706 - 1790) est un imprimeur, éditeur, écrivain, naturaliste, inventeur et homme politique. Il est l’un des pères fondateurs des USA et l’un des signataires de la Déclaration d’Indépendance. Dès 1776 il est venu en France comme ambassadeur officieux. Du 14 septembre 1778 au 17 mai 1785 il fut ministre plénipotentiaire des USA en France. Il participa également à la rédaction de la Constitution américaine.
4. Charles Gravier, comte de Vergennes (1719 - 1787), diplomate et homme d’État français. Il fut secrétaire d’État des Affaires étrangères de Louis XVI du 21 juillet 1774 à sa mort. C’est lui qui fit entrer la France comme alliée des États-Unis dans la Guerre d’Indépendance américaine. Il fut l’un des signataires du traité de Paris le 3 septembre 1783 qui marque la fin de la guerre d’indépendance américaine.
5. Frédéric II de Prusse (1712 - 1786), souverain de la dynastie des Hohenzollern. Il devint roi de Prusse en 1740. Il était souverain absolu, déiste et ami de Voltaire.
6. Le Baron Friedrich Wilhelm von Thulemeier (1735 - 1811) fut le ministre des affaires étrangères de Frédéric II de Prusse.
7. En latin dans le texte. La clause de la nation la plus favorisée est une clause fréquente des traités de commerce international selon laquelle chaque état signataire s’engage à accorder à l’autre tout avantage qu’il accorderait à un état tiers. Elle est encore utilisée dans les accords de l’OMC. Elle stipule que tout avantage commercial accordé par un pays à un autre doit être immédiatement accordé à la totalité des membres de l’OMC.
8. Charles Stephen Smith, Colonel Smith (1755 - 1816). Il fut secrétaire de la légation des États-Unis de Londres en 1784. Il épousa Abigail Nabby Adams (la fille de John Adams) en 1786.
- 3 -1787Négociations diplomatiques à Paris
Mai 1787
Mes devoirs à Paris se réduisaient à quelques sujets : la réception de notre huile de baleine, des poissons salés et des viandes salées en des termes favorables, l’admission de notre riz en termes égaux avec celui du Piémont, de l’Égypte et du Levant, une réduction des monopoles sur notre tabac par les Fermiers Généraux1, et une libre admission de nos produits dans leurs îles, furent les principaux sujets commerciaux qui demandèrent mon attention. À de nombreuses occasions, j’ai été aidé avec efficacité par le Marquis de La Fayette2, qui, grâce à son influence et son énergie, se révéla être zélé pour faire grandir l’amitié et le bien-être de nos deux nations ; et en toute justice, je dois également ajouter que le gouvernement français était entièrement disposé à nous plaire en toute occasion, et à nous accorder toutes les faveurs qui n’étaient pas contraires à leur intérêt. Le comte de Vergennes avait, dans le corps diplomatique, la réputation d’être prudent et malhonnête dans les relations diplomatiques ; et il est probable qu’il le fût avec ceux dont il savait qu’ils étaient malhonnêtes et hypocrites eux-mêmes. Comme il vit que je n’avais aucune opinion secrète, que je ne pratiquais aucune subtilité, que je n’étais mêlé à aucune intrigue, que je ne poursuivais aucun but secret, je l’ai trouvé aussi franc, honorable et raisonnable qu’aucun autre homme avec qui j’ai pu avoir à faire ; et je dois dire la même chose de son successeur Monsieur de Montmorin3, l’un des hommes les plus honnêtes et les plus dignes.