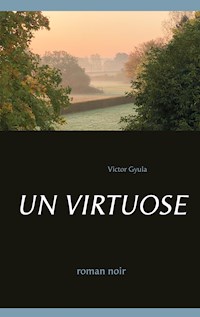
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Les réseaux de la mafia russe ont proliféré, comme des taupes sous une pelouse à l'abandon. Vodoleiev, Joukov, Blokhine, Kholodov : quatre anciens du FSB ont pris le contrôle des trafics en France. Face à eux, une brigade spéciale. Et un commissaire lettré, amoureux des arbres, hanté par le souvenir d'un pianiste disparu. Entre une fugue de Bach, un philosophe reconverti dans le trafic d'organes et dix-neuf cadavres autour d'un château en Yvelines, il y aurait de quoi s'égarer. Mais au milieu des ronces, on peut toujours se frayer un chemin, quitte à manier le sécateur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Chacun a un talent inné, mais à un petit nombre seulement est donné par nature et par éducation le degré de constance, de patience, d’énergie nécessaire pour qu’il devienne véritablement un talent, qu’ainsi il devienne ce qu’il est, c’est-à-dire : le dépense en œuvres et en actes.
F.W Nietzsche,Humain, trop humain, 263
Table des matières
Une rencontre
Dix ans après
Ronces
Papillon
Débroussaillage
Parc et jardin
Pelouses
Jardin anglais
Insectes
Plan d’eau
Adieux
Feuillus
Terre brûlée
Épilogue
1. UNE RENCONTRE
C’était un matin de janvier, dans le hall de la Gare Montparnasse. Froid glacial, chauffage limité. Je l’avais repéré de loin : son corps élancé, ses membres fins, une silhouette à la Lucky Luke… mais sans le chapeau. Jeans et chemise noirs, gants de soie. Raide, tremblant légèrement, il s’était planté à côté du piano. Une fille jouait la quatrième fugue du Clavier bien tempéré, avec une douceur résolue. Ça commençait comme une marche funèbre, avant de s’éclaircir en lignes mélodiques apaisantes. Elle était fine, de longs cheveux ramenés en arrière laissaient voir sa nuque et ses oreilles, un regard concentré… une espèce de sylphide. Lui se tenait tout près. Sous le charme, amoureux éconduit ou timide ? Accord final (do dièse mineur), point d’orgue : elle se leva, se dirigea vers les départs Grandes Lignes. J’attendis, curieux de voir comment il allait s’y prendre. Il resta figé devant le piano, comme un insecte devant du sucre au milieu d’un piège, hésitant. La fille s’éloignait sans qu’il tourne la tête. Sa pâleur était extrême, sa maigre silhouette égarée dans le hall, ressemblait à une tour d’allumettes. Il allait se trouver mal. Je le rejoignis en quelques pas, le récupérai avant qu’il ne s’effondre. Il ne pesait presque rien. La fille avait disparu.
Un peu plus tard… il s’était remis, avait repris des couleurs. Nous partagions une table au café Montparnasse. Il me racontait sa vie, ses yeux tristes dans les miens. A deux ans la découverte de l’instrument, les notes apprivoisées comme des oiseaux sauvages et dociles, à sept ans les leçons avec le Maître madrilène, à dix ans les premiers concerts, sept heures par jour de travail acharné, une jeunesse consacrée à quatre-vingt-huit touches.
— Pour moi ce clavier, c’était le monde. J’y étais chez moi. Savoir ce qu’on fera de sa vie avant même de savoir parler, ne jamais en dévier, c’est une bénédiction. C’est aussi… dangereux.
Propos étrange, qui sortait d’un visage tourmenté. Des cernes semblables à des tunnels, les épaules arrondies comme sous un poids. Il évoqua la solitude, l’isolement. Je m’étonnai. J’imaginais les musiciens solidaires, formant une sorte de communauté soudée, immergée dans un monde plein. Il secoua la tête.
— Ce n’est pas si simple. Il y a les Maîtres, mais il faut s’en défaire pour aller plus loin. Ils ne peuvent pas devenir des amis. Les musiciens avec qui on joue ? Nos relations se limitent à la musique. Quel intérêt d’aller boire un verre ? Tout est banal à côté des notes.
Je l’interrogeai sur la pianiste de la gare. Il eut un air surpris.
— La fille ? Elle jouait assez mal. Son rubato sur du Bach… En même temps, pour une pianiste amateur…
Elle ne l’intéressait pas. J’avais mal compris la scène. Il regarda dans le vide quelques instants, hésita :
— C’est le piano…
— Le piano ?
Je le comprenais de moins en moins. Il reprit :
— A vingt ans, j’avais signé pour deux disques, un Liszt et un Bach, avec la Deutsche Grammophon. Le premier était facile. Pour le second… je me suis préparé deux ans, c’était si compliqué. Liszt coule sous les doigts. Il faut maîtriser les notes et la vitesse, mais le sens me semblait évident. Alors que Bach : il faut jouer et entendre ensemble toutes les voix. S’il y en a une qui domine les autres, ce n’est plus du contrepoint, c’est une mélodie avec un accompagnement. Vous voyez la différence ?
— Je crois. Penser à plusieurs choses en même temps ? Pas facile.
— Il faut que les voix soient égales, mais aussi qu’elles soient variées. Il faut se dédoubler, et même se diviser en trois, en quatre ! C’est inhumain. Bach écrivait pour Dieu. La perfection, l’harmonie céleste. Tout est à sa place.
Il me regarda à nouveau et poursuivit, plus intense.
— Glenn Gould n’y est pas arrivé. Trop excentrique. Pas assez discipliné. C’est un bel échec pourtant. Il m’a aidé à trouver la clé. Si j’avais terminé ce disque… mais il n’est jamais sorti. J’en étais au milieu…
Sa voix de baryton était descendue d’une octave. Il ôta ses gants et posa ses mains sur la table. Elles étaient couvertes de lignes blanches, comme des toiles d’araignées durcies.
— L’épuisement après ces journées d’enregistrement…
Il cherchait ses mots. Une nouvelle hésitation, un regard vers moi.
— Je n’ai pas fait attention en sortant du studio. Un motard qui roulait trop vite. Les médecins m’ont dit que ma survie « tenait du miracle ». Après trois opérations, une rééducation de six mois, j’ai retrouvé mes mains. Elles étaient… « fonctionnelles. »
— Alors…
— Elles fonctionnaient, mais l’auriculaire de la main droite ne suivait plus, dans les passages difficiles. Un problème de vitesse. Je pouvais jouer comme un amateur. Pour moi c’était pire que ne pas jouer du tout.
Il tremblait à nouveau. Je crus qu’il allait se mettre à pleurer, mais il se tut. Et reprit :
— J’évite les pianos. Je ne vais pas au concert, je n’écoute plus de musique, je ne regarde même pas la télévision. On ne sait jamais. Mais aujourd’hui je suis entré dans cette gare…
Il sembla pensif un instant.
— C’est peut-être mieux comme ça. Comme ces gants. Ils me cachent les cicatrices, ils me les rappellent aussi. Il serait temps que je passe à autre chose.
Il se leva soudain et me serra la main.
— Merci.
Il quitta le café en laissant les gants sur la table.
Il m’avait dit son nom : Christophe Giraldo. Je trouvai le disque des études de Liszt. Il dominait la partition, avec plus de facilité encore que Cziffra, et un étourdissement venu de plus loin. Cziffra, flamboyant pianiste tzigane, avait porté de lourdes charges pendant la guerre. Il s’en était sorti, avait repris ses tournées, avec des bracelets pour atténuer la souffrance. Il n’avait pas renoncé. L’histoire de Giraldo avait l’amertume d’un gâchis.
Je cherchai aussi des traces de son Bach. Un article de la revue Diapason mentionnait le projet avorté. L’auteur avait assisté à une séance en studio. Il prétendait que Giraldo avait dévoilé quelque chose de nouveau, un mur invisible avait été franchi. Il fallait le croire sur parole : Giraldo avait récupéré les bandes, personne ne les entendrait plus. L’article me laissa perplexe, je le trouvais filandreux. On y trouvait cette phrase : « Sous les doigts agiles de Christophe Giraldo, les voix du Cantor n’avancent plus séparément, mais ensemble, telle une confrérie d’anges dont les membres, mystérieusement articulés, s’accordent sans que l’un n’ait jamais à hausser le ton, et pourtant chacun est entendu et chemine, court et virevolte. C’est l’harmonie céleste. »
C’est dangereux. Je comprenais. Giraldo avait perdu plus que la vie. J’espérais qu’il s’en sortirait. Sa poignée de main était ferme. Il était temps pour lui d’apprendre à faire autre chose. Il n’avait pas trente ans.
Je n’entendis plus parler de lui. Il m’avait laissé un désir : réaliser mon potentiel. Jusque-là, je flottais. Je n’avais pas de talent exceptionnel, ni la patience d’apprendre à manier un instrument ou un bistouri. Mais j’étais capable de concentration et d’effort. J’avais aussi une idée : remettre de l’ordre dans le chaos du monde. Ma voie était toute tracée.
2. DIX ANS APRES
J’aurais pu devenir professeur de lettres ou attaché culturel d’ambassade, et réussir dans mon domaine… mais je n’aurais pas connu les mêmes succès rapides et concrets. C’était aussi réjouissant qu’arracher les mauvaises herbes. On sait qu’elles reviendront, mais on a fait œuvre utile. Et l’acte d’arracher est source, en lui-même, d’une intense satisfaction. Le moment où la racine cède et sort de terre : la preuve de la force du jardinier. Et quand on jette les plantes parasites dans le tas d’humus : le rangement, l’ordre, l’harmonie retrouvée ! En les observant de près, on pourrait leur trouver des qualités esthétiques : le jaune brillant de la renoncule rampante, le cirse des champs et ses graines volantes, le chiendent aux rhizomes souterrains, le liseron blanc comme du lys… on serait presque tenté de les épargner. Mais il faut rester ferme. Elles nuisent à l’ensemble, elles menacent les roses et les arbres fruitiers. Bref, elles nous empoisonnent la vie. Arrachons donc, et jetons ces erreurs de la nature dans le compost où elles pourront se rendre utiles. J’éprouvais dans mon métier une sensation très proche, même si je savais qu’à la différence des plantes, les salopards que j’avais arrêtés, une fois tassés dans leurs cellules, étaient bien incapables de se décomposer en terreau fécond.
Je travaillais dur. J’écoutais souvent de la musique mais pas pour me détendre : pour me concentrer. Je lisais beaucoup. Un policier sans lettres est comme un arbre aux faibles racines : à la merci du vent. Les livres me confortaient dans la certitude d’exister.
J’avais un sentiment d’urgence. L’idée que si je m’arrêtais, le chaos s’étendrait. Seul, il m’arrivait de perdre pied, de ne plus savoir qui j’étais. Je replongeais dans le travail : le désherbage des criminels donnait un sens au monde. Pour les autres c’était un métier, pour moi c’était l’ancrage dans la vie. Différence qui explique mes progrès si rapides. Dans les années qui suivirent la gare Montparnasse, j’accumulai les points : des proxénètes aux trafiquants d’héroïne, enfin aux djihadistes. Chassés de Raqqa et Deir-Ezzor, les daechiens s’étaient déchaînés. Ils étaient devenus la priorité absolue des Ministres. On y mit les moyens : à coup d’infiltrations, perquisitions, répression… la menace finit par être éradiquée, aussi complètement que les parasites après dix épandages de Roundup. Je cherchais un nouveau défi, j’obtins une affectation à la BSAB, consécration ultime. C’était sept ans après ma rencontre avec Giraldo. Trois ans plus tard, on me confiait l’affaire Joukov… ma sortie de route. Au total : dix ans.
Après coup, tout découle d’une logique imparable. Mais lorsqu’on est sur le parcours, il paraît sinueux. Pour comprendre, il faut revenir au premier jour de ces trois dernières années.
Un lundi de septembre, je traversai la rue Marie-Georges Picquart, dix-septième arrondissement, quartier Batignolles. Ciel dégagé, température douce. De loin, le bâtiment ressemblait à un Lego géant : blocs de béton posés les uns sur les autres en quinconce, comme en équilibre précaire, dominant les voies ferrées de la gare SNCF Cardinet. Grandes baies vitrées, masse rassurante et moderne : les locaux neufs de la BSAB, ma nouvelle affectation. Mes trophées m’avaient valu d’être choisi. Ils ne prenaient que les meilleurs.
Un groupement d’élite, pour combattre la mafia russe en France. La Bratva avait creusé ses galeries sous nos yeux, quand nous traquions les derniers djihadistes. Les oligarques avaient débarqué les premiers, remplaçant les Qataris. Puis les anciens du FSB avaient suivi. Ensemble, ils avaient mis la main sur les activités payantes : jeux, prostitution, trafic d’organes, racket. Ils étaient partout. A défaut d’avoir vu venir, on réagissait… comme un jardinier, devant son gazon couvert de mottes de terre, se met en quête d’un traitement taupicide.
Un Ministre avait eu l’idée : Brigade Spéciale Anti-Bratva. Le sigle était inscrit sur la façade. Levant les yeux sous le vent léger du matin, je m’entraînai à le prononcer. La sonorité m’évoquait celle d’un silencieux : bsab, bsab, bsab. Sur la grande porte vitrée, l’image était gravée : un personnage athlétique écrasant une masse informe, sur fond bleu blanc rouge. Le blason de la BSAB… Certains discernaient, dans la bouillie terrassée, un ours, symbole de la Russie éternelle. Le dessin était flou, pas de quoi susciter l’intervention du Kremlin.
Dugommier m’accueillit à l’entrée. Tête carrée, cheveux épars, regard au laser derrière ses lunettes fines (presque invisibles). Poignée de main étonnamment douce, comme une caresse. Des paroles rares, une voix métallique : le patron de la BSAB. Il m’avait repéré dans le fichier des ressources humaines.
— Vous avez un beau palmarès.
— Merci. C’est un travail d’équipe.
J’avais dit ça pour paraître modeste. Cinq minutes plus tard, ouvrant la porte de mon nouveau bureau, doté de mobilier neuf et avec vue dégagée sur les voies ferrées du Transilien, j’éprouvai la plénitude que donnent les promesses du succès.
A midi, Dugommier nous réunit dans l’amphi. Face à l’ensemble de la brigade, sur l’estrade, il improvisa un discours, une sorte de feuille de route :
— Les Russes ont bénéficié d’une conjonction des astres. Nous étions occupés par les islamistes, et les concurrents n’étaient pas au niveau. Les Roumains brouillons, les Corses et les Marseillais affaiblis par les règlements de comptes, les Toulonnais pris dans la politique, les réseaux algériens décimés par l’antiterrorisme… et les Parisiens hors-jeu depuis Jo Attia et Pierrot le Fou. Mais leurs beaux jours sont finis. La chasse à l’ours est ouverte ! Apportez-moi des têtes. Si vous avez besoin de plus de moyens, n’hésitez pas. Les crédits sont ouverts, il faut en profiter.
J’avais demandé un adjoint solide. On me trouva un type motivé, qui venait de la DGSI. Un mètre quatre-vingt-dix, troisième dan d’aiki-ju-jitsu, diplômé de l’École Centrale Paris. A son actif, l’élimination de trois cellules de Daech. Il connaissait quelques mots de russe, reste de ses études. Pas plus que moi, il n’avait de temps à perdre. Nous nous mîmes au travail.
Trois mois plus tard, nous avions fermé deux salles de jeu près des Buttes-Chaumont. Au bout de six mois, nous avions coincé les racketteurs qui s’en prenaient aux bijoutiers. Après neuf mois, deux maisons clandestines, un réseau de trafiquants d’embryons. Nous commencions à dessiner les organigrammes.
Tout en bas : la force brute. Les soldats commandos, outils percutants pour les grandes occasions. Spetsial’noïe Naznatchéniyé : Forces à but spécial. En plus court : spetsnaz. Opérations coups de poing en Tchétchénie dans les années 2000. Combats rapprochés aux côtés d’Assad après 2010 en Syrie. Donbass, Géorgie, Crimée, Belarus, Chypre, Kosovo… ils avaient laissé leurs traces un peu partout, telle une nuée de sauterelles létales. Ils avaient pris leur retraite, abandonné leur blason à deux aigles portant épée surmontés d’une couronne impériale, et mis leurs compétences au service de la Bratva. En cas de problème, ils nettoyaient.
Au-dessus : des couches intermédiaires. Demi-soldes, contremaîtres, managers… Une organisation bien rodée, souple, mêlant hiérarchie et prestataires indépendants. C’était notre terrain de jeu, là où nous réalisions les arrestations, et recrutions les indics.
En haut… c’était le plus difficile à percer. Nous étions partis des oligarques, qui se montraient partout. Anton Banine avait racheté Hédiard à la barre du tribunal de commerce. Il avait fait la Une de Paris Match, posant devant la confiserie mythique de la Madeleine. Anatoli Glazkov, toujours un cigare à la main, avait sauvé la chaîne de magasins d’électronique Boulanger et ses emplois menacés par les ventes en ligne. Il prétendait que le commerce de proximité avait de l’avenir. Mais derrière les beaux discours… ils s’étaient diversifiés, entourés de vétérans des services secrets, et utilisaient leurs entreprises pour abriter les trafics. A force de recoupements, nous finîmes par comprendre. Les hommes d’affaires n’étaient que des façades rigolardes. Les vrais maîtres étaient les anciens du FSB.
Un an après mon arrivée à la BSAB, nous avions identifié le sommet de la pyramide. Les noms étaient punaisés dans mon bureau, avec leurs photographies. J’avais de longues listes des horreurs qu’on leur attribuait. Aucune preuve. Aucun témoin vivant. Les quatre Cavaliers de l’Apocalypse… on pouvait leur donner tous les surnoms qu’on voulait, ça ne changeait rien, ils restaient intouchables. On démontait une partie de leurs réseaux, on arrêtait des sous-fifres. Impossible de remonter jusqu’à eux.
Je rêvais d’eux la nuit. Je tournais en rond. Quand je pensais avoir parcouru un bout du chemin, la distance s’était encore accrue, comme chez Lewis Carroll. Mais l’horrible reine du pays des merveilles était bien gentille… je trouvais même à la Baba Yaga des airs de grand-mère attendrissante. Je faisais face à bien pire. Je revenais toujours à ces photos affichées sur le mur, face aux voies ferrées. Je murmurais leurs noms comme un exorcisme. La section française de la Bratva, avec ses yeux tranquilles.
Quatre noms. Quatre photos.
Andreï Joukov : photo prise à distance, visage fermé, tourné vers le téléobjectif tandis qu’il ouvre la porte d’un 4x4 BMW noir à la sortie du 36, rue de Lübeck. Cliché rare (trajets en vitres teintées, évite d’être vu en public). Aspect : un mètre quatre-vingt-dix et cent-cinquante kilos, chauve. Tel un bonhomme de neige humain. La force occulte derrière le groupe Boulanger (le jeu, la drogue).
Arkadi Blokhine : pose de dandy, costume prince de Galles taillé sur mesure et pochette colorée. Cheveux blonds ondulés. Léger double menton, souriant, à l’aise. Une photo parmi des dizaines, prise à la tribune d’un colloque. L’homme ne se cache pas. Fonction officielle : directeur dans une fondation pour l’amitié franco-russe, siège au 31, rue du Faubourg Saint-Honoré. Activités présumées : racket, trafic d’héroïne.
Alexeï Vodoleiev : barbe finement taillée, entre le roux et le brun, la couleur de ses cheveux. Un faux air de Tchekhov, ou Lénine (en plus fin, plus svelte et avant la calvitie). Photo prise à l’aéroport (vol pour Téhéran). Fixe l’objectif, ironique et sûr de lui, l’œil pétillant. Conseiller spécial auprès du PDG d’Hédiard. Activités supposées : trafic d’organes.
Vladimir Kholodov : visage large et menton carré, masse de muscle, l’air d’un paysan des steppes. Longue cicatrice traversant la joue gauche, cheveux noirs en bataille, tatouage de spetsnaz visible sur la main droite. Photo prise à distance, à travers la vitre d’un hôtel au moment où il lève la tête. Photographe inconnu. Seul cliché disponible (presque un fantôme). Domine les réseaux de prostitution.
Les quatre Cavaliers. Pièces centrales d’un jeu où les rois, les reines, les tours et les fous n’étaient que des figurants.
— Ce n’est qu’une question de temps. On les aura.
Dugommier était confiant en nos capacités. Je l’étais aussi, au début… mais leurs regards imperturbables, narquois, sur mon mur, finissaient par me faire douter. Leurs regards, et le reste.
3. RONCES
Arracher des mauvaises herbes : un plaisir sans ombre. Enlever des ronces, c’est différent. On se pique, à moins de porter des gants d’une qualité exceptionnelle. Elles s’entremêlent, se recouvrent, ne laissent aucun passage sûr. On peut s’écorcher les jambes en se concentrant sur la protection des mains. Il arrive qu’on découpe la tige d’un framboisier, en voulant le libérer des épines qui l’entourent. Une fois la ronce arrachée ou découpée, le travail est loin d’être fini. Il faut la déplacer ailleurs, et c’est une nouvelle épreuve… La BSAB, c’était des ronces du matin au soir. Je vieillis plus durant ces trois ans, que durant les sept qui les avaient précédés.
Six mois après mon arrivée, un repenti s’était proposé pour coincer Arkadi Blokhine l’élégant. Il lui en voulait pour des raisons personnelles, n’avait plus de famille sur qui faire pression, ne craignait plus rien. Sous protection 24 heures sur 24, nourri avec des rations militaires, gardé dans un lieu aussi sûr qu’un abri antiatomique... Sa tête avait explosé d’un coup, comme une pastèque d’Halloween. L’un des hommes qui le protégeaient s’était pris des bouts de cervelle dans les yeux et les narines, avait mis un mois à s’en remettre. L’affaire avait affolé en haut lieu, on pensait à une infiltration de la brigade par les Russes, pendant deux semaines tout le monde était suspect. Jusqu’à ce qu’un jeune technicien du labo, après une analyse minutieuse des débris, découvre le mode opératoire. Nous avions commis une erreur : le repenti avait un œil de verre. Cadeau de Blokhine, qui l’avait fait piéger à tout hasard. Il se méfiait de ses cadres clés. Détonation à distance par signal radio...
Je croyais avoir tout vu, mais à côté des Russes, les autres étaient des enfants ou des amateurs. Deux événements me firent entrevoir des ramifications angoissantes.
D’abord la filature d’un sbire de Vodoleiev, égaré entre les tombes du Père Lachaise. L’épisode m’avait marqué. Pour ne pas me faire repérer dans un endroit pareil, un mercredi de février en début d’après-midi, je m’étais surpassé, circulant tel un fantôme entre les cénotaphes et les sépulcres. Les touristes n’étaient pas à Paris. Aucun fan de Jim Morrison, pas de Polonaise à la recherche de Chopin. Une dame seule, pensive, face à une tombe étrange où se mêlaient l’étoile de David et la croix du Christ. Couple mixte, ses ancêtres peut-être ? A part elle, Oleg et moi, le cimetière était vide.
Oleg Bogomolov, colosse de deux mètres, chef de la sécurité rapprochée d’Anton Banine, le patron des magasins Hédiard. La vénérable chaîne de friandises





























