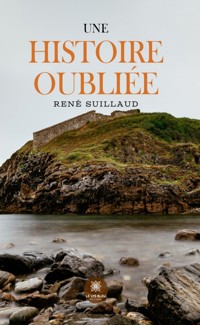
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Fils de paysans de la pointe de la Bretagne, Antoine survit à plusieurs tentatives d’assassinat après l’incendie criminel de sa maison familiale. Emporté par les bouleversements de la Révolution, il est contraint de fuir jusqu’aux Antilles où il se battra pour l’abolition de l’esclavage. Cependant, il ignore que son destin est étroitement rattaché à celui de Pierre du Baillif de Kerloch, un navigateur de l’époque de la traite négrière, et à la découverte d’une île inconnue et d’une civilisation primitive dont les valeurs seront bafouées par la colonisation. Quel lien secret unit les deux hommes ?
À PROPOS DE L'AUTEUR
Ancien responsable de communication en entreprise,
René Suillaud se passionne pour l’étude de la France des Lumières, inspiré par des œuvres littéraires telles que L’Île au Trésor de Robert Louis Stevenson et Oliver Twist de Charles Dickens. Ses recherches l’ont plongé dans un contexte historique riche, tout en suscitant une réflexion sur la perte de mémoire des civilisations disparues.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 695
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
René Suillaud
Une histoire oubliée
Roman
© Lys Bleu Éditions – René Suillaud
ISBN : 979-10-422-2108-9
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
« Le musée est fermé le lundi, monsieur », l’agent de la billetterie n’a pas pris la peine de me regarder, me prenant pour un touriste en mal d’inspiration.
L’assistante du président est désappointée – j’ai une heure d’avance – pas disponible, il est en rendez-vous. Une heure pour moi, un luxe que je m’accorde en forçant la main des organisateurs du vernissage. Un agent de sécurité veille sur l’espace d’exposition et sur ma présence délétère.
Tu me regardes, brillant de mille feux. De ton bois intérieur, veux-tu m’exprimer ta gratitude ? Notre complicité a fini par aboutir, mais elle va bientôt prendre fin, tu le sais. Ton cheminement n’a pas été simple, mais tu te tiens bien là, adossé à ce mur d’un lieu prestigieux. Du ministère de la Culture à la présidence du musée avec, à chaque étape, un véritable entretien d’embauche. La commission d’acquisition a fini par t’adopter. Ton âge avancé a imposé un certain nombre d’examens : rayons X, chambre d’anoxie et quelques touches de chirurgie esthétique. Tu es beau comme un dieu ! tu es le Dieu Soleil.
Elle s’approche avec une discrétion que mon recueillement apprécie. Son sourire serein m’invite à l’accueillir.
« Je suis l’attachée de presse. On s’est parlé au téléphone et on a même échangé quelques mails. Merci pour vos corrections. J’en ai tenu compte pour le dossier de presse » me montrant les documents qu’elle porte sous le bras.
Elle pose les quelques exemplaires, au cas où, en me précisant que des journalistes devraient être présents. Le Parisien pourrait faire un papier… son sourire grandit devant cette perspective. « Si je peux me permettre, ajoute-t-elle, pour toute sollicitation d’interview, il serait préférable de les envisager après les discours ».
« Ça vous plaît ? » la responsable de la collection caraïbe vient d’arriver. Son excitation est palpable dans les quelques commentaires qu’elle émet sur la présentation de l’œuvre, l’éclairage et les textes d’accompagnement. Sans se donner la peine de terminer sa phrase, elle rejoint des personnalités a priori de premier rang qui craignaient, à tort, d’arriver en retard.
Un flot d’invités envahit l’espace. Emporté par les vagues, le président vient de se rapprocher. Quelques échanges de politesse sur notre plaisir de partager ce moment précèdent le regret d’un empêchement de dernier moment de madame la ministre – une réunion impromptue avec les intermittents du spectacle, semble-t-il. « Mais l’attaché culturel – vous le connaissez, non ? – va la remplacer ».
À cet instant, j’aperçois Fabienne qui tente de se faufiler dans cette salle bondée. « Permettez-moi de vous présenter mon épouse. Elle aussi, est passionnée d’art » sans que j’aie le temps de préciser sur quelle forme d’art se porte sa passion. Le représentant du ministère vient d’arriver et le maître de cérémonie abandonne une conversation prometteuse sur l’art sous toutes ses formes pour le rejoindre. Que la fête commence !
Les discours s’enchaînent et, le regard fixé sur le Dieu Soleil qui illumine la fin de matinée, je pense à tout ce chemin parcouru jusqu’au Musée des Arts Premiers.
Après-midi d’été dans le Finistère – Les vacances coulaient doucement. Sortis de leur hibernation, les vieux vélos dépoussiérés nous encourageaient à entreprendre de longues balades. Les températures estivales et le soleil fortement généreux en cette saison avaient été suffisamment motivants pour des immersions répétées dans les eaux fraîches de ces plages du bout du bout… du bout du monde.
La météo s’était invitée aux discussions du déjeuner. Fabienne avait choisi l’option plage avec Justine et Timothée, nos aînés. À quelques jours de la fin de nos vacances, avait-on le droit d’ignorer le moindre rayon de soleil ? Les nuages étaient pourtant bien menaçants, alternant avec les éclaircies. Pour moi, pur breton de souche, la perspective d’une remontée en catastrophe sous des trombes d’eau ou de bronzage en gros pull sur le sable me laissait circonspect.
Grégoire, en pleine préparation de ses années de Lettres supérieures, allait s’isoler dans sa chambre. Il estimait avoir suffisamment enrichi son capital soleil pour tenter de rattraper le retard accumulé dans ses révisions. Rousseau et Stendhal méritaient bien un peu plus d’attention. Parmi mes devoirs de vacances, jusqu’à ce jour, j’avais fait preuve d’une procrastination chronique pour décrocher un vieux tableau du salon et le remplacer par une photographie de Joël Meyerowitz, achetée une fortune l’hiver précédent à la galerie Polka à Paris. « La maison est vraiment dans son jus, il faut lui donner un peu de jeunesse. Ce “Louis XIV” qui trône au milieu du salon me donne l’impression que nous habitons dans un musée », me répétait Fabienne. Compte tenu de l’échéance proche de notre fin de séjour, la tâche devenait prioritaire.
À l’aide, Grégoire ! Le décrochage de cette vieille croûte allait indéniablement perturber sa concentration. Il regretterait la plage. Chacun son escabeau pour maîtriser une descente coordonnée de ce tableau imposant, vite fait bien fait. Impatient de retourner à ses occupations, il me pressait d’enchaîner avec la pose du nouveau cadre. L’emplacement vide laissait apparaître un contraste de couleur laissé par le temps que l’envergure de la photographie recouvrirait bientôt. Mais au-delà de ce détail, ce « Louis XIV » nous avait caché une porte fermée par un morceau de bois. Après l’effet de surprise, ma curiosité de voir ce qui s’y dérobait, suppliait encore quelques minutes supplémentaires du temps précieux de mon fils.
À l’éclairage de la lampe du smartphone, une forme se dessinait, laissant éclater des reflets à plusieurs endroits. Le contour de l’objet faisait penser à une étoile de mer géante et les toiles d’araignées qui s’y reflétaient donnaient à notre découverte un air fantasmagorique. Dans un tourbillon de stupéfaction et d’excitation, nous interrogions cette œuvre muette désormais étendue sur la table du salon. Un soleil aux rayons flottant en plein vent et un visage étrangement expressif en son milieu nourrissaient notre imagination. La structure en bois était recouverte d’une fine couche de ce que je supposais être de l’or. Quelques brillants de plusieurs couleurs s’y étaient détachés, laissant apparaître les épreuves du temps.
Derrière la sculpture que nous venions d’extraire de sa cachette, il m’avait semblé apercevoir un autre objet. Grégoire, résigné à être à mon service encore quelques minutes, du haut de son mètre quatre-vingt-dix, constata de lui-même qu’il était mieux armé que moi pour l’atteindre. Avec le courage d’Indiana Jones pour affronter les araignées, il plongea ses bras prolongés par un balai. Après plusieurs tentatives, la chose finit par se rapprocher. Il s’agissait d’une boîte à bijoux taillée dans un bois marqueté.
« Louis XIV » remplacé par une vue new-yorkaise de Joël Meyerowitz façon Hopper, je libérai enfin Grégoire. Pas le temps d’admirer le changement de décoration du salon, priorité à l’ouverture du coffre. Il contenait une multitude de papiers bien tassés les uns contre les autres, des lettres regroupées en paquets entourés de lacets fermés par un sceau. Ce rangement imposait une lecture de chronologie. Mon impatience était à son comble comme si je venais de découvrir la grotte de Lascaux et qu’une de ses œuvres rupestres était accompagnée de son mode d’emploi. Je m’installai dans un des fauteuils du salon pour commencer ma lecture.
Le lever du soleil
Juin 1791, dans la presqu’île de Crozon
« Tutine, arrêt’de s’couer ! » la jument de Ty-Jean s’emballait souvent dans les chemins lorsqu’elle se trouvait devant la perspective d’une bonne ligne droite. Mais les ornières, elle ne les évitait pas et, à cette heure, trop matinale pour moi, elle perturbait mon sommeil au fond de la charrette. Afin de ne pas salir mes beaux vêtements, je m’étais enroulé dans une grande couverture qui me protégeait des salissures des paniers de légumes.
J’ignorais à cette époque combien cet homme allait compter dans ma vie. Ty-Jean, avait la cinquantaine, de petite taille et trapu, il était même un peu gros. Ses cheveux hirsutes, son visage et ses mains burinés marquaient le grand marin qu’il avait été, désormais bien ancré à notre terre. Il veillait sur moi chaque jour comme un second père. Il consacrait une partie de son temps à mon éducation, m’apportant modestement ses quelques notions de calcul et de lecture. Originaire de Nantes, il parlait français mieux que quiconque ici et, si je maîtrise la langue de Molière aujourd’hui, je lui dois les rudiments de mon apprentissage.
Ty-Jean représentait à la fois une invitation au voyage et, dans un autre registre, une source d’énergie inépuisable. Avant d’habiter dans la presqu’île de Crozon, il avait longtemps navigué sur l’océan Atlantique et connaissait les terres d’Afrique et des Caraïbes. Sa rencontre avec Monsieur le comte datait de ces traversées et depuis, il lui était resté fidèle. En plus de la terre qu’il cultivait ardemment, il était devenu l’homme à tout faire du domaine. Il s’assurait de la bonne tenue des cultures et veillait que chaque famille mange à sa faim.
L’insouciance est une vertu essentielle de l’enfance et j’en abusais. À la maison, je parlais breton. Mais, lors des veillées, Ty-Jean venait nous raconter des histoires en français. Ses récits de navigation faisaient rêver le petit fils de paysans que j’étais dont la destinée se limiterait probablement à cultiver les terres de ses parents. Très souvent, François, mon copain de toujours, venait écouter Ty-Jean. Fils cadet d’une famille de six enfants, il habitait dans une ferme située plus loin dans le village. Ensemble, nous gambadions à travers la lande, le bois de Lesteven et les dunes qui bordent la plage. Du haut de nos dix années, la nature n’avait aucun secret pour nous. Parfois, ma cousine, petite Anne, nous rejoignait dans nos escapades. Il nous arrivait de nous aventurer jusqu’à Kerdreux, le village où elle habitait en traversant les champs et les marais lorsqu’il n’y avait pas trop d’eau. Nous étions heureux de notre liberté d’enfants, une liberté que nos pères perturbaient parfois en nous demandant de ramasser le goémon destiné à enrichir la terre.
J’étais un rêveur et il m’arrivait d’imaginer des contrées lointaines, les yeux ouverts, lors de promenade en solitaire, le long de la plage sauvage qui longe l’océan, cette plage située au bout du bout. Impossible d’aller plus loin, à moins de prendre un bateau. Après des semaines et des semaines de mer, les premiers rivages seraient ceux de l’Amérique et des Caraïbes. C’est ainsi que Ty-Jean nous décrivait cet autre monde lors des veillées d’hiver.
Difficile à cet instant de ma vie de percevoir le moindre signe précurseur de la violence d’une révolution en marche. En ce mois de juin 1791, je n’éprouvais aucun sentiment de souffrance ou d’inconfort. Pourtant, la pauvreté accompagnait le quotidien de ma famille. Je vivais avec mes parents au village de la Palue à la pointe de la Bretagne. Notre maison – la plus vieille du village, disaient les anciens – était modeste, posée dans l’alignement du chemin qui mène jusqu’à la plage. Dans le prolongement, l’étable était occupée par notre unique vache et une dernière bâtisse servait de soue au cochon. Devant, quelques poules picoraient dans un enclos construit pour les protéger des renards. Nous vivions de faibles revenus de paysans et ma mère réussissait à nous nourrir des produits de la ferme.
Au moment même où j’écris ces mots, je m’aperçois que les conditions de vie dans les campagnes n’ont pas vraiment évolué au fil des décennies. À l’époque, j’étais loin d’être conscient de cette précarité. L’intérieur de notre maison sombre à cause des fenêtres trop petites gardait la fraîcheur en été lorsque le soleil inondait de sa chaleur la cour à l’extérieur. Mais en hiver, l’humidité persistait et le feu qui crépitait dans la cheminée ne suffisait pas à réchauffer la pièce principale. Suivant l’orientation du vent, la fumée envahissait la maison, rendant l’air irrespirable et nous étions parfois obligés d’ouvrir les deux portes pour faire des courants d’air. Nous toussions beaucoup et ma mère disait que ce brouillard permanent dans lequel nous vivions en était la cause. Nous dormions tous dans la même pièce dans des lits-coffres situés de chaque côté de la cheminée, mes parents dans l’un et moi dans l’autre.
« Réveille-toi, Antoine. On arrive bientôt ». À l’approche du bourg de Crozon, le chemin devenait plus régulier, m’invitant volontiers à somnoler encore un peu. Mais Ty-Jean en avait décidé autrement. Il allait me déposer au manoir de Kerloch où je rencontrerai Monsieur le comte. Pourquoi moi et quelle était la raison de ma venue ? Je l’ignorais. Je connaissais le seigneur du domaine pour l’avoir vu lors de ses visites des fermes de la Palue, mais je n’aurais jamais osé lui adresser la parole. Je me souviens que, plus petit, il avait posé sa main bienveillante sur ma tête comme une marque d’affection. La timidité m’avait paralysé. Avant le départ matinal, mon père m’avait transmis un chapelet de recommandations concernant les règles de politesse à respecter, ce qui était loin de me rassurer à l’approche du manoir. Ma mère m’avait vêtu des habits du dimanche, ceux que je portais pour aller à l’église de Saint-Hernot. Dans un panier, recouvert d’un tissu, elle avait posé un gâteau aux pommes que je devais remettre à Monsieur le comte.
La charrette s’arrêta dans la cour du manoir. Ty-Jean m’aida à descendre, me laissa entre les mains d’une servante avant de reprendre sa route vers la place de l’église où il allait vendre ses légumes.
« Antoine ? » Je sursautai. L’effet de surprise était total. Il s’était approché sans que je m’en aperçoive, son pas sur le plancher en provenance d’une petite porte dérobée était resté silencieux.
Majestueux. C’était le seul qualificatif qui me venait à l’esprit depuis que la charrette de Ty-Jean avait franchi le porche. Je connaissais ce mot depuis que Ty-Jean m’avait décrit dans les moindres détails les ors du château de Versailles qu’il avait eu la chance d’approcher. Le manoir de Monsieur le comte n’avait rien à envier à la description de la résidence royale qui m’avait été faite. Majestueux, ces bouleaux disposés à intervalles réguliers de chaque côté de l’allée principale. Entre deux arbres, je devinai un grand colombier planté au milieu d’un parterre de fleurs. Majestueux, le fronton qui s’élevait au-dessus du corps de logis. La cour grouillait d’activité à cette première heure. D’un côté, les écuries laissaient apparaître un attelage et, déjà, des hommes étaient affairés auprès des chevaux. De l’autre, quelques ouvriers agricoles rangeaient les greniers des hangars. Ty-Jean les connaissait tous, ce qui rendait l’éloignement de sa charrette en direction de Crozon encore plus terrible pour l’enfant que j’étais, abandonné dans un monde trop majestueux pour lui. Majestueux, le couloir central qui donnait sur un grand escalier de pierre et laissait sur sa droite une salle à manger et l’accès aux cuisines. À l’opposé, une grande porte sculptée s’ouvrait vers une immense salle. La servante me demanda d’y pénétrer. Monsieur le comte ne tarderait pas à me rejoindre. Majestueux enfin, cet espace de réception, trop grand pour un petit homme comme moi.
Majestueux voulait dire intimidant. La grandeur et la splendeur de cette pièce me laissaient plaqué contre un mur. Pendant un moment, je n’osai bouger dans ce monde inconnu, le regard figé vers le plafond peint d’une fresque biblique. J’ignore comment je trouvai assez d’audace pour me diriger vers la bibliothèque. La curiosité d’y trouver des livres de navigation me faisait l’effet d’un aimant. Monsieur le comte était un grand marin et sa passion pour la mer passait aussi par la lecture. Les traités de navigation et les registres de Marine m’impressionnaient par leur taille et par leurs titres trop techniques. En m’approchant d’une des deux grandes fenêtres, j’aperçus le jardin. Un ruisseau y serpentait en pente douce jusqu’à l’étang de Kerloch. En me retournant, je remarquai deux grands tableaux qui semblaient, par leur disposition de chaque côté de la porte, montrer la dichotomie entre les deux vies de Monsieur le comte. L’un, présentant la terre par l’allégresse générale de paysans au travail des champs et l’autre, la mer avec un équipage en activité sur un bateau paisiblement amarré dans un port. Ces deux fresques exprimaient une impression de sérénité.
Mais le plus majestueux fut l’instant suivant. Au-dessus de la grande porte, une sculpture d’un grand soleil se mit à scintiller dès qu’un rayon sorti des nuages pénétra par la fenêtre. L’objet aux formes rustres brillait de tous ses éclats d’or et de pierres précieuses, inondant la pièce de sa lumière. L’effet avait quelque chose de surnaturel comme une apparition à vocation religieuse. À cet instant, Monsieur le comte me surprit en pleine extase.
Je sursautai, comme surpris la main dans le sac de la désinvolture de mes observations. « Quelle belle lumière ! » s’extasia-t-il. Le maître des lieux s’approcha de moi en rejoignant mon regard interrogatif. « Ce soleil te fascine, je vois ». Intimidé par le grand homme, je n’osai prononcer un seul mot. Une tenue soignée, un port altier et une perruque élégante, quelle prestance ! J’osai à peine tendre le panier où se trouvait le gâteau aux pommes cuisiné par ma mère. Pourtant, derrière ses signes de noblesse, se cachaient à la fois le poids d’un certain âge et une tristesse mal dissimulée par son sourire bienveillant. J’étais trop jeune pour deviner ce que pouvait révéler ce regard mélancolique. Il aurait presque pu être aussi âgé que Ty-Jean, mais contrairement aux paysans de la presqu’île, il n’avait pas le dos accablé par le poids du labeur.
La servante entra avec un plateau sur lequel un bol de lait fumait. Une forme de couleur marron y avait été immergée. « As-tu déjeuné ce matin ? » La maigre soupe que j’avais ingurgitée au réveil avait disparu de ma mémoire à la vue de la brioche, de quelques fruits et de ce mélange lacté qui s’annonçaient devant moi. Monsieur le comte, d’une main chaleureuse posée sur mon épaule, m’invita à m’asseoir devant la table sur laquelle ce festin m’attendait. « C’est du chocolat des Antilles. Tu vas sûrement aimer ». Toutefois, mon regard revenait vers ce soleil étrange et le maître des lieux s’en aperçut. « Cette sculpture qui provient d’un de mes voyages s’appelle “le Dieu Soleil”. Elle m’a été donnée par un grand chef caribéen ». L’explication s’imposait et, voyant l’obsession visuelle qui me ramenait à l’objet, il rejoignit à nouveau mon regard : « derrière ce soleil se cache une longue histoire ».
Noblesse et pauvreté, les deux termes me semblaient antinomiques. Monsieur le comte venait d’affirmer que pendant son enfance, il vivait dans des conditions proches de la paysannerie. Sans doute n’avait-il pas réellement conscience de la vie dans les fermes de son domaine à l’heure où la Révolution française grondait et remettait en cause les privilèges ?
J’appris que ses origines étaient normandes, une vieille famille noble du Perche, descendant d’Hubert de la Cholme, grand chevalier du XIIIe siècle. Il avait grandi au manoir de la Mesnière – tout de même, un manoir ! – Comment peut-on se considérer pauvre en habitant dans une telle demeure ?
Plus couramment habitué à entendre parler en breton à cette époque, je ne maîtrisais pas la langue française parfaitement, mais Monsieur le comte employait un vocabulaire simple qui me permettait de le comprendre. Je replongeai mes lèvres dans mon breuvage chocolaté en l’écoutant attentivement.
Les années 1760, dans le Perche
« Nous étions nobles par les titres, mais en vérité nous étions pauvres, affirma-t-il. La toiture fuyait et l’habitation était dans un état de délabrement général. Pour subvenir aux besoins du foyer, quelques champs étaient cultivés par mon père lui-même et les repas quotidiens demeuraient peu frugaux. Les revenus restaient faibles tant les terres étaient difficiles à travailler. J’ai passé mes plus tendres années dans ce manoir, entouré de mes parents, mon frère, Paul, et ma sœur, Armande. Soucieux de notre avenir, mon père avait confié notre éducation à un précepteur (tout de même un précepteur !). Pour lui, la nourriture de l’esprit était prioritaire à celle de notre ventre. Écriture, lecture, calcul occupaient les matinées de notre enfance dans une austérité entretenue pas cet homme vêtu de noir, au regard sombre et d’une rigueur traduite par une sévérité de tout instant. L’homme ayant servi dans une grande famille londonienne pendant une décennie avait souhaité retrouver son pays d’origine et vivre proche de ses parents devenus très âgés. Ce retour s’était traduit par des sacrifices pécuniaires qu’il acceptait sans sourciller. Son expérience nous donna l’opportunité d’appréhender des notions de la langue anglaise.
Noblesse et pauvreté, deux termes difficiles à conjuguer avec un avenir prometteur. Le mien oscillait entre l’armée royale et le clergé, le droit d’aînesse revenant à Paul dans la possession du domaine que je lui laissais volontiers au vu des difficultés que notre père rencontrait pour en assurer la survie. Pour ma sœur, les nombreux sacrifices d’économie que nous faisions étaient destinés à notre jardin qui, je dois le reconnaître, était d’une grande beauté grâce aux soins que ma mère y portait. Aux beaux jours, mes parents y organisaient des réceptions auxquelles la noblesse de la région était conviée avec pour seule motivation de trouver pour Armande le meilleur des partis.
Mon père m’exprimait sa préférence pour une carrière militaire. Sans doute, quelque exploit de bataille de ma part aurait-il rapporté titres et rentes à notre famille ? En attendant l’heure du choix, il insistait auprès de notre précepteur pour que mon maniement de l’épée soit parfait grâce à un entraînement soutenu. Les chasses sur notre domaine complétaient cette préparation par une maîtrise parfaite de l’équitation et des armes à feu. Ma mère, quant à elle, voyait en moi un futur archevêque et jouait de ses relations familiales avec l’évêque de Sées pour tracer mon avenir ».
Depuis le début du récit, nous n’avions pas vraiment détourné notre regard de ce soleil qui nous laissait, l’un comme l’autre, béats d’admiration. « Je réalise en te parlant que mon oncle est le point d’origine de toute cette histoire », reprit-il en montrant de sa main la sculpture qu’il venait de qualifier d’histoire.
« Le frère de mon père avait suivi un tout autre chemin, quittant très tôt le domaine familial, au grand désespoir de mon grand-père, pour rejoindre la ville de Nantes. Guidé par ses lectures, il voulait découvrir d’autres pays, partir à l’aventure et parcourir le monde. À son arrivée dans la grande ville et fort de quelques recommandations, il fit ses premières armes chez un riche marchand. Il découvrit alors le commerce des colonies et bientôt celui du bois d’ébène. Puis il lança son propre commerce auprès des armateurs de la place en acheminant lui-même vers Versailles et Paris, sucre, café et cacao, cette fève qui devient le chocolat que tu viens de boire. Ces commanditaires le chargeaient en retour de l’achat d’armes et de munitions chez quelques armuriers parisiens. Très vite, son activité lui rapporta un bon pécule et il comprit que les grandes fortunes de la place s’étaient faites sur mer entre l’Afrique et les Antilles. Pour suivre le même chemin, il lui fallait prendre des risques en investissant dans un navire de taille suffisante pour effectuer ces traversées. Avec l’aide de financiers nantais, de quelques relations qui engagèrent des parts dans l’affaire, la participation, certes modeste, de mon grand-père et de ses quelques économies, il acheta un brick qui avait déjà beaucoup voyagé. Après le recrutement d’un capitaine chevronné, il décida d’embarquer afin de superviser lui-même son commerce lors de ce premier périple qui se conclut avec succès par un retour lucratif à Nantes. Mon oncle m’a souvent raconté ce voyage dans les moindres détails, lors de ses visites à notre demeure familiale. Ces récits me faisaient rêver d’une autre vie que celle d’un paysan petit noble voué à l’armée ou au culte ».
Bois d’ébène, je ne comprenais pas pourquoi les bateaux allaient en Afrique chercher du bois pour le déposer aux Antilles et cela perturbait mon écoute. Monsieur le comte s’en aperçut. « Ty-Jean ne t’a donc pas expliqué ? demanda-t-il avec embarras. Le bois d’ébène a la particularité d’être de couleur très sombre et cette expression est employée pudiquement pour qualifier le commerce d’hommes noirs capturés pour être vendus comme esclaves de l’autre côté de l’océan Atlantique ». Devant mes yeux écarquillés d’épouvante, il s’empressa d’ajouter « Pour ma part, je trouve, plus que jamais, ces pratiques totalement inhumaines, mais à l’époque, il s’agissait, dans mon esprit, de prisonniers de guerre entre tribus et ce commerce allait leur permettre de s’élever de l’état sauvage à celui d’un monde civilisé. Ma position sur le sujet a bien évolué depuis, mais il est trop tôt dans mon histoire pour en parler davantage. Nous y reviendrons ».
Début novembre 1765 à la Mesnière
Comme chaque année à la Toussaint, mon oncle qui possédait désormais trois navires, rejoignit le manoir de la Mesnière pour commémorer nos morts, accompagné de ma tante et de mon cousin. Vincent, le fils de mon oncle, avait tout de l’archétype des gens des villes qui veulent montrer leur différence aux gens des champs. Il était habillé de beaux tissus provenant des meilleurs tailleurs de Nantes. Il portait ces vêtements avec soin alors que ma tenue laissait toujours à désirer. Il excellait à l’escrime et, malgré l’entraînement régulier de mon précepteur, il me battait à chaque occasion. Et surtout, cette assurance qu’il avait lui donnait une prestance qui me manquait. Il donnait son avis sur tout, participait à toutes les conversations, toujours au fait des événements qui marquaient la société, alors que je restais souvent silencieux et oublié lors de discussions en public. Malgré toutes ces différences et une vanité de mon cousin qui m’agaçait quelque peu, je prenais plaisir à lui faire découvrir la campagne percheronne qui manquait à son goût d’horizons maritimes. Je partageais son avis. Alors que nos parents et nos grands-parents débattaient du manoir, des terres et de leur rendement, nous nous évadions à cheval, seule discipline où je prenais l’avantage sur lui.
Les verres de cidre qui nous avaient été versé dans une ferme des alentours n’étaient pas étrangers d’une certaine décontraction que j’accuserai plus tard lors du dîner familial. Je m’étais fait un devoir de montrer à Vincent les chemins tortueux qui menaient aux différentes exploitations du domaine. Au passage, les paysans me saluaient et j’en éprouvai une grande fierté de notable devant lui. La fille d’un des fermiers était d’une grande beauté et l’invitation de son père à nous désaltérer était une occasion rêvée de l’admirer de plus près, de lui parler peut-être. Nous étions, mon cousin et moi, complices de ce stratagème, mais nous devions attendre le retour des vaches à l’étable pour apercevoir la belle. Malheureusement, l’attente fut longue et, quelques verres de cidre plus tard, nous dûmes nous contenter d’un léger sourire sur un visage lumineux avant de reprendre notre chemin.
Nous étions tous réunis autour du dîner et les conversations tournaient autour de l’avenir des enfants. C’est avec une certaine fierté que mon oncle annonça que son fils allait rejoindre Brest pour devenir officier de la Marine royale. Je n’avais aucune accoutumance à l’alcool, mais les quelques verres bus peu de temps auparavant m’avaient donné une assurance que je ne me soupçonnais pas. Devançant avec impolitesse la prise de parole de mon père, j’exprimais aussi mon désir de traverser les mers, à la découverte d’autres mondes et de suivre le même chemin que mon oncle. Cette annonce jeta un silence au milieu du repas et je crus, un instant que mon grand-père allait avoir un malaise. Cette déclaration avait des airs de ressemblance avec celle de son propre fils qui avait touché son honneur quelques années auparavant. Pour mon père, elle avait l’effet d’une trahison.
Comme pour réchauffer la conversation, mon oncle proposa de laisser mûrir mon idée jusqu’à Pâques, date à laquelle nous étions conviés à rejoindre Nantes pour les fêtes.
Mars 1766 à Nantes
Six mois interminables venaient de s’écouler. Six mois de discussions houleuses avec mon père et de pleurs de ma mère. Six mois pendant lesquels mes parents tentaient en vain d’infléchir mon projet tantôt avec autorité, tantôt par des raisonnements sur les conséquences familiales d’un tel choix concernant mon avenir. Mes parents n’avaient imaginé les carrières futures de leurs enfants uniquement qu’en mesurant l’impact positif sur le rang que notre famille pourrait gagner. Une carrière dans l’armée ou dans le clergé présentait clairement davantage d’opportunités que celle d’un aventurier dans la Marine marchande. Six mois de souffrance où les relations difficiles que j’entretenais avec mes parents m’étaient insupportables. Est-ce une lassitude dans nos débats ou un véritable calcul de mon père sur les intérêts cachés de mon choix ? À l’approche de l’échéance, je sentis le climat s’adoucir sans pour autant que ma décision finisse par être acceptée.
Nous rejoignîmes Nantes pour les fêtes organisées autour de la cathédrale puis mes parents reprirent le chemin de la Mesnière alors que je m’installai dans une chambre de l’appartement luxueux de mon oncle situé sur le quai de la Fosse.
J’ai su très vite qu’il allait être de ces amis qui comptent dans une vie. Jean-Marie Bouvier était un garçon d’à peine vingt ans. Grand et mince, il semblait porter des vêtements trop grands pour lui. Son regard soutenu par des yeux d’un bleu profond laissait deviner une personnalité hors du commun. Sa chevelure châtain clair et ondulée lui donnait une allure de marin de grand large qui séduisait les jeunes filles des alentours.
Si nous avions en commun une rupture de ban avec nos parents respectifs, cela ne suffirait pas pour créer notre amitié. Jean-Marie Bouvier avait une éloquence qui n’était pas accompagnée du brin d’arrogance qui caractérisait la facilité de s’exprimer de Vincent, mon cousin. Au contraire, il était à la fois force de conviction et prudence polie, respectueuse de l’avis de l’autre. L’autre, c’était moi et, si je buvais ses paroles, elles m’aidaient à m’affirmer et à ajuster mon opinion. « Et toi, tu en penses quoi ? » me demandait-il fréquemment et ses interpellations m’aidaient à grandir, à mûrir et à sortir de mon cocon.
Son père, perruquier réputé de la ville d’Angers, l’avait désigné pour lui succéder à la tête de son commerce, mais Jean-Marie avait décidé son avenir autrement. Depuis quatre années, il travaillait pour mon oncle et avait embarqué à deux reprises pour le lointain voyage. Des débuts prometteurs où, avec intelligence, il s’était fait une place de second sur un des bateaux de la compagnie jusqu’au jour où, par négligence, la chaîne d’une ancre avait glissé sur sa jambe, la broyant sous le poids. Une chance dans ce malheur, le drame se produisit à l’arrivée au port. Mon oncle lui dépêcha un médecin immédiatement qui resta réservé les premiers temps. Des risques d’infections laissaient planer le doute d’une amputation éventuelle, hypothèse qui aurait définitivement ruiné ses ambitions, mais son état se stabilisa très vite. Atèle, béquilles, rééducation et surtout une volonté de guerrier eurent raison de ce handicap.
Vincent avait rejoint le port de Brest pour suivre sa formation d’officier et, au début, j’occupais sa chambre où je m’enfermais à la nuit tombée pour me plonger dans des livres d’hydrographie et d’astronomie que j’avais trouvés dans la bibliothèque de l’appartement. Chaque matin, je rejoignais les entrepôts situés à quelques centaines de mètres. Comptabilité et gestion des stocks de marchandises n’avaient plus aucun secret pour moi. Je tenais minutieusement l’inventaire des denrées fraîchement arrivées de Guadeloupe, en attente d’un départ imminent vers les grandes villes. Même tenue comptable pour les marchandises prêtes à embarquer pour une prochaine traversée triangulaire. « Tu dois connaître les bases de ce métier, mon garçon », ne cessait de me répéter mon oncle qui savait bien que je n’étais pas venu à Nantes pour manipuler des chiffres et les aligner dans des tableaux. « Les bases de ce métier », je ruminai ces mots en l’interpellant au fond de moi : quelles bases ? De quel métier parlait-il ? Je sortais de l’entrepôt en maîtrisant tant bien que mal ma furie pour sillonner le quai grouillant d’activité. Les déchargements de navires allaient bon train alors que les préparations de départ s’exprimaient par une effervescence généralisée. Une véritable invitation à un voyage auquel je n’étais pas convié.
L’accident de Jean-Marie l’avait cloué à quai, laissant s’éloigner sa goélette pour dix-huit mois. Il comblait ce départ manqué par l’inspection de deux autres navires de la flotte. Il supervisait leur remise en état et leur préparation pour de prochains départs, une activité qui ne suffisait pas à tenir en place cet hyperactif de la mer. Exténué de nos gémissements, Jean-Marie et son mal de navigation, moi et ma soif non assouvie d’enseignement de la mer, l’armateur nous abandonna l’un à l’autre. « Faites ce que vous voulez, je ne veux plus vous voir », lâcha-t-il un jour de mauvaise humeur.
Cette irritation de mon oncle avait rattaché deux âmes en pleine perdition. Jean-Marie n’avait qu’une idée en tête, celle de reprendre la mer et chaque départ de bateau lui brisait le cœur comme un amour s’éloignant pour longtemps. Mais il fallait attendre le retour de la Fillette, la goélette à laquelle il était affecté. Le médecin était intraitable sur ce délai indispensable à une parfaite rééducation. Son temps libre fut alors consacré à ma formation de marin. Il m’apprit combien j’étais ignorant du monde de la navigation. Ses explications étaient très claires. Nous montions sur n’importe quel bateau et il m’en présentait les moindres composants en me détaillant leur utilité. Chaque mât, chaque cordage et chaque voile auraient bientôt un sens pour moi.
Mes dix-sept ans révolus, le petit pécule que me procurait mon travail me donnait l’opportunité de quitter l’appartement et de louer une chambre dans une petite rue près du port. Ce départ correspondait à un désir d’indépendance pour mieux découvrir, en m’éloignant de l’environnement familial, l’univers maritime qui m’attendait. J’avais l’impression d’être trop protégé et d’être privé des réalités par mon statut de neveu de l’armateur et l’amitié grandissante de Jean-Marie me confirmait ce sentiment.
« La maîtrise de la mer ne s’acquiert pas à l’aide d’un titre de noblesse, mais en étant confronté aux aléas de la nature. C’est elle qui forme la vraie valeur des hommes », me déclara-t-il un jour en me narguant sur mes origines. Il était convaincu que seul le travail acharné permettait de grandir, de devenir un homme respectable. Je rejoignis très vite cet avis. Cette ambition se doublait pour lui d’une grande avidité que je n’arrivais pas à partager. Je savais qu’il voulait naviguer à nouveau, mais il avait aussi l’intention de confirmer ses capacités à devenir un capitaine aux yeux de mon oncle ou d’autres armateurs de la place. Amasser davantage d’argent et pouvoir à son tour, un jour, créer sa propre compagnie à la force de ses mains, il voulait ainsi tordre le cou au destin que son père lui avait prédit et à celui que des privilégiés comme moi pouvaient lui interdire. Bien sûr, ses convictions nous heurtaient, mais j’affûtais ma personnalité au contact de ces débats qui finissaient par nous enrichir intellectuellement. Au bout de nos discussions, nous nous retrouvions sous les valeurs qui nous rapprochaient : le sens de la liberté, le besoin de découvrir le monde et une recherche d’un soupçon d’aventure.
« Il est mort ? » demandai-je à Monsieur le comte qui s’empressa de rectifier : « Tu as raison, j’ai tort de parler de lui au passé. Il vit en Guadeloupe où il s’est installé depuis de nombreuses années ».
« Eh ! toi là-bas, tu vas rester bras croisés longtemps ? » Jamais personne ne m’avait parlé comme cela. L’interpellation me laissait dans un état de sidération.
La Fosse, c’est ainsi que nous appelions notre quai, était le théâtre d’une belle excitation depuis le début de la matinée. Des voix hélaient l’approche d’un navire qui, avec lenteur, progressait vers nous. La Fillette était enfin de retour. Mon oncle fut le premier à monter à bord. État satisfaisant des hommes et opulence de marchandises, le sourire radieux de l’armateur, à sa descente de la passerelle, après quelques échanges avec le capitaine, en disait long sur le bonheur financier que lui délivrait cette arrivée. Le déchargement pouvait commencer.
« Tu veux peut-être’ que j’vienne t’chercher par la peau des fesses ? » Trop préoccupé à protéger l’état de mon postérieur, je sortais de ma torpeur pour accourir au plus vite aux ordres de l’homme qui m’interpellait. J’enchaînai quelques allers-retours, mais Jean-Marie venait de glisser à l’oreille de mon donneur d’ordre une information en me fixant du regard avec un léger sourire. « Laissez cela, reprit l’homme d’une voix un tantinet doucereuse, ce n’est pas pour vous ». Imperturbable, je continuais mes navettes sous l’air désolé de celui qui dirigeait les manœuvres. « Et d’abord, continuez votre tutoiement, c’est ainsi que vous devez me parler », répondis-je. « La nature fait la valeur des hommes », je me répétai l’affirmation de Jean-Marie en me disant que la formule s’adaptait aussi bien sur mer que sur terre. Mes origines ne feraient rien à l’affaire et je devais transporter ces « foutus » fardeaux à la force de mon dos au même titre que les autres hommes. À chaque charge trop lourde, mon nouvel ange gardien appelait un marin à ma rescousse. Puis nos rôles devinrent complémentaires. Il coordonnait le déchargement, m’indiquait les denrées concernées et j’orientais les marins vers les lieux de stockage prévus pour chacune d’elles. L’homme faisait entendre sa voix et tout le monde la respectait, tout le monde le reconnaissait, tout le monde le surnommait petit Jean et nous l’appelons Ty-Jean.
L’appel du large m’émoustillait, mais je savais que le jour n’était pas encore venu. Avec la même sévérité que lors de notre première rencontre, il allait compléter la formation de Jean-Marie par des cas pratiques. Le tutoiement était devenu réciproque. Je faisais et refaisais des nœuds marins jusqu’à la perfection et si ma dextérité ne se conjuguait pas avec rapidité, je devais recommencer sous les ordres de mon maître. Hisser et affaler les voiles devaient se faire avec agilité et seul l’entraînement rigoureux et répété de Ty-Jean me faisait progresser. Je cernais chez lui une autorité naturelle qui se confirmait auprès de l’équipage. J’intégrais cette manière de s’affirmer dans l’enseignement qu’il me délivrait. Il s’avéra plus utile que celui de Jean-Marie dans les relations avec les hommes que je devais diriger dans les années qui suivirent.
Où trouvait-il cette force de caractère ? Orphelin très jeune, il avait eu plusieurs vies pendant son enfance, notamment dans les bas-fonds de Nantes. C’est d’ailleurs là qu’il avait été recruté. Depuis, il était resté fidèle à mon oncle et à son capitaine, Yvon le Briard. À chaque retour, il se réfugiait dans une cabane qu’il s’était construite en aval du fleuve. Il possédait même une barque et, lors de nos temps libres, je le rejoignais et nous naviguions sur la Loire. Barrer, sentir le vent et border la voile, des sensations qui m’envahissaient peu à peu lors de nos sorties. Nos escapades nous menaient de plus en plus loin, jusqu’au jour où j’aperçus le bout de l’estuaire. L’entrée de l’océan provoqua en moi une aspiration de liberté à laquelle je ne pouvais me détacher. Il me fallait encore patienter avant de répondre à l’appel du grand large. La barque vira de bord, mais je ne pouvais détacher mon regard de cet horizon maritime qui m’encourageait à tourner une nouvelle page de ma vie.
« Tu connais Diderot ? » Avant de quitter le foyer familial, mon précepteur m’avait chargé de quelques volumes de maîtres à penser qui me permettraient de maintenir et, à cet instant, d’étaler mon érudition.
« Tu sais ce qu’il dit à propos de l’esclavage dans son Encyclopédie ? “Les hommes naissent tous libres. C’est le plus précieux de tous les biens que l’homme puisse posséder”. Tu crois vraiment qu’on a le droit d’enlever la liberté à ces Africains sans se sentir coupable ?
— Dis-toi, mon cher Antoine, qu’ils sont des prisonniers de guerre. Dans des conflits entre tribus, ils ont été capturés par les vainqueurs et nous ne faisons que monnayer leur butin.
— Dans nos conflits, les prisonniers de guerre sont tous des combattants. Tu ne vas pas me faire croire que les femmes et les enfants sont tous des combattants ?
— Si, répondit Jean-Marie qui sentait l’énervement monter en lui devant mes arguments des plus convaincants.
— Arrête d’affirmer ce qui n’est pas défendable. Tout cela est contraire aux principes religieux. “Tu aimeras ton prochain comme toi-même”. Tu penses vraiment que la traite part d’un bon sentiment envers les Noirs ? (J’étais vraiment énervé contre l’absurdité des raisonnements de Jean-Marie).
— Tu ne crois pas si bien dire, répliqua-t-il. Son visage présentait une expression de satisfaction comme si je lui avais tendu sur un plateau son mets préféré. Ces êtres demeurent à l’état sauvage lorsque nous en prenant possession. En les détachant de leur environnement, nous leur donnons la possibilité d’évoluer pour devenir des femmes et des hommes civilisés, de vivre dans de meilleures conditions. Et ça, c’est de l’amour, car, en plus…
— Ils n’ont rien demandé. C’est uniquement une question d’argent. Ils vivaient heureux dans leurs villages.
— Tu m’as coupé la parole, Antoine ». Je sentais Jean-Marie exaspéré.
« J’allais te dire que, en plus, une fois arrivés aux Antilles, certains maîtres vont leur apprendre notre religion, les faire baptiser et leur offrir ainsi la protection de Dieu. N’est-ce pas aimer son prochain comme soi-même, ça ? conclut-il avec une certaine satisfaction.
— Aimer son prochain, c’est d’abord lui laisser sa liberté. Liberté de choisir sa vie. En leur supprimant leur liberté, nous leur ôtant tous leurs droits. Et, comme dit Rousseau…
— Écoute Antoine, je ne sais pas où tu veux en venir, coupa Jean-Marie avec animosité. Tu ne vas pas changer le cours de l’Histoire. Qu’est-ce que tu veux ? Que ton oncle arrête de faire naviguer ses bateaux vers l’Afrique ? Va lui dire… tu verras ce qu’il va te répondre. Je suppose que c’est toi qui l’as sollicité, non ?
— Oui, mais si on ne fait rien, ça ne changera pas.
— Tu veux partir, oui ou non ? finit-il par hurler à mon oreille. Si tu ne veux pas de ce commerce, tu peux encore choisir la pêche en haute mer ou encore la Marine royale. Ces choix sont sûrement plus en cohérence avec tes idées même s’ils ne sont pas aussi exotiques. Mais arrête de m’embêter avec ces idées stupides », finit-il par conclure en claquant la porte.
Monsieur le comte se leva, saisit une carafe et se versa un verre d’eau. « Un verre d’eau ? Un jus de pomme ? »
La suite de l’histoire se faisait attendre et le moment de silence se prolongeait, signe d’une méditation compliquée.
« Tout cela peut te paraître incroyable. Celui qui tenait ces propos allait prendre la mer et participer activement au transport des Noirs vers leur destin d’esclaves ? Antiesclavagiste et négrier à la fois, une absurdité que je ne te laisserai pas accepter plus longtemps sans explications. Et pourtant, cette conversation avec Jean-Marie a bien eu lieu. Quelques semaines avant ces échanges, je m’étais plongé dans des lectures sur la navigation, les côtes africaines, les Antilles françaises, la pratique du commerce et de l’esclavage. Les ouvrages des penseurs qui évoquaient ces derniers sujets allaient forger mon opinion au point de noircir mon enthousiasme pour ce voyage. Pourquoi ces lectures ne m’ont-elles pas fait renoncer à mon projet ?
Devant mon insistance répétée, mon oncle avait fini par céder, j’allais faire partie de la prochaine traversée. C’était plus fort que moi. Ma fièvre d’évasion, de découverte de nouveaux mondes et d’une vie plus palpitante était intacte. Plus que tout, à l’approche du départ, elle s’intensifiait. L’incident qui avait entaché mon amitié avec Jean-Marie s’éloignait peu à peu. Je n’osai plus aborder ce sujet devenu tabou. Au fond de moi, comme pour mieux me justifier, j’adoptai plus ou moins son point de vue. Mon esprit devenait de moins en moins perturbé par ces pensées et l’influence de mon ami me permettait d’avancer. Et lorsque ma culpabilité refaisait surface, je me persuadai que ce voyage serait une expérience qui me permettrait de juger du sujet en bonne connaissance.
La Fillette était un bateau rapide qui présentait le double avantage de réduire les temps de navigation et, en cas d’attaque en mer, de pouvoir fuir l’assaillant grâce à son excellent barreur, Yvon Le Briard. Pour cet homme d’un certain âge, la mer n’avait aucun secret et son expérience garantissait ma sécurité, élément de poids pour rassurer mon oncle. Après son dernier périple, la remise en état de la goélette la rendait apte à affronter une nouvelle traversée.
Alors que notre capitaine, soucieux des capacités et de la bonne santé de son équipage s’attachait au recrutement des marins à l’aide du médecin chirurgien, la préparation du bateau allait mettre à rude épreuve mon impatience : l’inventaire et le chargement des marchandises chères aux négociations à tenir le long des côtes africaines précédaient l’embarquement des vivres. Difficile d’imaginer la qualité et la variété des objets que nous emportions, encore plus difficile d’imaginer les quantités d’eau et de denrées que le tonnelier et le cuisinier prévoyaient pour garantir notre survie. Avec Jean-Marie, je coordonnais le chargement. Sur le pont, Ty-Jean veillait au rangement et au travail préparatif de l’équipage.
Antiesclavagiste dans l’âme, j’allais devenir complice de négriers. Je savais que c’était le prix à payer pour réaliser mon rêve ».
1768, départ pour les côtes africaines
« Il m’est difficile de trouver les mots justes pour exprimer les émotions que je ressentis à ces moments. Pourtant je m’en souviens comme si c’était hier. Tu excuseras la simplicité imagée de mes propos ».
Monsieur le comte prit un air théâtral que je ne lui connaissais pas pour me raconter la suite.
« Levez l’ancre, larguez les amarres ! Un coup de tonnerre heurta ma poitrine m’inspirant à la fois la peur et la joie de l’inconnu.
Les écueils s’avéraient nombreux, notre avancée restait lente et prudente. Mon impatience était rythmée par un cœur qui battait de plus en plus fort au fil de notre progression vers l’estuaire.
La rencontre de l’océan. Une grande respiration m’envahit au moment où mon regard plongea vers l’horizon infini.
Le fleuve venait de s’élargir pour laisser place à l’océan. Une légère houle s’était formée au moment où je jetai un dernier regard sur le rivage qui s’éloignait. Je faisais connaissance avec un équilibre incertain qui allait devenir mon quotidien. Le soleil s’élevait sur une terre de plus en plus lointaine, prenant sa place dans un ciel dégagé. Quelques mouettes suivaient notre trace comme pour nous encourager sur notre route. Et la magie se produisit, transformant le monde en une immensité d’eau qui semblait sans limite. Un sentiment mêlé de liberté et d’humilité. Ce serait la nature qui me ferait devenir un homme et les aléas de la mer allaient y contribuer.
Le voyage jusqu’au golfe de Guinée fut normalement long. À bord j’étais pilotin et, avec l’aide du capitaine ou de Jean-Marie, je tenais la barre quand le temps le permettait. J’étais en formation avec l’objectif de devenir un jour officier et assurer moi-même les responsabilités de commandement d’un bateau. Pour l’instant, j’affinais mon apprentissage de la navigation par des exercices pratiques et je faisais connaissance des différents métiers exercés au sein du bateau.
L’escale le long de la côte africaine fut particulièrement interminable. Nous avions jeté l’ancre à l’entrée d’un fleuve. Un air moite et étouffant nous faisait regretter le vent marin de notre traversée. Yvon Le Briard, accompagné du médecin chirurgien et de quelques hommes, s’absentait. Il avait exigé que je reste à bord afin d’épargner à mon jeune âge les affres des rencontres de notre escale. L’aménagement de la goélette pour accueillir nos futurs hôtes était la seule occupation de ces journées interminables. Une langueur générale s’installait profondément sous une chaleur étouffante, touchant au moral d’un équipage désœuvré. Nous attendions impatiemment que les négociations aboutissent. Comme un signe d’un départ prochain, nous reçûmes l’ordre de décharger les armes et munitions, tissus, métaux et pacotilles que nous avions embarqués à Nantes en guise de monnaie d’échange. Nous attendîmes encore quelques jours avant l’arrivée du nouveau chargement.
Des bêtes et non des hommes, c’est ainsi que je m’étais préparé à cette rencontre, éloignant loin de ma mémoire les réflexions qui avaient précédé mon départ. Ce fut un choc de voir, pour la première fois de ma vie, des êtres de couleur sombre. Je m’attendais à des bêtes et je découvrais des enfants, des femmes et des hommes dont l’expression de résignation ou de haine s’exprimait dans leur regard soutenu par des yeux blancs plus contrastés que les nôtres. Ils descendirent docilement dans la cale pour occuper l’espace que nous avions préparé ».
J’étais impatient et cela se voyait. Monsieur le comte l’avait remarqué.
« Loin de moi l’idée de te faire une description détaillée du déroulement du voyage ou une présentation étape par étape de ce qu’était le commerce du bois d’ébène… bois d’ébène, tu suis ? Non, ce serait trop long, mais il faut tout de même que je t’explique dans quel état d’esprit je me trouvais lorsque cette aventure extraordinaire a commencé ».
« Aventure extraordinaire », deux mots qui résonnaient et qui devaient me tenir en haleine.
Monsieur le comte reprit son récit :
« La traversée vers les Antilles était particulièrement interminable et pénible. Interminable par la monotonie des journées, rythmées par des tâches répétitives liées au sort de nos captifs. Interminable par le nombre de jours nécessaires pour joindre ces deux bouts de terre. Interminable lorsqu’un calme plat nous plantait là, au milieu du néant. Pénible aussi par l’esprit qui régnait à bord, primant davantage le rôle de geôlier à celui de marin. Pénible l’affrontement quotidien des regards tristes de ces Noirs que j’observais chaque jour sur le pont. Pénible l’odeur pestilentielle de la cale qui nous rappelait sans arrêt les conditions et le manque d’hygiène de l’espace. Pénible enfin la maladie et la mort qui guettaient comme une menace obsessionnelle. »
« Moi, Pierre ». Monsieur le comte avait repris son ton théâtral pour me décrire la suite de son histoire. Posant la main sur sa poitrine, il reprit « Pierre » et désignant du doigt un personnage imaginaire « et toi ? »
Je répétais et il fallut un moment pour que j’obtienne une réponse : « Yahoé ». Il s’appelait Yahoé et alors que je prononçais à mon tour Yahoé, il finit par murmurer « Pire ».
— Non je ne suis pas « Pire », m’esclaffai-je… Pierre.
— Père…
— Piiièèèrrre, insistai-je.
— Piièèrre !
— Oui c’est ça ! m’exclamai-je en signe de victoire.
Je finis par deviner un léger sourire au milieu de son regard triste.
Ce dialogue, si cela peut s’appeler un dialogue, me valut la colère du capitaine. Il m’ordonna de le suivre dans sa cabine.
« Vous ne devez pas tenter le moindre rapprochement avec des captifs. Votre comportement est inadmissible et indigne d’un garçon de votre rang. En essayant de nouer un contact, vous l’avez traité avec égard ce qui est un signe de faiblesse. La moindre faille dans notre attitude peut être exploitée pour fomenter une révolte. C’est une faute que je devrais lourdement sanctionner. Cette fois-ci, je vais faire preuve d’indulgence, mais veillez à ne pas refaire cette erreur ».
J’avais découvert au fil des jours les tristes conditions de traitement des Noirs qui croupissaient sous nos pieds. Lors d’une de leurs sorties quotidiennes, je m’étais hasardé à aborder ce garçon qui menait le chant africain rythmant les pas imposés par leurs geôliers. Pour quelle raison l’avais-je fait ? L’arrivée de « la marchandise », comme s’obstinaient à répéter les officiers et, au premier chef, Jean-Marie, avait éveillé en moi un peu d’humanité. À chacune de leurs apparitions sur le pont, je regardais passivement leurs visages pleins d’innocence et je souffrais de voir le traitement moral que nous leur faisions subir. Pourquoi lui ? Yahoé était un grand garçon qui pouvait avoir mon âge. En tentant de lui parler, je voulais montrer que, derrière nos comportements, nous pouvions faire preuve de bienveillance. Quelle naïveté au milieu de cette embarcation négrière ! Je n’allais pas changer le monde et l’abolition de l’esclavage n’était pas pour demain.
Comme pour éloigner de mes pensées toute récidive, Yvon Le Briard m’avait supprimé tout contact avec les captifs pendant plusieurs jours. Puis progressivement, je repris le rythme de l’activité quotidienne du bateau.
De quelle inconscience faisais-je preuve ! Un beau jour, alors que je participai à la distribution de rations, j’osai, au fil de mon avancée dans la travée, appeler Yahoé à voix basse à plusieurs reprises, jusqu’au moment où j’entendis mon prénom comme un écho. Heureusement, mon audace n’eut aucune conséquence, car personne ne s’en aperçut.
Ces épanchements pour nos captifs ne menaient à rien. Au contraire, ils pouvaient être néfastes pour la suite du voyage. Il fallait que je rentre dans le rang et je me forçais à les considérer comme des prisonniers de guerre que nous convoyions vers leurs prisons. Cette vision de notre commerce m’était plus confortable.
Enfin, nous aperçûmes bientôt les premières côtes de la Guadeloupe. Nous étions arrivés et nous accueillîmes cette nouvelle par une joie partagée.
Janvier 1769 en Guadeloupe
Alexandre est devenu un des plus grands planteurs de Guadeloupe, mais, à l’époque, il se contentait d’accompagner son père lors des ventes d’esclaves. Je les avais repérés dès leur arrivée dans l’entrepôt, car tous les deux se distinguaient des autres acheteurs. Leurs tenues soignées contrastaient avec la négligence que les autres hommes affichaient. J’étais surpris que le rang de ces gros exploitants ne leur impose pas de changer leurs habits lorsqu’ils devaient se rendre en ville. Leur attitude était choquante. Ils examinaient les captifs comme s’ils étaient au marché aux bestiaux. Ils les palpaient, les auscultaient, leur ordonnaient en aboyant, de marcher, de s’accroupir, de se contorsionner et leur ouvraient la bouche ou écartaient leurs paupières à la recherche d’un vice caché. Et ceci, sans la moindre retenue. Alexandre et son père, au contraire, gardaient des réserves et lorsque leurs observations nécessitaient la participation des captifs, leur demande se faisait avec bienveillance, exprimant leurs souhaits sans la moindre agressivité.
Avec l’aide de notre médecin chirurgien, le capitaine Le Briard avait organisé la vente en regroupant les esclaves par lots plus ou moins équitables. Toutefois, le groupe où Yahoé avait été affecté se distinguait par son nombre plus conséquent. Il comptait une vingtaine de captifs, quelques jeunes hommes et femmes, des couples avec leurs enfants et des Noirs visiblement plus âgés. Le père et le fils s’attardaient devant ce lot puis s’approchèrent de mon protégé. Je me permis de les interpeller.
« Il s’appelle Yahoé, je l’ai suivi pendant notre traversée. Je pense que vous faites un bon choix ».
Les deux hommes furent surpris de mon intervention.
« À qui ai-je l’honneur ? me demanda le plus âgé des deux.
— Je vous prie d’excuser mon impertinence, répliquai-je, confus de l’audace qui m’avait amenée à les accoster. Je m’appelle Pierre de la Cholme, neveu de l’armateur du bateau qui a convoyé ces Noirs pour vous.
— Enchanté mon garçon. Je suis Ferdinand de… (je n’avais pas retenu le nom) et voici mon fils, Alexandre.
— Je peux me permettre de vous demander pour quelle raison vous voulez prendre une option sur un lot aussi imposant ?
— Nous venons d’acquérir des terres qui jouxtent notre propriété et, pour les défricher et les exploiter, j’ai besoin de davantage de personnel. Par ailleurs, la composition de ce groupe me semble saine. On devine quelques rapprochements familiaux, ce qui facilite l’intégration et donne de meilleurs résultats ».
L’homme me semblait sympathique et mon intervention ne l’avait pas choqué outre mesure. Mon insolence était insupportable et, si une oreille de notre capitaine avait traîné derrière moi, j’aurais été renvoyé sur la goélette immédiatement et peut-être soumis à un certain nombre de coups de fouet.
Je bafouillai et les mots n’arrivaient pas à constituer une phrase correcte dans ma tête. Pourtant, je voyais les regards interrogatifs de deux hommes posés sur moi en attente de ma question.
« Euh… j’ai une question… Est-ce que pour vous… ce n’est pas difficile… non ce n’est pas ce que je veux dire… comment vivez-vous… la présence d’hommes et de femmes… déracinés de force de leur pays, privés de liberté pour être, à votre service, corvéables à merci ? » En mon for intérieur, je poussais un souffle de soulagement d’avoir réussi à aller jusqu’au bout de ma phrase, mais, en même temps, au fond des yeux des deux planteurs, j’essayais de deviner les fusils qui allaient se dresser sur moi pour me punir de ma nouvelle impertinence. Allaient-ils tout simplement ignorer la question indigne du neveu de l’armateur et dresser leurs talons vers la sortie ?
Rien de cela ne se produisit et, avec une sérénité désarmante, le père me répondit ;
« Mon garçon, je comprends que votre jeune âge rende difficile l’apprentissage de ces pratiques. Elles font partie des règles en usage à notre époque et elles sont ancrées dans un héritage lointain. Nombreux sont ceux qui en abusent, mais ce n’est pas notre cas ». Il balaya du regard l’assemblée des autres planteurs qui remplissaient l’entrepôt avant de poursuivre.
« Contrairement à certains qui épuisent leurs esclaves aussi bien moralement que physiquement jusqu’à la mort, nous veillons à ce que nos hôtes vivent bien. Yvon Le Briard me connaît bien pour cela, vous pourrez lui demander.
— Pourquoi ne viendriez-vous pas nous rendre visite ? suggéra Alexandre. Vous pourriez apprécier la tenue de notre plantation et de notre personnel. Qu’en pensez-vous, père ?
— Effectivement, c’est une excellente idée et je vais en glisser un mot à votre capitaine. À plusieurs reprises, durant ces séjours, il vient évaluer la quantité de sucre que nous lui proposons pour son retour en France. Ce serait une belle occasion de vous faire découvrir notre domaine ».
Alertés par notre chevauchée, Ferdinand, sa femme et leurs deux enfants, Alexandre et Eloïse, nous attendaient sur le perron. Un litige concernant notre commerce avait retenu Yvon Le Briard à Basse-Terre. Il était inconcevable de décommander cette venue à une échéance aussi proche et le capitaine avait confié à Jean-Marie cette charge d’inventaire qui faisait l’objet de notre visite. Ce changement n’était pas pour me déplaire. Je préférai accompagner mon ami que l’homme avec qui j’entretenais des relations distantes, voire tendues depuis l’incident que j’avais causé avec Yahoé. Jean-Marie s’empressa d’excuser l’absence du capitaine.
« Rien de grave, j’espère ? demanda Ferdinand.
— Non, rien de grave, répondit Jean-Marie, mais il souhaitait que l’affaire soit réglée au plus vite, battre le fer tant qu’il est chaud.
— Comme je le comprends. Yvon est un ami de longue date. Nous sommes de la même trempe et nous n’aimons pas laisser traîner les choses. Je trouverai l’occasion de descendre à Basse-Terre et de le revoir au moins une fois avant votre départ.
— Je le lui dirai. En attendant, j’espère que je ne vous déçois pas par ma présence.
— Comment pouvez-vous penser cela, Jean-Marie ? Nous avons déjà eu l’occasion de traiter ensemble et ce fut pour moi un plaisir. Vous êtes le bienvenu et vous aussi, Pierre de la Cholme, si j’ai bonne mémoire ».
J’observais mon ami qui, à ces derniers mots, s’était raidi. D’un côté « Jean-Marie » et de l’autre « Pierre de la Cholme ». Cette distinction avait pour lui la saveur d’une différence de statut à laquelle le planteur était attaché.
Le majordome, resté en retrait, nous invita à pénétrer dans l’habitation. La fraîcheur du grand hall contrastait avec la chaleur naissante en ce milieu de matinée. Je me souviens de ces jus de goyave qui nous attendaient dans le salon comme d’une explosion de soleil et d’une oasis de fraîcheur dans mon palais, une vraie révélation tellement bienvenue après ce périple à cheval.
« Alexandre va vous faire visiter la plantation et au retour, vous vous arrêterez aux entrepôts où notre régisseur vous attend pour faire le point sur les pains de sucre déjà préparés pour vous. Nous vous attendons vers midi pour le déjeuner ».
Les champs de canne étaient en pleine activité et de nombreux esclaves s’affairaient à la coupe. Je reconnus Yahoé et nous échangeâmes un regard. Je crus apercevoir un sourire qui se transforma rapidement en une expression de résignation. Je reçus ce changement d’attitude comme un reproche. Je représentais ceux qui l’avaient arraché à sa famille pour le réduire à cette condition d’esclave. Rien de tel pour faire remonter en moi le sentiment de culpabilité.
« Yahoé s’est bien adapté à notre plantation, précisa Alexandre, volant au secours de mon regard planant dans le vide. Il partage une case avec deux autres garçons déjà chez nous depuis quelques années et tout se passe bien. Voyez là, l’homme âgé près de lui, il s’agit de Vocaire. Il a été choisi pour lui servir de tuteur. Il lui apprend la canne, comment travailler, lui explique comment la vie s’organise dans l’exploitation. A chaque nouveau est dédié un ancien esclave pour faciliter son intégration et lui apporter un peu de chaleur humaine dans ce monde inconnu.
— Je reconnais dans vos propos beaucoup de bienveillance envers vos esclaves. Cependant, je doute que cela suffise à effacer la privation de liberté, le souvenir d’un autre monde et d’une autre vie ».





























