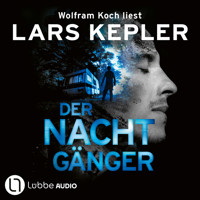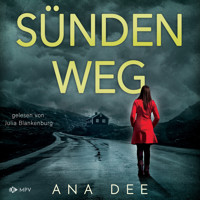Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Victor Laurens, jeune paysan de l’Aveyron, s’engage dans l’armée en 1802 à 20 ans et participe aux batailles décisives de l’époque napoléonienne. Soldat aguerri, il monte en grade, mais après sa démobilisation lors de la Restauration, il se sent étranger à son Aveyron natal, profondément marqué par ses années de guerre. En quête de liberté, il décide de tout quitter pour l’Amérique, un nouveau monde où il espère enfin trouver sa place. À travers des épreuves et des rencontres inattendues, il est accueilli par une tribu indienne, découvrant une vie enfin libre… Mais qu’est-ce que la liberté ?
À PROPOS DE L'AUTEUR
Enseignant en génie mécanique, Vincent Maillebuau a consacré l’essentiel de sa carrière à former des élèves de BTS, notamment à Vierzon. Aujourd’hui retraité, il profite de son temps libre pour explorer ses passions : la recherche, l’écriture et l’histoire. Curieux de tout, il se plonge dans des périodes historiques fascinantes et découvre des sujets qu’il n’avait pas eu l’occasion d’aborder durant sa vie professionnelle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 196
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vincent Maillebuau
Une vie libre
Roman
© Lys Bleu Éditions – Vincent Maillebuau
ISBN : 979-10-422-7261-6
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
I
Une vie de soldat
La conscription
Je m’appelle Victor Laurens, je viens de fêter mes vingt ans. J’ai vu le jour le 14 avril 1782 dans une famille de fermiers travaillant au domaine de « La Boriette » près du village de Campuac. Vingt ans c’est l’âge pour la conscription, le maire de la commune est passé à la maison ce 1er mai 1802, dans deux jours je devrai me présenter à la commission de recrutement. Le jour dit, je me suis levé tôt, en prévision de 3 heures de marche pour être à 8 heures à Espalion. Du plateau de Campuac à Estaing il y a deux cent cinquante mètres de dénivelé, je prends mon bâton et c’est parti, la lune éclaire ma route, la difficulté sera au retour, pour le moment je descends. Un peu plus loin, je salue le père Paulain qui attendait devant chez lui, je lui explique où je vais, il ne répond pas et se contente de hocher la tête. Plus bas, je traverse le hameau de Montaigut, pas un chat, j’entre dans la forêt qui habille ce versant du Lot. Arrivé à la rivière, je décide de ne traverser que le ruisseau de Luzanne, c’est moins profond et je ne mouillerai pas mon pantalon, puis il ne me restera que onze kilomètres de plat jusqu’à Espalion. Je ne connais la ville que pour y être venu au marché, il me faut aller à la mairie où se tient la commission. Dans le canton, il y a peu de gens de mon âge, le tirage au sort ne m’épargnera sûrement pas. Et puis payer un remplaçant, ma famille n’a pas l’argent. Ne pas y aller signifie arrestation par les gendarmes, de la prison et peut-être la mort. Dans le village, on ne se déplace pas souvent, le dimanche pour aller à la messe ou chez un oncle pour y travailler.Dans ma tête tout se bouscule, d’après Jean Bouscayrol, qui a fait les guerres de la république, 1793-1800, et qui est revenu amputé d’une jambe, c’est l’occasion de voir du pays, de vivre des aventures, de rencontrer des gens différents. Mais c’est surtout quelque chose d’inconnu, et je ressens de plus en plus mon ventre se resserrer.
Vers 17 heures, je quitte la commission de recrutement, j’ai été accepté pour la revue de départ.
Dans trois jours à la préfecture de Rodez se déroulera la commission d’affectation, nous sommes huit du canton à avoir été recrutés. La veille du jour fixé, je rejoins le village pour emprunter la charrette d’un transporteur que mon père connaît. Il va à Bozouls, et de là la malle-poste me conduira à Rodez.
Une fois arrivé dans la ville, je demande mon chemin. À quoi peut ressembler une caserne ? Je finis par arriver devant un grand bâtiment avec de grandes grilles, un peu plus loin une file de garçons s’est formée, je les interroge, c’est là. Je dois passer une visite médicale, un infirmier me mesure, me pèse, me fait lire un panneau, me pose des questions en tournant autour de moi, me demande l’âge de mes parents, combien de frères et sœurs j’ai, leurs âges, quelles maladies j’ai eues… Puis un officier me reçoit en entretien, il me parle de la république, de l’état, de ce que je sais faire, de mon niveau scolaire. Je me sens perdu, des questions que je ne m’étais jamais posées, l’impression d’être en vente dans une foire. Un peu plus tard, on me rappelle, la décision est prise, au vu de ma taille (1,78 mètre) et de mon apparente condition physique. Je serai versé dans la cavalerie. D’après l’officier recruteur, je serai affecté au 18e régiment de Dragons, qui est cantonné dans les environs de Toulouse. Dès le lendemain, je partirai avec les autres futurs « dragons » sous la conduite de deux gendarmes.
Je ne reconnais qu’un jeune parmi les recrues, Jean Raynal, un grand blond avec de larges épaules, qui vient du Nayrac, je l’ai rencontré une fois à la foire d’Espalion, nous avions dû maîtriser un taureau Aubrac un peu vif.
Le voyage sera long, nous marchons au rythme imposé par les gendarmes qui eux sont à cheval. Nous faisons des étapes pour manger, respirer un peu, nous nous asseyons sur les bords des chemins, ce sont les seuls moments où nous pouvons parler. Jean aime raconter ses anecdotes, il aime rire et c’est contagieux pour nous. Les repas sont composés de viande séchée, de saucisse, de pain et d’un peu de fromage. Le soir, nous nous arrêtons dans des relais de poste, ou une gendarmerie. Nous dormons souvent dans une grange, sur du fourrage ou de la paille. Je me rapproche de Jean Raynal, quelqu’un à qui parler. Il me fait oublier mon angoisse. C’est la même chose pour lui, et nous parlons la même langue, nous n’avons pas à chercher nos mots. Le rythme de marche qui nous est imposé est dur, les étapes sont toujours bienvenues.
Enfin, nous arrivons au casernement, nous allons dormir plus confortablement, sans le vent et l’humidité de la nuit. Chacun reçoit son paquetage, uniforme, chaussures, une formation sur l’ordre militaire : le garde à vous, saluer un supérieur, rester immobiles pendant plusieurs minutes, rester alignés, se taire, comment répondre à un supérieur. Cette période paraît interminable, Jean trouve que le sous-officier instructeur ressemble à son grand-oncle, voix claire, rocailleuse, regard dur, il se donne une contenance en se balançant de droite à gauche à chacun de ses pas.Nous dormons dans une grande pièce, le dortoir, sur des lits de camp et sous des couvertures de laine qui grattent. Le soir, je repense à ma vie au village, ma famille et la ferme me manquent, je peine à trouver le sommeil malgré la fatigue accumulée.
Les journées passent vite, nous sommes réveillés à 5 heures, notre petit déjeuner est composé d’une soupe, de pain et d’une rasade de vin, ensuite il nous faut nettoyer les stalles à l’écurie, nourrir, brosser, vérifierles fers et les sabots, puis harnacher, seller les chevaux. Suivent différents exercices : maîtrise du cheval, manipulation des armes, sabre ou fusil, nettoyage des armes… Une compétition s’installe entre nous : qui sera le meilleur, le plus rapide ? Les repas sont basés sur des viandes séchées, du pain et des légumes. Manger et boire nous permet de récupérer à la suite des exercices.
Après quelques jours de classe vient l’exercice de monte, pour de nombreuses recrues, une angoisse supplémentaire.Pour moi, monter à cheval n’est pas un problème, je suis habitué à harnacher des chevaux de trait, je les montais même à cru, la différence est que les chevaux du régiment sont plus légers, ils ont un caractère plus difficile. Il nous faut monter plusieurs chevaux, le premier est un animal docile, puis suivant nos capacités, nous montons des chevaux plus jeunes, plus vifs, des étalons bien nerveux. Ces exercices se font pour les premiers en manège, puis en extérieur lorsque la conduite des chevaux est acquise, ces journées sont longues et fatigantes, mes fesses s’en souviennent encore. Je passe d’un exercice à l’autre, il nous faut faire obéir nos montures de façon à garder la formation ou s’en détacher suivant une trajectoire déterminée. Le plus difficile est d’apprendre le maniement du sabre, en exercice ils sont en bois, mais il y a les coups que nous recevons suite à de mauvaises parades, l’escrime n’est pas le but de l’entraînement, nous devons apprendre à esquiver. Certains n’apprécient pas de se sentir dominés, ils tapent comme des brutes, et ils en deviennent les plus gros dangers. Le tir au fusil nous amène à chercher la bonne position, nous habituer à la fumée, à la détonation, l’odeur âcre de la poudre qui emplit les narines. Pour la précision de mes tirs, je suis les conseils d’un de mes équipiers qui a déjà tiré au fusil, je dois contrôler ma respiration au moment de tirer, et ne pas me laisser intimider par les remontrances des sous-officiers qui manquent parfois de délicatesse. Puis vient une deuxième série de cours d’équitation, ils commencent dans un manège, le cheval tenu au bout d’une corde par l’instructeur, le futur cavalier doit monter sur le dos du cheval, s’y maintenir et si possible s’adapter aux différentes allures, suivant les habitudes de chacun cette première étape se passe plus ou moins bien. Une fois cette compétence acquise, une selle et un harnais nous sont donnés, ensuite la formation évolue vers la maîtrise des manœuvres que doit connaître le soldat. Nous devons nous exercer au maniement du sabre à cheval, cheval au galop, il nous faut frapper un mannequin, d’abord nous apprenons les exercices individuellement, puis nous les faisons en groupe d’une dizaine de cavaliers. Pour compléter notre formation, on nous initie au saut d’obstacle, seul puis en groupe. À la fin de ce cycle, un sous-officier décide de l’aptitude de chacun à rejoindre une unité de combat.
Je suis déclaré apte. Comme j’avais suivi les cours du « petit séminaire » de six à quatorze ans, je sais lire et écrire, mais j’ai un peu perdu l’habitude de ce parler français qui dans ma campagne n’était pas beaucoup pratiqué, c’est également le cas de beaucoup de soldats natifs du sud, cette aptitude me vaut au bout de deux mois une promotion au grade de « maréchal des logis ». Je conduis et je suis responsable d’un groupe de cinq hommes, en fait je sers plutôt de porte-voix au capitaine qui dirige le centre d’entraînement. Les sous-officiers instructeurs testent mes capacités de chef, rassembler les hommes, me faire obéir, prendre une décision dans une situation particulière, me repérer sur une carte, utiliser une boussole, et cela pendant une semaine. Je suis mis en situation : je dois conduire cinq hommes dans un village, trouver des vivres (nourriture, eau), les gérer, les distribuer, et pour finir rejoindre un point défini où nous attendent mes juges. Tous ces tests sont réalisés sous la surveillance d’un vieil adjudant et d’un officier.
Enfin, la décision tombe : un détachement de dix recrues va rejoindre le régiment, j’en ferai partie. Notre affectation, l’escadron, la compagnie, nous sera fournie à chacun lors de notredépart le lendemain matin. J’ai perdu Jean Raynal, nous avons été séparés dès notre arrivée au casernement.
Les campagnes
L’automne est déjà bien entamé quand arrive l’ordre de mouvement du régiment. En tant que soldats, nous ne connaissons pas notre destination, nous savons seulement que nous nous dirigeons vers l’Est, nous pensons à un retour en Italie. Le capitaine Esculier commande notre compagnie. C’est un homme d’une trentaine d’années qui a connu les campagnes qui suivirent la révolution, il est autoritaire, ses ordres sont lancés d’une voix forte et claire, il m’a l’air humain, il est respectueux des hommes. Moi, je seconde le lieutenant Dumourier, jeune homme de vingt-cinq ans, issu d’une famille de militaires, il ne parle pas beaucoup, il a la réputation d’être un bon soldat, il est fougueux, moi je parais plus calme, c’est sûrement pour cela qu’on nous a associés.
Nos déplacements se font en plusieurs étapes, d’une ville à une autre, parfois nous installons un campement.
Nous commençons l’étape chevaux au pas, pendant une heure, puis nous faisons une halte d’une dizaine de minutes pour permettre aux chevaux de se soulager, nous vérifions la tension des sangles de nos selles, nos paquetages, puis nous repartons au pas quelques minutes, et nous passons ensuite au trot durant deux heures avant de reprendre le pas puis de nouveau le trot. Dans les côtes et les descentes trop prononcées, nous mettons pied à terre. À l’arrivée, nous devons étriller les chevaux, les nourrir et, si possible, les abriter, ce qui nous oblige vers la fin des étapes à regarder si un bâtiment ou un recoin peut convenir à notre bivouac. Ces phases de déplacements sont éprouvées, les chevaux ne doivent pas être fourbus, si le voyage est long il faut conserver une bonne capacité de combat.
Nous apercevons des villages qui ressemblent à mon village de Campuac, les différences visibles sont surtout liées aux clochers des églises, aux pierres utilisées dont la couleur varie, aux toitures, au relief, aux bosquets, à la distribution des champs, et aux murets de pierres qui parfois séparent les parcelles. Deux semaines plus tard, nous arrivons en vue du Rhône, et là nous comprenons que nous n’allons pas en Italie, car notre trajectoire prend la direction du nord. Les hommes essaient de savoir qui sera leur futur ennemi, mais aucune information ne perce. Je questionne le lieutenant Dumourier :
— Savez-vous contre qui nous allons nous battre ?
— Pour le moment, seul le colonel doit savoir où nous allons, il ne nous a pas informés, sûrement pour éviter de renseigner les espions !
Puis il finit par me dire :
— Le premier consul, Napoléon Bonaparte, s’est fait couronner « empereur » le 18 mai 1804, il a pour objectif de s’opposer à l’Empire britannique, qui est le principal ennemi de la République française. Ennemi qui coalise tous les royaumes européens afin d’anéantir le régime issu de la révolution, et surtout de rabattre les ambitions du premier consul, maintenant empereur.
Les troupes se dirigent vers le nord, peut-être pour s’embarquer et envahir l’Angleterre. Entre nous, les paris sont ouverts.
En arrivant en vue des forêts vosgiennes, nous obliquons vers l’Est, et nos unités se joignent à l’armée qui marche vers la Bavière.
Mon escadron se spécialise dans la reconnaissance. Une dizaine de cavaliers part dans une direction donnée, vers un village, une colline, une vallée, nous devons observer si une troupe se trouve dans les parages ou s’il y a des traces du passage de soldats. Nous devons également être prêts à intervenir afin de protéger les équipages et les artilleurs qui marchent en fin de colonne, en complément de deux escadrons de cavaliers et d’un régiment de fantassins. Un soir, nous découvrons dans un vallon un campement de soldats en uniformes blancs, des Autrichiens. Trois hommes, le lieutenant qui commande le petit groupe et moi, nous approchons courbés, fusil en main. Derrière une poignée d’arbustes, nous évaluons l’effectif de cette troupe. Alors discrètement un par un nous faisons demi-tour vers les chevaux et rejoignons le gros de l’armée pour faire notre rapport quant à l’effectif et le matériel aperçu. Le lendemain, nous retournons observer cette troupe, de façon à déterminer ses mouvements, savoir si l’effectif a changé. Un autre groupe tente en même temps une approche suivant une autre direction pour mieux situer cet ennemi.
Nous ne savons pas comment l’état-major utilise nos informations, il nous demande de noter les mouvements des différentes unités, et d’en compter les effectifs. Le lieutenant nous transmet les ordres, il lui a été interdit de participer aux reconnaissances, un officier ne doit pas se faire prendre ! Nous devons repartir en chasse afin de bloquer d’éventuelles patrouilles ennemies avant qu’elles ne décèlent la position et l’effectif réel de notre armée.
Première bataille
Au détour d’un bosquet, nous nous retrouvons nez à nez avec un groupe de cavaliers en uniformes blancs, ils sont une vingtaine, nous ne sommes que dix. Le lieutenant réagit en prenant son sabre :
« Cavaliers, sabre au clair ! »
« Non ! Mon lieutenant, ils sont trop nombreux, rejoignons le capitaine », je réussis à le retenir et à le convaincre de fuir en nous dirigeant dans la direction où doit se trouver le groupe conduit par le capitaine, nous servons d’appât, ils pourront utiliser leur fusil pour nous couvrir, et les prendre à revers, de plus nous serons deux fois plus nombreux. Nous faisons donc demi-tour à bride abattue et… les cavaliers autrichiens à nos trousses pendant trois ou quatre kilomètres, je commence à me demander si mon idée était bonne.
« Mon capitaine, où êtes-vous ? » mais maintenant plus trop moyen de réfléchir. Enfin d’une colline déboulent le capitaine et ses hommes sabre au clair, les Autrichiens s’arrêtent net, nous faisons de même. Je dégage mon fusil, épaule et tire, un ennemi tombe, le restant de notre groupe fait de même, puis sabre au clair nous chargeons. L’officier autrichien est tué par une balle, ses hommes ne résistent pas longtemps, ils tentent de s’échapper, mais nous les encerclons, ils se rendent, ce qui est très bien pour nous car ils ne pourront pas transmettre d’informations à leurs chefs, nous avons réussi notre mission. Les hommes me sont reconnaissants pour mon initiative et surtout parce que j’ai convaincu le lieutenant. Le capitaine me félicite, comme quoi le lieutenant m’a laissé la paternité de notre manœuvre. Le lendemain, on nous envoie observer une colline occupée par des Autrichiens. Il faut en évaluer l’effectif, et repérer les éventuels mouvements autour du village d’Elchingen.
À l’aube du jour suivant, la bataille commence. La cavalerie légère, hussards et chasseurs doivent prendre et garder le pont non loin de là jusqu’à ce que l’infanterie arrive. Ce pont doit permettre à l’armée de passer au nord du Danube. Nous, les dragons, sommes déjà sur la rive nord, nous devons nous regrouper afin de couvrir le flanc gauche de l’armée du général Dupont. Les carrés d’infanterie commencent à se mettre en place et à avancer tout en restant hors de portée. Les escadrons de dragons se tiennent à gauche de l’infanterie, les escadrons de cavalerie légère se tiennent à droite. L’ordre est donné à l’infanterie d’avancer, les canons ennemis commencent à toner, nous sommes occupés à tenir nos chevaux, et devons attendre. Nous voyons la cavalerie légère se lancer vers les canons, elle passe sous les tirs pour les prendre de côté, les coups de canon diminuent puis cessent, l’infanterie accélère son pas, la cavalerie se retire, la fumée des tirs de fusil commence à voiler le paysage, mais on devine les carrés d’infanterie autrichiens qui commencent à descendre de la colline. C’est à ce moment-là que nous nous mettons en mouvement, d’abord au pas pour nous positionner. Notre tâche consiste à harceler les carrés de fantassins de façon à les éclater.
Notre escadron passe au trot, nous sommes encore loin, je peux voir l’autre compagnie se diriger vers l’avant du premier carré, nous le contournons par le côté gauche. Le capitaine donne l’ordre de la charge, nous passons au trot. Je ne suis pas au premier rang, j’ai du mal à bien voir, d’autant que nous sommes focalisés sur le choc que nous allons bientôt subir. Les premiers cavaliers ont pénétré le carré, les coups de sabre pleuvent, les coups de baïonnettes aussi, il faut écarter les lames menaçantes et frapper rapidement. Je n’ai plus d’angoisse, il faut réagir très vite, pas le temps de penser, rien d’autre ne compte que les baïonnettes et les coups de sabre… Puis la trompette sonne le repli, je ne me fais pas prier, je dirige mon cheval hors de la mêlée et je prends la direction prise par les autres. L’escadron se reforme, notre compagnie doit cette fois attaquer le carré d’infanterie de face, nous devons charger nos mousquets de façon à pouvoir tirer avant le contact. L’ordre est donné de nous lancer avec mousquets au poing. J’épaule, tente de viser et quand l’ordre vient je tire puis je remets le fusil dans mon dos, saisis mon sabre et tente de maîtriser mon cheval de l’autre main. Les chevaux sont au trot et je vois arriver très vite ces uniformes blancs et surtout leurs baïonnettes dressées vers moi. Je frappe pour écarter les lames de mon cheval. Les coups de sabots de mon cheval sont aussi efficaces que moi. Je finis par traverser le carré, une fois de l’autre côté, je reprends ma charge vers les fantassins. Je suis le capitaine, nous traversons une fois de plus, puis de l’autre côté nous nous arrêtons. Les fantassins français sont rentrés en contact avec l’ennemi. Une trompette brise le vacarme des combats, les Autrichiens se replient.
Le lieutenant me donne l’ordre d’escorter le groupe de prisonniers vers l’arrière afin de les remettre à une compagnie d’infanterie.
L’armée ennemie se replie dans la ville d’Ulm, nos unités se regroupent, comptant chacune ses pertes. C’est avec l’accalmie que nous pouvons ressentir les émotions liées à la bataille, nous nous regardons mais sans insistance. Je vois le capitaine venir vers moi :
— Prends cinq hommes et va récupérer les chevaux errants dans les alentours.
Cela me va tout à fait, rester inactif me semble difficilement supportable. Je prends cinq hommes, il nous faut repérer puis approcher les chevaux isolés, ne pas les apeurer puis les saisir par les rênes. Une fois qu’un d’entre nous tient un cheval, il devient gardien, et nous lui ramenons ceux que nous attrapons. Lorsqu’il en a huit, un deuxième gardien lui prête main-forte. Nous ramenons au camp seize chevaux, un autre groupe en a fait autant, il nous faut les nettoyer, les brosser puis les alimenter en plus des nôtres.
Le lendemain, nous suivons notre corps d’armée qui doit prendre position devant Ulm côté ouest, un autre corps doit se positionner côté sud-est et le troisième corps côté nord, ainsi l’armée autrichienne est encerclée dans la ville.
Nous installons notre campement, les autres régiments ont fait de même, dans chaque unité quelques hommes montent la garde. Le lendemain, on nous donne l’ordre de nous équiper, de nous ranger, et d’avancer afin que nous soyons visibles de la ville. Les fantassins ont reformé leurs carrés, mais aucun ordre ne vient. Un peu plus tard, l’information que les Autrichiens se rendent nous parvient, une bataille gagnée et pas de morts.