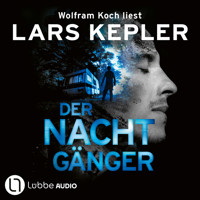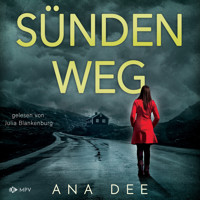Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Véritable petit bijou, ce roman épistolaire publié en 1824 se présente comme une variation sur la jalousie et ses affres. Confrontée à l'image obsédante de son amant disparaissant dans la calèche d'une autre beauté au sortir de l'opéra, notre héroïne tente de comprendre et de calmer les mille émotions qui l'assaillent.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 103
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vingt-quatre heures d'une femme sensible
Vingt-quatre heures d'une femme sensiblePréface-Vingt-quatre heures d’une femme sensibleLettre premièreLettre IILettre IIILettre IVLettre VLettre VILettre VIILettre VIIILettre IXLettre XLettre XILettre XIILettre XIIILettre XIVLettre XVLettre XVILettre XVIILettre XVIIILettre XIXLettre XXLettre XXILettre XXIILettre XXIIILettre XXIVLettre XXVLettre XXVILettre XXVIILettre XXVIIILettre XXIXLettre XXXLettre XXXILettre XXXIILettre XXXIIILettre XXXIVLettre XXXVLettre XXXVILettre XXXVIILettre XXXVIIILettre XXXIXLettre XLLettre XLILettre XLIILettre XLIIILettre XLIVLettre XLVLettre XLVI et dernièreConclusionPage de copyrightVingt-quatre heures d'une femme sensible
Constance de Salm
Préface
Petite leçon à l’usage des femmes jalouses
Josyane Savigneau.
Le Monde, 2 février 2007.
Ce court roman épistolaire a été publié de manière anonyme en 1824 ! : Vingt-quatre heures d’une femme sensible ou Une grande leçon, de la princesse de S…, quarante-quatre lettres écrites par une femme à l’homme qu’elle aime, en une nuit sans sommeil et une journée d’angoisse, pour dire tous les tourments de la jalousie.
Un soir, au sortir d’un concert, cette femme a vu disparaître son amant, qu’elle veut épouser, en compagnie de la « belle » et « coquette » « Mme de B*** ». Et, chacun le sait, « l’amant le plus fidèle, le plus intime même, a-t-il jamais su résister aux provocations de la coquetterie !? ».
Voilà que s’enclenche le fatal mécanisme de la jalousie, ajouté à la tendance qu’ont beaucoup de femmes à aimer le malheur, à l’anticiper, au lieu de jouir du présent. « Je vous aime, mon ami, plus que l’on n’a jamais aimé ! ; mais il ne se passe pas une minute de ma vie sans qu’une secrète anxiété ne se mêle à l’enchantement de ma passion. »
De lettre en lettre, montent le désespoir et la folie. Engrenage classique, presque banal, de la passion. Tout cela va très mal finir… Ici, il n’en est rien. Le jeune homme était parti au bras de Mme de B*** pour assister à son mariage, en secret, avec son oncle, lequel lui disputait, jusqu’alors, la femme qu’il aime – l’auteur des lettres de folle jalousie.
« La jeune dame qui a écrit ces lettres épousa son ami au bout de huit jours. On ignore si elle l’instruisit de tout ce qu’on vient de lire. »
Est-ce pour cette fin heureuse que ce beau texte est tombé dans l’oubli, comme son auteur, Constance de Salm (1767-1845), à laquelle Claude Schopp, qui a exhumé ce roman, rend un hommage justifié dans une postface très documentée !?
La belle Constance de Théis était de ces femmes libres comme le XVIIIe siècle en a vu naître. Avant d’épouser le prince de Salm, elle était mariée à un chirurgien, Jean-Baptiste Pipelet, dont elle divorça (grâce à la loi de 1792) en 1799. C’est sous ce nom qu’elle apparaît dans La Vie de Henry Brulard, de Stendhal ! : « La poésie me fit horreur (…) mais j’admirais fort et avec envie la gorge de Mme Constance Pipelet, qui lut une pièce de vers. Je le lui ai dit depuis ! ; elle était alors femme d’un pauvre diable de chirurgien herniaire. »
Constance de Salm a en effet écrit des poèmes, sans doute pas inoubliables, et des drames, peut-être moins réussis que cet unique roman. Elle tenait un brillant salon, où elle recevait notamment Jean-Baptiste Say, Talma, Houdon, Girodet, Alexandre Dumas, Stendhal… Ses contemporains admiratifs la surnommaient « Muse de la Raison » ou « Boileau des femmes ».
Elle avait peu de goût pour le sentimentalisme et les femmes soumises, et si elle écrivit Vingt-quatre heures d’une femme sensible, c’était, disait-elle à l’amie à laquelle elle dédiait ce livre, pour « répondre par là à quelques reproches qui m’avaient été faits sur le ton sérieux et philosophique de la plupart de mes ouvrages ».
Elle voulait avant tout, comme elle y insistera dans un avant-propos à ses Œuvres complètes (publiées en 1842), non seulement « faire un tableau complet de cette multitude de vives sensations, qui sont, en quelque sorte, le secret des femmes », mais aussi, ce que « peu de lecteurs ont vu », « montrer jusqu’à quel point elles peuvent les égarer, et leur donner par là une utile et grande leçon ».
En un mot, inciter les femmes à penser leur liberté. D’ailleurs, au cœur même de sa dérive de jalousie, l’héroïne de Vingt-quatre heures s’interroge sur l’amour, « un caprice, une fantaisie, une surprise du cœur, peut-être des sens » ! ; « L’amour n’est donc pas une condition inévitable de la vie, il n’en est qu’une circonstance, un désordre, une époque… Que dis-je !? un malheur ! une crise… une crise terrible…, elle passe, et voilà tout ».
Penser et demander aux femmes de penser. Écrire à un ami ! : « J’aime l’indépendance en tout » – il n’en fallait pas plus, et il n’en faut toujours pas plus, pour être considérée comme un « bas-bleu ». C’était certainement une raison suffisante pour que Constance de Salm soit injustement oubliée. Et il n’est pas certain qu’aujourd’hui encore sa leçon puisse être entendue.
* * *
Une femme des Lumières sort de l’ombre
Astrid de Larminat.
Libération, le 1er février 2007.
La princesse de Salm fut un brillant esprit de la fin du XVIIIe siècle, féministe avant l’heure.
Une réédition permet de la (re)découvrir.
L’oubli qui a recouvert le nom de la princesse Constance de Salm après sa mort, en 1845, est inversement proportionnel à la notoriété qu’elle connut de son vivant comme écrivain et à l’influence qu’elle exerça dans les sphères intellectuelles et même politiques. Si elle figurait encore dans le Larousse au XIXe siècle, de nos jours, elle n’est même plus mentionnée dans les ouvrages recensant les femmes de lettres ! Une réhabilitation s’imposait donc. Claude Schopp, universitaire spécialiste d’Alexandre Dumas, s’y est employé, lui qui s’est fait une vocation d’exhumer des auteurs que le temps a enfouis et de les rééditer pour les ressusciter. « Il y a beaucoup de vivants dans les cimetières, de nombreux auteurs qu’on a enterrés sans s’aviser que leur œuvre, elle, était bien vivante », assure-t-il, avec la gourmandise du chercheur. Constance de Salm était l’une de ses intimes depuis longtemps ! : son salon, l’un des mieux fréquentés de Paris sous l’Empire, fut en effet le premier à accueillir le jeune et ambitieux Alexandre Dumas.
C’est en tombant sur une notice de 1908 évoquant Vingt-Quatre Heures d’une femme sensible comme « un roman qu’on ne lit plus mais qui mériterait d’être réédité », que l’universitaire ourdit le projet de sortir un jour de son cachot de la Bibliothèque nationale l’unique roman de « la Princesse ». C’est désormais chose faite. Le livre n’est pas encore en librairie que déjà Elsa Zylberstein a exprimé le désir de le porter à la scène. Lors de sa publication, en 1824, ce roman épistolaire où l’auteur avait décidé de « ne pas dire un mot qui ne fût dicté par le sentiment ou la passion » avait déjà rencontré un vif succès.
Il conquit notamment le public féminin qui s’identifia à cette héroïne dont la raison est égarée par la jalousie.
Par cet ouvrage, dont la prose fluide et cadencée épouse les infimes variations de l’âme, ses transports subits, l’arythmie d’un cœur épuisé de passion, Constance de Salm, à qui on attribua le titre de « Muse de la raison », désirait nuancer la réputation de sérieux que lui avaient valu ses nombreuses épîtres et œuvres de circonstance. Elle voulait prouver qu’elle n’était pas dénuée de ce qu’elle considère comme le plus bel apanage de son sexe, la sensibilité qui n’agit pas que sur les affections de l’âme, mais « éclaire et agrandit l’esprit », précise-t-elle dans la préface du roman.
Les jeunes filles doivent être instruites comme les garçons.
Elle n’eut de cesse de faire admettre l’égalité des hommes et des femmes face à la création. Le siècle des Lumières n’avait pas suffi à dissiper les préjugés sur ce sujet et beaucoup d’hommes regardaient avec condescendance celles qu’ils appelaient les « bas-bleus ».
Pour s’en convaincre, il suffit de se reporter, dans la remarquable postface de Claude Schopp, à un commentaire d’Henri Beyle. Ce dernier ayant assisté à la séance d’une société savante nota dans son journal qu’il avait « admiré fort et avec envie la gorge de Mme Constance Pipelet qui lut une pièce de vers ». Exquise muflerie qui précède des propos peu élevés sur les penchants érotiques de cette dame trop intelligente… La première tragédie de Constance avait pour héroïne la poétesse grecque Sapho. En introduction, l’auteur faisait allusion à ces poètes machistes, inquiets « de trouver des rivales dans un sexe où ils ne cherchent que des admiratrices ». En 1897, elle se fendit même d’une Épître aux femmes où elle exhorte ses semblables à sortir de l’enfance.
Première femme à être admise en 1895 au Lycée des arts, institution qui avait peu ou prou remplacé les académies supprimées au début de la Révolution, elle bénéficiait alors d’un réseau d’appuis suffisant pour se permettre ce genre de déclarations, réclamant, notamment, que les jeunes filles soient instruites comme les garçons.
Devenue princesse de Salm par son second mariage, elle ne manquera pas, en temps voulu, d’interpeller Napoléon sur certains articles du Code civil injustes pour son sexe… Dans ses œuvres complètes, qu’elle réunit à la fin de sa vie, ses Pensées, rédigées à la manière de La Rochefoucauld, pourraient être rééditées avec bonheur, d’après Claude Schopp, qui n’exclut pas de se plonger dans la dizaine de cartons remplis des lettres qu’elle reçut pour rédiger une biographie romancée de celle qu’il nomme « la Marguerite Yourcenar de la fin du XVIIIe ».
* * *
Adresses de femmes
Par Delphine Peras.
L’Express, 3 février 2007.
Le roman de Constance de Salm, écrit en 1824, devrait faire un malheur en librairie. Car ces lettres d’amour d’une maîtresse jalouse relèvent d’un art épistolaire des temps passés que le public plébiscite.
Vous avez aimé Laissez-moi, de Marcelle Sauvageot, réponse d’une jeune tuberculeuse à la lettre de rupture de son amant, sublime épître datant de 1933 et rééditée en 2004 !? Vous ne résisterez pas à ce nouveau trésor qu’exhument aujourd’hui les éditions Phébus ! : Vingt-Quatre Heures d’une femme sensible, de Constance de Salm (1767-1845). Il s’agit cette fois d’un court roman épistolaire, publié en 1824, sous ce titre-là précisément – avant le fameux Vingt-Quatre Heures de la vie d’une femme, de Stefan Zweig. Au rythme de 44 missives adressées à l’élu de son cœur, l’auteure, une femme du monde, donne libre cours à l’afflux d’émotions qui la submerge depuis qu’elle a vu son « ami » quitter l’Opéra au bras d’une autre.
S’ensuit une nuit d’insomnie où notre héroïne ressasse sa passion, ses affres comme ses bonheurs. C’est exquis, c’est extrême. C’est l’amour fou, furieux, dans sa plus belle expression. « Je n’ai plus qu’une pensée, celle d’être à vous ! ; qu’une crainte, celle de ne l’être pas », écrit-elle, passant aussitôt au tutoiement, tour à tour éplorée, excédée, résignée. Il y a du Phèdre chez cette femme si entière. On pense aussi à la Princesse de Clèves ou encore à la Duchesse de Langeais.
L’actrice Elsa Zylberstein ne s’y est pas trompée ! : après son coup de cœur pour Laissez-moi, qu’elle a joué aux Bouffes-du-Nord – précédant Claire Chazal, qui en fera la lecture au Petit Théâtre de Paris, chaque mardi à 19 heures, à partir du 6 mars – elle vient de succomber à ces Vingt-Quatre Heures d’une femme sensible et envisage de le lire également sur scène ! : « Constance de Salm parle de la jalousie avec une telle élégance ! J’y ai retrouvé la même lucidité que chez Marcelle Sauvageot et de ces phrases inoubliables sur les hommes et l’amour, sur la prise de possession de l’autre. C’est une leçon d’humanité très moderne », s’enflamme-t-elle.
Claude Schopp, grand spécialiste d’Alexandre Dumas, a découvert en 1982 ce « petit roman charmant » signalé par plusieurs biographies du XIXe siècle. C’est que Constance de Salm, féministe avant l’heure, fut une intellectuelle de renom et son salon, l’un des mieux fréquentés de Paris, notamment par Stendhal et Dumas fils. « Il y a beaucoup de vivants dans les cimetières ! : la postérité a laissé de côté des écrits qui peuvent encore se lire avec intérêt », estime Claude Schopp.
De fait, ces textes retrouvés par hasard, où la sensibilité féminine s’exprime avec une singulière intensité, chaque fois sous une forme brève et épistolaire, ont tous connu un succès inattendu. Ainsi, Laissez-moi a atteint les 70 000 exemplaires vendus. Et, surtout, Inconnu à cette adresse, de l’Américaine Kathrine Kressmann Taylor (1903-1997), paru en 1938 et republié en 1999 par les éditions Autrement sans publicité particulière, est vite devenu un livre culte ! : échange de lettres entre un Américain juif et un compatriote d’origine allemande devenu antisémite en revenant dans son pays, il s’est vendu à un bon million d’exemplaires rien qu’en France.
De quoi inciter Autrement, trois ans plus tard, à éditer derechef une correspondance inédite en français ! : 84, Charing Cross Road, d’une autre Américaine, Helene Hanff (1916-1997), portant cette fois sur l’amour de la littérature.
Ce délicieux dialogue a lui aussi trouvé son public et s’est écoulé à 55 000 exemplaires. Assurément, à l’ère des SMS et des Texto, les (vraies) lettres n’ont pas dit leur dernier mot…