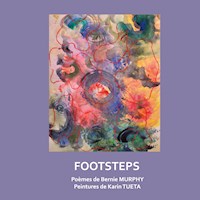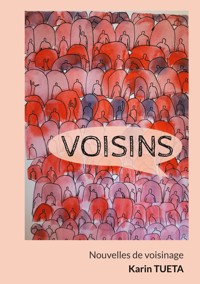
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
L'auteur, à travers dix sept nouvelles, dix-sept lieux différents et tranches de vie, nous dépeint le quotidien d 'une vie de voisinage dans sa diversité : relation de partages, d'amitiés, de violences de solidarité, d'amour. Chaque chapitre illustré par un arbre, symbole d'enracinement vient témoigner de la vie d'une femme aux différents stades de son existence, comme des mutations de notre société. "Voisins" n'est pas simplement un récit autobiographique qui se déroule sur une période de quarante ans, c'est une médiation profonde sur l'interconnexion humaine, une ode à la communauté et une célébration à trouver de la résonance même dans les moments les plus inattendus. Karin Tueta parvient ainsi à universaliser ses expérience de voisinage et nous offre une introspection à la fois personnelle et collective, rappelant à quel point nos vies sont intrinsèquement liées à celles qui nous entourent. Un récit d'une grande sensibilité.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Née en 1968 à Paris, Karin Tueta, est peintre et vidéaste. Elle expose en France comme à l’étranger depuis plus de vingt ans.
Au travers de sa peinture, ses vidéos arts, ses nouvelles autobiographiques, elle vient sonder le concept de résonance, qui caractérise la relation qu’entretient l’homme avec les autres et le monde.
Pour en savoir plus : www.karintueta.fr
Précédentes publications :
La Marche, Recueil de citations illustrées, 2020.
Foosteps, avec les poèmes de Bernie Murphy , BOD 2021.
À mes voisins,
Qui ont fait de moi, la voisine que je suis devenue.
À ma famille,
Qui a partagé avec moi ces rencontres.
À Isabelle Vrinat
Pour son précieux regard.
À Kika,(2008/2023)
Médiatrice en rencontre de voisinage.
Avertissement :
Ces nouvelles sont le fruit de ma mémoire, mais que sont les souvenirs sinon des récits que l’on se fait du passé ?
Il serait donc juste de préciser au lecteur que toute ressemblance avec des faits et des personnages existants ou ayant existés serait purement fortuite et ne pourrait être que le fruit d’une pure coïncidence…
Voisins,
Sommes-nous totalement distincts de ces âmes qui vivent proches de nous ?
Voir s’y un,
Ne font-ils pas partie aussi de nos identités multiples chères à Amin Maalouf ?
Voir zinzin,
En bien ou en mal, ils font partie de notre quotidien.
Voix un, voix‘in,tant de voix !
Table des matières :
Préambule «
De drôles d’histoires
»
Chapitre 1 : «
Clé de sol
»
Chapitre 2 : «
Voir les pyramides
»
Chapitre 3 «
Deux adolescents à leurs fenêtres
»
Chapitre 4 : «
Le vietnamien d’en bas
»
Chapitre 5 «
Des pigeons intelligents
»
Chapitre 6 «
Fucking french bitch
»
Chapitre 7 : «
Vivre à deux
»
Chapitre 8 : «
Le sicilien
»
Chapitre 9 : «
Cuisine avec vue
»
Chapitre 10 : «
Cirilo
»
Chapitre 11 : «
Chronique d’une cité
»
Chapitre 9 : «
Une escapade
»
Chapitre10 : «
Le fils
»
Chapitre 11 : «
Jour de pain
»
Chapitre 12 : «
L’Emilione
»
Postambule «
Portraits de femmes en paysage de Hyères
»
Préambule
« Sème du bonheur dans le champ du voisin, tu seras surpris de constater ce que le vent fera produire au tien. »
Juliette St-Gelais
La plage des Pesquiers est déserte en ce matin de jour de semaine, la mer azur a des allures de lac, une intense lumière illumine le rivage bordé de pins parasols.
Son sable flamboyant est ponctué de quelques laisses de mer de ci de là.
Tout respire la sérénité.
C’est un jour d’après mistral à la visibilité exceptionnelle, les vagues sont douces et leurs cadences réconfortantes.
Mes pieds frissonnent au contact de l’eau encore froide d’avril.
De minuscules poissons se précipitent sur mes orteils avec agressivité, ils me mordent, je ris de ce chatouillement intempestif et de leur obstination à chasser les premiers baigneurs, puis pénètre dans l’eau calme.
Anesthésiée par le froid, je ne ressens plus aucune douleur.
Le poids de mon dos, ma nuque, mes épaules, disparaît instantanément.
Un bien être intérieur m’envahit devant la beauté du paysage et mon corps allégé de son poids.
A l’horizon, Porquerolles se distingue par ses étranges rochers des Mèdes, l’île vient se confondre à l’ouest avec la presqu’île de Giens. On aperçoit au loin son village insulaire avec ses voiliers blancs.
En quelques mouvements de brasse, je rejoins Florence, et m’enquiers :
— Vous avez besoin d’aide pour sortir de l’eau ?
Elle se jette en arrière, plonge sa tête dans l’eau puis se redresse d’un coup, le visage ruisselant, ses cheveux courts aux boucles grisonnantes sont maintenant mouillés :
— Non, non, je vais me débrouiller…. Ne vous inquiétez pas !
Elle s’immerge à nouveau.
— Oh, quel bien elle me fait ! Je ne peux pas m’en passer, le matin j’ai du mal à me lever mais je me dis, tu vas y aller et cela me donne du courage, après on est si bien, …dites…c’est … c’est un peu comme une drogue.
Elle se retourne vers moi, éclate de rire, un rire joyeux et franc, ses yeux plissés par le soleil et les gouttelettes d’eau de mer.
Au loin à l’est, c’est l’île de Port Cros, d’abruptes collines d’un bleu sombre se dessinent sur l’eau.
Kika, le fox terrier, nous rejoint.
Elle a assurément développé une relation privilégiée avec Florence, notre voisine, depuis que nous avons emménagé dans la maison à Hyères.
La chienne nage volontiers depuis qu’elles ont fait connaissance, alors qu’elle refusait d’y mettre la patte auparavant. Je la soupçonne de rêver nous quitter pour devenir l’animal favori de notre voisine, qui, avec sa passion pour les animaux, son véganisme depuis soixante ans et son grand jardin, représente objectivement un meilleur foyer d’adoption pour elle.
— Kika ! Kika !
Nous l’appelons chacune de notre côté. La chienne se dirige vers Florence puis vers moi, sa queue telle un gouvernail, des promeneurs s’arrêtent pour observer son jeu aquatique.
Elle est ressortie, lassée par l’effort et patiente sagement près de ma serviette et mon sac de plage.
C’est une règle implicite bien établie entre nous, elle se baigne en premier mais doit après surveiller mes affaires.
Florence se retourne vers moi :
— Voyez-vous… moi, je n’ai rien vécu, je n’ai rien à raconter, je n’ai pas eu d’enfants, je ne me suis pas mariée, je n’ai pas travaillé … Les autres, ils vous racontent, j’ai fait ceci, mes enfants font cela, moi, je n’ai rien à dire.
Je souris :
— Oui mais, vous avez trouvé un bel équilibre dans votre vie, vous avez su apprécier ce que vous avez reçu. Au contraire, Florence, vous êtes un modèle de vie pour moi !
— Vous croyez !?
Elle pouffe, c’est un rire enfantin, elle me paraît paradoxalement plus jeune, plus jeune que moi alors qu’elle a plus de soixante-dix ans. Je reprends :
— Oui, bien sûr ! D’ailleurs, cela me fait penser aux Australiens qui se lèvent tôt pour nager avant le travail ou qui nagent le soir après dans les piscines d’eau de mer à cause de la puissance des vagues, ils profitent du bien être que la nature peut leur offrir, au lieu de rester devant leurs écrans.
— Les Australiens ? Mais pourquoi vous me parlez des Australiens ?! Vous êtes marrante vous, vous avez toujours des drôles d’histoires …
Elle nage maintenant en direction de la plage, esquisse quelques pas assurés, dans l’eau, rien ne transparaît de ses problèmes d’équilibre, elle continue :
— Vous m’étonnez toujours ! Vraiment ! Vous devriez écrire tout cela dans un livre !
Elle rit à nouveau. Nous sortons de l’eau, elle chancelle, vacille et se résout enfin à prendre mon bras :
— Ah ! Si je n’avais pas ce problème d’équilibre !
Elle retrouve son panier d’osier usagé avec une petite serviette à losanges verts et marrons, un motif en vogue dans les années soixante-dix.
— Profitons de ce rayon de soleil ! Dommage que Maurice ne soit pas là, comme il aurait aimé cette belle journée, je pense que lui et son compagnon nous rejoindront la semaine prochaine.
Nous empruntons alors le petit chemin de sable qui mène aux grandes villas des Pesquiers pour rejoindre la voiture.
De hauts pins parasols abritent le quartier côtier des anciens salins de Hyères, ils confèrent une atmosphère paisible au lieu, une ombre majestueuse l’été aux rues et aux grandes maisons de vacances.
Dans notre quartier proche du centre-ville, ce sont des bigaradiers qui égaient nos rues. Ils embaument toute une semaine au printemps, d’une odeur suave captivante.
La couleur vive des oranges apparaît à travers leurs épais feuillages, elles sont d’un vert brillant à l’automne, orangée dès décembre, décoratives comme des boules de Noël.
Après les jours de fort mistral, les agrumes de la ville se mettent à joncher les trottoirs, comme abandonnées là. Les collégiens chahutent parfois avec, jusqu’à ce que les cantonniers se décident à les ramasser à la toute fin de la saison hivernale.
Le fruit est amer et moins riche en chair. Les mamies en font des confitures, d’autres du vin d’orange, il est commun d’en offrir, rare d’en acheter.
2
Cette année, tout est devenu si différent.
Devant l’obligation de vivre cloîtré, une frénésie de cuisiner s’est emparée de nombreux concitoyens, quand d’autres ont fait une orgie de séries violentes en s’abonnant à une nouvelle chaîne américaine, j’ai fait pour la première fois de la confiture des fruits de notre oranger.
La délicieuse odeur des fruits dans la marmite a empli la maison, je me suis remémorée les jours de confiture, l’été, ou ma mère préparait les bocaux pour l’hiver. La mémoire olfactive est si suggestive, que m’est revenue, alors, l’image des fruits appétissants qui patientaient sur la table ronde de la terrasse de N, abricots, fraises, quetsches, posés là, sur de grands torchons, avant d’être plongés dans le faitout de cuivre.
Les pots à la couleur dorée ont rejoint l’importante réserve d’Ulysse, mon fils de vingt-cinq ans, qui sait mettre en valeur chaque aliment au mieux mais n’a pas de place chez lui pour les stocker.
Dès que nous pourrons nous retrouver tous ensemble comme avant, dans la rue, insouciants, ou aux portes des maisons, j’en offrirai à Pierre Marc, Philippe, et Simone, mes voisins, je sais qu’ils en raffolent.
Clé de sol
Annick est assise sur le petit muret qui fait face à l’entrée B.
Je ne suis pas surprise de la voir là, je sais qu’elle passe dorénavant tous ses dimanches chez nos voisins de palier les Iglesis, depuis que j’ai Mme Missana comme maitresse.
D’après Mme Iglesis, Annick devrait bientôt venir habiter chez eux la semaine et pourra enfin quitter la maison d’enfants où elle vit. C’est une grande maison avec beaucoup de jouets mais aucun enfant de la résidence n’a envie de prendre sa place car c’est un endroit pour les enfants qui ont des parents morts de maladies ou d’accidents de voiture et que cela ne doit pas être drôle tous les jours.
Je me demande si nos voisins sont allés à la maison d’enfants et ont choisi Annick comme fille, comme on choisirait une paire de chaussures à son pied chez le marchand du centre-ville avec le méchant berger allemand, ou si c’est plutôt le fait du hasard, comme lorsque nous nous donnons la main dans la cour de l’école à la fin de la récréation, eux sans enfants, elle sans parents.
Ils l’ont peut-être choisie parce qu’elle sait beaucoup de choses, qu’elle est déjà grande, qu’elle a beaucoup d’idées sur le monde, ça doit être plus pratique pour eux qu’un bébé qui ignore tout de la vie.
Annick se redresse et me fixe du regard un instant, elle paraît ailleurs.
Je m’approche d’elle et observe qu’elle se tient penchée sur un étrange cahier. Aussitôt, d’autres enfants de la résidence nous rejoignent. Nous nous tenons tous autour d’elle, curieux.
Elle s’affaire à coller des insectes, le cahier en équilibre sur ses genoux avec du film transparent et note leurs noms dans la marge, elle dit qu’il faut être précis bien mettre la date et le lieu de la capture.
Nous la regardons perplexes.
— Pouvez-vous m’aider à capturer des insectes que je n’ai pas encore, Il me faudrait certaines araignées…Il me manque aussi un scorpion ! D’ailleurs je suis moi-même scorpion !
J’ignore totalement ce qu’elle veut dire par là mais n’ose en souffler mot devant les autres.
Son petit cahier d’écolier Clairefontaine est déformé par l’addition des collages des petits cadavres desséchés qui le fait gondoler. La plupart des insectes qu’il contient, provient d’après elle de la résidence :
— Observez cette mouche en bas de la page, vous voyez ce bleu, il a des reflets plus sombres. C’est unique !
Elle voit donc de la beauté dans ces bêtes si banales…
— Regardez bien mon cahier pour ne pas m’apporter ceux que j’ai déjà, il serait inutile de les tuer pour rien.
— Et comment les attrape-t-on ? Demande alors Sophie, la plus âgée d’entre nous, l’air vaguement dégoûté et dubitative.
Je ne ressens aucune répugnance pour ces drôles de bestioles obstinées, c’est juste que je ne les avais pas considérées jusqu’à ce jour.
Annick patiente, reprend ses explications, il nous faut regarder partout, partout où on ne regarde jamais, les coins de mur, les portes, les rebords des fenêtres, les caniveaux…Elle insiste, il nous faut chercher les différences entre l’une et l’autre espèce pour mieux les répertorier : de l’observation naît la diversité, de la désignation la connaissance, un travail de classement, c’est un jeu, un jeu sérieux de grand.
Je l’observe à la dérobée, ses cheveux bruns très longs ondulent le long de son dos mince, son jean à pattes d’éléphant est délavé, sa chemisette à fleur trop courte et étroite. Sa peau porcelaine contraste avec ses yeux sombres aux cils noirs et courbés.
Elle relève la tête et nous interroge sur ce qui différencie l’abeille de la guêpe, qui d‘après elle sont des hyménoptères comme la fourmi.
— Vous pensez que c’est leur pyjama à rayures qui n’est pas le même ?
— Oui, bien-sûr !
C’est un cri choral qui sort de nos gorges à l’unisson tant nous sommes flattés de l’intérêt que nous porte cette fille mystérieuse, mature (elle a déjà dix ans) et au savoir immense.
Annick répond d’un ton catégorique :
— Pas du tout ! Ce sont leurs poils ! Les guêpes ont les poils raides et longs ! Il faut une loupe pour les voir…
2
Des noisetiers forment une haie derrière nos bâtiments, ils perdent leurs feuilles l’hiver, tristes et décharnés. Au printemps, leurs bourgeons se métamorphosent en feuilles du jour au lendemain, puis éclatent les fleurs aux formes sculptées et aux filaments rouges. Les petits fruits verts se forment, et la haie se couvre de noisettes délicieuses et mûres pour la cueillette automnale. Nous écrasons l’oléagineux d’un grand coup de talon, avant de nous en délecter. Les grands aident parfois les petits ou ceux qui ont des semelles de caoutchouc trop molles.
Quand le temps s’y prête, nous jouons à cache-cache, depuis l’espace vert situé à l’arrière des immeubles, jusqu’aux sous-sols obscurs les jours de pluie. Ce sont alors des courses folles, où il est question de vie et de mort. Nous courrons sonner à la porte de Mr et Mme Iglesis, nos voisins de palier, libérant ainsi pour un temps les parkings de nos bruyantes courses-poursuites.
Mme Iglesis ouvre doucement, un sourire amusé devant notre essoufflement, nos joues écarlates :
— Oui ?
C’est pour voir la souris !
Elle nous laisse alors pénétrer dans son petit appartement, où nous nous dirigeons vers la cuisine observer le rongeur aux yeux rouges, le petit mammifère tourne avec frénésie dans sa roue, le poil immaculé. Dans un sursaut d’angoisse, Il s’en extirpe, effrayé par nos voix et bondit d’un bout à l’autre de sa cage. Nous aimerions tous le surprendre endormi. Certains d’entre nous prétendent d’ailleurs avoir pu l’observer ainsi, son petit corps blanc abandonné sur le côté, ses yeux clos, son flanc dévoilant ses minuscules pattes, mais cela n’est que vantardise, car d’après Mme Iglesis, le petit animal est bien trop peureux pour se laisser aller au sommeil devant nous.
3
Un jour de printemps, j’arrive hors d’haleine devant le vestibule d’entrée de mon bâtiment après une vaine poursuite et m’autorise un temps de pause afin de reprendre mon souffle.
Un air de piano parvient jusqu’à moi, c’est celui de M. Iglesis, qui habite comme nous le rez-de-chaussée de l'immeuble.
Un délicieux sentiment de bien-être m’envahit alors que je m’adosse au mur sous sa fenêtre, je l’écoute jouer en observant les nuages défiler dans le ciel. Ceux-ci se meuvent en rythme, en accord avec la mélodie. L’intensité du ciel et de la musique sont venus remplacer les mobylettes agaçantes, qui vont et viennent, les vrombissements des moteurs défectueux, qu'un voisin répare là, sur le parking sous nos fenêtres.
La musique s’arrête soudain. M. Iglesis vient fermer sa fenêtre et m’aperçoit.
— Que fais-tu là ?
Je lève les yeux vers lui :
— J’écoute …
Il me sourit, étonné de ce public inattendu, ses yeux minuscules se plissent derrière ses lunettes, il passe sa main sur son crâne dégarni :
— Tu veux venir voir le piano ?
Mes yeux distinguent dans l’obscurité du salon, le piano droit ivoire, placé contre la cloison qui sépare nos deux appartements, il domine de sa présence immaculée tout l’espace du petit séjour.
Mr Iglesis s’assoit et joue. Ses doigts glissent avec une dextérité prodigieuse, les notes aigus et les graves résonnent. Ensemble elles produisent un tourbillon d’émotions.
Je m’applique à mémoriser les touches de l’instrument, bien observer comme Annick le fait avec ses insectes.
Il s’interrompt, se tourne vers moi souriant :
— Tu veux essayer ?
Je me hisse sur le tabouret beaucoup trop haut, mes mains n’atteignent pas le clavier, Mr Iglesis le tourne jusqu’à trouver la bonne hauteur, tout en mâchonnant un minuscule cigarillo, il émane du séjour une odeur de tabac froid.
— Il te faudrait deux ou trois coussins.
Il prononce ces mots avec son accent chantant.
Mon père dit qu’il vient d’une île où il y a eu la guerre ou des événements graves, qui l’ont forcé à partir du jour au lendemain.
Comme les murs de notre immeuble sont aussi fins que du papier, nous entendons tout de nos voisins, le piano de Mr Iglesis comme d’autres bruits des voisins du dessus, eux moins agréables.
Ainsi nous savons que Mr Iglesis ne joue pas seulement de son piano mais qu’il chante aussi, jour et nuit, avec Nana Mouskouri, une chanteuse de son pays qu’il adore, mais ce sont toujours les mêmes disques et cela agace mes parents. Ils disent que cela pourrait être drôle si ce n’était pas si répétitif.
—La musique a son propre alphabet… je t’écris le nom des notes au-dessus en lettres, ce sera plus facile pour toi pour t’en souvenir.
Il me montre la position des doigts de la main sur le clavier, dessine sur une feuille posée au-dessus du clavier des ronds noirs et blancs et ajoute à la marge avec un geste rapide une clé, qui dit-il, ouvre la musique.
— Tu t’entraîneras à faire la clé de sol pour une prochaine fois ?
J’acquiesce d’un signe de la tête et me saisis de l’obscur feuillet, sans oser lui avouer que je ne sais pas lire.
J’aimerai lui dire que l’année prochaine je saurai, que j’irai à la grande école mais je ne dis rien de crainte de le décevoir, qu’il change d’avis, qu’il n’y ait pas de prochaine fois, alors je répète avec application dans ma tête « Do ré mi fa sol Sol fa mi ré do » …
Voir les pyramides
Dès le retour de l’école, nous nous retrouvons dans la rue de notre lotissement en construction.
L’allée jusqu’alors en terre, vient d’être recouverte d’un mélange de gravier et de goudron qui abîme les pneus des vélos et empêche la glisse des patins à roulette.
Nous sommes déçus, nous aurions préféré un bel asphalte lisse comme celui devant la poste qui vient d’être construite, mais peu nous importe, nous sommes dehors après la classe, plutôt qu’à revoir nos leçons, au plus vite expédiées. Il s’agit le plus souvent de mots ennuyeux à chercher dans le dictionnaire puis à en recopier les définitions.
Les pavillons se construisent les uns après les autres, il règne une odeur de ciment humide.
Nous visitons imprudemment les chantiers, découvrant un après-midi des masques à gaz de la grande guerre dans le trou des fondations d’une maison, enfourchons nos vélos à toute vitesse pour sortir du quartier et aller jusqu’à Noiseau-2 ou même Noiseau-3 où nous retrouvons d’autres camarades de classe. Corinne a souvent sa sœur cadette Nathalie sur son porte-bagage, et moi, mon petit frère.
Nous sommes « Les Patinos », lançons des enquêtes d’après mes lectures des éditions des bibliothèques rose puis verte.
Les jours de pluie, nous jouons chez l’une ou l’autre aux poupées Barbie, Corinne choisit la blonde à roller et je prends la noire, patineuse à glace qui me vient d’un lointain oncle du Canada.
J’en suis fière, elle surprend. La blonde est toujours amoureuse de Ken, un blond tout aussi parfait physiquement qu’elle, il se montre toujours serviable, sa promise étant plutôt capricieuse dans ses exigences. La mienne n’a pas de mari mais sauve des enfants en les adoptant, comme Joséphine Backer, une chanteuse d’avant, elle a aussi sa propre fille à la peau noire et aux couettes auburn.
Fatiguées par les mélos des Barbie, nous devenons les Claudettes, celles de Claude-François, dont nous connaissons les chorégraphies par cœur et hurlons « Alexandrie, Alexandra », en lançant le 45 tour des centaines de fois à fond, organisons des spectacles, imitant les jeux radios ou télévisés avec nos cadets comme public, qui rapidement, se lassent.
2
Ce jour d’été 1976, notre premier dans la maison, il fait une chaleur caniculaire. Il n’a pas plu depuis longtemps, la poussière des chantiers voisins sature l’atmosphère. Le temps est lourd comme si un orage devait éclater, cette chaleur intense nous empêche de nous élancer, de danser.
Corinne me dit que nous sommes comme en Afrique, ou dans n’importe quel pays où il y a des noix de coco et des palmiers, tant il fait chaud. Les Barbies sont à moitié nues et brûlent sur des plages imaginaires.
Je rentre de chez mon amie pieds nus, je ne supporte plus mes sabots en bois que je porte à la main, mon short vert-pomme en jersey et mon tee-shirt à losanges orange et jaune collent à ma peau.
Après le virage, je peux apercevoir toute notre rue, c’est la rue du Président Kennedy, le gentil président américain assassiné, anciennement nommée quartier de la Briqueterie. Malgré le soleil puissant qui m’aveugle je distingue ma mère le balai à la main, parlant avec le fils du voisin dont l’estafette est garée en travers de la rue.
Elle semble en colère.
Comme ils vont et viennent son père et lui sur les chantiers, ils ne prennent jamais le temps de bien se garer.
Ma mère m’aperçoit, elle est étrange, elle me dit de rentrer vite à la maison et son ton est sans appel.
Malgré moi je regarde le sol, et vois du sang et des petits morceaux de chairs.
Je me précipite à l’intérieur, les murs sont nus, dans l’attente des tapisseries et de bibelots muraux, je cours à travers les pièces vides de la maison chercher le chaton, notre chaton gris adoré, né de Griseline, la chatte de Corinne.
« Berlioz ! Berlioz ! »
Il ne connaît pas encore bien son nom, alors j’insiste.
Il reste introuvable, je cherche, derrière le canapé de velours bleu, sous le buffet.
Je cris « Berlioz ! » une dernière fois et comprends enfin.
Il n’y a plus de chaton, plus de Berlioz, lui qui ne devait pas sortir, avec cette chaleur les portes-fenêtres sont restées ouvertes et le jardinet n’est pas clôturé.
Le petit être adorable parti en mésaventure telle la chèvre de Monsieur Seguin, a disparu, sans avoir eu le temps de vivre la vie que nous souhaitions partager avec lui.
Un grand désespoir me submerge, des larmes coulent de mes yeux, mon souffle s’appauvrit, j’ai l’impression qu’un ogre s’est posé sur ma poitrine.
3
Christine, la fille de la voisine, vient nous garder un soir.
C’est la première fois que mes parents nous laissent ainsi, mais avec Christine c’est un peu une fête.
Elle est si gaie, elle nous apprend à rouler les « rrr » en espagnol, qu’elle étudie à la fac de Vincennes, où ma mère va aussi depuis qu’elle a décidé de reprendre ses études. « Perrrro » dit elle et nous répétons, cela me plaît beaucoup.
Elle va se marier en juin avec un Espagnol qu’elle a rencontré là-bas, un homme très bien d’après ma mère.
Nous l’accompagnons pour l’essayage de sa robe de mariée, sa mère, ma mère et moi.
La robe ne me fait pas rêver, je la trouve un peu ridicule, avec son satin brillant, j’espère ne devoir jamais avoir à en porter une comme celle-ci.
De toute façon, je déteste les robes en général mais je ne dis rien pour ne pas les décevoir, elles s’exclament enthousiastes : — Tu en auras une aussi comme celle-ci quand tu seras grande ! pensant là me faire plaisir.
Non ! Plus tard, je préférerais être Zorro, Columbo ou Kungfu, surtout pas une princesse quelconque qui s’évanouit pour un rien, une simple potiche.
Mais Christine est heureuse, nos mères aussi …
C’est plutôt l’Espagne qui m’attire, ce pays où il faut faire tourner sa langue dans la bouche en même temps que l’on prononce les lettres comme si l’on devait danser ou rythmer les mots, ce pays au bord de la mer avec des palmiers d’après les cartes postales de Christine.
Ma mère dit que c’est triste pour la mère de Christine mais qu’elle a raison de partir vivre là-bas.
Christine est partie depuis plus d’un an maintenant, son père boit et sa mère est malade, son frère continue de foncer dans la rue et à garer l’estafette n’importe comment, mais il baisse toujours les yeux quand je le vois débouler. Il sait que je le juge et que je n’oublie pas Berlioz, le chaton.
Depuis qu’il a fait son service militaire, il a grossi, mais surtout, beaucoup plus intéressant, il a appris à projeter des films !
Alors il décide de créer un évènement dans ce village où il y en a si peu. Il se charge seul de diffuser un De Funès dans la salle municipale, avec les chaises de l’école.
Il dit qu’il ne fait qu’un essai, et c’est un grand succès. Tout le monde est présent pour le film. N devient l’espace d’une soirée une ville avec son cinéma, ce n’est plus un village de mille cinq cents âmes, mais une ville entourée de champs et de forêts. Malgré ce succès, J’ignore pourquoi, mais c’est bien dommage, il ne renouvelle pas cette expérience.
A Noël, Christine revient, elle est si gaie que leur maison se remet à vivre. On entend la joie oubliée depuis la maladie et l’alcool.
Sa mémé, du moins la femme qui a élevé sa mère, vient souvent leur rendre visite, grande et forte avec une blouse à fleurs bleues et mauves, elle est deux fois plus grande et large que Suzanne, la mère de Christine.
D’ailleurs celle-ci est de plus en plus maigre et fragile. Je suis plus grande qu’elle maintenant.
Elle confesse à ma mère qu’elle aimerait divorcer. Son mari est toujours au bar-tabac face à l’église, comme le facteur qui a toujours son vélo garé devant.
Il ne fait que boire et crier sur elle, pourtant si fragile.
Parfois il la pousse fort et la fait souffrir. Elle dit qu’elle a commis une erreur en l’épousant mais ne sait pas quoi faire d’autre que subir.
Suzanne va et vient à l’hôpital de Créteil à cause de sa maladie mortelle, et à chaque fois elle est plus faible.
Elle porte une perruque qui ne lui va pas et sort peu, la mémé vient de plus en plus souvent.
Cette dernière n’est pas sa mère mais c’est celle qui l’a sauvée pendant la guerre quand ses parents ont disparu, elle est son unique soutien.
Mon père dit que ses parents ont dû être juifs. Elle répond à ma mère qu’elle ne sait pas, que cela ne l’intéresse pas, d’ailleurs elle déteste les Juifs comme la mémé, elle en veut à ses parents qui l’ont abandonnée en disparaissant soudainement, elle n’a gardé par ailleurs, aucun souvenir d’eux, car elle était bébé.
Comment peut-on abandonner son bébé comme cela ?
Je me demande bien ce que cela doit vouloir dire « être Juif ».
Décembre. Son mari s’est décidé à quitter la maison, il traîne avec une autre alcoolique au bar de N et vit chez celle-ci. Elle va pouvoir enfin divorcer.
Pourtant, quelques mois plus tard, lorsque nous allons nous recueillir sur sa tombe au petit cimetière derrière l’église, il y a leurs deux prénoms gravés sur la tombe, avec son nom à lui déjà inscrit.
Cela nous énerve beaucoup, ma mère et moi qu’elle n’ait finalement jamais réussi à lui échapper et qu’elle doive porter son nom pour l’éternité.
A l’enterrement il sanglotait fort et criait « Suzanne, ma Suzanne ! » et reprenait de plus bel, lui si dur avec elle.
Ce n’était pas logique.
Peut-être avait-t-il enfin compris ce qu’il lui avait fait endurer, ou bien s’apitoyait-t-il sur lui-même, en hurlant ainsi sans scrupules, lui le pauvre veuf qu’il était devenu, lui le seul en peine et le plus à plaindre, alors que ses enfants restaient eux dignes et silencieux devant sa mascarade, accompagnant leur mère avec respect et discrétion.
Christine revient nous voir plusieurs fois les années qui suivent l’enterrement de sa mère, puis le décès de son père.
De passage en France avec son mari, elle sonne à notre porte à l’improviste et c’est toujours une grande joie d’entendre son rire communicatif qui n’a pas disparu malgré tout cela. Nous hurlons en l’apercevant des fenêtres de l’étage « C’est Christine ! C’est Christine ! ».
A 15 ans, je vais chez l’une de ses étudiantes à Valencia, pour apprendre l’espagnol. Je la retrouve fidèle à elle-même, féminine et joyeuse, même lorsqu’elle m’entend répondre en valencien à son étudiante, qui m’intégrant parfaitement à sa famille n’avait pas songé à me parler en Castillan.
4
De hautes haies de tuyas dissimulent désormais les petits pavillons.
Le cèdre planté par mes parents il y a dix ans domine la maison de son envergure. Majestueux, il ombrage les pièces de vie l’été, mais les assombrit l’hiver, abrite les hirondelles au printemps, fait de notre demeure un petit havre caché des regards.
Je vais au lycée. Dans le car qui me mène à la gare RER, nous parlons ensemble, les gens de N, les anciens enfants, qui avons joué dans les rues ensemble.
Les voisins parlent aux jeunes, les jeunes aux plus âgés.
J’attends le car avec Sylvie Zoé, mais elle peine souvent à être à l’heure et prend le suivant pour arriver plus d’une demi-heure en retard en classe, rouge et essoufflée.
Je suis donc le plus souvent seule à patienter au feu-rouge de la route nationale qui traverse le village, gênée par le froid, la pluie, les regards insistants des automobilistes arrêtés au feu qui me dévisagent.
Si je me tiens trop en retrait dans l’abri bus en béton, je cours le risque de rater le car, de devoir attendre encore quarante minutes et d’arriver au mieux en retard en compagnie de Sylvie.
Le chauffeur ne daigne pas s’arrêter si on ne lui fait pas de grands signes, alors qu’il ne passe jamais d’autres cars à cet endroit et qu’il n’y a aucune autre raison logique d’attendre là. Il est crucial d’être parfaitement visible, surtout dans la brume du matin qui monte des champs.
Au retour, je descends à l’arrêt de la mairie face à l’église.
Souvent je remonte la route qui mène à notre lotissement en discutant avec plaisir avec cette voisine.
C’est une femme d’une soixantaine d’année aux cheveux très courts aussi petite qu’énergique.
Elle a été institutrice et habite la petite maison derrière celle de sa fille, qui, elle, donne dans notre rue. Sa petite fille était en classe de primaire avec moi.
La maison de ses enfants a un petit air prétentieux.
C’est la dernière maison de la rue à avoir été construite, si grande qu’il ne reste rien du terrain pour le jardin. Elle a été construite sur une haute bute avec une rocaille très fournie. Celle-ci abrite un garage immense, dans lequel stationnent les deux fourgons avec lesquels ils travaillent sur les marchés.
Les pavillons du quartier sont comme de grands appartements posés sur des petits jardins.
Nous sommes les seuls à avoir une terrasse et à en profiter l’été, à l’abri des regards à l’arrière de la maison. Elle donne sur le jardin et sur le mur de la ferme en pierre de Brie.
L’été, nous parlons fort et rions lors des repas, nous sommes les seuls de toute la rue à manger dehors. On distingue les télévisions des voisins, les bruits de vaisselle, tandis que nous sommes dehors à regarder le cerisier, le saule pleureur, la tombée de la nuit et à parler.
Quand il y a des invités ou de la famille qui viennent d’Allemagne ou d’Italie visiter Paris, c’est la fête.
Les dimanches dans la rue Kennedy, il y a cette odeur de pot au feu et le bruit des cocottes-minutes qui sifflent la fin de la cuisson à toutes les fenêtres des cuisines.
Après le repas dominical, c’est la promenade derrière le cimetière ou vers la forêt.
Un jour, comme un autre du mois de mars, je remonte le petit chemin avec l’institutrice retraitée qui revient comme tous les mercredis du marché de Sucy-en-Brie, son caddie à la main.
Elle me raconte qu’elle va prendre l’avion pour la première fois et enfin réaliser le rêve de sa vie pour son anniversaire et celui de Nathalie, sa petite fille.
Elles partent toutes les trois en Egypte descendre le Nil à la découverte des pyramides.
Son gendre et son petit-fils n’ont pas voulu faire partie du voyage, et elles ont finalement décidé de partir entre femmes. Elle rit de leur audace.
Elle est passionnée d’égyptologie.
Je ne lui dis pas que mon père vient de là-bas.
Au repas du soir, je raconte à mes parents ce voyage fabuleux entre femmes et fais part de mon étonnement que les hommes n’en profitent pas. Mes parents en discutent, ils disent que nous allons y aller aussi bientôt.
Ils disent régulièrement « A Pâques nous irons là-bas » et puis un attentat, ou quelques événements les font changer d’avis. J’ignore que mon père n’a pas encore le droit d’y retourner, dans ces années-là.
Au retour des vacances de Pâques, le lundi aux environs de 19h, je sors pour retrouver ma voisine Christelle, nous nous rendons ensemble à notre cours de danse.
Christelle a grossi depuis qu’elle a arrêté la compétition de natation et se montre très volontaire pour le modern jazz.
Elle est blonde et a des yeux bleus si clairs qu’on dirait deux halogènes, je trouve qu’elle a un air de Boy George, le chanteur, avec son maquillage.
En moins de cinq minutes, nous arrivons devant notre ancienne école primaire, les cours de modern-jazz ont lieu dans le préau où les écoliers jouent les jours de pluie.
Parfois le sol est marqué par les traces de boue des pas des enfants. Les barres sont beaucoup trop basses pour nous et mal fixées.
Je ne peux m’empêcher de me souvenir, à chaque fois que je pénètre dans le préau, du jour où, écolières, nous avions eu la visite d’un homme venu nous montrer ses serpents. La présentation de l’anaconda avait été des plus impressionnante, l’homme le portait autour du coup et était passé dans les rangs pour nous permettre de le toucher.
Marianne nous rejoint, elle est aussi fine que Christelle a les épaules larges, elles sont amies depuis la primaire et ont un an de plus que moi, sa maison se trouve dans l’impasse qui donne sur notre rue.
— Vous avez vu aux nouvelles, l’incendie de l’hôtel Louxor au Caire ? nous demande-t-elle.
— Oui, c’est terrible ! répondons-nous en chœur.
— Nathalie, sa mère et sa grand-mère étaient dans l’hôtel, je crois… je crois qu’elles sont mortes …
L’enterrement peut enfin avoir lieu lorsque Leurs dépouilles calcinées sont rapatriées des semaines plus tard.
C’est un triste rassemblement qui unit le village sous le choc. Une communion d’ombres noires vient rendre un dernier hommage aux trois cercueils alignés côte à côte sous l’autel de la petite église romane de N.
Comme Il n’y a pas assez de place pour tout ce monde à l’intérieur, beaucoup sont restés dehors, ils se tiennent debout face à l’église pour se recueillir.
Lorsque le curé termine son sermon, les silhouettes endimanchées de noir quittent la petite place en silence sous les marronniers pleins des bourgeons du printemps.
C’est bouleversant tout ce monde et ce silence sur ce parvis habituellement peu fréquenté.
Les larmes nous montent aux yeux. Je pense à Nathalie, morte à dix-sept ans, à sa charmante grand-mère si heureuse de partir qui n’aura finalement pas même eu le temps de découvrir les pyramides.
Disparaître à cause d’un court-circuit, d’un système d’alarme qui ne fonctionne pas, d’un mauvais concours de circonstances, mourir de malchance. Périr brutalement… La mort est imprévisible, injuste quand bien même elle prévient avant, je me remémore alors la pauvre Suzanne se débattant face à la maladie, il y a des années de cela.
Il nous faudrait vivre intensément, vivre comme si demain tout pouvait finir, profiter de chaque instant…
De retour du lycée, j’emprunte soir après soir, ce même petit chemin piétonnier qui longe leur maison aux volets clos, et je ne peux m’empêcher de les revoir elles.
J’ai l’impression qu’elles vont sortir et que les trois cercueils étaient factices.
Mais depuis l’enterrement, la maison de Nathalie garde les volets toujours fermés.
Il n’y a plus de lumière du jour qui pénètre dans le pavillon, plus de fourgons qui émergent du grand sous-sol.
Le père et le fils se tiennent là, terrés dans la terreur de leur triple deuil, comme abandonnés par la vie, eux, les rescapés d’un rêve cauchemardesque, auquel ils avaient refusé de participer.
Une ou peut-être deux années plus tard, il semble qu’elle ouvre enfin les volets.
Oui …
Qui de la rue n’aura pas reconnue la mère de Nathalie en cette femme qui devait ignorer tout ou presque de la tragédie.
A-t-elle compris pourquoi personne ne pouvait la saluer ? L’effroi des voisins …
A-t-elle saisi qu’elle représentait un fantôme aux yeux de tous ?
Cette blondeur, cette silhouette, cette même coupe de cheveux.
Comment avait-t-il pu trouver femme si ressemblante ?
Étions-nous les témoins de la réincarnation d’une femme tragiquement disparue ou les spectateurs d’une illusion parfaite, celle d’une comédienne qui s’était chargée d’endosser le rôle de l’épouse en portant ses habits, sa coiffure ?
Était-il possible de demander à une personne plus ou moins consciemment d’être le double vivant d’une autre décédée ?
A cette représentation tragique, il manquait la fille et la grandmère.
Une jeune fille disparue à l’orée de ses 18 ans et une femme mûre rêvant de visiter les pyramides.
Adolescents à leurs fenêtres
S. est une ville allemande, frontalière à la France, avec plus de 150 000 habitants.