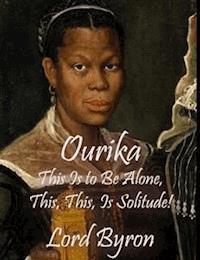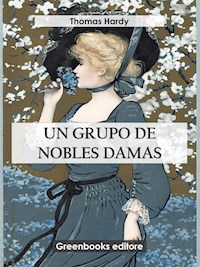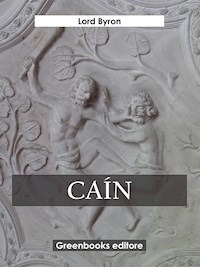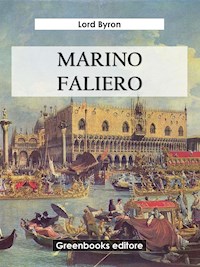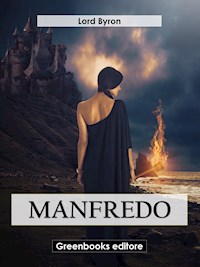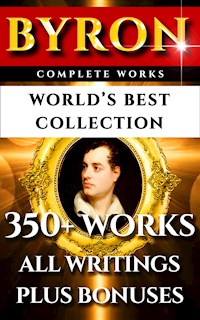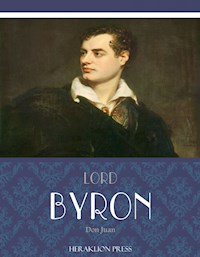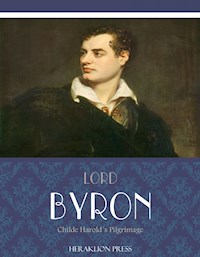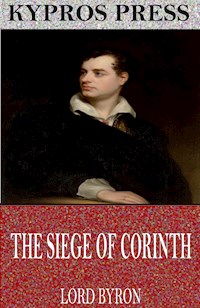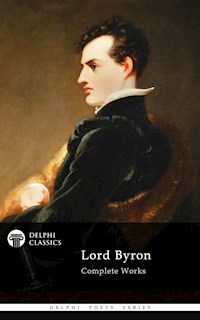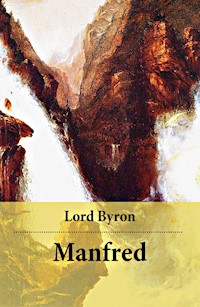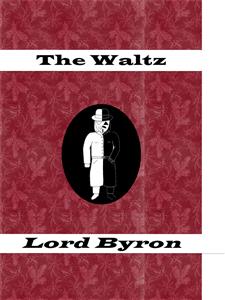Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Extrait : "JOSÉP : Mon bien-aimé, calme-toi. WERN : Je suis calme. JOSÉP : Pour moi, oui ; mais non pour toi : ta démarche est précipitée ; quelqu'un dont le cœur serait tranquille ne parcourait point d'un pas si rapide une chambre comme la nôtre. Si c'était un jardin, je te croirais heureux et j'aimerais à te voir aller avec l'abeille de fleur en fleur ; mais ici..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335097153
©Ligaran 2015
Cette Tragédie est dédiée par l’un de ses plus humbles admirateurs.
Le drame suivant est tiré en entier de Kruitzner, histoire allemande publiée, il y a plusieurs années, dans les Contes de Cantorbéry, de Lee, composés, je crois, par deux sœurs. L’une ne fournit que Kruitzner et une autre nouvelle ; mais elles passent pour être beaucoup supérieures à tout le reste de la collection. J’ai adopté les caractères, le plan et même les paroles de cette nouvelle en beaucoup d’endroits. Quelques caractères ont été modifiés ou altérés, quelques noms ont été changés, et j’ai ajouté un personnage, Ida Stralenheim ; pour tout le reste, j’ai suivi l’original. Fort jeune encore (j’avais alors environ quatorze ans), je lus cette nouvelle, qui fit sur moi une impression profonde, et qui déposa en moi le germe de bien des choses que j’ai écrites depuis. Je ne crois pas que ce roman ait jamais été très populaire, ou peut-être sa popularité a-t-elle été éclipsée par d’autres grands écrivains qui ont suivi la même carrière ; mais j’ai généralement vu que ceux qui l’avaient lu convenaient de la singulière puissance d’esprit et de conception que l’auteur avait déployée dans cette nouvelle. Je dis conception plutôt qu’exécution, car le sujet aurait pu être développé plus habilement. Parmi ceux qui partageaient mon avis relativement à cet ouvrage, je pourrais citer plusieurs noms illustres ; mais cela ne serait d’aucune utilité, car chacun doit juger d’après ses propres sentiments. Je renvoie le lecteur à l’histoire originale, afin qu’il puisse voir quels développements je lui ai donnés ; et je crois qu’il trouvera plus de plaisir à lire le roman que le drame qui en a été tiré.
J’avais commencé un drame sur ce sujet dès 1815 (mon premier essai dramatique, si l’on en excepte une tragédie, Ulric et Heina, que je fis à l’âge de treize ans, et que j’eus le bon sens de brûler) ; j’avais déjà achevé un acte, lorsque différentes circonstances m’empêchèrent de continuer. Il doit exister parmi mes papiers, en Angleterre ; mais, comme on ne l’a point retrouvé, je l’ai récrit, et j’ai ajouté les actes suivants.
Le tout n’a point été écrit pour la représentation.
Pise, février 1822.
HOMMES. WERNER ou SIÉGENDORF.
ULRIC.
STRALENHEIM.
IDENSTEIN.
GABOR.
FRITZ.
HENRICK.
ERICK.
ARNHEIM.
MEISTER.
RODOLPHE.
LUDWIG.
LE PRIEUR ALBERT.
FEMMES. JOSÉPHINE.
IDA STRALENHEIM.
Les trois premiers actes se passent sur la frontière de la Silésie, et les deux derniers au château de Siegendorf, près de Prague. – Époque : la fin de la guerre de Trente Ans.
La grande salle d’un château délabré dans le voisinage d’une petite ville, sur la frontière nord de la Silésie. – La nuit est orageuse.
Werner et Joséphine.
Mon bien-aimé, calme-toi.
Je suis calme.
Pour moi, oui ; mais non pour toi : ta démarche est précipitée ; quelqu’un dont le cœur serait tranquille ne parcourrait point d’un pas si rapide une chambre comme la nôtre. Si c’était un jardin, je te croirais heureux et j’aimerais à te voir aller avec l’abeille de fleur en fleur ; mais ici…
L’air est froid ; la tapisserie laisse pénétrer le vent qui l’agite. Mon sang est glacé.
Oh ! non !
Pourquoi ? Voudrais-tu donc le voir glacé ?
Je voudrais lui voir son cours naturel.
Qu’il continue à couler jusqu’à ce qu’il soit versé ou arrêté dans son cours, – peu m’importe quand.
Ne suis-je donc plus rien dans ton cœur ?
Tu es tout.
Comment peux-tu donc désirer ce qui doit briser le mien ?
Sans toi, j’aurais été… – n’importe quoi, mais un mélange de beaucoup de bien et de beaucoup de mal ; ce que je suis, tu le sais ; ce que j’aurais pu ou dû être, tu ne le sais pas ; mais je ne t’en aime pas moins, et rien ne nous séparera.
Werner s’éloigne brusquement, puis se rapproche de Joséphine.
L’orage de la nuit influe peut-être sur moi ; je suis un être accessible à toutes les impressions ; je me ressens encore de ma dernière maladie, dans laquelle, en veillant à mon chevet, mon amour, tu as plus souffert que moi.
Te voir rétabli, c’est beaucoup ; te voir heureux…
En as-tu connu qui le fussent ? Laisse-moi être malheureux avec le reste des hommes.
Pense à tous ceux qui, dans cette nuit d’orage, frissonnent sous la bise aiguë et la pluie ballante dont chaque goutte les courbe davantage vers la terre, qui ne leur offre d’autre abri que sa surface.
Et ce n’est pas là ce qu’il y a de pire : qu’importe une chambre commode ? c’est le repos qui est tout. Les malheureux dont tu parles, oui, le vent hurle autour d’eux, et la pluie ruisselante les pénètre jusqu’à la moelle. J’ai été soldat, chasseur, voyageur ; aujourd’hui je suis indigent, et dois connaître par expérience les privations dont tu parles.
N’es-tu pas à l’abri de ces privations ?
Oui, d’elles seules.
C’est déjà quelque chose.
Sans doute, pour un paysan.
L’homme d’une haute naissance doit-il méconnaître le bienfait d’un asile que ses habitudes de délicatesse lui rendent plus nécessaire encore qu’au paysan, alors que le vent de la fortune l’a poussé sur les écueils de la vie ?
Ce n’est pas cela, tu le sais ; tout cela nous l’avons supporté, je ne dirai pas avec patience, quoique tu en aies fait preuve, – mais enfin nous l’avons supporté.
Eh bien ?
Quelque chose de plus que nos souffrances extérieures (quoiqu’elles fussent suffisantes pour déchirer nos âmes) vient souvent me torturer, et maintenant plus que jamais. Sans cette maladie malencontreuse qui m’a saisi sur cette frontière inculte, qui a épuisé tout à la fois mes forces et mes ressources, et qui nous laisse… – Non, c’est plus que je n’en puis supporter ! – Sans cette circonstance j’aurais été heureux, ainsi que toi, – J’aurais soutenu la splendeur de mon rang, – l’honneur de mon nom, – du nom de mon père, – et surtout…
Mon fils, – notre fils, – notre Ulrich, depuis longtemps absent, eût été de nouveau pressé dans mes bras, et sa présence eût rassasié de joie le cœur de sa mère. Voilà douze ans ! il n’en avait alors que huit. – Il était beau, il doit l’être encore, mon Ulrich, mon fils adoré !
J’ai été souvent poursuivi par la fortune ; elle vient de m’atteindre dans un lieu où je ne puis plus faire de résistance, où je suis malade, pauvre et seul.
Seul ! mon cher époux ?
Ou pire encore, – enveloppant tout ce que j’aime dans mon infortune actuelle, plus cruelle qu’un isolement complet. Seul je serais mort, et tout eût été fini pour moi dans un tombeau sans nom.
Et je ne t’aurais pas survécu ; mais, je t’en conjure, rassure-lui ! Nous avons lutté longtemps, et ceux qui sont aux prises avec la fortune finissent par triompher d’elle ou par la fatiguer ; ou ils arrivent au but, ou ils cessent de ressentir leurs maux. Console-toi, – nous retrouverons notre enfant.
Nous étions à la veille de le retrouver, et de nous voir indemnisés de toutes nos souffrances passées ; – et nous voir ainsi déçus !
Nous ne sommes pas déçus.
Ne sommes-nous pas sans argent ?
Nous n’avons jamais été riches.
J’étais né pour la richesse, le rang, le pouvoir ; je les ai goûtés, je les ai aimés ; hélas ! j’en ai abusé et les ai perdus par le courroux de mon père dans ma jeunesse extravagante ; mais cet abus a été expié par de longues souffrances. La mort de mon père m’ouvrait de nouveau une voie libre, semée toutefois de périls. Le parent, l’être froid et rampant, qui a si longtemps tenu ses yeux fixés sur moi, comme le serpent sur l’oiseau à qui la frayeur fait battre des ailes, m’aura devancé, se sera approprié mes droits, et ses usurpations lui auront procuré la fortune et le rang des princes.
Qui sait ? notre fils est revenu peut-être auprès de son aïeul, et a revendiqué tes droits.
Vain espoir ! depuis son étrange disparition de la maison de mon père, comme s’il eut voulu hériter de mes fautes, ou n’a eu de lui aucune nouvelle. Je l’avais quitté, en le laissant chez son aïeul, sur la promesse de ce dernier que sa colère ne s’étendrait pas jusqu’à la troisième génération ; mais on dirait que le ciel réclame son inflexible prérogative, et veut, dans la personne de mon fils, punir les fautes et les erreurs de son père.
J’ai meilleur espoir. Jusqu’à présent, du moins, nous avons trompé les poursuites de Stralenheim.
Nous l’aurions pu sans cette fatale indisposition, plus funeste qu’une maladie mortelle ; car si elle n’ôte pas la vie, elle nous ôte tout ce qui en fait la consolation ; en ce moment même, il me semble que je suis entouré de toutes parts des pièges de ce démon avare ; – qui sait s’il n’a pas jusqu’ici suivi notre piste ?
Il ne connaît pas ta personne, et nous avons laissé à Hambourg les espions qu’il avait si longtemps attachés à nos pas. Notre voyage inattendu et ton changement de nom rendent toute découverte impossible ; on ne nous croit ici que ce que nous semblons.
Ce que nous semblons ! ce que nous sommes ; – des mendiants malades, sans espoir, même à nos propres yeux. – Ha ! ha !
Hélas ! quel rire amer !
Qui devinerait, sous cet extérieur, l’âme fière du rejeton d’une illustre race ? qui, sous cet habit, l’héritier d’un domaine de prince ? qui, dans cet œil éteint et morne, l’orgueil du rang et de la naissance ? et, sous ce front hâve, ce visage creusé par la faim, le seigneur de ces châteaux où mille vassaux trouvent chaque jour une table abondante ?
Tu ne t’occupais pas de ces choses mondaines, mon Werner, quand tu daignas choisir pour ton épouse la fille étrangère d’un exilé errant.
La fille d’un exilé était un parti sortable pour le fils d’un proscrit ; mais j’espérais encore t’élever au rang pour lequel nous étions nés tous deux. La maison de ton père était illustre, quoique déchue de sa splendeur, et sa noblesse pouvait rivaliser avec la nôtre.
Ton père ne pensait point ainsi, quoiqu’il sût que nous étions nobles ; mais si mon seul titre auprès de toi eût été ma naissance, elle n’eût été à mes yeux que ce qu’elle est.
Et qu’est-elle donc à tes yeux ?
Tout ce qu’elle nous a valu : – rien.
Comment, – rien ?
Ou pire encore ; car dès l’origine elle a été un cancer dans ton cœur ; sans elle nous aurions supporté gaiement notre pauvreté, comme des millions de mortels la supportent ; sans ces fantômes de tes ancêtres féodaux, tu aurais pu gagner ton pain comme tant d’autres ; ou si cette nécessité t’eût semblé trop dégradante, tu aurais essayé, par le commerce et par d’autres occupations civiques, de réparer les loris de la fortune.
Je serais devenu un bon bourgeois anséatique ? Excellent !
Quoi que tu aies pu être, tu es pour moi ce qu’aucun état humble ou élevé ne saurait, jamais changer : le premier choix de mon cœur, – qui t’a choisi sans connaître ta naissance, les espérances, ton orgueil ; sans connaître de toi autre chose que tes douleurs ; tant qu’elles dureront, laisse-moi les consoler ou les partager ; quand elles finiront, que les miennes finissent avec elles ou avec toi.
Mon bon ange ! telle je t’ai toujours trouvée ! Cet emportement, ou plutôt cette faiblesse de mon caractère, ne fit jamais naître en moi une pensée injurieuse pour toi ou pour les tiens. Tu n’as point entravé ma fortune : ma propre nature, quand j’étais jeune, était suffisante pour me faire perdre un empire, si un empire eût été mon héritage ; mais maintenant, châtié, dompté, épuisé et instruit à me connaître… – perdre tout cela pour notre fils et pour toi ! Crois-moi, lorsque dans mon vingt-deuxième printemps mon père m’interdit sa maison, à moi, le dernier rejeton de mille aïeux (car j’étais alors le dernier), j’éprouvai un choc moins douloureux qu’à voir, malgré leur innocence, mon enfant et la mère de mon enfant enveloppés dans la proscription que mes fautes ont méritée ; et, cependant, alors mes passions étaient toutes des serpents vivants, enlacés autour de moi comme ceux de la Gorgone.
On entend frapper à la porte.
Écoule !
On frappe !
Qui peut venir à cette heure ? Nous recevons peu de visites.
La pauvreté n’en reçoit jamais qui ne la rendent plus pauvre encore. Eh bien ! je suis préparé.
Werner met la main dans son sein, comme pour y chercher une arme.
Oh ! ne prends donc pas cet air. Je vais ouvrir ; ce ne peut être quelque chose d’important dans ce lieu retiré, dans cette contrée inculte : – le désert met l’homme à l’abri de l’homme.
Elle va à la porte et ouvre.
Idenstein entre.
Bonne nuit à ma belle hôtesse, et au digne, – comment vous nommez-vous, mon ami ?
Ne craignez-vous pas de le demander ?
Craindre ? parbleu ! je crains en effet. On dirait, à vous voir, que je demande quelque chose de mieux que votre nom.
De mieux, Monsieur !
De mieux ou de pire, comme le mariage ; que dirai-je de plus ? Voilà un mois que vous logez dans le palais du prince. – Il est vrai que depuis douze ans son altesse l’a abandonné aux revenants et aux rats ; mais, enfin, c’est un palais. – Je dis que voilà un mois que vous logez chez nous, et cependant nous ne savons pas encore votre nom.
Mon nom est Werner.
Un beau nom, ma foi ! aussi beau qu’on en vit jamais figurer sur l’enseigne d’un boutiquier. J’ai, au lazaret de Hambourg, un cousin dont la femme portait ce nom-là. C’est un officier de santé ; aide-chirurgien, il espère devenir chirurgien un jour, et il a fait des miracles dans sa profession. Vous êtes peut-être allié de mon parent ?
De votre parent ?
Oui, nous sommes parents éloignés. Bas à Werner. Ne pouvez-vous vous accommoder à l’humeur de cet ennuyeux bavard, jusqu’à ce que nous sachions ce qu’il nous veut ?
J’en suis vraiment charmé ; je m’en doutais, j’avais quelque chose dans le cœur qui me le disait : – c’est que, voyez-vous, cousin, le sang ce n’est pas de l’eau ; et, à propos d’eau, ayons du vin, et buvons à notre plus ample connaissance : les parents doivent être amis.
Vous paraissez avoir déjà assez bu ; et quand cela ne serait pas, je n’ai pas de vin à vous offrir, à moins que ce ne soit le vôtre ; mais vous le savez ou devriez le savoir : vous voyez que je suis pauvre et malade, et vous ne voulez pas voir que je désire être seul ; mais, au fait ; quel motif vous amène ?
Quel motif pourrait m’amener ?
Je ne sais, quoique je devine ce qui pourra vous faire sortir.
Patience, cher Werner.
Vous ne savez donc pas ce qui est arrivé ?
Comment le saurions-nous ?
La rivière a débordé.
Hélas ! pour notre malheur, nous le savons depuis cinq jours, puisque c’est le motif qui nous retient ici.
Mais ce que vous ne savez pas, c’est qu’un grand personnage qui a voulu traverser, malgré le courant et les représentations de trois postillons, s’est noyé au-dessous du gué, avec cinq chevaux de poste, un singe, un caniche et un valet.
Pauvres créatures ! en êtes-vous bien sûr ?
Oui, du singe, du valet et des chevaux ; mais jusqu’à présent on ignore encore si Son Excellence a péri ou non ; ces nobles sont durs en diable à noyer, comme il convient à des hommes en place ; mais ce qui est certain, c’est qu’il a avalé l’eau de l’Oder en assez grande quantité pour faire crever deux paysans : en ce moment, un Saxon et un voyageur hongrois qui, au péril de leur vie, l’ont arraché au gouffre des eaux, ont envoyé demander pour lui un logement ou un tombeau, selon que l’individu sera mort ou vivant.
Et où le recevrez-vous ? Ici, j’espère ; si nous pouvons vous être utiles, – vous n’avez qu’à parler.
Ici ? non ! mais dans l’appartement même du prince, comme il convient à un hôte illustre : – les pièces sont humides, sans doute, n’ayant pas été habitées depuis douze ans ; mais comme il vient d’un endroit beaucoup plus humide encore, il n’est pas probable qu’il s’y enrhume, s’il est encore susceptible de s’enrhumer ; – et, dans le cas contraire, il sera encore plus mal logé demain ; en attendant, j’ai fait allumer du feu, et préparer tout ce qu’il faudrait au cas où il en réchapperait.
Le pauvre homme ! j’espère de tout mon cœur qu’il se rétablira.
Intendant, avez-vous appris son nom ? Bas à sa femme. Ma Joséphine, retire-toi ; je vais sonder cet imbécile.
Joséphine sort.
Son nom ? mon Dieu, qui sait s’il a maintenant un nom ? Il sera temps de le lui demander quand il sera en état de répondre, ou bien lorsqu’il faudra mettre le nom de son héritier dans son épitaphe. Tout à l’heure, vous trouviez mauvais que je demandasse le nom des gens.
C’est vrai, vous parlez sagement.
Gabor entre.
Si je suis importun, je demande mille pardons.
Oh ! nullement ! vous êtes dans le palais ; cet homme est étranger comme vous ; je vous prie de ne pas vous gêner. Mais où est Son Excellence, et comment se porte-t-elle ?
Son Excellence est trempée et fatiguée, mais hors de danger : elle s’est arrêtée, pour changer de vêtement, dans une chaumière où j’ai moi-même quitté les miens pour ceux-ci ; elle est presque entièrement remise de son bain, et sera bientôt ici.
Holà ! oh ! qu’on se dépêche ! Ici, Herman, Weilbourg, Pierre, Conrad !
Entrent divers valets auxquels Idenstein donne des ordres.
Un noble couche au palais cette nuit ; – ayez soin que tout soit en ordre dans la chambre damassée ; – entretenez le poêle. – J’irai moi-même au cellier, – et madame Idenstein (c’est mon épouse, étranger) fournira le linge de lit ; car, à dire vrai, c’est un article merveilleusement rare dans l’enceinte de ce palais, depuis une douzaine d’années que Son Altesse l’a quitté. Et puis, Son Excellence soupera sans doute ?
Ma foi ! je ne saurais dire ; je pense que son oreiller lui plaira mieux que la table, après le plongeon qu’elle a fait dans la rivière ; mais pour que vos provisions ne se perdent pas, je me propose de souper moi-même, et j’ai là dehors un ami qui fera honneur à votre repas avec tout l’appétit d’un voyageur.
Mais êtes-vous sûr que Son Excellence… – Quel est son nom ?
Je n’en sais rien.
Et cependant vous lui avez sauvé la vie.
J’ai aidé en cela mon ami.
Voilà qui est étrange ! sauver la vie à un homme qu’on ne connaît pas !
Il n’y a rien là d’étrange ; car il est des gens que je connais si bien que je ne me donnerais pas cette peine-là pour eux.
Dites-moi, mon ami, qui êtes-vous ?
Ma famille est hongroise.
Et vous l’appelez ?
Peu importe.
Je crois que tout le monde s’est fait anonyme ; personne ne se soucie de me dire son nom. À Gabor. Dites-moi, je vous prie, Son Excellence a-t-elle une suite nombreuse ?
Suffisamment nombreuse.
Quel est le nombre de ses gens ?
Je ne les ai pas comptés. C’est le hasard qui nous a amenés justement à temps pour retirer Son Excellence par la portière de son carrosse.
Oh ! que ne donnerais-je pas pour sauver un grand personnage ! – Sans doute vous aurez pour récompense une jolie somme ?
Peut-être.
À combien croyez-vous pouvoir l’évaluer ?
Je ne me suis pas encore mis aux enchères ; en attendant, ma meilleure récompense serait un verre de votre Hockcheimer, – un verre orné de riches grappes et de devises à Bacchus, plein jusqu’au bord du vin le plus vieux de votre cellier, en retour de quoi, au cas où vous seriez en danger de vous noyer, genre de mort qui très probablement ne sera pas le vôtre, je vous promets de vous sauver pour rien. Vite, mon ami ; et songez que pour chaque rasade que je sablerai, une vague de moins coulera sur votre tête.
Je n’aime guère cet homme-là. Il semble discret et bref, deux qualités qui ne me conviennent pas du tout ; toutefois il aura du vin ; si cela ne le déboutonne pas, la curiosité ne me permettra pas de dormir de la nuit.
Idenstein sort.
Ce maître de cérémonies est l’intendant du palais, je présume. L’édifice est beau, mais délabré.
L’appartement destiné à celui que vous avez sauvé, est mieux disposé que celui-ci pour recevoir un malade.
Je m’étonne que vous ne l’occupiez pas ; car vous paraissez être d’une santé délicate.
Monsieur !