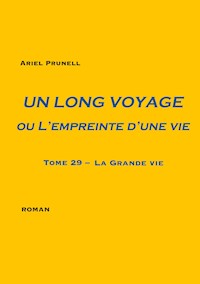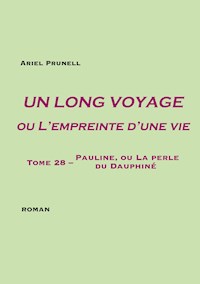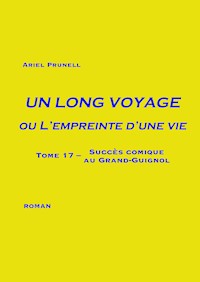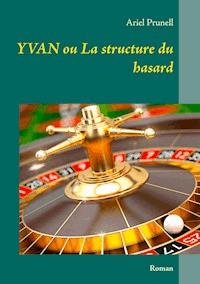
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Cloué sur son lit d’hôpital, Yvan raconte le fatal concours de circonstances qui l’y a conduit. Étudiant à Grenoble au début des années soixante dans un lycée huppé, puis en Fac de droit, au contact de jeunes issus de milieux aisés, il compense ses origines modestes et sa petite taille par sa grande gueule. Il aspire moins à faire partie de cette société qu’il méprise qu’à bénéficier des avantages matériels et moraux qu’elle peut lui dispenser. Instruit par l’exemple de son meilleur ami, débutant au cinéma, avec qui il partage brièvement les fastes et les travers de la vie parisienne branchée, il s’est en effet persuadé que l’argent est le chemin obligé du bonheur. Il croit l’atteindre grâce à un riche mariage, mais l’argent leur est compté par une belle-famille occupée aux antipodes à en gagner plus encore. En avoir beaucoup, très vite, devient alors son obsession, qu’il canalisera dans l’élaboration avec ses quatre compères d’une martingale à la roulette capable de dompter les hasards du tapis vert et de contenir les sautes d’humeur de la bille d’ivoire. La suite, tant aux plans financier que sentimental et amical, sera bien loin de ses espoirs initiaux, et finira par tourner au drame : un grave accident de voiture. Le récit dépeint l'ambition sociale de notre révolutionnaire pré-soixante-huitard, englué dans une société figée, et jette un regard aigu sur les poncifs qui, pour lui, la guident. Il est aussi l’occasion d’une réflexion originale sur les jeux d'argent, et sur les motivations et ressorts psychologiques de ceux qui s'y adonnent. Avec, en toile de fond, l’amitié singulière du héros pour Sacha, l’inspirateur et le moteur de l’équipe des "martingaleux".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 547
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DU MÊME AUTEUR :
JUSQU’À CE QUE MORT S’ENSUIVE Contes et nouvelle de ce monde et de l’autreBoD (Books on Demand) 2012
UN LONG VOYAGE ou L’empreinte d’une vie – Tome 1 RomanBoD (Books on Demand) 2015
Sur le hasard :
Le hasard, c'est peut-être le pseudonyme de Dieu quand il ne veut pas signer.
Théophile Gautier
Nul vainqueur ne croit au hasard.
Nietzsche
Sur le destin
On n'entend pas de trompettes le jour où l'on prend les décisions importantes pour le reste de notre vie. Le destin œuvre en silence.
Agnès de Mille
L’homme porte son destin attaché au cou comme une clé USB. Inconnu
Sur la chance :
La chance s'attrape par les cheveux, mais elle est chauve.
Stendhal
La chance est la forme laïque du miracle.
Paul Guth
Sur le jeu :
Jouer, c'est expérimenter le hasard.
Novalis
Il y a des circonstances où il faut s'abstenir de jouer à la bourse, aux courses, au baccarat ou à la roulette : primo, quand on n'a pas les moyens et secundo, quand on les a.
Alphonse Allais
La sagesse au jeu est de savoir s'arrêter... à un kilomètre de l'entrée du casino.
Patrick Sébastien
Prologue
Voilà, c’est fait, j’ai obéi, j’ai écrit les premiers mots, avec une volonté si nouvelle en moi que je n’arrive pas à y croire. J’ai l’impression que quelqu’un dicte et lit, tout ensemble, au-dessus de moi. Je voudrais essayer de guérir en racontant mon voyage. Quelque regret que j’en aie, je sais qu’il n’y a pas d’autre façon de le recommencer !
J’écris sur le conseil, sur l’ordre, devrais-je dire, de cet homme omniscient, mon psychiatre psychologue, qui en sait sur moi tellement plus que moi, lui qui m’a déclaré : « Tout le mal est venu d’un duel entre votre faiblesse et votre religion de la force. Pour vous reconstruire, il vous faut d’abord vous libérer du poids qui vous écrase. Essayez de raconter ce que vous avez vécu, sans en omettre aucun détail. Vous avez tout votre temps. Si vous y parvenez, vous serez délivré, en tout cas c’est ce que je crois… »
« Ton nom : Lvionok, qu’on prononce ici Lovniko, par facilité, ton nom, en russe, signifie : petit lion. » C’est tout au moins ce que l’on m’avait affirmé, quand j’étais enfant. J’en avais éprouvé une grande fierté. Plus tard, ma mère, qui n'avait que moi comme garçon, m’appela souvent, dans ses furies d’embrassades : « Mon petit roi ! » Aveuglé de baisers, je me raidissais et je pensais avec orgueil : « Je suis bien plus qu’un petit roi : je suis un petit lion ! »
Jusqu’à quel moment ce sentiment de gloire intime m’a-t-il accompagné ? Sans doute jusqu’au jour où, alors que j’étais comblé, un retournement de mon sort m’a giflé à toute volée. Je me suis effondré, et c’est alors que j’ai découvert la faiblesse qui était enfouie tout au fond de moi, et qui m’a maintenant submergé.
C’est lui qui doit avoir raison : tout cela est venu de ce que j’ai trop admiré les forts, ou, tout au moins, ceux qui veulent paraître tels. Ceux-là vont toujours trop loin. Moi, je m’y suis brisé, au sens propre du mot, en attestent les cicatrices que je porte encore dans ma chair et dans mon esprit. Les vrais forts ce sont les sages. À présent je le sais, même si je crains que ce soit bien tard…
Mais ma pensée n’est déjà plus avec moi, elle a quitté ma chambre d’hôpital, elle a fui mes journées vides de convalescent et mon présent amorphe, elle entre dans mon passé mille fois plus vivant…
SOMMAIRE
Prologue
MARIELLE
YOURI
SACHA
Fig. 1:
Organigramme de la table de roulette
LA MARTINGALE
Fig. 2 :
Les images
Fig. 3 :
Retranscription de coups
Fig. 4 :
Les motifs d’images :
Fig. 5 :
Le tableau oblique
MONTE-CARLO
Les grandes espérances
Fig. 6 :
Le casino de Monte-Carlo dans les années 60
MONTE-CARLO
La descente aux enfers
Fig. 7 :
…à un moment, dans mon vertige
L’ENGRENAGE
LA TRAHISON
L'ŒIL DU CYCLONE
LES BOSSONS
LE DRAME
Épilogue
MARIELLE
1
D’abord des explications fastidieuses, impossible d’y échapper.
Je jure que je ne savais pas qu’elle était riche. Les envieux de Grenoble, les fielleux de la Fac peuvent bien affirmer le contraire, je jure que je ne le savais pas.
Une surboum chez un fils de magistrat. Elle était assise dans un coin, mince, blonde, les yeux gris, jolie et sérieuse, réfléchissant à quoi, au lieu d’imiter les copains qui s’agitaient frénétiquement, en bas et chaussettes, sur le marbre du salon ?
Je suis entré, je l’ai vue seule et je suis allé droit à elle. Uniquement parce qu’elle n’avait pas l’air comme les autres, uniquement, oui, ce n’était pas écrit sur son front qu’elle avait du fric, ou tout au moins que son père en avait !
Je lui ai parlé, je lui ai dit : « Vous ne vous amusez pas ? » Elle m’a répondu : « Pas vraiment ! Pourquoi, c’est obligé ? – Non, mais alors… – Alors, je suis venue voir. – Bon, mais alors… – Alors, je regarde. »
J’étais un peu refroidi, tout en trouvant que c’était logique, ce qu’elle disait. Après tout, ils étaient bien tous des pantins à se désarticuler ainsi, et elle les jugeait. Je m’empressais d’opiner, pour lui faire plaisir. On avait à peine échangé quelques phrases que je savais déjà qu’elle ne mentait jamais, et surtout qu’elle ne se mentait pas à elle-même (je ne savais trop pourquoi, mais je sentais que c’était important). Peut-être sa façon de prononcer, sa diction nette et dure… Elle parlait bien, tout en ne reculant pas devant les mots hardis, elle ne laissait pas tomber les finales, on comprenait tout, malgré le chahut. Je me suis aperçu qu’elle aimait aussi écouter, c’était rare chez les filles que je fréquentais.
Elle était très fine, aussi, trop fine pour moi, elle a dû me mépriser un peu, dès l’abord, et par la suite. Je m’empoisonne assez de le comprendre, à présent que je repasse mon film.
Un peu théoricienne. Elle aimait discuter. Elle avait un pouvoir sur les mots. Moi, j’avais le respect du muscle, de la performance, du défi, j’aimais les copains, les bistrots d’étudiants, tous les endroits où je pouvais ouvrir ma grande gueule. Elle aussi devait les aimer, ces bistrots, car je l’y retrouvais souvent, mais ce n’était pas pareil. Elle y venait pour s’échapper, je crois que ça n’allait pas fort chez elle, une famille à divorces, toute une tribu, divisée par la distance, qui s’entendait mal, des histoires d’héritages, de pensions, de procès, une vraie salade. Mais elle ne parlait presque jamais d’elle, les histoires de famille, je ne les ai apprises que plus tard, et au compte-gouttes. Dès que je me risquais à lui poser une question sur ce chapitre, elle se fermait, elle devenait froide, il me semblait qu’elle n’était plus avec moi, et aussitôt je prenais peur (alors quoi, je l’aimais déjà ?). Quand j’ai su, cette retenue m’a bien étonné. Si j’avais été riche, moi, je l’aurais crié sur la place Grenette, en m’accompagnant d’un tambour et de trompettes !
Deux semaines de longue patience, et je l’ai eue. Elle n’était plus vierge. Mais j’expliquerai tout cela plus tard.
Celle-là oui, je l’ai aimée. Je le crois, du moins. À l’époque je n’en savais trop rien, je ne me posais pas de questions de ce genre. Ce n’est qu’à partir du moment où j’ai commencé à avoir mal que je l’ai ressenti.
Ça s’est passé dans un pré, à mi-montagne, vers Saint-Nizier. Il y avait des boutons d’or de tous les côtés, on était sur un lit de boutons d’or. Un vrai présage ! Avec elle, si j’avais eu moins envie j’aurais été plutôt intimidé. Dès que ça a été fini, elle s’est relevée, a remonté la fermeture éclair de sa jupe, et il y avait tant de dignité dans son absence d’embarras que je me sentais un petit garçon dans mon jean serré à la mode, avec l’envie de me sauver. Et elle, ni agressive, ni gênée, ni désinvolte, au lieu de me dégoûter après, comme les autres, elle m’a plu davantage qu’avant. On est remontés dans sa 2 CV. Elle m’a dit : « Si ça te fait plaisir de conduire… » Je n’aurais pas raté ça, même si je n’avais pas le permis, mais je me suis bien gardé de le lui dire.
Après, dans les débuts, elle m’en disait encore plus que ma mère dix ans avant : « Tu es mon dieu ! Yvan, tu es mon dieu ! » Elle ne croyait à rien, mais elle avait quand même besoin d’un dieu, palpable. J’avais beau penser qu’elle y mettait un peu de littérature, c’était agréable. Je croyais que le petit lion était devenu adulte.
Et je ne comprenais pas que c’était le petit lion, le tout petit, qu’elle aimait, justement, c’est mon psy qui me l’a fait comprendre. Le roi des animaux ? Disons plutôt que j’étais le roi des c..s, oui, c’est ce que je pense de moi aujourd'hui, même si je ne l’écris pas.
Après trois mois de plein air – on était en été, et elle n’avait jamais voulu qu’on aille à l’hôtel, elle disait que l’hôtel c’était réservé à la prostitution et à l’adultère, que dans les prés c’était plus pur, plus naturel, qu’il y avait des fleurs, et moi qui étais trop fauché pour lui en offrir et encore plus pour payer la chambre, je lui répondais : « Je te comprends ! Tu as bien raison ! » – après trois mois, donc, elle m’a annoncé que ça y était. J’avais dû faire mouche la première fois, du côté de Saint-Nizier.
Nous étions dans une surboum – encore ? je ne faisais donc que ça ? On dansait. Nous avons toujours aimé danser ensemble. Minces et souples tous deux, et à peu près de la même taille, elle un peu plus grande, à cause des talons. Elle venait de me dire, l’air soudain fatigué : « Il y a trop de fumée ici, on respire mal, tu ne trouves pas ? » Ces mots à peine articulés, la voilà qui porte la main à sa bouche et qui part en courant vers la salle de bains. Je restais là, stupide, bousculé par les couples… J’ai réalisé au bout de quelques secondes et je suis allé voir. Avant que je pousse la porte, elle s’est trouvée devant moi. Autour de ses lèvres, c’était d’une couleur bizarre.Elle a pris une de mes mains dans les siennes : « Les premiers symptômes, Yvan, mon chéri ! » (elle avait le vocabulaire juste, elle ne savait pas parler sans choisir ses mots). Toute contente – mais comment font-elles pour se réjouir de cette calamité ? Je connaissais le mot du fendant Alexandre Borraz : « Elles sont mieux placées que nous pour comprendre la splendeur de la Création ! Elles ont en elles une pépite d’éternité ! »
Moi je n’apercevais rien de cette splendeur. Tout au contraire, un poids de cent kilos venait de me tomber sur la nuque, j’étais anéanti. Mais la lumière de ses yeux attirait les miens, jamais, depuis, je ne les ai vus s’illuminer de la sorte. Ce devait être contagieux, je me suis senti très content, moi aussi, d’un seul coup, sans comprendre pourquoi ni comment.
Rentré chez moi, je n’en ai pas dormi de la nuit (elle non plus, elle me l’apprit le lendemain). Toute une nuit, c’est long ! Je passais par des phases d’excitation, suivies de découragement. Cette infecte société et toutes les complications qu’elle cultivait, contre laquelle je braillais souvent, dans nos cénacles de bistrots ou d’amphi, avec des trouvailles d’expression que je croyais formidables, il allait falloir que, d’une façon ou d’une autre, je me mette en règle avec elle. Et des phases de révolte, des ruades terribles qui m’asseyaient d’un coup sur mon lit. Et l’argent, où est-ce que je trouverais l’argent pour faire pousser le gosse, puisque le roi des animaux n’était même pas foutu de se nourrir lui-même ?
Quand je l’ai revue, elle, à la Fac, le lendemain, pas très fraîche non plus, tout en la surveillant du coin de l’œil avec une prudence instinctive, j’ai parlé de le faire passer. Elle a bondi : « Tu n’as pas honte ? » Un emportement, une bourrasque, j’en ai reculé d’un pas. J’ai hoché la tête : « Écoute, on est si jeunes ! Et tu crois qu’on pourra continuer à étudier, avec un bébé ? Mariés, bon, il y en a d’autres, ça n’empêche pas, mais ça ?… » Un peu plus tard elle comprenait, oui elle comprenait… Ça se communiquait, comme sa joie de la veille, mais cette fois c’était ma frousse qui l’envahissait.
À cette époque c’était fréquent, on se sentait passer l’un dans l’autre, l’esprit suivait la chair, jamais plus je ne retrouverai cela, avec personne.
Elle s’est appuyée contre le mur, elle était toute blanche, j’ai eu peur, je l’ai prise à la taille pour la soutenir. Nous nous sommes embrassés, je crois qu’elle pleurait, sa joue était mouillée, et moi… moi… je me dégonflais, comme un lion en baudruche, nous étions seuls avec ce fardeau… heureusement ça n’a pas duré, il arrivait du monde, des heureux qui ne connaissaient pas leur bonheur.
Après nous avons été à la bibliothèque, consulter des livres médicaux. Il y avait la quinine, et d’autres médicaments abortifs aux noms plus compliqués. La Suisse aussi, et ça c’était sérieux, mais où trouver le numéraire ? Elle ne me disait toujours pas qu’elle en avait, ou qu’elle pouvait en avoir. Elle voulait garder son gosse, mais pouvais-je le comprendre alors ?
On essaierait les emménagogues, qui étaient en vente libre. On est sortis et on a marché sans rien dire, les yeux perdus. On se sentait seuls, seuls à se mettre à hurler, parce qu’on ne pouvait se confier à personne. Moi qui me fabriquais une renommée avec mes blagues, je n’allais pas me vanter de celle-là ! « Tu aurais quand même pu faire attention ! » a-t-elle murmuré, tout à coup, sans me regarder. Justement cette idée était en train de me tarauder comme un mal de dents. Nous étions pas mal humiliés, surtout moi, honteux comme des gamins qui ont cru pouvoir jouer avec les allumettes, malgré la défense des parents, et ont foutu le feu à l’appartement. Puis l’humiliation montait d’un cran : nous, orgueilleux, car elle était orgueilleuse elle aussi, beaucoup plus sûrement que moi, nous, ambitieux, enragés d’échapper au méprisable sort commun, voilà que l’on commençait comme tout le monde, pis : comme ceux qui n’ont pas de veine: on était déjà des écrasés. Ah, c’était bien fini, je me jurais de ne plus chasser que des femmes mariées !
Avec les emménagogues, on n’est pas allés bien loin. Après la quatrième tentative, on a décidé de renoncer. On s’était donné rendez-vous place Paul Mistral. De loin je lui avais fait signe, comme chaque fois : « Alors ? » et elle avait secoué la tête, tristement. Le petit bout d’être avait la vie dure. Les bras ballants, nous nous sommes vus minuscules devant la montagne du mariage, autant escalader l’Himalaya en espadrilles. La comparaison m’était venue toute seule, on était arrêtés sur la place, on apercevait au loin les Belledonnes formidables qui muraient l’horizon grenoblois. Le désespoir m’a serré à la gorge, et elle aussi, j’ai bien vu son menton qui se défendait contre la grimace. Aux abois, on a décidé, tête baissée : « Quoi, on va se marier, voilà tout ! » Et aussitôt ç’a été comme un lever de soleil. Oui, pourquoi pas, mais pourquoi pas ? Estce que c’était un si grand malheur de se mettre à vivre ensemble ? De ne plus se quitter comme on était obligés de le faire trois ou quatre fois par jour, en se retournant à n’en plus finir ?
Oui, celle-là je l’ai aimée, dès le début elle a dû me toucher en plein cœur. Autrement je l’aurais admirée, et ça m’aurait empêché de l’aimer. Pour moi, les femmes, si je me mets à admirer leur intelligence, c’est manqué, il me semble qu’elles en sont moins femmes.
Elle était très blonde. D’origine polonaise, comme moi. Nous n’avons guère pris garde à ce détail, et pourtant ça explique beaucoup de ce qui s’est passé ensuite. Un peu timbrés, les slaves, ce n’est pas moi qui peux dire non. Quant au désir physique, il n’y avait que l’appétit de mes dix-neuf ans. Je ne la désirais pas plus qu’une autre, le mystère n’était pas là. Sans être grande, elle était longue, avec, pourtant, plein de courbes parfaites. Quand elle était dans notre lit, il m’arrivait de me reculer pour mieux la regarder, avant de me jeter dessus.
Elle, elle n’éprouvait pas grand-chose, mais elle ne déguisait pas, elle ne faisait pas comme d’autres que j’avais connues, qui poussaient des gémissements postiches parce qu’elles avaient honte de ne rien sentir. Elle, je crois que c’était plutôt mon plaisir à moi qui l’intéressait, qui l’attendrissait. Pas encore éveillée, mais vicieuse, j’ai commencé à m’en apercevoir au bout de six mois, et encore, ce n’étaient que des intuitions qui me frôlaient, puis me quittaient, aussi légères qu’un oiseau qui s’envole d’une branche pour se poser sur une autre. Et elle aussi, d’ailleurs, ses velléités de raffinement se dissipaient tout de suite, sans doute parce qu’elle comprenait que je ne les voyais pas. Est-ce que j’ai vu quoi que ce soit, pauvre imbécile qui croyait tout savoir sans avoir rien appris ? Si j’avais su me débarrasser à temps de ma jeunesse ! Borraz qui, à trente ans, se prenait pour un ancêtre, Borraz répétait, à ce qu'on m'avait dit, que la jeunesse pouvait être la plus dangereuse des périodes de la vie, parce que c’était encore celle de l’inconscience, alors qu’on s’était libéré de la tutelle des parents. « Les jeunes sont capables de foutre leur vie en l’air sans s’en apercevoir. » Oh combien ! Moi, je lui aurais ri au nez, si j'avais été à ce moment en face de lui, je lui aurais répondu que sa place était au Muséum d’Histoire Naturelle, et qu’il devrait inscrire dans ses volontés dernières : « Je désire être naturalisé. »
Sensuelle elle l’était, mais pas physiquement. Je soupçonnais que cette sorte de langueur, de mollesse nerveuse des Polonaises, et leur furieux appétit, elle les aurait eus, si elle n’avait pas été une intellectuelle. Chez elle, l’esprit nuisait au corps. Cérébrale, elle ne l’était peut-être pas encore, mais si j’avais été malin, j’aurais compris que ça allait venir.
Étudiante, très étudiante, ah, cela ! Un orgueil intellectuel un peu raide, un peu fabriqué, sous sa féminité corporelle qui rachetait tout. Elle se croyait très forte, beaucoup plus forte que moi, et elle ne se trompait pas. Autrement rien ne serait arrivé. Accoutumé aux numéros le plus souvent à lunettes qu’on côtoyait à la Fac, je trouvais ça bizarre, une pédante qui n’était pas laide. Et pourtant, chez elle, cet orgueil devait quand même être la recherche d’une compensation. Car il y avait quelque chose, et voilà, nous y venons : elle marchait les pieds un peu en dehors, en canard, pour employer cette expression palmipède qui dépeint bien cette particularité-là. Son allure, un peu disgracieuse de ce fait, c’était comme une verrue sur une belle main. Je ne lui en ai jamais parlé, et elle se taisait aussi là-dessus, mais je sentais qu’il y avait une ombre et je comprenais que c’était cela. Une seule fois, j’ai surpris un aveu, oh, presque rien, une phrase un peu en l’air, en apparence, mais j’ai su tout de suite que pour un aveu, c’en était un : « J’ai fait de la danse classique, ça m’a fait du bien pour ma démarche. » Ce jour-là est un des rares où j’ai senti en moi quelque chose de bon : j’ai eu pitié d’elle, et je l’en ai aimée davantage. Nous nous sommes disputés souvent. Jamais, même au fort de la colère, quand on s’envoyait des injures, jamais je ne lui ai jeté ça dans les jambes… sans jeu de mots.
Une consolation amère me vient de cette constatation : il y avait quand même pour moi des limites à ne pas franchir, il y avait quand même quelque chose que je n’avais pas sali. C’était cela, cette paille dans son métal, qui me fixait à elle, oui, à présent je crois que c’était cette chose un peu ridicule qui était à la pointe de mon amour.
2
Les parents, les amis, d’un bout à l’autre de notre horizon, il a fallu faire savoir qu’Elle avait un bébé dans le ventre, l’avouer à certains, et le cacher à d’autres, ce qui était peut-être aussi dur. L’avouer à ceux qui avaient le droit, le pouvoir, plutôt, de nous accabler, et le cacher à ceux qui en auraient ri ou fait semblant de nous plaindre, car qui pouvait nous en féliciter ? Mais ceux-là l’apprenaient on ne savait comment : « T’as tapé dans le mille ? » « Tu fondes une famille ? » « T’as fabriqué un lardon ? » Et ça se répétait. Mais l’explosion était pour plus tard, car la mèche était allumée, et elle semblait interminable. Elle vivait en effet déjà dans la hantise du jour où ça se verrait. Borraz disait que la création d’un être vivant étant une œuvre sublime, la Nature, au lieu de déformer la femme dans la grossesse, devrait plutôt la rendre belle à en crier. De manière à faire envie à toutes. Il précisait ensuite que le vrai message s’adressait aux hommes, pour qu’ils sachent qu’ils devaient passer leur chemin et s’adresser à d’autres.
Un soir, juste avant qu’on se décide enfin à prévenir la famille (on avait si peur qu’on remettait sans cesse), j’ai été renseigné sur sa position sociale par un soi-disant copain, le plus salaud de tous. Il est vrai qu’il avait son motif : il avait été son premier amant.
« Tu t’embêtes pas, mon cochon ! Tu sais renifler la bonne occase !
– Ça te dérange ? En tout cas, moi, je sais les garder !
– C’est pour moi que tu dis ça ? Tu parles comme je m’en fous ! D’abord je t’ai rendu service : c’est moi qui me suis tapé le moins bon côté du boulot !
– Faut que je te remercie, si je comprends bien ?
– Tu peux, je t’ai laissé la bonne affaire.
– Quelle bonne affaire ?
– Fais pas l’ignorant, c’est pas ton genre ! Les hectares d’hévéas, tu vas pas me dire que tu savais pas qu’ils existaient, les hectares d’hévéas ?
– Qu’est–ce que tu racontes ? Quels hévéas, quels hectares ?
– Quand tu lui as tâté les nichons, t’as pas senti qu’ils étaient en caoutchouc ? Eh, farceur ! »
Sur le moment je n’y ai pas cru tout à fait, je me suis dit que si les hectares existaient, ils avaient dû être pas mal multipliés par les trompettes de la renommée. J’ai couru dare-dare au bistrot où j’avais une chance de la trouver. Elle y était. Je l’ai embrassée :
« Tiens, on vient de me donner une leçon de botanique. Je viens d’apprendre l’existence des hévéas. Qu’est-ce que c’est cette plante-là ? Tu la connais, toi ? »
Elle m’a regardé avec des yeux pleins de trouble, et même de crainte, m’a-t-il semblé. J’ai mordu : « Alors, il faut vraiment que ça soit moi qui t’en parle ? »
Elle s’était déjà ressaisie. Elle a paru très mécontente, elle m’aurait engueulé s’il y avait eu le moindre tort de mon côté. Et c’était vrai, oui, le père était quelque part en Amérique du Sud, à veiller sur des milliers d’hectares d’hévéas, à leur faire exsuder des cruzeiros. Ça rapportait gros, à croire que le caoutchouc était indispensable à la survie de l’humanité.
J’étais sidéré en même temps que furieux. Qu’elle ait pu me cacher ça, qu’elle ait eu une pareille force de dissimulation, ça dépassait l’entendement. Comment pouvait-elle aimer quelqu’un en qui elle n’avait pas confiance ? Et pourquoi ? Elle a simplement prétendu qu’elle voulait être sûre de moi.
Il y avait aussi des usines, des entrepôts, des actions, des capitaux dans les banques, tout ça s’est agité dans ma cervelle de fauché comme un tourbillon d’étoiles. J’en aurais pleuré. Je me répétais : C’est pas possible, c’est pas à toi que ça arrive ?
Et c’est ici qu’il me faut bien dire qui je suis.
Mon père, Polonais. Fils de Russe. Foutus dehors de partout et de père en fils par les révolutions et les guerres. Faire leurs valises en pleurant, changer d’hôtel, prendre le train, passer des frontières à la sauvette, la peur au ventre et la main sur la bouche des gosses, ils n’avaient fait que ça, dans la famille. Par-dessus le marché mon père avait fait du terrorisme en Pologne, je n’ai jamais su si c’était contre les Allemands ou contre les Russes, ma mère refusait de s’expliquer là-dessus. Finalement, mon père avait trouvé ce qu’il cherchait : la prison politique. Là-bas, c’était dur. Il n’a pas mis longtemps à en être délivré pour l’éternité. Heureusement, je n’en ai pas souffert car je n’avais alors que deux ans. Quand j’en parlais à ma mère, elle me disait que je n’avais pas aimé mon père, que je ne respectais pas sa mémoire. Il est bien difficile de s’intéresser à ceux qu’on n’a pas connus, surtout quand on sait qu’ils vous ont abandonné pour la satisfaction d’aller planter des bombes. Ceux qui n’ont pas eu à en pâtir les appellent des héros. Moi je pensais qu’il aurait mieux fait de s’intéresser à sa famille. Borraz disait qu’une loi devrait interdire l’héroïsme à ceux qui ont femme et enfants. Sous peine de mort. Il est vrai que celleci se charge de les remettre dans le droit chemin. Ma mère est restée veuve cinq ans, à travailler comme une bête pour que son petit roi ne s’aperçoive de rien. Le travail, ça lui tenait lieu de tout : de divertissement, de bonheur, de pensée, et même d’homme. Elle était modeste par essence, une écrasée d’origine, et de vocation. À cause de cela, souvent je lui en voulais, et quelquefois – rarement – j’en étais attendri. Une maman toute petite et toute maigre, qui voulait pourtant vous faire étudier pour qu’on soit moins malheureux qu’elle, et qui y avait réussi en dépit de tous les obstacles.
Cinq ans après la disparition de mon père, s’est présenté un remplaçant : un ouvrier, modeleur sur bois, encore un modeste. Il a voulu des enfants à lui. Le temps de grandir de quelques centimètres, je me suis retrouvé avec deux petites sœurs.
Je suis quand même entré au lycée, puis à la Fac. Merci de t’être laissé convaincre par ta sainte femme, ô numéro deux qui a disparu à ton tour ! Veuve une seconde fois. Ma mère avait décidément la vocation. Et celle des travaux ingrats. Après dix ans de répit, elle s’est remise au travail, comme au retour de vacances.
Dans ma situation, j’obtenais bourse sur bourse, voilà comment je pouvais être à la Fac. C’était mérité car puis-je ajouter que, quoique inférieur à Elle sur ce point, je m’en tirais plutôt bien ? Dans ce milieu, j’ai eu un peu de mal au début, puis la parade est venue d’elle-même. Quand je me trouvais au milieu de ces gaillards qui roulaient voiture, qui sortaient ostensiblement des billets de mille pour qu’on leur rende la monnaie, j’ouvrais ma grande gueule, je n’osais pas ne pas parler, j’avais peur, autrement, de sentir le fils d’ouvrier, et à ma propre surprise (au début), on m’écoutait. Les parents, les oncles, les tantes – du côté de papa il n’y avait plus personne, ils avaient tous disparu dans les camps et les fusillades –, toute cette cohorte il me semblait que je la traînais derrière moi, tous des naïfs, bourrés de principes, dont celui de la pauvreté digne et honorable n’était pas le moindre.
Pour comble de bonheur, j’étais petit. Comment aurais-je pu m’en tirer, sinon en faisant illusion ? Je n’avais d’ailleurs pas besoin de me pousser beaucoup pour ça, c’était dans ma nature. Gymnastique, piscine, judo, karaté, canulars, bagarres – j’avais compris, je fonçais en faisant celui qui n’avait pas peur des coups, et c’étaient les autres qui avaient peur –, jactance, tout y passait, mais ça ne me donnait pas un père bâtonnier ou sous-préfet.
Le sommet de ma revanche sur ma lignée, c’est quand j’ai concouru pour un prix de beauté plastique. De beauté plastique, oui, avec mon mètre cinquante-six ! Le prix, je l’ai pas eu, bien entendu, j’étais trop petit, mais j’avais quand même franchi toutes les éliminatoires, et j’ai été bien plus fier de cet exploit farfelu que de réussir à mes premiers examens de licence – je préparais une licence de droit, et Elle une licence de lettres.
J’étais donc sorti de moins que peu. J’en avais assez souffert, surtout au lycée Champollion. « La profession de votre père ? » En pleine classe, ils vous demandaient ça ! Ça courait de pupitre en pupitre, j’entendais : « Industriel… médecin… expert-comptable… inspecteur d’académie… ingénieur… banquier… » j’en avais des sueurs, mon tour approchait, rien à faire, c’était à moi. Au lieu de mentir, je me mettais à gueuler : « Ouvrier ! » et tout en faisant le flambard, je sentais sur mes joues, malgré moi, le rouge de la honte. De la façon dont c’était dit, quelques-uns se fendaient la pipe, la tête baissée sur leur cahier. Ça me sauvait la mise. Je crois même que certains, les moins stupides, m’ont admiré. Ça faisait révolutionnaire.
Un temps, j’ai essayé d’en sortir par la politique. Je me suis fait trotskiste. Pas communiste : trotskiste. Ce sont les manuels qui se font communistes. Comme à tous les fauchés, ça m’a fait du bien de haïr. La haine, c’est ce qui ressemble le plus à la force, ça m’a fait illusion pendant quelque temps. On m’a bombardé secrétaire. Malheureusement le contact des huiles du parti m’a rapidement dégoûté : braillard et ambitieux, écœuré j’ai été de me trouver au milieu de plus ambitieux et plus braillards que moi. Et quant aux militants de base, je me rappelle un petit fonctionnaire qui montait à la tribune pour un oui et pour un non et qui ne savait que répéter : « …la classe ou-vriè-ère ! ou …travailleu-lleuses, travailleu-lleurs ! » ce qui déclenchait des tornades d’applaudissements. Trop de cons, pour moi ça n’a pas été longtemps tolérable. Un jour de nausée, je me suis décidé à faire un éclat, je suis monté à la tribune et j’ai dit : « J’aimerais qu’on arrête de vous bourrer le crâne. Vous mobilisez le nom des travailleurs. S’il n’y avait que les ouvriers en fait de travailleurs, il y a longtemps qu’on serait tous morts de misère. Est-ce que vous croyez que le restant du pays fait la sieste ? Alors, au nom de quoi voulez-vous prendre le pouvoir pour vous tout seuls ? Au nom de la liberté ? » On m’a foutu à la porte en me priant de ne plus revenir. J’étais bien content. Le lendemain, je suis passé à l’extrême droite. Sans scrupules, je ne croyais à rien, qu’à mon amusement et à une issue possible. Pour moi, il n’y avait pas de milieu : de gauche, de droite ou du centre, s’ils n’étaient pas des idiots, des opportunistes ou des utopistes, ils ne pouvaient être que des salauds. À l’extrême droite, moi qui avais la religion de la force, j’ai trouvé mes maîtres. J’ai reçu plus de coups que j’ai jamais pu en donner. J’ai lâché alors l’action sociale, pour me retrouver devant mes problèmes personnels.
Quoi, je viens d’écrire tant de mots sur la question de mes origines ? Faut-il que ce sujet me tienne à cœur !
Dès que je l’ai connue, Elle, dès que j’ai constaté que j’avais su la faire mienne, un grand calme m’est venu de ce côté-là. Même avant de savoir qui elle était. Et quand mon inquiétude perçait quand même, elle me rassurait : « Voyons, Yvan, qu’est-ce que ça peut faire ? Ça ne t’empêche pas d’être toi, et c’est toi que j’aime, c’est toi qui m’intéresses, pas les tiens ! »
3
À peu près en même temps que sa connaissance, un peu avant, j’avais fait celle de plusieurs fils de bonne famille, ce qui a pas mal contribué à me faire croire que ça y était, que je sortais par faveur spéciale de la malédiction qui pesait sur la mienne, de famille. Ils formaient une petite équipe, un simple trio, mais bougrement sympathique : André Couvain, Georges Alfandari et Claude de Séréis. André, fin et fragile, une frimousse de fille, Georges, brun au point que c’en était choquant, assez petit, les joues en lune et des yeux de gazelle, un type entre le persan, le caucasien et le juif. Claude, mince et très brun, lui aussi, mais de façon moins dure : le genre espagnol ou portugais, avec une barbe qui lui faisait le bas du visage tout bleu. André préparait une licence de mathématiques, Georges et Claude étaient avec moi à la Fac de Droit. Ils m’avaient adopté avec une facilité surprenante. Un peu poseurs tous trois, mais surtout pour s’amuser. Toujours ensemble. Ils ne faisaient pas cent mètres à pied, quand ils n’avaient pas la voiture de papa, c’était celle de maman, la Porsche rouge de Mme Couvain était notre préférée, on s’y entassait aussi souvent que possible. Grâce à eux, j’avais enfin connu les sports d’hiver, une journée à Saint-Pierre de Chartreuse ou à l’Alpe-d’Huez représentant pour ma mère une impossibilité financière, sans compter l’équipement (qu’ils m’avaient prêté). Deux mois après le jour faste où je les avais connus, j’entrais en possession de mon permis. J’avais considéré ça comme le premier galon à prendre, et je m’y étais mis sans attendre.
Adopté, traité en égal, j’étais voituré chaque jour, ils venaient même me chercher à domicile. Je pense qu’ils m’avaient coopté pour ma grande gueule, et aussi parce que j’étais, je crois, assez bon copain. Assis à l’avant, le nez à la vitre pour qu’on me voie tout au long de mon quartier, les premiers temps j’avoue que ça me grisait ; ma première voiture me semblait encore loin.
Ces amitiés-là, j’ai l’impression qu’elles m’ont servi auprès d’Elle, mais après tout je n’en suis pas si sûr, elle était tellement à part. Ma mère, elle, me désapprouvait : « Qu’est-ce que tu fiches avec ces garçons qui ne sont pas de ton milieu ? Un jour ou l’autre tu en souffriras. »
Quant à l’argent, Alfandari en avait toujours plein les poches : son père, sa mère, son grand-père, ses tantes, toute une sainte famille de richards, il les tapait à part, par correspondance, et ces ruisseaux de mandats faisaient une rivière qui se perdait presque aussitôt dans l’océan des tournées générales et des virées dans les environs, car, la plupart du temps, c’était lui qui régalait. Il le faisait sans ostentation, avec un naturel et une insouciance qui me confondaient, moi qui comptais le premier sou. Son père était consul dans une grande ville voisine, pour le compte d’un pays du Proche-Orient. Le père d’André Couvain était médecin spécialiste. Quant à Claude, sa mère, chirurgien dentiste, était veuve d’un avocat, en mémoire de qui il faisait son droit. Elle s’était récemment remariée avec le comte Dunand de Buivres, qui se contentait, lui, d’être ce qu’il était.
Ce Claude. Je me rappelle la première fois où j’allai chez lui : j’en reçus un choc dans l’estomac : un appartement immense, on n’en finissait plus de traverser des pièces bourrées de tableaux (le comte protégeait et conseillait toute une cour de peintres, aux dires de Claude), de cuivres, de masques, de vases, de statues, un musée… Un énorme couteau damasquiné, que j’avais voulu ouvrir. Du Tolède. Claude disait qu’ils en fabriquaient un comme ça, un mètre cinquante ouvert, pour le plaisir, pour la gageure, tous les cinquante ans. Son beau-père l’avait rapporté d’un de ses voyages. Il était à cran d’arrêt, avec une crémaillère. Pour le refermer je m’y étais mal pris, la lame était revenue trop vite, si je n’avais retiré mes doigts à temps, vous ne liriez pas ces lignes en ce moment. Bien des fois, plus tard, si j’ai supporté sa tutelle despotique, ce doit être à cause de l’impression écrasante que je ressentis ce jour-là.
Ces amis distingués, le jour où le mariage devint officiel, j’éprouvai une basse peur de les perdre, pensant tout d’abord qu’ils pourraient me juger infréquentable. Mais le lendemain, tout devint plus clair. J’étais maintenant, au moins sur le papier, leur égal. Et j’allais pouvoir les recevoir chez moi. Restait cependant une inconnue : l’accueil qu’Elle leur ferait, elle les connaissait de vue, sans plus.
Mais où est-ce que j’en suis ? Le mariage, que je me dépêche de décrire le mariage, au lieu de me perdre dans les méandres. Sinon je n’arriverai jamais à ce qui a suivi. Et ce qui a suivi, c’est précisément ce que je cherche à comprendre, et il me semble, justement, que je commence à entrevoir pourquoi cet homme m’a dit d’écrire ce que j’ai vécu.
4
Le père de Marielle – ça y est, je l’ai lâché, qu’il a été lourd à écrire, ton prénom, ma femme ! –, le père de Marielle et sa seconde épouse ont tout de suite accepté la situation, avec toutes ses conséquences. C’étaient des pragmatiques, comme j’imagine que sont tous ceux qui font de l’argent. Peut-être aussi que l’idée d’avoir tout de suite un petit-fils ou une petite fille était agréable au papa. À savoir s’il en aurait eu jamais avec cette intellectuelle de fille qu’il avait jugée, me dira-t-il en a parte, incapable de concevoir autrement que par distraction ou par surprise.
Chez ma mère, ça ne s’est pas passé sans mal. La discussion, âpre, après avoir commencé par une énumération interminable des sacrifices auxquels elle avait consenti pour que je fasse des études – elle était sûre que je ne les finirais pas –, en passant par d’amères réflexions sur ma manière bien personnelle de lui en témoigner reconnaissance, s’est terminée par ces mots : « Après tout, ça te regarde, fais ce que tu voudras ! Puisque la bêtise est faite… »
Avec le père, ça n’a pas traîné. Délégation était donnée à un sien ami, de passage à Paris. Et pan, un appartement ! Et pan, un mobilier ! Et pan, une nouvelle voiture ! Et pan, une mensualité ! En rafale ! Quand on a de quoi, on sait toujours quoi faire pour être agréable. La démonstration a convaincu ma mère, et elle m’agaçait pas mal à répéter, les mains jointes : « Quelle chance tu as, mon petit ! C’est i-nes-pé-ré ! »
Moi je jubilais aussi, naturellement, et encore plus qu’elle, mais en dedans. Elle, elle voyait mon bonheur. Pour moi ce mot n’avait guère de sens, le bonheur je le respirais comme M. Jourdain faisait de la prose, ce que je voyais c’était le fric ! Et dans les moments où je n’étais pas grisé par le sentiment d’être un nouveau riche, je rigolais doucement, parce que c’était une sacrée gifle aux sacro-saints principes. Fais ce qui est défendu et tu seras récompensé !
Après les bans de la mairie, et ceux que les copains entonnaient en mon honneur dans les bistrots successifs, arriva le Jour de Gloire. La veille, le père munificent avait sauté dans un avion, accompagné de sa seconde femme. Ma mère, mes sœurs, leurs oncles et tantes, mes trois copains Georges, André et Claude, et toute la smala de Marielle, ils nous ont tous emmenés à Vienne, chez Point, pour le repas de notre vie. Il fallait ce restaurant-là, « un des meilleurs du monde ! » disait Alfandari qui s’en mettait jusque-là, il fallait ce restaurant-là au planteur, qui jouait au milliardaire. Nous étions soixante-dix, plus les enfants, qui avaient un menu et une table à part. En tout, quatre-vingt-quatorze.
Aux desserts, le beau-père avait exigé du sommelier toutes les marques de Champagne. Toutes. Toutes les grandes, bien entendu. Et du millésimé. Les bouteilles arrivaient par escouades, ça pétait de toutes parts. De temps en temps je prenais conscience et je me disais : C’est pas possible, tout ça c’est pour toi ! Pressé de prononcer une allocution, moi la grande gueule, je n’ai pas réussi à sortir un mot. Sans doute le Champagne. Par bonheur, ceux qui tentaient de m’écouter n’étaient pas plus frais que moi, à part le beau-père et la belle-mère qui eux tenaient le coup – ils avaient l’habitude ! J’ai appris par Marielle qu’ils en buvaient à tous les repas –, et se sont montrés indulgents. Les choses commençaient bien.
Trop bien !
Le père et la belle-mère sont repartis deux jours après. C’est que leur temps valait cher, pas comme le mien. Je les ai quand même suffisamment vus pour les décrire. Lui, ingénieur, grand, sec, les cheveux en brosse, les sourcils roux. Un nerveux, un impétueux, un casse-cou inspiré. Là-bas il avait réussi, par saccades. Un va-et-vient d’actions, de cruzeiros et d’hévéas, une galopade effrénée vers la fortune.
Un peu fragile, comme sa fille, petite comme elle mais nettement plus ordinaire, la mère de Marielle, qui vivait sur la côte d’Azur, était là aussi. Assez insignifiante, elle se montrait peu, sans doute écrasée par la réussite de son ex-mari et la présence de sa rivale – j’y viens ! Est-ce que je me rappelle son visage seulement ? J’ai compris par la suite qu’elle n’avait pu soutenir longtemps le train d’enfer que lui imposait son mari. Alors, il s’était débarrassé d’elle comme d’une maladie, pour s’associer à une battante, belle femme un peu grosse, grande comme lui, une organisatrice hors pair.
Avant de partir, il m’avait dit : « Mon cher Yvan, ta licence de droit te servira tout juste à devenir clerc de notaire ou surnuméraire aux PTT. Dès que tu auras décroché ton diplôme, fais-moi le plaisir de passer à la Gestion d’Entreprise. Et aussitôt après, vous venez nous rejoindre, je te collerai la direction d’une de mes usines ! » Un oui humble et émerveillé, c’est tout ce que j’avais pu répondre.
Cette proposition ne pouvait être que de pure politesse, c’est ma conviction aujourd’hui. Avec leur expérience, ils avaient forcément flairé le zéro que j’étais.
En somme, ce qui m’arrivait était, en soi, plutôt banal, le changement de situation mis à part. La suite devait l’être beaucoup moins. Mais comment aurais-je pu le pressentir alors ?
5
Mariés, on le fut. Après le coup de feu de la décision, le projet nous avait d’abord paru étrange, presque surréaliste. Surtout à moi. Je m’y étais résolu seulement sous la menace, et je ne sais si, dans le fond, j’ai jamais considéré notre détermination comme tout à fait valable. Une fois la famille mise dans le coup, particulièrement la sienne, la machine était lancée, nous prenant en charge presque malgré nous.
Je voudrais ne pas me rappeler ce que j’éprouvai lors de la nuit de noces, qui pour nous avait perdu toute signification, après une étreinte absurde parce qu’elle était peut-être la centième au lieu d’être la première. L’horreur du vide, le sentiment vertigineux que je n’avais plus rien à faire de ma vie, que j’étais arrivé sans être jamais parti. Tout était devenu légal, légitime et monotone, j’avais vieilli d’un coup. Et à côté de ce désert, une anxiété sournoise, presque informulée : Tout ça, ça n’est pas vraiment toi ! Comment réussiras-tu à sortir de là, combien de temps cela pourra-t-il durer ?
Et aujourd’hui, en y réfléchissant, aujourd’hui où je commence seulement à comprendre, je m’interroge : ma conduite d’après n’a-t-elle pas d’un bout à l’autre et à mon insu été guidée, et même dominée par ce doute sur la réalité de ma nouvelle condition, et sa pérennité ?
Le lendemain, au réveil, la réalité avait repris sa place, j’étais retombé dans l’inconscience quotidienne, dans l’anesthésie bienheureuse.
D’abord, au lieu de l’obscurité de la nuit où il n’y a de visible que l’intérieur de soi, le bleu du matin éclairait Marielle endormie et gracieuse dans le désordre de ses cheveux. De fait, c’était la première nuit que je passais à côté d’elle. M’apparurent ensuite mes meubles tout neufs. J’étais envahi par ce sentiment réconfortant d’être chez moi, chez nous – j’y reviendrai.
Il y avait aussi les hévéas, que j’avais complètement oubliés. De la même façon qu’il n’était pas désagréable de débarquer à New York en n’ayant fait que changer de fauteuil, il était bien intéressant d’être parvenu à la richesse sans avoir eu à faire le trajet dans un wagon à bestiaux. Cette satisfaction assez basse me réconforta pendant plusieurs jours, tout en laissant subsister une ombre indéfinissable. Je ne veux pas me faire meilleur que je ne suis, mais peut-être que je souffrais vaguement du sordide de cette appréciation.
Et puis, je disposais maintenant d’une femme, et des commodités qui allaient avec. Car mes besoins étaient fréquents, et pouvoir les satisfaire chaque fois qu’ils me prenaient et au moment où ils me prenaient, c’était une telle nouveauté qu’elle aurait justifié n’importe quoi – excepté, peut-être, le mariage… Avec ça, Marielle s’était transformée, quelle chose étrange, je ne parvenais pas à m’y habituer. Elle ne collait plus avec cette image d’étudiante que j’avais d’elle, allant et venant parmi les autres, à la Fac, et m’accompagnant en cachette dans les prés. En souvenir, sans doute, elle mettait toujours des fleurs sur la table de nuit, elle avait même acheté des boutons d’or artificiels aux Galeries ! Il est vrai qu’au naturel les pétales tombaient irrésistiblement.
J’ai remué bien d’autres idées, ce jour-là et les suivants. Que tout serait plus clair si je les avais notées ! Mais à cette époque, je vivais comme une machine tourne, sans y penser, réfléchir, pour moi, c’était du temps à vivre perdu.
Pour Marielle, c’était le contraire, je crois. Elle était contente sans ombre, elle devait l’être, car je la sentais toute paisible. Placide. Détendue. Son esprit bien fait aimait les situations nettes. Elle avait désormais un mari, elle allait pouvoir aimer tranquillement, sans craindre le reproche de personne. La stabilité ! Que de fois l’ai-je entendu prononcer ce mot magique ! La stabilité, ça permettait tous les efforts, et donc ça conduisait nécessairement à toutes les réussites. Moi, j’apercevais principalement qu’on devait finir par s’y ennuyer ferme. Je me gardais de le lui dire, car elle aurait réalisé combien, mentalement, elle avait d’années de plus que moi, alors qu’elle n’en avait, sur l’état civil, que quelques semaines.
En fait d’ombre, il y en avait une, cependant. Il y avait la grossesse, et elle a tenu de la place, au sens propre et autrement ! « Une femme grosse, l’expression s’est tellement fondue dans l’usage qu’on ne voit plus à quel point son sens en est littéral. » Voilà sa remarque, un jour ! Oh combien c’était vrai ! Pour elle qui, je l’ai dit, était mince et élancée, ça se voyait encore plus. Alors, quelle déchéance quand elle arrivait à la Fac et qu’elle cherchait, en rentrant l’abdomen, à se faufiler parmi les groupes sans attirer l’attention ! D’autant plus que ses grands airs et ses critiques mordantes lui avaient fait pas mal d’ennemies. M’en aurait-elle voulu pour en être la cause première ? Je ne suis pas loin de le croire. Je me rappelle ce qu’elle m’a répondu, un jour où je lui disais que ça n’était pas une honte : « Bien sûr, toi, tu peux te montrer sans qu’on regarde d’abord ton ventre ! » Et un moment plus tard, d’une voix inquiète : « Savoir si je redeviendrai comme avant !… » La rassurer m’était facile car son état m’inspirait plutôt de la fierté, comme un gage montré à tous, surtout à toutes, qu’il ne me manquait rien.
Et l’appartement ! Les Crésus nous avaient acheté un trois-pièces-cuisine en duplex, avec un escalier en colimaçon. Leur dévolu, ils l’avaient jeté, avec notre accord, sur un immeuble neuf et résolument moderne, style Le Corbusier, avec des piliers, une sorte d’hippopotame sur des pattes de sauterelle. Nous étions au douzième, et nous recevions des paquets de lumière, beaucoup trop de lumière, de tous les côtés. Heureusement, il n’y avait jamais eu pléthore de soleil à Grenoble, où trois rivières ensemble et les résidus des zones industrielles se chargeaient d’entretenir un brouillard quasi-permanent. Les murs du salon étaient peints en bleu et ceux de la chambre en jaune vif. On n’avait pas de tableaux : depuis que j’avais vu ceux du comte de Buivres, j’en voulais de Maîtres, ou rien. Mais Marielle avait tiré un joli parti de quelques potiches, mauves dans la chambre, jaunes dans le salon.
D’abord on a eu un plaisir fou à vivre là-dedans. Marielle ne sortait plus que pour faire les courses et se rendre à la Fac. Moi, je continuais d’aller au bistrot, mais j’écourtais, je rentrais en hâte pour évoluer au milieu de MES meubles, j’ouvrais leurs portes trois, quatre fois de suite, sans nécessité. On marchait sur une surface, on évoluait dans un volume qui étaient à nous, rien qu’à nous. Et on avait un bar, un électrophone, la télévision ! Le soir on n’arrivait pas à se coucher, pour ne pas perdre une heure de tout ce qui était à nous.
Et puis, petit à petit, sournoisement, on s’est lassés, elle comme moi, de cet appartement saugrenu, comme d’un vêtement excentrique, comme d’un bibelot baroque acheté dans un magasin pour touristes, dans le ravissement du premier regard et le dépaysement des vacances. Je retrouve ce sentiment, l’impression de vivre à part, pas comme les autres : on se faisait l’effet d’un couple de démonstrateurs oubliés dans l’Appartement modèle, au Salon de l’Habitat du Futur.
Ça nous embêtait d’autant plus qu’il était à nous, que c’était plus difficile d’en changer. Du moins je l’ai cru, jusqu’au jour où j’ai appris qu’il était au nom du beau-père. Comme les meubles. Je n’avais rien eu à signer, bien sûr, mais je le croyais quand même, je ne savais pas, on n’était jamais passés devant notaire, chez les miens. J’en ai reçu un choc, je n’étais donc pas chez moi ! Elle non plus ! Ça modifie les sentiments vis-à-vis de la famille. Je l’ai écrit au beau-père. C’est elle qui m’a répondu : « Qu’on vous explique : c’était pour vous éviter les impôts ! C’était pour te rendre service, mon petit vieux ! » Aussi étrange que cela puisse paraître, c’est bien comme cela qu’elle m’avait appelé de prime abord. Mais voyons, si c’était vrai, je n’en savais rien non plus. Ma mère n’en avait jamais payés, d’impôts.
Deux jours plus tard, je n’y pensais déjà plus. Adorateur de l’argent, je l’étais, mais il restait pour moi une divinité vague. Passé l’ivresse du premier moment, une saine appréciation de ma situation me portait à considérer que la possession n’était qu’un mot, que l’usage seul était une réalité tangible. Donc pas de souci !
De plus, les beaux-parents, ils étaient vieux, et moi j’étais jeune. Certes, c’est elle qui hériterait – j’étais maintenant renseigné ! –, mais ne réussirais-je pas alors à l’amener où je voudrais, comme je l’avais toujours fait ? Je pouvais donc avoir de solides espérances, notamment, à mes heures cyniques, celle qu’ils seraient victimes de la guérilla, des fièvres, des morsures de serpent, de l’infarctus du myocarde, de la dysenterie ou, plus sûrement, de la cirrhose du foie, bref… les occasions d’avaler prématurément son bulletin de naissance ne devaient pas manquer, là-bas… « Le cynisme, c’est seulement une vision nette des réalités. » disait Borraz.
6
Et Cyril, pas possible, j’oubliais Cyril ! C’est vrai, je m’en souviens à peine. Je ne l’ai pas assez connu. Et comment s’attacher à une sorte de petit animal informe et vagissant, qui ne fait que téter, hurler et faire son petit caca à longueur de journée – et de nuit, hélas ? Les femmes, peut-être, mais nous ?
Cyril est né quatre mois après notre nuit de noces, tout le monde était au courant, la performance n’a étonné personne. À la sortie, il était tout ratatiné et tout rouge, comme un rôti dans ses ficelles, la figure simiesque, grimaçante. Ce doit être une terrible épreuve de venir à la lumière. Et le changement n’était pas de son goût, il gueulait à en perdre son commencement d’haleine, c’était bien là l’unique trait qui pouvait me le faire éventuellement reconnaître comme mon fils. On m’avait prévenu, mais ç’a été quand même un choc. Je l’ai pris dans mes paumes incertaines, ils étaient tous là (sauf le père), je ne pouvais pas faire autrement. La belle-mère, qui devait comprendre, la fine mouche, m’a crié : « Yvan, c’est ton fils ! C’est ton fils, mon petit vieux ! » Je ne le savais que trop, c’était justement ça qui me faisait peur. Avec ça les infirmières qui me regardaient, une étincelle de rigolade au coin de l’œil, me semblait-il. Comme papa, on pouvait facilement trouver plus convaincant que moi. C’est dur de l’être, d’un seul coup, à vingt ans. Ça y était, j’étais définitivement enfermé dans la vie des adultes, jusqu’alors la porte n’était que poussée, à présent le verrou était mis.
Marielle a sevré l’enfant très tôt, un mois après la naissance. Elle craignait que le petit suceur lui fît tomber la poitrine, ce qui se produisit quelque peu. En plus, l’accident lui avait laissé des vergetures, disgrâces qui la mettaient dans une fureur noire, quand une imprudence verbale de ma part les lui rappelait. J’écris : l’accident, et ce n’est pas un mot cynique, Marielle considérait en effet cette maternité comme un accident sur son parcours – pour moi, c’était plus que ça : une catastrophe. Pauvre Cyril, lui n’y était pour rien ! Son attitude avec son bébé était assez étrange. Elle se montrait parfois agressive avec lui, ce qui se traduisait par des négligences, une mauvaise volonté ostentatoire aux soins ; et d’autres fois elle se jetait sur lui et le mangeait de baisers qui devaient lui faire mal. Mais il ne bronchait pas, comme s’il comprenait, alors qu’il nous aurait crevé les tympans au moindre semblant de tape. J’ai fini par comprendre : elle l’aimait quand il lui apparaissait comme un morceau d’elle qui vivait séparément, elle le détestait quand elle voyait en lui un second Yvan ! Ce dédoublement ne se serait sans doute pas produit si ç’avait été une fille.
… Je sors brusquement de mon rêve éveillé. Le médecin est passé. Avant de m’y replonger, je constate que je commence à prendre goût à raconter mon histoire. Au reste, faut-il le rappeler, je n’écris pas : je m’administre un remède, sur ordonnance.
J’insisterai peu sur les joies de la paternité, je ne dirai pas mes crises quand Cyril rugissait pendant une heure, en pleine nuit, avec une vigueur, semblait-il, inépuisable, une méchanceté éclatante et le besoin évident de nous empêcher de dormir, comme s’il nous en voulait d’avoir été contraint de quitter le farniente fœtal. Mais un souvenir précis me saisit. Il fallait faire prendre l’air au petit. Et dans cette ville, ce n’était pas du luxe ! Car elle baignait souvent dans la pollution de ses usines, que sa situation dans la vallée du Grésivaudan, fermée sur deux côtés par les hautes murailles des massifs de la Chartreuse et des Belledonnes, pouvait entretenir pendant plusieurs jours, sinon semaines d’affilée. Marielle y allait, au square. Mais moi, me promener dans les rues en poussant le landau, non merci ! Je n’ai fait qu’une seule tentative, et ce jour-là j’ai été refroidi pour le compte. On était sur le boulevard, on avançait à petits pas, et voilà que j’entends, comme si cela sortait d’un hautparleur : « Ho, Lovniko, on se balade en famille, avec sa bourgeoise ? » Le temps d’avoir chaud au visage et j’ai aperçu deux fielleux de la Fac, m’apostrophant depuis la vitre baissée d’une voiture roulant à notre hauteur. Des passants se sont retournés, tout sourires. Je les ai ignorés, et ils se sont éloignés. Je savais que j’avais l’air idiot, c’était encore plus vexant que de l’être réellement : au moins, alors, on peut ne pas s’en apercevoir.
Pourtant, vis-à-vis d’André, de Claude et de Georges, les seuls relations qui m’intéressaient, ma position s’était sérieusement améliorée. C’étaient maintenant eux qui venaient chez moi – en principe, ils n’allaient pas chez les gens mariés, ils venaient quand même parce que c’était moi. Mon pigeonnier est même devenu très vite le G.Q.G. de l’équipe, on pouvait y veiller, y discuter tout notre soûl, bien mieux que dans la chambre unique de chacun d’eux – et encore, André partageait la sienne avec un frère cadet. Il y avait l’appartement, mais aussi la maîtresse de maison. Dans les débuts, ils en étaient saisis, ils hésitaient à s’asseoir, ils montaient l’escalier, ils regardaient tout, et quand ils redescendaient, ils nous dévisageaient, ils devaient nous trouver bizarres, c’était toujours Yvan et Marielle, mais ça n’était plus ni Marielle ni Yvan. Du coup, ils n’osaient plus la tutoyer, il a fallu que je mette les choses au point. Il faut dire que dans ce milieu effervescent de la Fac, mon mariage avait fait du bruit : le bouche-à-oreille aidant, Marielle passait pour une fille de milliardaire, et moi pour le gendre du roi du caoutchouc. Me sachant pauvre, ils ne comprenaient pas qu’un tel père eût pu accepter un tel gendre. Quelques-uns soupçonnaient que mon mérite n’avait été que celui d’engrosser la fille, les autres m’attribuaient des talents cachés, dans les deux cas, mon prestige n’en était que plus grand.
L’un dans l’autre, à part quelques moments de gloriole intense, il me semble n’avoir pas été tellement heureux pendant cette période, que je ne savais pas être une simple période de transition avant le drame. Je me sentais un peu rejeté du monde, quand, normalement, j’aurais dû éprouver l’impression contraire, celle d’être enfin admis en son sein. Si j’avais travaillé, si j’avais débuté dans une profession quelconque et trempé huit heures par jour dans le bain des adultes, je comprends bien que ça se serait produit. Mais à la Fac et dans les bistrots d’étudiants qui la prolongeaient, c’était le temps des copains. Et le mariage, la paternité, ça ne collait pas ! Et moi je les avais gardés, ces copains, contrairement à beaucoup qui, dit-on, quand ils se mariaient, les perdaient, soit volontairement, par prudence calculée – la tentation est toujours là ! –, soit que la femme y ait mis le holà.
En analysant l’espèce de désarroi de mon bonheur de cette époque, je comprends mieux ses causes complexes et contradictoires. En face de Marielle, au plus secret du repli intérieur, j’avais la crainte qu’elle ne découvrît l’étendue de ma faiblesse. Ferais-je longtemps illusion à ce témoin toujours présent, et son amour serait-il toujours assez fort pour l’empêcher de porter sur moi son redoutable regard critique, comme elle le faisait d’ordinaire avec les autres ? Si un jour, une seule heure, elle me jugeait trop au-dessous d’elle, alors j’étais perdu. C’est tout au moins ce que j’avais cru au début.
En même temps ou par la suite, je ne m’en souviens plus exactement, j’ai soupçonné qu’elle n’était pas dupe de ma jactance, de mes propos de fier-à-bras, et de la poudre aux yeux que je n’avais de cesse de jeter à la ronde, et qui ne pouvaient être pour elle que des signes révélateurs. En fait, il était possible qu’elle m’aimât justement à cause de cette faiblesse, et des efforts désespérés que je faisais pour la cacher. Pour moi, c’était là un sentiment plus perfide encore. Car qu’adviendrait-il alors de mes rêves de domination, de mon idéal de force ? Plus la peine de les poursuivre, dès lors que quelqu’un, ma compagne, m’ayant percé à jour, m’aimerait un peu comme un second Cyril.
Mais assez d’apitoiements sur moi-même. Tout est maintenant en place. Le rideau peut se lever.
YOURI
7
Je dois à mes origines d’être paresseux et d’avoir une sainte horreur de tout ce qui peut présenter une apparence d’obligation et de régularité. Cette répugnance, que Marielle partageait, à un degré moindre, était la cause de levers tardifs qui désorganisaient nos journées.