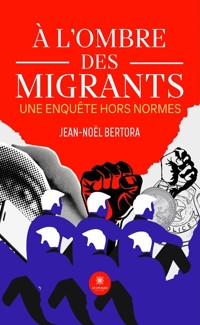
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
À Grande Pinthe, ville du littoral de la Manche, un téléphone retrouvé près d’un camp de migrants fait ressurgir une série de disparitions inexpliquées de jeunes filles. Tandis que les premières responsabilités paraissent établies, les coupables neutralisés, et que l’affaire semble close, des citoyens ordinaires, refusant l’oubli, poursuivent leur quête de vérité. Leur persévérance met au jour des révélations troublantes, forçant la justice à rouvrir les enquêtes. La vérité, longtemps enfouie, éclatera dans un dénouement aussi inattendu que tragique.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Curieux et engagé, Jean-Noël Bertora aime explorer les rouages de notre société à travers la fiction. Fort d’un parcours riche et d’un esprit critique affirmé, il considère le doute comme une démarche essentielle d’intelligence. Amateur de science-fiction et de politique, il a publié plusieurs romans mêlant anticipation, réflexion et imagination.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 528
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jean-Noël Bertora
À l’ombre des migrants
Une enquête hors normes
Roman
© Lys Bleu Éditions – Jean-Noël Bertora
ISBN : 979-10-422-8373-5
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
À Brigitte, mon épouse
Partie I
Alain Norek était las, fatigué, harassé, ankylosé, courbatu. Assis dans sa vieille Peugeot depuis six heures ce matin, sa montre indiquait 8 h 45. Personne n’était encore sorti de la maison bourgeoise qu’il surveillait. Qu’elle était dure la vie d’un détective désargenté ! Quelle déchéance pour un ancien policier émérite que de se retrouver à rechercher un flagrant délit d’adultère ! Dix ans après, Alain se demandait encore parfois, ce qui avait pu le décider, après la mort accidentelle de ses parents, à démissionner pour venir occuper la maison familiale dans cette ville côtière du nord de la France. Déjà paupérisée à son arrivée, la situation de cette cité se détériorait année après année. Désindustrialisation, chômage de masse, pauvreté économique, sociale et récemment, des flux migratoires qui venaient se briser sur les côtes de la Manche. Des êtres encore plus pauvres, plus malheureux que les autochtones, s’échouaient sur les grèves et sur les trottoirs de la ville de Grande Pinthe.
Sa licence de détective privé lui permettait de survivre dans ce désert social. Sa clientèle, celle qui pouvait s’offrir ses services, se recrutait chez les édiles, chez les quelques encore riches propriétaires, commerçants, ou chefs d’entreprises. Tout ce beau monde exploitait sans vergogne la populace composée de travailleurs précaires et aussi de quelques migrants ayant obtenu, par miracle, un titre de séjour temporaire. Comme Goran Devken, un Kurde, employé dans une entreprise de maçonnerie, pour lequel, son patron lui avait commandé une enquête pour pouvoir le licencier pour faute.
Que du bonheur !
En attendant, l’épouse infidèle de la grande boucherie du centre-ville ne sortait toujours pas de la maison de son amant. S’il parvenait à prendre des photos montrant madame la bouchère embrassant, sur le pas de la porte, monsieur l’architecte, peut-être qu’il pourrait alors percevoir les trois cents euros promis par le cocu désemparé.
Que du bonheur !
La porte s’ouvrit, Alain, surpris, empoigna précipitamment son appareil photo posé sur le siège passager, qui s’échappa de sa main engourdie par le froid. Il se pencha pour reprendre l’appareil, se releva pour voir la bouchère s’engouffrer dans sa voiture et partir, laissant s’envoler des billets de cent euros dans un souffle de gaz d’échappement. Bon, se dit Alain, il me reste encore un peu de monnaie pour aller boire un café avant d’explorer le Kurdistan.
Sur le trajet de retour vers le centre-ville, en faisant le point sur ses maigres finances, la question revint de savoir s’il n’allait pas devoir vendre la maison de ses parents. Ce serait un crève-cœur, mais s’il ne trouvait pas rapidement des recettes dans son activité, alors il devrait s’y résoudre. De plus, le marché immobilier national, en berne avec l’inflation galopante, se décomposait encore plus à Grande Pinthe. Qui voudrait et surtout qui pouvait acheter une maison ici, au milieu de cette déshérence ? Alors, ce n’était pas gagné !
Devant une tasse de café vide depuis longtemps, Alain relisait les quelques notes déjà relevées sur la situation de Goran Devken. Marié avec deux enfants, il habitait un préfabriqué installé dans une zone qui n’avait plus d’activité que le nom tant les industriels avaient depuis longtemps déserté la région. Aussi, dans des espaces laissés libres, la municipalité avait-elle aménagé d’anciens locaux professionnels en logements provisoires, dans l’attente de constructions d’habitats sociaux, toujours pas à l’ordre du jour du conseil municipal.
Au bout de cette zone, longeant la route d’accès à l’autoroute reliant la capitale régionale au terminal ferroviaire du tunnel sous la manche, s’étendait un bidonville fait de baraques, de constructions précaires, branlantes, voire de tentes, où s’entassaient des migrants, en majorité des Kurdes et des Afghans. Goran Devken s’y rendait souvent, pour apporter des vivres ou d’autres effets de première nécessité à ses compatriotes.
Toutes les observations d’Alain montraient un homme courageux, entièrement dévoué à sa famille, mais également préoccupé du malheur des autres au point de travailler encore plus pour aider plus pauvre que lui. Et c’était cela d’ailleurs que lui reprochait son patron : travailler au noir en dehors de ses heures rémunérées, en utilisant les outils de travail de l’entreprise. Alain devait constater ces activités illicites afin de motiver son licenciement. Non, décidément, c’était trop ! Alain décida de s’assurer de la réalité de ses premières observations. Si elles se confirmaient, le patron irait se faire voir ailleurs, chez les Grecs, les Afghans, mais pas chez les Kurdes. Il jeta quelques pièces sur la table en bois, sortit sans un mot pour rejoindre sa voiture, courbé sous la pluie froide d’un hiver naissant.
Les essuie-glaces, hors d’âge, peinaient à ôter la pluie de son champ de vision, tout en faisant un bruit de frottement crispant. Alain s’approchait du quartier anciennement nommé la ZI du Dyck où résidaient Goran et sa famille. Son GPS lui fit prendre une rue sur la gauche tout en lui indiquant qu’il se trouvait à une minute de sa destination. Il poursuivit jusqu’à voir le logement de Goran Devken et se gara sur une place de stationnement le long de la rue. Une recherche sur internet lui avait permis de trouver son numéro de portable. Il composa le numéro, estimant qu’un entretien téléphonique serait moins stressant pour un premier contact.
Sans répondre, après un court silence, Golan raccrocha sur un laconique « À ce soir ».
Fermant son téléphone, Alain Norek se dit qu’il avait tout le temps de rentrer prendre une douche, grignoter un en-cas, faire un mot croisé et pourquoi pas, ensuite, aller à la bibliothèque municipale en attendant 17 heures. Une journée peu exaltante, mais qui préserverait ses derniers euros. Ce serait bien utile après l’échec du constat d’adultère et avant ce qu’il allait sans doute décider concernant la mission Kurdistan.
Quand la porte s’ouvrit, Alain fut surpris. Il s’attendait à voir Goran, alors que se tenait devant lui, une femme vêtue d’une longue robe, ses longs cheveux bruns bouclés sur les épaules, un grand sourire sur son visage rond, des yeux vert brillant lui conféraient une prestance de reine. Sa surprise devait se voir, car, son sourire s’agrandit en lui disant :
Ce fut tout ce qu’Alain put dire, tant cette femme l’impressionnait. Il s’en voulait d’avoir été influencé par d’imbéciles préjugés sur les femmes orientales. Non, elle n’était pas soumise, cloîtrée au fond de la cuisine, emprisonnée dans un tchador. Elle pouvait recevoir chez elle un homme, un inconnu sans frayeur et sans complexe. C’était lui qui du coup en avait des complexes.
Une table, quatre chaises, un petit meuble bas sur lequel se posait un vieux téléviseur, un coin cuisine, un évier, un frigidaire, une plaque de cuisson, des étagères. Sans le vouloir, tout en buvant son thé, Alain venait de faire l’inventaire de l’unique pièce à vivre du logement. Sous le regard perçant de la femme assise à la table en face de lui, Alain se sentit rougir.
Deux enfants d’une dizaine d’années le précédaient. Ils se figèrent à l’entrée de la pièce en apercevant un homme assis à leur table ; un garçon et une fillette, plus jeune, leur cartable sur le dos, comme de bons écoliers, mais dans leurs yeux se lisait une grande frayeur.
Les deux enfants hochèrent la tête, trop intimidés pour répondre.
Sans un mot, sans une protestation, les deux enfants obéirent.
Il était plus de vingt-deux heures lorsque Alain quitta le domicile de Goran. Il n’en revenait pas de s’être impliqué autant. Un sourire ne quittait plus sa face rougie par le froid nocturne. L’impression de quitter la monotonie atone de son quotidien pour quelque chose qu’il n’osait nommer, mais qui faisait un bien fou à son ego perdu. Cette famille qu’il connaissait depuis quelques heures seulement lui paraissait avoir toujours été présente. Elle devenait son univers. Il avait partagé leur repas du soir. Une fois les enfants couchés après avoir mangé, Goran, Ezma, et lui autour d’une ashreshteh, une soupe de légumes et de vermicelles, discutèrent, commentèrent ses suggestions, parfois en doutant de leur faisabilité, parfois en riant aux éclats, parfois les larmes aux yeux. Ils refusèrent d’abord, non, pourquoi ? Puis oui, pourquoi pas ? Oh merci, oh Alain, trop, Alain trop, comment dire merci sans être à mille lieues de ce que l’on devrait vous dire. Et, c’est en trinquant avec un verre d’alcool que les choses furent acceptées et actées. Toute la famille déménagera dans la maison d’Alain.
Goran récupérera tous les outils qui prenaient la poussière dans l’atelier au fond de son jardin et utilisera ce même atelier pour ses préparations de chantiers. La maison familiale d’Alain était grande, plus de 150 m² sur deux étages. Il y aurait de la place pour y loger une famille de Kurdes au 2e étage accessible par une entrée particulière sur l’arrière. Alain installera des compteurs pour l’électricité et le gaz, qui seront les seules contributions de la famille, pas question de faire payer un loyer. Il faudrait seulement que Goran aménage une cuisine. Les travaux seront prévus la semaine prochaine et l’emménagement dans une quinzaine de jours. Alain riait tout seul au volant de sa vieille Peugeot en imaginant la tête du patron xénophobe quand il lui annoncera que son employé kurde était irréprochable.
Putain que ça faisait du bien ! Que du bonheur… !
Ce sondage, commandé par une grande marque de véhicules automobiles, n’en finissait pas de barber Annie Galiènne. Elle devait poser toujours les mêmes questions à des personnes tirées au hasard dans des répertoires téléphoniques informatisés, mis à sa disposition par l’institut de sondages pour lequel elle travaillait. La liste des questions sur un document écrit en braille reposait à côté de son ordinateur. Elle les énonçait à l’interlocuteur, les réponses et leurs échanges s’enregistraient automatiquement. En fin de matinée, elle clôturait son travail en appuyant sur une touche du clavier qui commandait la transmission du fichier à l’institut.
Annie Galiènne, aveugle de naissance, se contentait de cet emploi à mi-temps qui ne la sublimait pas, mais qui occupait ses matinées. Parfois, les thèmes des sondages se révélaient plus intéressants, comme celui, récemment, sur l’adaptation au changement climatique des familles dans leur vie quotidienne. D’autres, par moment, furent aussi dignes de son intérêt, mais le plus grand nombre touchait plus particulièrement les habitudes de consommations. Toute une matinée consacrée aux margarines, aux téléphones portables ou aux eaux minérales gazeuses, ne générait pas particulièrement un engouement à sauter au plafond. Mais, bon, son handicap ne lui offrait pas beaucoup de choix. Déjà, cet institut de sondages avait bien accepté de la recruter en lui donnant des outils adaptés.
Depuis dix ans quelle questionnait la population, elle commençait à saturer. Il faudrait qu’elle songe à étudier d’autres possibilités de travail. Son appartement de trois pièces dans un immeuble HLM de la périphérie de la cité était parfaitement adapté pour elle. Une pièce salon-salle à manger, une cuisine séparée, une chambre, une salle de bain, tout son univers en quelques dizaines de m² lui apportait confort et sécurité. Elle y était bien. Surtout qu’elle bénéficiait de la part des services sociaux de la commune et du département d’une aide permanente à domicile. Et pas n’importe laquelle puisqu’il s’agissait de Pierrick Laurent, là tout près. Il occupait un studio sur le même palier en face de son appartement.
Ah Pierrick ! Un colosse, plus de cent vingt kilos de chair et de muscles sur un châssis de presque deux mètres, lui était entièrement dévoué. Pierrick lui vouait une adoration sans limite, qui la gênait parfois, mais pas souvent. Il l’assistait en permanence, la protégeait de tout. Avec lui, elle trouvait ce qui lui avait manqué depuis sa naissance, la présence d’un proche, d’une amitié sans faille, désintéressée, honnête et chaleureuse. Abandonnée à quelques mois d’existence, confiée aux services de la DASS, de familles d’accueil en familles d’accueil toutes empressées de la faire partir, elle venait, depuis que Pierrick s’occupait d’elle, de trouver son ancrage.
Annie Galiènne aurait pu être pleinement heureuse si elle n’avait pas eu ce don qui la mettait aux contacts des misères du monde. Elle était ce que d’aucuns appelaient un médium, ou une extralucide. Elle pouvait sentir les émotions, les préoccupations, les stress, en posant ses mains sur celles d’une autre personne. Elle percevait également les émanations de quelqu’un ayant séjourné dans une pièce. Elle ne prédisait pas l’avenir, mais l’ensemble de ses perceptions lui conférait la capacité de conseils dont la justesse se révélait idoine neuf fois sur dix. Alors sa clientèle était nombreuse et fidèle.
Dès quinze heures, jusqu’à parfois vingt heures, elle se consacrait aux séances de prémonitions. C’était Pierrick qui en organisait toute la logistique. Il établissait les rendez-vous, percevait l’argent pour ceux qu’Annie faisait payer, assurait la sécurité des entrevues en y assistant, sans être vu depuis la petite cuisine. Son physique était en soi un gage de sécurité. Cependant, Annie savait que cela le gênait. Pierrick était agoraphobe, enfin pas entièrement, mais la multitude l’angoissait. Il ne parlait presque pas. Il ne répondait pratiquement jamais aux questions qu’on lui posait, enfin sauf avec elle. Ce mutisme le rejetait de fait, en faisait, aux yeux des autres, un être simplet, sujet de moqueries. Mais, derrière cette façade d’absence, se cachait une personnalité complexe. Pierrick possédait une mémoire exceptionnelle, une maîtrise des chiffres, des calculs les plus compliqués. Mais rien ne sortait de cette carcasse, sauf quand Annie le sollicitait. Elle était la seule à pouvoir communiquer avec lui. Jamais il n’y eut entre eux la moindre équivoque. Pierrick l’aimait d’un amour platonique. Elle avait, envers lui, un amour filial. Cela faisait plus de dix ans qu’ils s’étaient trouvés et aucun des deux n’imaginait pouvoir vivre autrement. Deux brefs coups de sonnette annoncèrent la venue de Pierrick. Il était d’une précision diabolique dans la gestion du temps. Cela ne faisait qu’une minute qu’elle venait d’envoyer le fichier d’interrogatoire à l’institut.
Annie savait qu’il souriait en se dirigeant vers la cuisine. Elle sentait les effluves de son bonheur traverser la pièce. Leur repas terminé, les plats, assiettes, couverts lavés et rangés dans les placards de la cuisine, Pierrick installa les chaises pour recevoir les clients de l’après-midi, tout simplement l’une en face de l’autre, de part et d’autre de la table, avec un espace calculé pour qu’Annie puisse, sans trop d’efforts, poser ses mains sur celles de la personne reçue.
C’était son bonheur à elle qui colorait l’atmosphère de la pièce à présent.
Sans avoir encore posé ses mains, Annie percevait la détresse, l’angoisse chez l’homme assis tout prêt d’elle.
Ce n’était pas qu’un manque de confiance qu’Annie percevait chez cet homme. Il y avait une fragilité ancienne, une blessure, un traumatisme puissant qui phagocytait sa personnalité. Elle se concentra encore plus… C’était, oh ! Mon Dieu.
Il se leva brusquement, renversant la chaise avec fracas et s’enfuit en courant.
La journée se termina plus sereinement. Ses derniers clients étaient des habitués. Elle les connaissait par cœur. Il revenait toujours, car la vie était dure pour eux et Annie savait exactement ce qu’il fallait leur dire, pour qu’ils soient, non pas plus heureux, non, mais plus eux-mêmes. Annie rendait leur personne plus lumineuse, plus présente, plus repérable dans la grande confusion de la société actuelle. Ils arrivaient tristes, inquiets, ils repartaient confiants en eux. Certains réussissaient à vivre mieux, à prendre les bonnes décisions, d’autres retombaient trop rapidement et revenaient la voir. Ceux-là ne la payaient plus. On ne pouvait rien lui cacher. Son don était trop puissant. Ceux qui avaient voulu la duper le regrettaient très rapidement. Et si Pierrick devait sortir de la cuisine, alors, les esprits se calmaient aussitôt. Seulement, Annie se préoccupait de l’augmentation de sa notoriété. On venait la voir de plus en plus loin et elle craignait de ne plus pouvoir assurer tous ces entretiens. Elle se fatiguait, elle n’avait plus vingt ans. Mais elle ne trouvait pas de solution à ce problème. Alors elle continuait.
Ce lundi matin, Alexandre Loiseau patientait sur le quai de la gare de Grande Pinthe, dans le froid et le vent. Son parka, remonté jusqu’au menton, côtoyait l’agacement qui commençait à lui prendre la gorge. Voilà près de trente minutes que le TER en provenance de la capitale régionale avait été annoncé avec un retard prévu de dix minutes. L’estimation ne devait pas être leur fort à la SNCF. En ce tout début de semaine, une nouvelle collègue devait arriver au commissariat et c’était lui, Alexandre Loiseau, l’inspecteur le plus ancien, qui allait avoir la charge, non seulement de l’accueillir, mais également, et surtout, de faire équipe avec elle. Vingt-cinq ans, sa nouvelle équipière avait vingt-cinq ans, il en avait le double. Misère de misère !
Le train entrait enfin en gare. Peu de passagers en sortirent, en majorité des jeunes, élèves, apprentis venant rejoindre les quelques établissements d’enseignement de la ville. Les flux importants allaient surtout dans l’autre sens, vers la capitale régionale, là où se situait la majorité des activités, des emplois. D’une voiture située en tête de train, Alexandre Loiseau aperçut, un petit bout de femme, chargée d’une énorme valise et d’un gros sac à dos. Il lui fit un signe de la main. Elle accéléra le pas et avec un grand sourire, posa sa valise, lui tendit la main.
La voiture, garée en double file avec le logo « POLICE » bien en vue, alors que des places de stationnement étaient libres juste à côté, fit soulever un sourcil à Sonia Fronce.
Une fois installés dans la voiture, en route vers le centre-ville, Sonia Fronce ne put s’empêcher de jeter des regards vers son collègue. Pas très grand, un mètre soixante-dix à peine, même un peu moins, légèrement ventripotent, enfin un plus qu’un peu, une petite moustache complétait une calvitie naissante, la cinquantaine bien tassée sans doute.
Le planton, en les voyant rentrer dans le commissariat, en rigolant, apostropha Alexandre Loiseau :
Dans le hall d’accueil, étroit et sombre, quelques quidams assis ou debout patientaient devant le gardien préposé aux enregistrements, protégé par une vitre en plexiglas. Il fit un signe de tête à leur encontre, trop occupé pour leur adresser une parole.
Effectivement, la pièce était petite. Deux vieux bureaux métalliques se faisaient face au centre du local, deux chaises en bois, sans doute issues du rebut d’une cantine scolaire, en guise de fauteuil, deux autres pour recevoir les personnes interrogées. Accolées au mur, deux armoires métalliques brinquebalantes complétaient le mobilier. Sur les bureaux, un ordinateur, un téléphone, à peine visibles sur celui d’Alex sous une avalanche de papiers, de classeurs, de chemises diverses. Sur le sien, un post-it jaune sur l’écran avec le mot « bienvenue » écrit d’une main malhabile.
L’entrevue avec le commissaire fut brève. Il parut à peine concerné par la venue d’une nouvelle collègue. Une fois les questions d’usage posées, ses remerciements prirent la forme d’un congédiement.
Une semaine, cela faisait une semaine que Sonia Fronce côtoyait ses collègues de la brigade d’investigation et de recherche. Outre son coéquipier, il y avait trois lieutenants, un capitaine, un major, deux brigadiers-chefs et deux brigadiers, tous OPJ, bien évidemment. Cette semaine d’observation passa à toute allure. Elle n’eut le temps que de parcourir, dans une grande diagonale, les dossiers archivés d’enquêtes résolues et de sortir pour prendre la mesure de la ville, de son environnement. Les équipes de sécurisation étaient fortement sollicitées par la présence du camp de migrants. Les violences y étaient quotidiennes, à l’intérieur du camp et même à l’extérieur. Parfois, comme aujourd’hui, les équipes d’investigation étaient appelées en renfort pour surveiller les abords du camp. Sonia et Alex, sans enquête en charge, étaient de la partie.
À un peu plus de cent mètres, juste devant eux, les agents en tenue d’émeute tentaient de repousser une foule hétéroclite en colère. Les bruits assourdissants de cris hurlés, d’avertissements par haut-parleur, saturaient l’atmosphère. Puis, se firent entendre les premières détonations de grenades lacrymogènes, les fumées, les cris à présent de panique, les ruées de la foule pour se sauver des nuages toxiques.
Tout en parlant, ils marchaient le long de la route, longeant un rebord en terre devant un petit fossé.
Alors qu’ils opéraient un demi-tour, Sonia aperçut un objet luisant dans l’herbe sur le côté.
Alors qu’elle se penchait pour le ramasser. Alex lui prit le bras.
La tension diminuait dans le camp. Les bruits s’atténuaient. Le retour au calme se précisait. Un appel radio les avertit qu’ils pouvaient partir.
La journée se terminait, trop tard, pour retourner au commissariat. Alors qu’ils réintégraient leur véhicule, une vieille Peugeot bleue avec un homme au volant les croisa.
Alain Norek rentrait chez lui après avoir passé une journée de… brin… comme on dit par ici. Couverte par le tumulte venant du camp des migrants, l’atmosphère, jusque dans le centre-ville, fut électrique une bonne partie de la journée. Alors qu’il devait discrètement surveiller les dépôts de déchets sauvages en bordure du littoral, la proximité de l’émeute dans le camp avait fortement obéré ses possibilités. Les divers professionnels, qui se déchargeaient d’une partie de leurs déchets toxiques dans les terrains vagues situés entre le petit fleuve La Marpe et les dunes, devaient avoir renoncé à le faire ce jour d’émeute et de violence. Il était donc resté toute la journée, caché derrière des buissons d’oyats, dans le sable froid et humide, pour rien. Mais, la communauté de communes, en charge de la gestion des déchets, le rémunérait pour dix journées de surveillance.
Comme il avait perçu que le calme revenait, il avait décidé, pour rejoindre la ville, de couper au plus court en empruntant la route passant devant le camp. La police était encore présente, il aperçut sur le bord de la route, l’inspecteur Loiseau et une jeune policière qu’il ne connaissait pas. « Au moins lui, il avait de la compagnie, et agréable en plus. Je n’aurais pas dû démissionner », se dit-il en souriant.
En poussant le portail de sa maison, il vit Ezma dans le jardin, occupée à enlever les mauvaises herbes de l’allée.
La présence de Goran et de sa famille dans sa maison c’était un vrai bonheur. Alain revivait. Et là, aller chercher des enfants à l’école était une vraie bénédiction. Toutes les petites misères de cette triste journée s’envolèrent. Heureux, Alain était heureux. Lui, le vieux célibataire endurci, solitaire, jusqu’alors enfermé dans une vie sans surprise, mais sans grand intérêt, ouvrait des volets, des regards sur un fourmillement de vies nouvelles. Certes, c’était en quelque sorte par procuration, mais plus qu’un observateur, il se sentait intégré dans cette famille. Il espérait qu’il ne se leurrait pas. Que Goran, Ezma le voyaient aussi comme un plus dans leur intimité et non seulement comme le bon propriétaire des lieux. Les enfants, eux, timides, un peu craintifs au début, étaient à présent complètement libérés avec lui. Il jouait aux échecs avec Akam, un garçon vif, intelligent, toujours souriant. Adar, la petite fille de neuf ans aussi douce qu’espiègle parfois, venait souvent lui demander de lui lire des passages de lecture. L’apprentissage du français se révélait parfois difficile. Il arriva devant l’école juste au moment de la sortie des élèves. Deux bolides bruns, crépus, bruyants, bondirent et jaillirent à l’intérieur de la voiture.
Les éclats de rire occultèrent le ronflement du moteur asthmatique de la vieille Peugeot.
La soirée était déjà bien avancée. Les deux enfants couchés, Goran et Ezma tenaient compagnie à Alain au rez-de-chaussée, dans ses appartements.
Autour d’un café et d’un digestif, ils revenaient sur les évènements de la journée.
L’homme qui sortait de l’appartement d’Annie Galiènne semblait émerger d’un bain de vapeur. Le visage rouge, des gouttes de sueur perlaient de son front, la démarche hésitante, tous les aspects extérieurs d’un malaise accompagnaient sa silhouette. Pourtant, ses yeux reflétaient calme et sérénité, que ne contredisait pas une esquisse de sourire sous sa moustache poivre et sel. Il venait d’avoir sa troisième séance depuis celle où il s’était enfui, paniqué de s’être vu percé à jour au plus profond de son intimité refoulée, enfouie sous des années de déni. C’était encore difficile. Il souffrait de revivre les agressions subies, mais, ensuite, Annie le reprenait en main. Elle s’immisçait dans son traumatisme, faisait sienne sa souffrance, l’éloignait de son souvenir, sans toutefois le supprimer. Il devenait le spectateur de ses propres agressions sexuelles subies. Il ne les refoulait plus, il les regardait comme une réalité, mais comme une réalité du passé. Annie, ensuite, le faisait remonter dans le véhicule de sa vie actuelle, lui redonnait le volant et il arrivait à lui faire part, timidement, de la direction qu’il souhaitait prendre. Il la quittait épuisé, mais confiant en lui-même. Son entretien d’embauche avait été concluant. Il travaillait chez Amazon depuis quinze jours. Il portait, rangeait, soulevait, des milliers de colis pendant huit heures d’affilée. Le salaire écrit dans son contrat en CDD se montait à mille euros nets. Dans son quartier, on le regardait à présent avec envie. Il avait trouvé un travail ! Mais tout cela grâce à cette femme exceptionnelle.
Pauvre femme, se disait Annie. Venir de si loin, réussir à surmonter tant de dangers, pour finir dans un bidonville. Et comme si ce n’était pas suffisant, perdre son mari, noyé dans la Manche. Pour des cas comme celui-là, elle n’était pas d’un grand secours. Son flux empathique ne pouvait pas supporter complètement une telle désolation. Elle ne put que compatir à sa souffrance, lui transmettre des ondes chaleureuses de soutien. Quoiqu’insuffisant, cela permit toutefois de lui donner un peu de forces, juste un peu pour ne pas sombrer.
La personne de l’association d’aide aux migrants qui l’accompagnait lui sourit.
Une vague de découragement submergea le flux d’Annie. Elle s’immisça dans ses plus récents souvenirs. Des images de violences, de colères, de blessures, de cris, de douleurs que vint supplanter une terrible résignation, une morne fatigue désespérée. Elle dut fouiller dans cet océan de malheurs, pour y chercher ce qui motivait encore cette personne, pour que sa volonté revienne surnager le flot jusqu’alors ininterrompu de fatalisme subi. Elle ne lui redonnait pas de l’espoir, ce serait vain, mais simplement la conscience de son existence, de son dévouement, de son aura qui illuminait les ténèbres d’une société perdue dans un individualisme mortifère.
De chaudes larmes baignaient son visage quand elle passa la porte du petit appartement d’Annie, sous le regard empathique d’un colosse muet.
Alexandre Loiseau regardait avec plaisir sa nouvelle collègue trôner au milieu des inspecteurs de la brigade de recherches. Tous, ils étaient tous tombés sous son charme, fait de gaieté, d’humour, de simplicité, mais aussi d’un professionnalisme qui pointait sous une désarmante et feinte naïveté. Elle venait d’apporter la fraîcheur d’une sincérité joviale et, depuis, la lumière semblait plus forte dans les bureaux défraîchis du deuxième étage. À l’instant, elle voulait leur montrer comment améliorer le café du distributeur.
À ce moment de son discours, elle donna un violent coup de pied au distributeur en l’invectivant, puis d’un geste brusque elle arracha la prise électrique. On entendit presque le râle de fin de vie de la machine obsolète. Et, d’un geste solennel, elle retira de dessous son bureau, une cafetière expresso…
Le vacarme des vivats qui suivit ébranla les murs du commissariat, fit trembler de stupeur les prévenus menottés dans leurs cellules, provoqua une arythmie cardiaque au commissaire qui s’assoupissait.
Une fois tout ce beau monde calmé, avec une tasse de bon café en main, Sonia revint s’asseoir à son bureau.
Puis, chacun se plongea dans les affaires en cours. Pour Alexandre et Sonia, il s’agissait d’un dépôt de plainte pour violence conjugale. Au bout de la troisième main courante, le policier de service avait réussi à convaincre la victime de porter plainte et le substitut du procureur venait de donner l’ordre de poursuivre. Rien de plus banal, malheureusement et l’affaire serait résolue rapidement.
Dans la voiture, sur le trajet, alors qu’ils sortaient du centre-ville, Sonia repensa au téléphone trouvé près du camp des migrants.
L’homme qu’ils rencontrèrent ne correspondait absolument pas à ce qu’ils avaient pensé. Un homme, dans la force d’une quarantaine entretenue, les avait reçus dans un appartement propre et rangé. À l’exposé de la plainte contre lui par son épouse, il se défendit en dénonçant sa mythomanie. Sonia lui montra les photos du visage défiguré par les coups. Il nia en être le coupable. Mais un sourire, qui lui échappa à ce moment précis, fit perdre toute crédibilité à ses dénégations. Il s’en rendit compte et alors sa parole devint violente, son attitude agressive. Le gardien intervint pour le maîtriser, lui passa les menottes et il fut embarqué dans la voiture, direction le commissariat. Il ne cessa de vitupérer durant le trajet, et quand Sonia se tourna pour lui sourire, il se déchaîna, la menaçant, l’insultant.
Les éclats de rire d’Alex et du gardien accompagnèrent sa figure déconfite.
Après l’interrogatoire de routine, le prévenu fut gardé une petite heure en cellule, le temps, pour nos deux inspecteurs de clore le rapport à destination du juge d’instruction.
Un stylo lancé dans sa direction effleura ses mèches blondes, tandis que leurs rires fusionnaient.
Au 2 rue de la briqueterie, une façade de briques rouges d’une maison étroite sur trois étages se tenait enserrée dans une longue lignée de maisons identiques.
On accédait à la porte d’entrée par quatre marches au bout d’un minuscule espace de terrain en friche, fermé par une grille rouillée.
Un bref coup de sonnette, et la porte s’ouvrit sur une femme entre deux âges, le teint défraîchi, les cheveux d’un blond pâle. Alexandre prit la parole.
Et la porte se referma sur les deux policiers dubitatifs et mouillés. La pluie venait de refaire son apparition.
Une fois revenus dans leur voiture, Sonia et Alexandre se séchèrent rapidement puis, la question de la suite à donner fut posée par Sonia.
Après presque une demi-heure de route fastidieuse, rythmée par le bruit des essuie-glaces, ils arrivèrent à l’adresse indiquée.
Effectivement, aucune trace de la présence de la jeune fille dans le taudis qu’ils venaient de quitter.





























