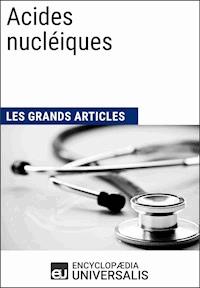
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Französisch
Découverts en 1868 par le biologiste suisse Friedrich Mischer dans les noyaux cellulaires, d'où leur nom (du latin nucleus, noyau), mais également présents dans le cytoplasme, les acides nucléiques sont des molécules d'origine naturelle qui jouent un rôle fondamental dans la vie et la reproduction des cellules animales...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 66
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782341004312
© Encyclopædia Universalis France, 2019. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Lenetstan/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Bienvenue dans ce Grand Article publié par Encyclopædia Universalis.
La collection des Grands Articles rassemble, dans tous les domaines du savoir, des articles : · écrits par des spécialistes reconnus ; · édités selon les critères professionnels les plus exigeants.
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
Acides nucléiques
Découverts en 1868 par le biologiste suisse Friedrich Mischer dans les noyaux cellulaires, d’où leur nom (du latin nucleus, noyau), mais également présents dans le cytoplasme, les acides nucléiques sont des molécules d’origine naturelle qui jouent un rôle fondamental dans la vie et la reproduction des cellules animales, végétales et microbiennes.
Tels qu’on peut les isoler des tissus animaux ou végétaux, ces acides se présentent sous forme de molécules polymériques, dont la masse moléculaire est comprise entre 25 000 et plusieurs centaines de millions. En effet, de même que les protéines sont formées par l’enchaînement de nombreux aminoacides et les polysaccharides par l’enchaînement de nombreuses molécules de sucres, les acides nucléiques sont constitués par l’enchaînement de nombreux motifs relativement simples, dissociables par hydrolyse ; chacun d’eux comporte une base azotée (purique ou pyrimidique), un sucre à cinq atomes de carbone ou pentose (ribose ou désoxyribose) et un acide phosphorique : ce sont donc des esters phosphoriques complexes que l’on nomme nucléotides. La structure du pentose est à l’origine de la classification des acides nucléiques naturels en deux catégories fondamentales : d’une part, les acides ribonucléiques (ARN) contenant comme pentose le ribose ; d’autre part, les acides désoxyribonucléiques (ADN) contenant comme pentose le désoxyribose (tabl. 1).
L’histoire des acides nucléiques commença par des travaux sur la structure de leurs constituants moléculaires, puis elle évolua rapidement vers des travaux de génétique fondamentale qui mirent en évidence la fonction de continuité génétique qu’exercent les acides désoxyribonucléiques (et même les acides ribonucléiques chez certains virus). En effet, la séquence de leurs nucléotides définit le code génétique (patrimoine héréditaire) de chaque individu. Les progrès remarquables des connaissances sur la structure et le rôle des acides nucléiques ont donné naissance à la biologie moléculaire, qui a pour but de rationaliser les données de la biologie descriptive classique en étudiant les processus de vie et de reproduction cellulaires au niveau des interactions entre molécules biologiques essentielles : acides nucléiques et protéines.
1. Nomenclature
• Nucléotides
Les bases azotées, dites nucléobases, qui entrent dans la constitution des nucléotides sont des bases organiques complexes dérivant de deux noyaux fondamentaux, la pyrimidine et la purine (tabl. 1). Le plus simple de ces deux noyaux, la pyrimidine, comporte deux atomes d’azote et quatre atomes de carbone, le tout formant un hétérocycle de six atomes. Le noyau de la purine est un hétérocycle comportant en tout neuf atomes : cinq de carbone et quatre d’azote. Les nucléobases puriques sont l’adénine et la guanine, les nucléobases pyrimidiques sont la cytosine, l’uracile (dans l’ARN) et la thymine (dans l’ADN).
Molécules constitutives des nucléotides. Tableau des molécules constitutives des nucléotides.
Les nucléosides sont des osides résultant de l’union d’une nucléobase avec un sucre à cinq atomes de carbone (pentose), qui est soit le ribose, ou β-D-ribofuranose, soit le désoxyribose ou β-D-2-désoxyribofuranose (tabl. 1). Les nucléosides sont donc, selon le cas, des β-D-ribofuranosides ou des β-D-2-désoxyribofuranosides.
Les nucléotides résultent de la phosphorylation des nucléosides. Dans le cas des mononucléotides qui existent à l’état libre dans les cellules vivantes, où leur rôle biochimique est fondamental, la position du groupement phosphoryle sur le sucre définit, pour une même base et pour un même sucre, deux nucléotides isomères différents dans le cas du désoxyribose, selon que le groupement phosphoryle est fixé en C-3′ ou en C-5′ et trois nucléotides isomères dans le cas du ribose selon que le groupement phosphoryle est fixé en C-2′, C-3′ ou C-5′.
Dans la figure 1 se trouvent indiquées les structures des principaux nucléotides que l’on peut obtenir par phosphorylation de l’adénosine ; les mêmes types de combinaisons sont possibles à partir de tous les autres nucléosides.
• Polynucléotides
Les polynucléotides sont des macromolécules constituées par l’enchaînement de plusieurs nucléotides reliés entre eux par une liaison 3′, 5′-phosphodiester : un seul groupement phosphoryle réunit les deux nucléotides contigus en estérifiant d’une part l’hydroxyle en position C-3′ du nucléotide n et d’autre part le groupement hydroxyle en position C-5′ du nucléotide n + 1. Ce type de liaison est le même en série désoxyribonucléique et en série ribonucléique (fig. 2).
Polynucléotide. Représentation schématique d'un polynucléotide. B représente une base azotée ou nucléobase (purine ou pyrimidine), S un sucre à 5 atomes de carbone ou pentose et P une molécule d'acide phosphorique, assurant la liaison entre deux nucléotides consécutifs, sous forme de liaison phosphodiester.
Le polynucléotide est par conséquent un polymère, constitué par une chaîne plus ou moins longue de monomères, les nucléotides. Or ces derniers sont de quatre sortes, si bien que leur enchaînement réalise une séquence dans laquelle l’ordre de succession des bases donne une identité particulière à chaque polynucléotide.
Les acides désoxyribonucléiques
Les acides désoxyribonucléiques sont des polynucléotides constitués par l’enchaînement d’un grand nombre de mononucléotides du type :
La base est soit de l’adénine, soit de la guanine, soit de la cytosine, soit de la thymine. On extrait facilement un ADN de haute masse moléculaire à partir du thymus de veau. La masse moléculaire de l’ADN isolé à partir de nombreuses sources, animales ou végétales, telles que thymus, germe de blé, bactéries, bactériophage, varie entre 1 million et plusieurs centaines de millions.
Les acides ribonucléiques
Les acides ribonucléiques sont constitués par l’enchaînement d’un grand nombre de nucléotides du type :
On trouve les mêmes bases que dans les ADN, à cette différence près que l’uracile remplace la thymine. Selon leur masse moléculaire et selon la fonction qu’ils assument, on distingue quatre classes principales d’acides ribonucléiques :
– Les mi-ARN et les si-RNA sont de petits ARN régulateurs (cf. BIOLOGIE - Les pratiques interventionnelles).
– Les acides ribonucléiques de transfert (ARN-t) sont des enchaînements de quatre-vingts nucléotides environ ; ils doivent leur nom au fait qu’ils servent à transporter les acides aminés activés au cours de la synthèse des protéines. La structure primaire de plusieurs de ces molécules a été déterminée.
– Lesacides ribonucléiques « messagers » (ARN-m) résultent de la transcription de l’ADN par des enzymes spécifiques, les transcriptases, et constituent le code génétique utilisé par les ribosomes pour la synthèse des protéines. La masse moléculaire des ARN messagers est variable selon la longueur de la protéine qu’ils ont à synthétiser.
– Divers acides ribonucléiques macromoléculaires jouent un rôle primordial : d’une part les ARN constitutifs des virus à ARN (virus de la mosaïque du tabac, de la grippe, de la poliomyélite, etc.) ; d’autre part, les ARN constitutifs des ribosomes, particules du cytoplasme cellulaire au niveau desquelles l’assemblage des aminoacides permet la biosynthèse des protéines.
2. Structure des acides nucléiques
• Conformation et masse moléculaires des ARN
Les ARN messagers sont des molécules filamenteuses à chaîne simple, donc monocaténaires, plus ou moins longues et de stabilité souvent précaire.
Les ARN de transfert, dont on verra le rôle dans la dernière partie de cet article, sont constitués par l’enchaînement de quatre-vingts nucléotides environ, le tout ayant une masse moléculaire de l’ordre de 25 000. L’alanyl-ARN-t de levure représenté sur la figure 3 comporte soixante-dix-sept nucléotides et sa masse moléculaire est de 26 000.
ARN de transfert : structure en feuille de trèfle. Alanyl-ARNt de levure. Cette structure représente la conformation primaire et secondaire d'un ARN de transfert selon le modèle dit en feuille de trèfle. Le résidu adénylique terminal (en haut) est lié à l'alanine par une liaison amino-acyl-adénylate. La boucle inférieure comporte l'anticodon caractéristique de l'alanine.





























