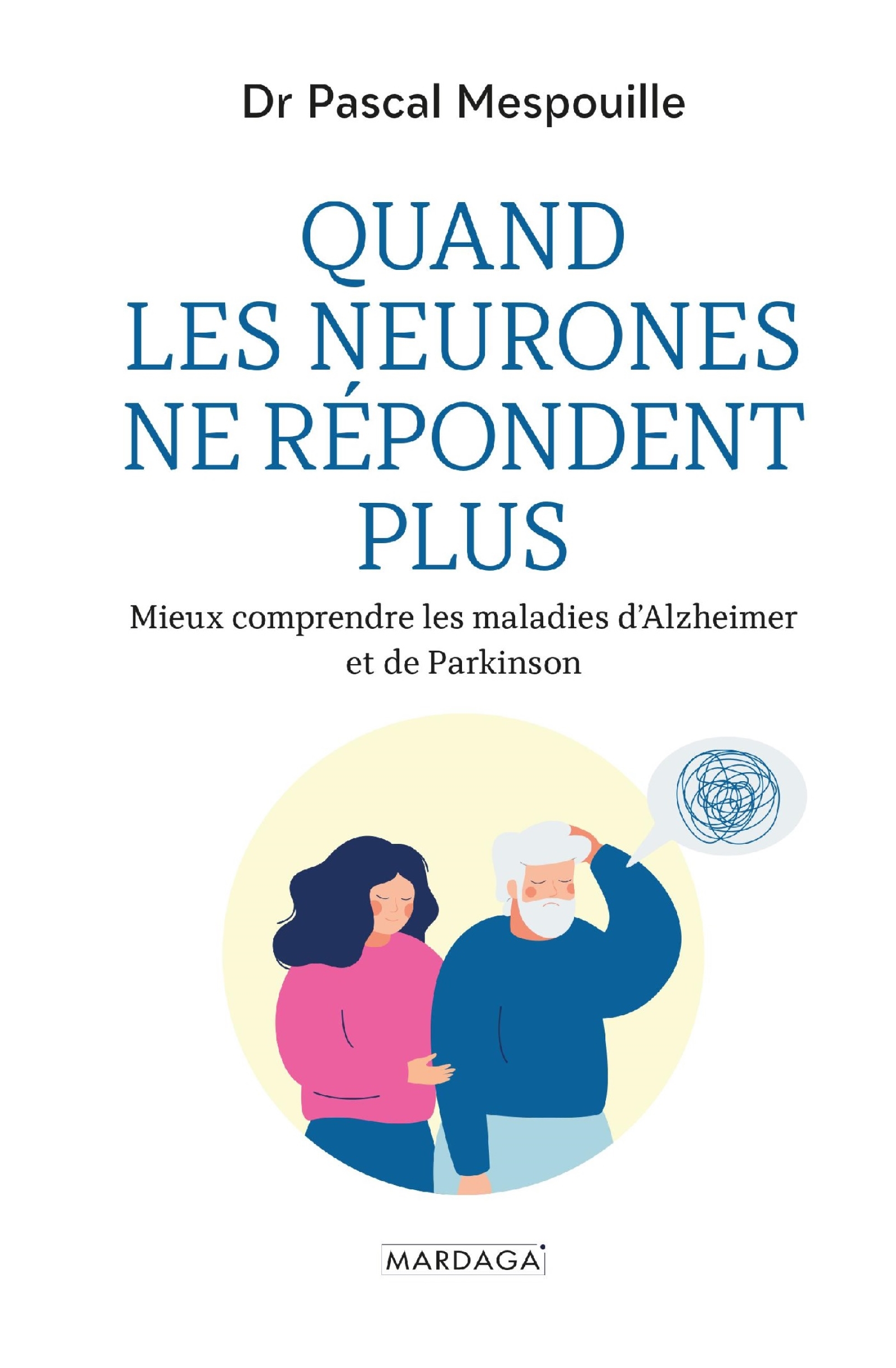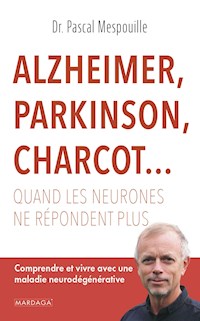
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Plongez dans cet ouvrage pour en apprendre davantage sur les maladies neurodégénératives et les apprivoiser...
Comment se manifeste la maladie d’Alzheimer ? Quels sont les symptômes de la maladie de Parkinson, et de Charcot ? Comment soutenir les proches qui en souffrent ? Comment accepter et mieux cohabiter avec ces pathologies ? Les maladies neurodégénératives touchent chaque année de plus en plus de personnes. Malgré cette importante présence, elles restent largement méconnues du grand public, ce qui rend leur diagnostic d’autant plus difficile à appréhender.
Le Docteur Mespouille, neurologue et chargé de cours sur le sujet, fait le point sur ces trois maladies. Il décrit avec précision les manifestations de leur développement ainsi que les premiers signes à détecter. Cette reconnaissance précoce est essentielle puisqu’elle permet une meilleure prise en charge des personnes qui en souffrent, et facilite leur cohabitation avec la maladie. Il aborde les difficultés rencontrées par les patients et propose des réponses concrètes aux questions que ceux-ci (se) posent. Illustrant son propos de nombreux témoignages, il apporte les connaissances nécessaires pour rassurer les patients et leur entourage, et permet à ces derniers d’accompagner au mieux leurs proches.
Un indispensable pour comprendre, accepter et mieux vivre les maladies neurodégénératives !
À PROPOS DE L'AUTEUR
Pascal Mespouille est un médecin spécialiste en neurologie depuis plus de 30 ans. Ancien chef de service, maître de stage et chargé de cours, il a pratiqué notamment aux Cliniques du Sud-Luxembourg, en Belgique. Il donne régulièrement des conférences sur le sujet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 449
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alzheimer, Parkinson, Charcot…
Dr Pascal Mespouille
Alzheimer, Parkinson, Charcot…
Quand les neurones ne répondent plus
Avant-propos
La collection « Santé en soi » évolue pour vous aider à devenir un acteur clé de votre santé.
Le temps est révolu où le patient n’avait que peu de ressources pour appréhender la maladie dont il souffrait. Même si les rapports entre le monde professionnel de la santé et le patient changent, le temps consacré à l’information manque régulièrement. De plus, sous la pression politique et dans un souci d’efficience économique, les institutions de soins développent des alternatives à l’hospitalisation et aux soins classiques. Il devient donc nécessaire pour toute personne d’acquérir plus d’informations pertinentes et d’autonomie face à la maladie.
Depuis sa création, dans chacun de ses ouvrages, la collection « Santé » des éditions Mardaga relève le défi d’apporter, sous une forme très accessible, une information médicale de grande qualité. Elle vise à offrir à tout lecteur des ouvrages qui traitent des questions qui animent aujourd’hui tant la communauté scientifique que la société autour de la santé dans sa définition la plus large.
Le livre que vous vous apprêtez à lire répond à un seul but : vous aider à devenir cet acteur bien informé et incontournable tant de votre santé que de vos soins médicaux. En effet, face à la multitude de sources d’informations consultables sous toutes les formes (réseaux sociaux, blogs, web, podcast, conférences, télévision, magazines), il est difficile de déterminer si les contenus sont fiables, validés par des experts ou douteux. Retrouver son chemin et un esprit critique dans cette infobésité qui nous pousse à appréhender beaucoup de données dans un temps de plus en plus court est parfois bien ardu.
Notre collection se veut être votre fil d’Ariane dans ce labyrinthe de surcharge informationnelle. Vous aider à apprendre et à comprendre tous les éléments utiles, sans pour autant les simplifier à outrance, est notre principale préoccupation.
Dans cet objectif, la collection évolue et évoluera encore avec la volonté d’offrir, si le sujet s’y prête, des approches plus dynamiques telles que des questions-réponses, des entretiens ou encore des controverses, tout en gardant un haut niveau de rigueur académique.
Au nom de toute la maison d’édition, je remercie les auteurs du présent ouvrage d’avoir répondu avec brio à cette approche dynamique de l’entretien avec un expert dans le domaine.
Je vous invite maintenant à lire ce livre, à le faire résonner dans votre quotidien et surtout à bien prendre soin de vous !
Professeur Frédéric Thys,
Directeur de la collection
Introduction
« Vous avez une maladie de Parkinson » ou « Votre conjoint a une maladie d’Alzheimer ».
Même assorti de précautions oratoires, le diagnostic énoncé par le médecin est souvent suivi d’un long silence angoissé, d’une sidération muette. L’émotion se trouve partagée entre un soulagement relatif, car cette annonce confère un sens à des symptômes présents depuis un certain temps, et un désarroi compréhensible engendré par ces mots qui sonnent comme un glas.
C’est sans doute vrai de tout diagnostic, qui alarme ou inquiète, face à une situation inconnue ainsi révélée. Dans certains cas, le constat médical portera sur un facteur de risque (« vous avez de l’hypertension ») ou suivra un incident (« la douleur que vous ressentiez vient d’une angine de poitrine ») ou encore évoquera les conséquences d’un accident (« votre chute dans les escaliers a provoqué une commotion cérébrale, des fractures… »).
Même quand il constitue l’annonce d’une pathologie somatique plus sévère (« vous avez un cancer »), le diagnostic répond habituellement à une plainte récente (« j’ai senti une masse en me lavant », « je tousse tout le temps », « je perds du sang quand je vais aux toilettes »…). Le message s’accompagne généralement de conseils ou d’options thérapeutiques, d’approches médicales ou chirurgicales, peut-être laborieuses ou pénibles à vivre, mais qui impliquent des espoirs de guérison, d’amélioration des douleurs, de stabilisation de l’état général, bref d’une certaine maîtrise du problème.
Dans le cas des maladies neurodégénératives, la situation se présente différemment : le problème sous-jacent existe depuis un certain temps ; le diagnostic de certitude se construit petit à petit ; la maladie interfère rapidement avec l’individu dans sa globalité et modifie sa personnalité ; son discernement ou ses relations sociales peuvent s’en trouver altérés ; et il n’y a aucun traitement curatif.
« Donc, je suis fichu, docteur ? » Pas du tout ! Les difficultés mentionnées sont bien réelles et il n’est pas question de les occulter. La prise en charge actuelle de ces pathologies permet, pour la plupart de ces affections, de vivre de manière correcte, pendant plusieurs années.
Les déficits progressifs et pertes de capacité graduelles amènent patients et entourage à se poser de nombreuses questions. Il n’est pas toujours facile, pour le médecin et les intervenants, de trouver, en temps voulu (c’est-à-dire quand elles se posent), les réponses à ces interrogations successives.
D’avoir vécu ce temps difficile du diagnostic, d’avoir partagé les problèmes qui en résultent, les questionnements, les moments d’espoir alternant avec les périodes de découragement, d’avoir éprouvé avec les patients et leurs familles les tourments existentiels, les recherches de solutions, mais aussi les quêtes de sens, dans le déséquilibre permanent d’un processus qui ne cesse d’évoluer, il m’a semblé qu’un livre abordant le vaste champ couvert par ces maladies s’avérait fécond. Un ouvrage qui se situerait à mi-distance d’une approche médicale complexe ou ardue et des aspects plus intimes, avec les anecdotes qui en disent long sur la fragilité vécue. Un récit qui tenterait de faire la part entre la richesse des approches possibles, plus appréciables et performantes qu’on ne le soupçonne, et les émotions suscitées par le déclin observé ainsi que les faux espoirs. Un texte reprenant les avancées récentes sans se leurrer sur les difficultés qu’elles soulèvent, soulignant les différences entre les plaintes initiales (mémoire, motricité, faiblesse…) et les diagnostics, avec, pour chacun d’entre eux, les évolutions prévisibles malgré les importantes variantes individuelles constatées sur le terrain. Un livre dans lequel toute personne confrontée à ces affections pourrait trouver des informations et des connaissances avérées portant sur les points précis qui l’interpellent, au moment où cela l’inquiète, en s’appuyant sur des aspects concrets et du vécu, où chacun pourrait dénicher des suggestions pratiques, sans se décourager ou s’épuiser. Un livre qui contiendrait aussi des chapitres qui s’écartent de la composante pratique du quotidien pour embrasser l’histoire de ces maladies, les concepts explicatifs qui se sont succédé, les errances, parfois, et les fulgurances qui ont permis maints progrès. Des connaissances plus étoffées, loin de n’être qu’une érudition stérile, peuvent en effet écarter le recours à des solutions trop simples pour être réalistes et évitent de faux espoirs.
Considérées comme rares jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle, les maladies neurodégénératives ont, de nos jours, les allures d’une épidémie. Elles ont débordé le registre médical pour envahir la sphère publique, sociale et économique. Non qu’elles soient subitement apparues, mais leur fréquence accrue, en bonne partie liée à l’augmentation de l’espérance de vie, s’accompagne d’un changement du regard qu’on leur accorde : l’excuse trop entendue du « c’est normal pour l’âge » ne doit plus avoir cours.
Les noms de maladie d’Alzheimer ou de maladie de Parkinson, pour ne prendre que les deux pathologies les plus connues, sont entrés dans le vocabulaire courant, quoique de manière imprécise. La première est souvent réduite à un synonyme de troubles mnésiques, la seconde évaluée dans la perspective du seul tremblement, qui est pourtant loin de la résumer.
Le contraste est saisissant entre l’évocation de ces affections dans le grand public ou dans les revues générales d’information, et l’ignorance quasi complète que la plupart des gens en ont. C’est d’ailleurs un réel obstacle à surmonter que cette méconnaissance, malgré le battage médiatique indiscutable dont les patients ou les familles n’ont retenu que quelques mots imprécis, quand ils ne sont pas inexacts.
Autrefois sous-estimées, éparpillées dans divers chapitres de la médecine et de la neurologie, ces pathologies dégénératives ont longtemps été réunies par l’ignorance des mécanismes qui les provoquaient et l’absence de traitement curatif. Elles ont aussi souffert d’une approche fataliste qui les considérait comme une sorte de vieillissement accéléré, ce qu’elles ne sont pas.
Marquées par une dégradation progressive et inéluctable, plus ou moins rapide, elles impliquent d’innombrables deuils à assumer au quotidien. Par leurs déficits induits, elles constituent une pénible réalité pour les patients qui ressentent, au plus profond d’eux-mêmes, cette régression, et pour leur entourage, qui en constate les effets avec un mélange d’impuissance et de tristesse, d’effroi et de résignation. Liée aux chutes, à la faiblesse musculaire, aux fugues ou à d’autres symptômes, une insécurité s’installe et impacte rapidement la qualité de vie des malades et de leurs proches.
Au-delà de la détresse existentielle, ces maladies sont coûteuses pour les patients, avec leur cohorte de séjours hospitaliers, d’aménagements nécessaires dans l’habitation, avec l’intervention de services d’aides à domicile. La dépendance s’accroît et finit, fréquemment, par un placement dans un home ou une institution de soins spécialisée. Les maladies neurodégénératives s’avèrent aussi onéreuses pour la société et constituent, depuis quelques décennies, un enjeu économique majeur. En ce début de XXIe siècle, on estime qu’elles touchent environ 2 % de la population. Parmi les causes de mortalité, elles se situent derrière les cancers, les pathologies cardiaques et cérébro-vasculaires, mais leur nombre progresse et devrait continuer à s’accroître pendant plusieurs décennies, constituant un défi pour les systèmes de soins qu’elles risquent de déstabiliser.
Pour avoir négligé, par impéritie ou, plus prosaïquement, pour des raisons budgétaires, d’intégrer la fréquence de ces maladies, de prendre en compte les difficultés grandissantes des familles à y faire face, notamment dans la durée, mais aussi le coût des interventions médicales, paramédicales et sociales, ainsi que la nécessaire professionnalisation des intervenants, nos sociétés ne se sont guère préparées pour affronter le problème. Elles n’ont pas de structures adaptées en nombre suffisant, et les réseaux coordonnés de soins, encadrés par des équipes soignantes formées à ces pathologies, ont tardé à se mettre en place.
Mieux prendre en charge ces maladies implique de mieux les connaître, avant tout en identifiant précisément les facteurs qui les provoquent. C’est le rôle des études épidémiologiques de préciser leurs caractéristiques, les éléments qui entraînent leur apparition et déterminent leur évolution. Elles doivent discerner les facteurs de risque modifiables et non modifiables. Cette connaissance implique aussi qu’il faille encourager coûte que coûte la recherche fondamentale et la soutenir davantage. La clarification des processus pathologiques en jeu est une condition indispensable à la mise au point de médicaments efficaces et, si possible, curatifs. Les nombreux dysfonctionnements relevés ces dernières années, qu’il s’agisse de l’accumulation anormale de protéines, du rôle du stress oxydant ou des mécanismes programmant la mort cellulaire, doivent faire l’objet d’une compréhension plus fine.
Il faut disposer de diagnostics précoces, lesquels font encore défaut, et précis, d’où l’intérêt de descriptions cliniques minutieuses, surtout dans les phases débutantes. En effet, il est plus que probable que ce sont des affections diverses, aux voies pathologiques différentes, liées à des mécanismes génétiques distincts, qui convergent de façon progressive vers des tableaux cliniques globaux, moins différenciés, que l’on qualifiera, selon les cas, de démence ou d’Alzheimer. Mais attendre ce stade avancé complique la mise au point de traitements. Il est donc important de subdiviser ces affections en sous-groupes afin d’obtenir des entités homogènes facilitant des approches thérapeutiques ciblées. Cela implique une attention accrue des médecins, dès l’apparition des anomalies cliniques initiales avec des praticiens formés à détecter très tôt des modifications comportementales, sans les banaliser.
Les firmes pharmaceutiques ont engagé d’importants moyens financiers dans la recherche de molécules prometteuses, mais les progrès sont lents. La découverte de traitements s’éternise, ce qui a fini par décourager certaines de ces entreprises, dont la vocation philanthropique se double d’une exigence de bénéfices, lesquels font défaut en l’absence de thérapeutique susceptible d’être commercialisée. Or les études concernant ces maladies impliquent des molécules à prescrire très tôt et pendant une longue durée, d’où un coût de recherche et de développement considérable. On constate que la plupart des grands groupes pharmaceutiques ont réduit, voire abandonné, les recherches dans ce domaine. La solution viendra peut-être de découvertes, plus ou moins fortuites, au sein de start-up en biotechnologie, lesquelles vendront leurs innovations à ces groupes, seuls susceptibles de réaliser les études préliminaires à l’exploitation de ces médications.
Nos connaissances ont déjà permis, pour certaines de ces maladies, le développement de traitements qui améliorent certains symptômes ou retardent leur progression. Mais, en l’absence, à moyen terme, de thérapeutiques susceptibles de réduire de manière significative l’occurrence de ces maladies, d’autres voies doivent être explorées.
La prévention est l’une de ces pistes. Contrairement à une idée reçue, une prophylaxie1 partielle existe pour certaines maladies neurodégénératives. Elle a été mise en œuvre fortuitement ces dernières décennies et a donné des résultats limités mais significatifs, notamment dans les démences. Il s’agit de stratégies de longue haleine qui porteront leurs fruits lentement, mais dont l’intérêt est évident.
Une approche globale, par des équipes pluridisciplinaires, est un autre axe à privilégier : l’idée pourrait être de créer des trajets de soins, médicaux et paramédicaux, centrés sur ces pathologies, à l’instar de ce qui existe pour d’autres affections.
Cela nécessite, de la part des décideurs et des professionnels, l’acquisition de compétences : il faut disposer d’une compréhension correcte de ces maladies, qui comportent d’importantes variantes individuelles à intégrer, afin d’anticiper le déclin. Un meilleur accompagnement, un soutien efficace aux patients et une formation plus pointue des aidants – qu’ils soient professionnels, paramédicaux ou infirmiers, familiaux ou bénévoles – sont nécessaires. Or, malgré l’accès à des sources d’information nombreuses, nous nous sommes aperçus, dans notre pratique médicale, que ces maladies restaient liées à un déni manifeste, un fatalisme certain et des opinions fausses mais bien enracinées. Il en résulte une errance diagnostique, puis thérapeutique.
Avant le diagnostic, le patient ou sa famille sont interpellés par des premiers signes, curieux, survenant dans un contexte inhabituel, qu’il s’agisse d’une brève hospitalisation, d’une infection, d’un voyage, d’un deuil… Cette apparition insidieuse est, erronément, attribuée à la fatigue, au stress, à la chaleur, à un moment de déprime, à l’âge ou encore à un effort inhabituel, autant d’explications qui retardent un premier examen médical. Sans parler du patient qui, parce qu’il ne reconnaît pas le trouble, tentera de convertir l’incident en trait d’humour ou le tournera en dérision, ou de l’entourage qui, quoiqu’étonné, préférera en sourire. Lorsqu’une consultation a lieu, les premiers signes visibles de la maladie sont peu marqués ou fluctuants. Le patient minimise son problème, l’attribuant à une inquiétude de son entourage. Le médecin lui-même risque de banaliser ou d’alléguer d’autres causes, comme un manque d’exercice, une alimentation inadéquate, un sommeil déficient. Si l’un ou l’autre examen est prescrit, il s’avérera souvent non contributif à ce stade, rassurant indûment le patient, la famille et le médecin. En outre, il n’est pas rare que ces premiers troubles s’accompagnent d’un état dépressif que justifient d’autres prétextes dans la tranche d’âge habituelle de ces maladies, à savoir la cinquième ou sixième décennie : retraite, départ des enfants, vie sociale moins riche. Avec, ici aussi, un risque de diagnostic retardé.
On objectera qu’un diagnostic précoce n’est pas utile en l’absence de traitement curatif. Répartie qui nécessite des réponses nuancées. Disposer d’un diagnostic, lorsque les premières plaintes se manifestent, contribue à calmer l’angoisse du patient. Celui-ci sent que « quelque chose ne tourne pas rond » mais sans penser qu’il est malade. Les excuses initiales de fatigue ou d’âge ne tiennent pas longtemps, et il doit y avoir « autre chose ». La souffrance morale occasionnée par cette période d’incertitude ne doit pas être négligée.
Le patient a le droit de savoir, même si le diagnostic doit être proposé au moment opportun. Il pourra exprimer son effroi, s’adapter, prendre des dispositions quand il en est encore capable, déterminer le niveau de soins souhaité, aujourd’hui ou demain, selon l’évolution de sa maladie et son degré de dépendance. Un diagnostic tardif le condamne à subir les prises en charge imposées, alors qu’il aurait pu disposer de temps pour prévoir et décider. Un constat médical posé au bon moment donne aux proches l’opportunité de comprendre les changements, de s’y adapter, d’accélérer, le cas échéant, certaines décisions : déménagement, aide spécifique, consultation du notaire, vente de la voiture… Autant de décisions lourdes de conséquences qui ne peuvent souffrir un délai trop long. On suggérera un accompagnement précoce du patient et de son entourage dans cette tranche de vie qui mobilisera toute leur énergie. Le champ des activités possibles, rétréci par la maladie, autorise encore l’appropriation d’un temps présent à vivre, avec le maximum d’intensité possible.
Il convient aussi de ne pas verser dans l’excès inverse : en l’absence de traitement curatif, rien ne sert de trop anticiper le diagnostic. On verra en effet que les anomalies devancent les premiers symptômes de plusieurs années (voire une dizaine d’années), donnant raison au Dr Knock qui affirmait que « les gens bien portants sont des malades qui s’ignorent » (Knock, p. 31). Inutile d’inquiéter le patient en lui annonçant une maladie qui ne se développera, peut-être, que dans dix ou vingt ans !
L’éthique médicale doit primer afin que le patient ne soit pas condamné à subir un diagnostic vécu comme une condamnation à mort. Le médecin traitant doit être rapidement sollicité et doit intervenir pour développer une stratégie graduée, personnalisée, intégrant les plaintes mais aussi la situation personnelle et les attentes éventuelles.
Une fois le bilan effectué et les symptômes incorporés dans un processus pathologique qui les explique, d’autres interrogations apparaîtront. Elles évolueront en parallèle avec les progrès de la maladie ou l’apparition de nouveaux signes.
Le ressenti du patient constitue un point de départ pour un dialogue fructueux entre la famille, le médecin et d’autres intervenants. Les demandes initiales portent sur les causes de la pathologie, sur les possibilités thérapeutiques. Viennent ensuite des sollicitations sur les moyens de ralentir la maladie, sur les possibilités de prévention. Les proches s’inquiéteront, à un moment donné, du rôle des facteurs génétiques avec, en filigrane, le risque pour la descendance.
Très tôt, car le patient y est réticent, il convient d’aborder le recours à des paramédicaux (kinésithérapeute, orthophoniste…), aux associations de patients ou aux services d’aide.
Comme nous l’avons dit, les sources d’information sont abondantes et accessibles mais on y trouve tout et son contraire. Il faut effectuer un tri et intervenir pour lutter contre les idées fausses et les pseudo-traitements. Si certaines sources sont excellentes, notamment celles de plusieurs associations de patients, d’autres, trop techniques ou scientifiques, se focalisent sur des détails qui risquent de noyer les personnes non initiées dans des fondements peu compréhensibles ou dans des concepts encore hypothétiques.
De ce point de vue, les publications scientifiques de qualité utiles aux professionnels ne sont pas exemptes de critiques : elles abordent des recherches pointues qui « pourraient » déboucher sur des progrès, des perspectives qui « autorisent » un espoir de traitement, nuances souvent occultées par des lecteurs à l’affût d’une solution à leur problème et ce, malgré les précautions oratoires réitérées des auteurs et le fréquent emploi du conditionnel. Impossible, acontrario, de passer sous silence les pseudo-informations qui pullulent sur de nombreux sites, masquant mal leurs à-côtés publicitaires, articles farfelus, voire mensongers, offrant des conseils « bienveillants » pour mieux vendre des panacées étonnamment ignorées des spécialistes avérés et dont la primeur serait mystérieusement réservée à ces sites.
Trop souvent, de vains espoirs naissent d’affirmations glanées dans des articles simplistes, qu’il s’agisse d’annonces prématurées d’un traitement novateur ou de moyens illusoires pour prévenir ces maladies (avec des solutions aussi ridicules que d’éviter le café ou le sucre, manger des kiwis ou des pamplemousses, et autres balivernes).
Nous espérons que ce livre offrira des perspectives et connaissances variées, dans une voie médiane à mi-chemin d’une vulgarisation excessive ou d’un abord scientifique ardu, afin de disposer d’un cadre cohérent dans lequel chacun pourra trouver des informations pertinentes autorisant une approche des soins soucieuse de la qualité de vie du patient.
1. Tous les mots suivis d’une astérisque sont définis dans le glossaire qui se trouve en fin d’ouvrage.
Partie 1 : Cadre général
Chapitre 1 Vieillir ou dégénérer ?
« La destinée naturelle de toutes les civilisations est de grandir et de dégénérer, et de s’évanouir en poussière. » (Alexis Carrel, L’homme, cet inconnu)
Dégénérer, nous apprend le dictionnaire, c’est « perdre ses qualités ». Cette définition s’applique dramatiquement aux maladies neurodégénératives avec la cohorte de pertes qui en résulte, qu’il s’agisse de capacités ou de compétences. De manière moins explicite est esquissée une dimension temporelle car le terme implique une progressivité : on ne dégénère pas instantanément. Nous n’avons pas affaire à un état figé mais à une évolution pathologique, dont on sait aujourd’hui que les dysfonctionnements initiaux anticipent de plusieurs années, voire de dizaines d’années, les premiers symptômes.
Qu’il s’agisse de la maladie d’Alzheimer avec ses « pertes » de mémoire (et d’autres fonctions intellectuelles et cognitives), de la maladie de Parkinson et sa « perte » de motricité (escortée d’autres symptômes moteurs, comme le tremblement, et de signes non moteurs), de la maladie de Charcot (sclérose latérale amyotrophique), dont l’atrophie musculaire s’accompagne d’une « perte » de la force musculaire et des capacités de déglutition, toutes ces affections sont dominées par une détérioration graduelle et inévitable. Mais ce concept de « perte de qualités » ne s’applique-t-il pas, tout simplement, à la vieillesse ? Avec ses oublis bénins, ses raideurs articulaires, son ralentissement intellectuel progressif ? Avec ses pertes (de cheveux), ses rides, ses chutes, son sommeil moins récupérateur ?
Qu’est-ce qui sépare le phénomène physiologique inéluctable du processus pathologique ? L’âge est-il, comme on a pu le croire, le seul critère ? Selon la date de naissance, le problème mnésique serait, par exemple, pathologique mais, après une date limite, il deviendrait « normal ». Avant 65 ans, on parle de démences préséniles (pathologiques), ensuite de démences « séniles » sans solution envisageable. Le tremblement serait anormal chez le jeune, mais pas chez la personne âgée…
Si l’âge peut sembler un critère « objectif », quels paramètres permettront de fixer le moment précis où le bon grain se sépare de l’ivraie, la santé de la maladie ? Puisque le processus pathologique commence avant les signes cliniques, faut-il prendre en compte ce moment – inconnu – ou attendre la période du diagnostic, au risque de tomber dans la subjectivité car certains patients consultent plus rapidement et certains médecins sensibilisés seront plus vite alertés par des signes mineurs ? L’âge n’est pas une modalité convaincante même si la plupart de ces pathologies voient leur fréquence croître avec lui.
Le concept de dégénérescence, sur lequel nous reviendrons dans le chapitre 2, est lui-même inadéquat car très connoté XIXe siècle, avec des notions de déclin moral, de déchéance, frappant des familles dont les mœurs s’éloignent des préceptes prônés par la bourgeoisie et les savants.
Identifier ce qui distingue le vieillissement physiologique (sénescence*) du vieillissement pathologique (sénilité*) a pris du temps. Un terme comme « démence sénile », toujours utilisé, laisse entendre que cette pathologie, liée à l’âge, est un passage obligé de la vie, quasi sans intérêt diagnostique ou thérapeutique. Le mot « sénile » en est venu à constituer une catégorie fourre-tout quand il n’est pas, lui aussi, une invective. De nombreuses personnes trouvent encore normal qu’un senior de 70 ou 80 ans perde la tête ou tremble.
D’où cette question : vieillir, est-ce dégénérer ou évoluer ?
Si l’on répond par la première alternative, il n’y a pas de solution thérapeutique possible car l’altération apparaîtra tôt ou tard. En outre, cela fige le problème : on « est » dégénéré ou on ne l’est pas, alors qu’il s’agit d’un processus qui se déroule dans le temps. Par contre, en privilégiant la notion d’évolution, on autorise des recherches et d’éventuelles solutions. C’est pourquoi de nombreux scientifiques et médecins, mais aussi des écrivains ou des philosophes, estiment qu’il conviendrait de remplacer cette expression obsolète par un vocable moins daté, n’insistant pas sur les seules pertes mais sur l’évolutivité de ces maladies, laquelle autorise de constantes adaptations. Certes, changer les mots ne modifie pas les maux qu’ils désignent : si l’usage d’une expression comme « maladie neuro-évolutive » ne changerait rien aux souffrances de ceux qui la vivent, elle peut tout de même contribuer à convertir notre regard sur ces pathologies et, peut-être, à adopter une attitude moins fataliste. Encore faudrait-il trouver un terme qui fasse consensus, ce qui n’est pas le cas pour le moment.
Comme leur étymologie l’indique, ces maladies sont caractérisées par une dégénérescence, définie comme une perte de structure ou de fonction de certaines populations cellulaires, en l’occurrence ici, les cellules cérébrales et, essentiellement, les neurones. Dans les maladies neurodégénératives, les neurones s’altèrent (perte de structure) et ils meurent. Les fonctions qu’ils accomplissaient ne sont plus remplies, et des symptômes apparaissent, selon la catégorie neuronale impliquée : perturbations de la mémoire ou du comportement, troubles de la marche, tremblements, atrophies musculaires…
Dès le XIXe siècle, on avait souligné une composante héréditaire ou familiale – les deux notions étaient encore confuses. D’immenses progrès en génétique ont permis une meilleure compréhension de ces maladies, qu’il n’est plus possible d’évoquer sans quelques bases dans ce domaine.
Quelques notions sur le système nerveux
« Nerveux : se dit chaque fois qu’on ne comprend rien à une maladie. Cette explication satisfait l’auditeur. » (Gustave Flaubert, Correspondance) Isolé du reste de l’organisme par une barrière appelée hémato-encéphalique, le système nerveux est classiquement divisé en un système nerveux central (avec ses structures : cerveau, cervelet, tronc cérébral, moelle épinière) et un système nerveux périphérique (constitué de prolongements nerveux ou nerfs).Figure 1Coupe sagittale du cerveau.
Les neurones sont les particules élémentaires du système nerveux, les « atomes » de ce qu’il rend possible : pensée, mouvements et sensibilité. Ils sont constitués d’une partie centrale, souvent appelée « soma », d’arborescences qui y mènent (les dendrites*) et d’une fibre principale unique qui en émerge, l’axone. Celui-ci conduit le signal électrique depuis le corps neuronal avant de se ramifier en forme d’arborescence terminale au niveau de la synapse. Cette dernière constitue le point de contact entre deux neurones ou entre neurone et muscle. L’axone peut avoir une longueur variable de quelques millimètres à plus d’un mètre. Si l’information circule, au niveau axonal, sur un mode électrique, sous forme de potentiels d’action, elle s’effectue par voie chimique, via les neurotransmetteurs*, entre deux neurones ou entre neurone et muscle.Figure 2Les cellules du cerveau.Au niveau du système nerveux central, les axones sont regroupés en faisceaux (que l’on appelle souvent « tractus »). Ils forment, dans le système nerveux périphérique, les nerfs. Outre l’information électrique qu’ils véhiculent, les axones transportent de nombreuses protéines depuis le soma jusqu’aux synapses où elles assurent diverses fonctions dont la communication entre les neurones. Au nombre de cent milliards, les neurones établissent des connexions avec plusieurs milliers d’autres cellules, constituant un formidable entrelacs, en constante évolution, dont les configurations possibles dépassent de loin le nombre d’étoiles de l’univers. Les neurones sont reliés par des relations complexes, à d’autres cellules cérébrales, au rôle encore partiellement connu : les oligodendrocytes et les astrocytes. Les oligodendrocytes fabriquent la gaine de myéline qui entoure les axones dans le système nerveux central. La myéline ressemble à une gaine qui entoure les prolongements axonaux, les isole et favorise la vitesse de l’information. Elle est altérée dans des maladies cérébrales inflammatoires comme la sclérose en plaques, et des maladies périphériques variées, les neuropathies (diabétiques, alcooliques, ou dégénératives abordées dans le chapitre 7). Les astrocytes sont des cellules qui véhiculent, depuis les artères, les nutriments dont les neurones ont besoin. Ils participent à la synthèse de molécules plus complexes, à la cicatrisation en cas de mort neuronale. Leurs fonctions, assez mal connues, constituent un véritable « service d’aide » au neurone. Neurones, oligodendrocytes et astrocytes ont une origine commune : il s’agit de cellules souches, retrouvées dans le cerveau embryonnaire. Longtemps, on a cru que ces cellules ne pouvaient plus se multiplier ou se différencier après cette période, dogme partiellement invalidé sur lequel nous reviendrons (chapitre 8). Mentionnons encore la microglie, constituée de cellules d’origine sanguine, qui possède une fonction immunitaire insuffisamment connue. Elle pourrait s’avérer importante : on trouve notamment ces cellules autour des plaques amyloïdes, qu’elles semblent incapables d’éliminer et dont nous parlerons plus en profondeur par la suite.
… Et quelques notions de génétique
« L’imbécillité me semble respectable si elle est génétique, pas si elle vient d’un choix. » (Mario Vargas Llosa, Les Cahiers de don Rigoberto) De nos jours, plus de 90 % des maladies neurodégénératives sont considérées comme « sporadiques* » car elles surviennent de manière apparemment spontanée, sans antécédent familial connu. La part de l’hérédité semble faible, limitée à des affections héréditaires comme la maladie de Huntington ou, pour certaines autres classiquement sporadiques comme la maladie d’Alzheimer ou la maladie de Parkinson, circonscrite à de rares familles bien identifiées, au nombre de quelques centaines à travers le monde. Toutefois, de nos jours, on considère plutôt que la composante sporadique révèle une large part d’ignorance. La survenue apparemment aléatoire d’une maladie dégénérative relève de nombreux facteurs génétiques, plus ou moins connus, interférant entre eux et avec des mécanismes environnementaux. Qu’en est-il de la part héréditaire ? Le préfixe « hérédo » est ambigu : dérivé du mot latin signifiant « héritier », il ne distingue pas ce qui relève de l’héritage (acquis) et de l’inné (que l’on appellerait aujourd’hui le gène). Or il est indispensable de discriminer ces deux termes, souvent amalgamés, que sont « familial » et « héréditaire ». La notion de « familial » inclut de nombreux éléments qui peuvent être présents dans certaines familles ou groupes sociaux, sans être véhiculés par les gènes. Il peut s’agir d’habitudes alimentaires (régime végétarien, recettes de grand-mère…), de traditions éventuellement liées à la religion (viande halal, casher…), de règles d’hygiène (au niveau de l’environnement, de la maison, de la propreté corporelle…), de la pratique de certaines professions (le fait d’être agriculteur de père en fils, donc d’être exposé à des risques similaires, comme des engrais) ou encore de facteurs plus larges, notamment culturels (exposition au soleil…). Tous ces éléments ont la capacité de se « transmettre » via des règles, des règlements et des histoires. Ils peuvent s’amplifier ou être délaissés en fonction d’événements historiques, de découvertes scientifiques, voire d’effets de mode. Ils peuvent avoir des répercussions sur la qualité de vie et la santé : campagnes de vaccination, exposition excessive au soleil, alimentation déséquilibrée… Qu’ils soient familiaux ou sociétaux, ils n’ont rien d’héréditaire et relèvent exclusivement de la culture. L’hérédité consiste, quant à elle, en la transmission des caractères d’un être vivant à ses descendants par l’intermédiaire des gènes. Nous sommes constitués d’innombrables cellules qui remplissent différentes fonctions. Au minimum, chaque cellule doit être capable de maintenir sa structure et de se reproduire par division. Elle est constituée d’un milieu interne appelé cytoplasme et d’un noyau où se trouvent les chromosomes. Pour accomplir ces missions élémentaires, chaque cellule dispose « d’ouvriers spécialisés » que sont les protéines*. Celles-ci sont composées d’un certain nombre d’acides aminés* que, schématiquement, on peut se représenter comme des perles d’un collier. Les acides aminés biologiquement utiles sont au nombre de 20, chacun d’eux ayant une « forme » différente (le mot doit être pris au sens large, incluant des interactions chimiques et électriques). Leur succession ordonnée confère une configuration précise à la protéine qui est responsable de son rôle. Les protéines sont donc fabriquées, en fonction des besoins cellulaires ; elles effectuent leur tâche puis sont détruites. Les acides aminés qui les constituent sont alors recyclés et peuvent former de nouvelles protéines. Pour que ces molécules effectuent leurs tâches au moment opportun, elles doivent être « supervisées ». C’est le rôle du génome, c’est-à-dire de l’ensemble des gènes dont dispose la cellule. Toutes les cellules humaines disposent de 23 paires de chromosomes à l’exception des spermatozoïdes et ovules qui n’en contiennent que la moitié. Chaque paire est transmise par chacun des parents. On distingue 22 paires, appelées autosomes*, et une paire de chromosomes sexuels (XX chez la femme, XY chez l’homme). Ces chromosomes, situés dans le noyau cellulaire, contiennent les instructions nécessaires à nos cellules pour entretenir leurs parois et leur milieu intérieur, se reproduire et exercer leurs fonctions. Cette information se situe au niveau des gènes, au nombre de 25 000 environ chez l’être humain. Les chromosomes sont constitués d’ADN*, une double hélice composée de nucléotides dont la succession définit le génome. Ces nucléotides, briques élémentaires de l’ADN, se distinguent les uns des autres par leurs bases, au nombre de quatre : l’adénine (A), la cytosine (C), la guanine (G), la thymine (T). Ces bases sont complémentaires : la cytosine présente sur une des hélices de l’ADN est toujours couplée à une guanine sur l’autre, idem pour l’adénine et la thymine. La transmission de l’information se fait via une transcription qui exprime le contenu d’une partie de l’ADN en une copie appelée ARN* messager. Cet ARN tire parti de la complémentarité des bases : si l’ADN propose une guanine, l’ARN sera constitué d’une cytosine, etc. Dans un second temps, au niveau d’une structure appelée ribosome, l’ARN est traduit en acides aminés : ce passage d’un langage nucléique en une séquence précise d’acides aminés est le fameux « code génétique », considéré comme universel. D’une personne à l’autre, les gènes peuvent être légèrement différents sans que cela implique un problème. C’est le cas notamment de la couleur des yeux ou des cheveux. Dans certains cas, une mutation* peut modifier le gène. Elle peut être secondaire à des causes extérieures (radiations) ou être spontanée. Le plus souvent, elle ne change rien aux fonctions du gène, auquel cas elle passera inaperçue. Il arrive cependant que le gène muté code pour une protéine différente, moins efficace, et une pathologie peut se développer. Deux cas peuvent alors se présenter. Puisque nous possédons deux variantes de chaque gène, l’un hérité du père, l’autre de la mère, le gène muté peut « dominer » et provoquer une maladie : on parle de transmission autosomique* dominante, c’est-à-dire que le gène n’est pas situé sur un des chromosomes sexuels (X ou Y). Si, au contraire, le gène muté ne provoque pas de maladie (car le gène sain, non muté, compense), il faudra que les deux gènes soient altérés pour qu’un problème apparaisse : on parlera d’hérédité autosomique récessive. Certaines maladies, liées à la mutation d’un seul gène, sont appelées monogéniques. Elles sont rares dans le domaine qui nous occupe ; signalons tout de même le cas de la maladie de Huntington. Dans les autres cas, la présence de mutations ne provoque pas ipso facto de maladie mais modifie son risque d’apparition. On parle de maladies multigéniques. Il s’agit d’une prédisposition (accrue ou réduite) à développer la maladie. C’est probablement à ce niveau que se joue l’intrication du génome avec l’environnement : le risque, majoré ou minoré, ne s’applique que dans certains contextes. Il reste encore à comprendre la manière dont on passe des gènes aux protéines. Nous avons vu qu’il existe quatre bases au niveau de l’ADN et vingt acides aminés à spécifier pour construire les protéines. Cela implique que chaque acide aminé doit être codé, au niveau de l’ADN, par trois bases (d’où la notion de triplets). Car si une seule base codait un acide aminé, seuls quatre d’entre eux pourraient l’être. Si deux bases codaient un acide aminé, le nombre de combinaisons serait de 4 × 4, soit 16 acides aminés, nombre encore insuffisant. C’est pourquoi trois bases sont nécessaires, pouvant coder 64 acides aminés (4 × 4 × 4). Concrètement, certains acides aminés peuvent être codés de plusieurs manières différentes. Par exemple, si la première base est une cytosine (C), la seconde une adénine (A), la troisième une guanine (G), le triplet « CAG » codera pour un acide aminé appelé glutamine. Mais cette même glutamine peut aussi être codée par le triplet CAA. Cela explique pourquoi les mutations ont des effets différents : si, dans le cas de la glutamine, une mutation remplace, sur l’ADN, une guanine par une adénine, au niveau de la traduction en protéine, cela ne change rien : CAG ou CAA codent pour le même acide aminé. La protéine sera identique et « l’erreur » présente sur l’ADN, sans effet.En ce qui concerne les maladies neurodégénératives, on conçoit que la répétition anormale de triplets au niveau de l’ADN entraînera la présence de trop d’acides aminés dans la protéine, ce qui l’empêchera de remplir sa fonction.
Le vieillissement : normal ou pathologique ?
« Comme c’est ennuyeux de vieillir quand on est vieux ; quand on est jeune, ça ne fait rien. » (Paul Morand, Le Réveil-Matin)
Rien de plus difficile à percevoir que l’évidence : tous les étés, les pommes tombent, et, toute l’année, nous vieillissons. La chute des pommes, qu’il s’agisse d’une histoire véridique ou apocryphe, a trouvé son Newton : une explication a été donnée à un phénomène à ce point flagrant que nul ne l’avait identifié comme problématique. De même que la chute d’un objet constituait une « obligation » qui ne nécessitait aucune explication, la vieillesse, inévitable, ne relève d’aucun questionnement et n’est donc pas un sujet d’étude. Vieillir étant un état contre lequel nous ne pouvons rien faire, inutile de perdre son temps à savoir pourquoi nous le faisons.
Vieillir est-il vraiment inéluctable ? Comme souvent, on trouve, dans la mythologie grecque, une première approche de ce problème et une distinction pertinente entre une vie éternelle, avec ou sans vieillissement.
Tithon, prince troyen, frère de Priam (roi mythique de Troie dans l’Iliade), était d’une grande beauté. Il fut enlevé par Éos, déesse de l’aurore. Celle-ci demanda à Zeus de lui conférer l’immortalité, ce que le père des dieux accorda, mais Éos avait omis de requérir pour lui la préservation de la jeunesse. Tithon devint éternel mais de plus en plus vieux et desséché. Il fut alors quitté par Éos. L’expression grecque « une vieillesse de Tithon » signifie une vie qui ne cesse de s’éterniser, mais devenue sans attrait.
Jusqu’à une époque récente, aucune approche médicale ne s’était démarquée de l’évidence du temps qui passe. La médecine ne voyait, dans la vieillesse, qu’une période de déclin inéluctable, surtout en ce qui concernait les facultés de l’esprit. Hippocrate, le père de la médecine, détaille de nombreuses maladies qui accompagnent l’âge avancé mais ne mentionne pas de pathologies que l’on appellerait, de nos jours, neurologiques ou psychiatriques, spécifiquement liées à la vieillesse. Certes, il parle de folie, de manie ou de mélancolie, mais sans corréler leur fréquence à l’âge du patient. Ce désintérêt durera longtemps. Au Moyen Âge et au début de la Renaissance, tous les problèmes mentaux sont présumés relever d’une punition divine et traités comme tels.
Avant l’époque des Lumières, ce n’est pas chez les médecins mais chez Montaigne que l’on trouve un commentaire du rôle de l’âge sur les facultés de l’esprit : « Tantôt c’est le corps qui capitule le premier devant la vieillesse ; tantôt c’est l’âme. J’en ai vu beaucoup qui ont eu le cerveau affaibli avant l’estomac et les jambes ; et comme c’est un mal peu sensible pour celui qui en est atteint, qui ne se voit pas facilement, il en est d’autant plus redoutable. » (Essais, Livre I, chapitre 57).
Alors que la pédiatrie constitue une spécialité médicale à part entière, reconnaissant les spécificités des problèmes infantiles, physiologiques comme pathologiques, la gériatrie a tardé à se démarquer des autres spécialités. De nombreuses maladies, dont la fréquence augmente avec l’âge, ont été confondues avec le vieillissement normal. Or ce n’est pas parce qu’un processus devient fréquent qu’il est obligatoire. Bien des personnes âgées se fracturent le fémur, mais ce n’est pas une caractéristique nécessaire du grand âge !
C’est donc lentement qu’a émergé cette distinction entre un vieillissement pathologique et la sénescence*, et ce n’est sans doute pas un hasard si nous ne disposons pas de définition unanime de la vieillesse. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) retient le critère – pour le moins arbitraire – de 65 ans et plus ; chiffre qui, curieusement, était celui utilisé, sans aucun fondement, pour distinguer les démences dites préséniles, dont la maladie d’Alzheimer ou celle de Pick, des démences séniles, distinguo qui a retardé la prise en compte du problème et qui, heureusement, a cessé d’être d’actualité. Soixante-cinq ans, c’est aussi l’âge de cessation de l’activité professionnelle dans un grand nombre de pays ; chiffre que les politiciens aimeraient relever ou qu’ils augmentent déjà pour des logiques économiques alors que le chiffre réel de l’âge de la pension est souvent plus bas, pour diverses raisons, notamment celles de pénibilité et de handicaps ou encore d’évolution rapide des technologies, peu compatible avec la constante remise en question d’un travail qu’un âge avancé rend ardue. Retenir un âge de 75 ans pour définir la vieillesse nous semble plus pertinent. C’est dans cette tranche d’âge que de nombreuses personnes commencent à recourir à des services d’aide ou à des équipements domestiques afin de maintenir leur autonomie. Ce sont des critères qui sont aisés à objectiver.
Certains ont proposé de définir la vieillesse par l’âge moyen des personnes hospitalisées en institution gériatrique. Il oscille autour de 85 ans, avec d’importantes différences selon les pays, les structures familiales et les moyens économiques. Ce critère nous semble inadéquat car il transforme toutes les vieillesses en pathologies. En outre, il ne tient pas compte des raisons qui ont contraint ce séjour gériatrique : maladie intercurrente, pathologie neurodégénérative, problèmes sociaux, précarité financière, isolement familial… Enfin, il a le défaut d’envisager la prise en charge du patient à un moment tardif, quand les défaillances s’accentuent ou se multiplient, rendant laborieuses les interventions.
Quoi qu’il en soit, le vieillissement normal est un processus complexe, plurifactoriel, lent et progressif, caractérisé par une diminution des réserves permettant à l’organisme de s’adapter à des agressions (efforts, maladies aiguës, stress…). Cette réduction varie d’un organe à l’autre et selon les individus, selon leur passé (maladies antérieures, éventuelles séquelles, traumatismes…) et les facteurs de risques auxquels ils ont été exposés.
Les mécanismes à l’origine du vieillissement sont loin d’être élucidés. Des facteurs génétiques interviennent. Il existe des familles dans lesquelles, sauf accident, de nombreux individus vivent longtemps, plaidant pour un terrain héréditaire associé à cette longévité accrue. A contrario, il existe d’exceptionnelles maladies génétiques, les progéria, qui mènent à un vieillissement rapide de l’organisme : dès les premières années de la vie, les enfants présentent des symptômes rencontrés à un âge avancé (perte de cheveux, rides, athérosclérose, problèmes cardiaques). Ces maladies servent de modèles pour étudier les mécanismes impliqués dans le vieillissement.
La manipulation de gènes chez l’animal a accru la longévité chez des vers, des mouches ou des souris, permettant aussi de progresser sur les facteurs contrôlant le vieillissement. Des modifications de l’environnement (en particulier des réductions caloriques) ont permis d’augmenter la durée de vie des animaux. Une fois de plus, on constate que des éléments internes, génétiques, et externes, environnementaux, sont intriqués de manière complexe.
Quand les cellules vieillissent et meurent…
Toutes les cellules ne sont pas égales face à l’âge. Si certaines peuvent se reproduire quasi indéfiniment, d’autres ont une capacité de renouvellement limitée : à chaque division, l’extrémité du chromosome est amputée d’un court fragment. À un moment, l’altération est telle qu’elle n’autorise plus de nouvelle division. On a parlé, pour ces cellules, d’horloge biologique qui définirait la longévité de l’espèce et, au sein de celle-ci, des individus. D’autres cellules ont une capacité de renouvellement faible ou nulle. C’est le cas des neurones*.
Comment les cellules meurent-elles ? Les chercheurs ont identifié trois grandes voies :
• L’apoptose*.
Dans certains cas, la cellule déclenche sa propre destruction en réponse à un signal. C’est ce que l’on appelle l’apoptose. Contrairement à la nécrose cellulaire, pathologique, l’apoptose ne s’accompagne pas d’inflammation. C’est une voie physiologique, sous contrôle génétique. Elle est d’ailleurs nécessaire à la survie des organismes multicellulaires qui doivent rester en équilibre entre une prolifération des cellules, pour remplacer celles qui s’abîment, et leur destruction, quand elles sont devenues inutiles ou quand elles ont perdu leurs compétences. C’est un moyen de prévenir une prolifération anormale comme celle observée dans les cancers.
Constatant un phénomène d’apoptose dans les maladies neurodégénératives, des recherches ont été effectuées car, en contrôlant mieux ce processus, on espérait ralentir cette mort cellulaire. Toutefois, le mécanisme s’avère complexe, dirigé par de nombreux gènes, lesquels déterminent un niveau de régulation d’une extrême précision dans cet équilibre instable entre multiplication et contrôle.
Certains chercheurs pensent que les accumulations anormales de protéines, comme celles observées au sein des plaques amyloïdes dans la maladie d’Alzheimer (voir chapitre 3), pourraient favoriser la mort cellulaire par apoptose, ce qui entamerait le processus pathologique. Mais la mort cellulaire par apoptose est-elle à l’origine de ces maladies ou, au contraire – et plus probablement – est-elle leur conséquence ? Si la question n’est pas tranchée, les espoirs fondés sur cette piste s’en trouvent relativisés à ce jour.
• Le stress oxydatif.
Pour expliquer l’altération cellulaire, on a également évoqué la piste du stress oxydatif. Les réactions chimiques nécessaires aux cellules pour exercer leurs fonctions entraînent la production de radicaux libres (substrats nocifs générés par l’oxygène que nous respirons et par les réactions chimiques qui en dérivent). Ces radicaux sont très réactifs et endommagent les cellules au niveau de leurs parois, de leur noyau ou de leur cytoplasme.
L’organisme possède des moyens pour s’en défendre. Des protéines spécifiques existent pour capturer ces radicaux toxiques et empêcher leur diffusion. Mais, ici aussi, l’équilibre est précaire entre agression et défense. Il peut être perturbé si trop de radicaux libres sont produits (rôle de l’environnement ?) ou si les systèmes de protection s’érodent (du fait de l’âge, de maladies, d’un déficit immunitaire, voire d’autres événements de vie). Outre leurs effets délétères immédiats sur la cellule, ces radicaux pourraient, selon certains, modifier la configuration normale des protéines, les rendant impossibles à éliminer.
Cette idée de stress oxydatif s’est répandue dans le grand public, non sans confusion avec le mot « stress », connu de tous, mais qui, dans cette acception, n’a pas la même signification ! Le stress, au sens commun du terme, est une réponse normale de l’organisme face à une situation problématique. Il s’agit d’une réaction qui permet au sujet de survivre à un danger ou de surmonter une difficulté. C’est une réalité subjective dépendant de la situation stressante et de sa perception par l’individu, en fonction du contrôle qu’il en a et de sa possibilité d’anticiper le problème. Le stress n’est pas bon ou mauvais en soi : un stress aigu, par la sécrétion d’adrénaline qu’il entraîne, mobilise l’organisme (accélération du rythme cardiaque, hausse de la tension artérielle, contraction musculaire, libération de glucose…) et permet de surmonter une épreuve difficile. Mais, en devenant chronique, il exerce des effets néfastes : les hormones produites en excès bloquent les mécanismes physiologiques, d’où la cohorte de symptômes reliés au stress, parmi lesquels on retrouve l’épuisement, la dépression, les maladies cardiaques ou encore la faiblesse immunitaire.
Le stress oxydatif cellulaire est très différent. Il semble jouer un rôle majeur dans l’apparition des maladies liées à l’âge, voire dans la sénescence* (donc indépendamment d’un processus pathologique). De nombreuses preuves ont confirmé son rôle. En laboratoire, on a été capable de le limiter par des substances qualifiées d’antioxydantes. Cela pourrait constituer une piste thérapeutique intéressante. De nombreuses firmes, pharmaceutiques, alimentaires ou commerciales, l’ont compris et ont étudié, plus ou moins sérieusement, d’innombrables molécules « antioxydantes » pour en souligner le rôle protecteur, réel ou supposé. On connaît des substances antioxydantes : extraits purifiés de Ginkgo Biloba ou vitamine E, par exemple. Leur effet semble limité mais de nombreuses inconnues subsistent : quand prescrire ces traitements ? Faut-il les entreprendre préventivement ou attendre les premiers symptômes ? À quelle posologie ? Sont-ils encore efficaces une fois la maladie installée ? Valent-ils pour toutes les pathologies dégénératives ?
Des études complémentaires seront nécessaires pour définir la valeur et le rôle de ces molécules. Elles devraient impérativement être réalisées car l’approche est prometteuse. Toutefois, les ajouts de ces antioxydants dans des compléments alimentaires ou vitaminés, que l’on nous propose déjà, sont trop peu dosés (leur production a un coût) et ne servent qu’à attirer les clients, sans aucune preuve d’efficience avérée. Si certaines substances antioxydantes doivent, un jour, démontrer leur efficacité, ce sera convenablement purifiées et correctement dosées.
• Le système ubiquitine-protéasome.
À l’intérieur des cellules, il existe un mécanisme chargé d’éliminer des protéines déficientes : il s’agit du système appelé ubiquitine-protéasome. Une petite protéine, l’ubiquitine, marque les protéines défaillantes en vue de leur destruction par une structure, le protéasome. Celui-ci s’attaque à toute protéine marquée, la décomposant en substrats plus petits qui seront réutilisés dans de nouvelles combinaisons. Le marqueur qu’est l’ubiquitine est, lui aussi, libéré et ira identifier d’autres molécules qui dysfonctionnent, et seront détruites à leur tour. Comme on peut le présumer, ce système nécessite un équilibre délicat. Lorsque ses capacités d’élimination sont dépassées, pour des raisons internes ou externes, des protéines malformées ou inefficaces peuvent s’accumuler dans la cellule et perturber son fonctionnement.
Il se fait que l’ubiquitine se retrouve dans certains agrégats observés dans des maladies dégénératives. Cette observation a incité des chercheurs à suspecter un dysfonctionnement du système ubiquitine-protéasome dans leur genèse. C’est une possibilité mais, comme pour l’apoptose, il est difficile de savoir ce qui est la cause ou la conséquence du processus pathologique.
Ces grandes voies sont mieux connues mais leur complexité n’autorise pas, à court terme, de possibilité thérapeutique. Les recherches se poursuivent, riches en possibilités, y compris dans d’autres domaines, dont la cancérologie.
Les rides du cerveau
Un dogme obsolète
On a longtemps cru que le vieillissement des neurones différait totalement de celui des cellules somatiques. Un dogme neurologique a prévalu affirmant que les neurones ne sont pas susceptibles de se reproduire après la neurogenèse qui se produit durant les trois premiers mois de vie du futur enfant. Toute perte neuronale était dès lors irréversible, ce qui était catastrophique, surtout quand on ajoutait que nous perdions des milliers ou des dizaines de milliers de neurones chaque jour… Si le stock définitif est en place à la naissance, le nombre total ne pouvait que décroître, même en l’absence d’accident ou de traumatisme, ce qui apportait une explication au déclin intellectuel des seniors et un éclaircissement sur l’atrophie cérébrale observée lors d’autopsies de personnes âgées. Au passage, cela renforçait une attitude fataliste.
Ce dogme est à nuancer, de même que les conclusions que l’on en tirait. S’il est vrai que l’apprentissage, notamment chez l’enfant, s’accompagne d’une disparition de nombreux neurones, cette perte est largement compensée par la multiplication des synapses* et des connexions entre cellules cérébrales. À un maillage dense, mais indifférencié, l’apprentissage substitue certaines connexions préférentielles, d’où l’affirmation du célèbre neurobiologiste français Jean-Pierre Changeux (L’homme neuronal, 1983) : « Apprendre, c’est […] éliminer. »
De plus, ces dernières décennies, on a démontré que certaines régions du cerveau pouvaient produire de nouveaux neurones, notamment au niveau de structures impliquées dans la mémoire comme les hippocampes.
En neurologie, la découverte de cellules souches, ancêtres communs aux cellules cérébrales (à l’exception de la microglie), a aussi écorné le dogme : des cellules indifférenciées étaient capables, en proliférant, de renouveler leur population puis de se différencier en neurone, astrocyte ou oligodendrocyte. Elles sont cependant exclusivement retrouvées chez l’embryon et dans certaines zones cérébrales. En outre, leurs capacités de migration dépendent de gènes aux actions antagonistes* qui agissent en cascade. Nous reviendrons dans le chapitre 8 sur les espoirs qu’elles suscitent, et sur les limites actuelles des recherches.
Quand la perte devient-elle anormale ?
Contrairement à ce que l’on pourrait intuitivement penser, la perte neuronale ne semble pas significative dans la sénescence*. Certes, le cerveau âgé diffère, qualitativement et quantitativement, du cerveau jeune, mais il en va de même pour les autres organes. Le vieillissement cérébral comprend une diminution du nombre des neurones et des neurotransmetteurs* ainsi qu’une raréfaction de la substance blanche, compensées par une amélioration des relations neuronales au niveau des synapses.
Des études chez l’animal ont montré que les altérations cellulaires (comme des neurones plus petits) s’observaient avec l’âge, contrebalancées par la richesse dendritique. De plus, on pouvait limiter ce déclin en soumettant l’animal à des stimulations plus riches. Autrement dit, le maintien d’un environnement varié suffit longtemps à compenser les pertes. Voilà encore une piste à explorer, aisée à appliquer, et une manière positive de percevoir l’environnement, qui trouverait ici une version optimiste : multiplions les stimulations, le cerveau en profite !
Sur base de ces recherches, certains ont même affirmé que le vieillissement n’est pas lié aux modifications cérébrales mais à une approche sociétale qui considère comme évident qu’un senior n’a plus besoin d’être stimulé ! La vieillesse découlerait de nos sociétés qui relèguent les vieillards à la marge. Les intégrer à une vie plus active retarderait la sénilité*. Au demeurant, n’était-ce pas ce qui prévalait dans les sociétés traditionnelles où la grand-mère restait utile en cuisinant, tout en surveillant les jeunes enfants ou en partageant avec eux ses compétences, qu’il s’agisse d’éplucher les légumes ou de casser des noix ? On redécouvre aujourd’hui cette évidence. Certains architectes ont développé des projets adoptant ces idées, par exemple dans des maisons « kangourou » qui mixent les contacts générationnels.
Dans les maladies d’évolution lente, le cerveau dispose de temps pour développer d’autres connexions. C’est ce que l’on appelle la plasticité cérébrale : de nouveaux circuits neuronaux se forment, des mécanismes se mettent en place pour compenser le déficit. Un équilibre s’instaure et perdure. Cette capacité se perd progressivement : le temps passant, apparaîtront une moindre flexibilité, une augmentation du temps de réaction, un ralentissement dans le traitement de l’information et une fragilité accrue à de nouveaux incidents.
Les neurones sont des structures délicates, avec un besoin impérieux de glucose et d’oxygène. Grands consommateurs d’oxygène, ils sont sensibles au stress oxydatif. Ils sont également vulnérables aux ions* métalliques, d’où la nécessité d’étudier les métaux présents dans notre environnement, qu’ils soient dispersés dans l’air ou l’eau, ou dans l’alimentation. Chacun connaît les particules fines générées par le trafic automobile et ses effets sur la santé par le biais de l’inhalation respiratoire. De nombreux métaux sont toutefois nécessaires aux fonctions vitales, dont le fer, le cuivre et le zinc. Leur concentration précise dans l’organisme est agencée par de nombreuses protéines. En carence ou en excès, ils peuvent altérer les neurones. Plusieurs études ont démontré que l’accumulation du fer dans le cerveau, avec l’âge, pouvait constituer une source de stress oxydatif et déclencher (chez l’animal) un processus dégénératif. D’autres métaux, sans fonction biologique, ne peuvent exercer que des fonctions toxiques : c’est le cas de l’aluminium, incriminé dans la maladie d’Alzheimer – sans que cela soit réellement prouvé –, du mercure, du plomb, du cadmium ou du manganèse – dont le rôle est, par contre, avéré dans la maladie de Parkinson. La plus grande prudence est requise dans ce domaine environnemental, influencé par la pollution urbaine et industrielle. Une meilleure compréhension du risque lié à l’exposition aux métaux permettrait une prévention par une réduction de la pollution, dans le domaine du possible, mais aussi en déchiffrant comment ces métaux franchissent la barrière hémato-encéphalique et se retrouvent dans le cerveau. Des pistes médicamenteuses pour réduire ce passage pourraient être envisagées.