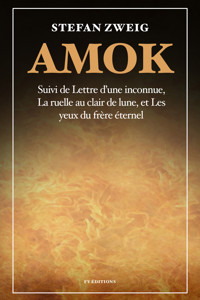
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: FV Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Publiée pour la première fois en 1922, Amok raconte l'histoire d'un médecin en proie à une passion dévorante. Se livrant à un récit confessionnel, le docteur K., dévoile au lecteur la façon dont il a sombré peu à peu dans une folie destructrice. Dans la préface signée par Romain Rolland, il est écrit qu'il est ici question de « l'enfer de la passion au fond duquel se tord, brûlé, mais éclairé par les flammes de l'abîme, l'être essentiel, la vie cachée. » Dans cette nouvelle édition dont la mise en page a été optimisée afin d'en faciliter la lecture, cette nouvelle est suivie par trois autres : Lettre d'une inconnue, La ruelle au clair de lune et Les yeux du frère éternel, texte présent dans le recueil original mais qui fut écarté des éditions publiées après 1930.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Amok ou le fou de Malaisie
Suivi de « Lettre d’une inconnue », « La ruelle au clair de lune » et « Les yeux du frère éternel »
Stefan Zweig
Traduction parAlzir Hella
Traduction parOlivier Bournac
Préface deRomain Rolland
FV Éditions
Table des matières
Préface à la première édition française
AMOK OU LE FOU DE MALAISIE
LETTRE D’UNE INCONNUE
LA RUELLE AU CLAIR DE LUNE
LES YEUX DU FRÈRE ÉTERNEL
Préface à la première édition française
L’effort est remarquable en France, depuis la fin de la guerre, pour connaître l’art étranger. Après le blocus de la pensée nationale et son régime de restrictions, la faim s’est réveillée plus vive, et, les frontières rouvertes, elle a accepté de toutes mains, les aliments. Cette jeune vie vorace, qui renaît, est un heureux symptôme, qui rappelle l’ardente curiosité européenne de la génération française d’il y a un siècle, celle de 1820 à 1880, qui se réunissait autour du Globe et désignait Ampère pour saluer Goethe à Weimar. Il faut s’en féliciter, mais il faut se hâter d’en jouir et savoir mettre le moment à profit. Le moment est bref. Il est de règle qu’après s’être dispersé au-dehors l’esprit se concentre de nouveau en sa maison fermée. Tâchons qu’il ait, avant, fait provision des meilleurs fruits de la pensée du monde !
Or c’est là qu’est le danger. L’esprit ne sait pas toujours choisir. La pensée étrangère a un cuisant désir, malgré les critiques qu’elle en fait, des suffrages de la France. Le jugement de Paris est revêtu d’un traditionnel pouvoir de consécration. Aussi, à peine les portes entrebâillées par la paix, se sont rués en France, avec quelques vrais artistes, quantité de commis voyageurs de l’art étranger. Il en est résulté de fâcheuses méprises. Les plus prompts et les plus bruyants ont accaparé les premières places ; et l’on a pu craindre qu’ils ne gardassent toute la table. Certains des artistes les plus probes et les plus recueillis, ayant le dégoût de ces exhibitions de salons et de banquets, sont restés à l’écart et, s’oubliant eux-mêmes, ont été oubliés. Le plus paradoxal était que, tandis que Paris faisait fête à tels écrivains allemands qui avaient participé à tous les égarements de la fureur nationaliste contre la France, les vrais amis de la France, ceux qui avaient été pendant la guerre les fidèles gardiens de l’esprit européen, ont été – à une ou deux exceptions près – systématiquement laissés de côté.
Ainsi, l’un des plus purs artistes d’Allemagne, un poète et un nouvelliste de la lignée des Goethe et des Gottfried Keller, Hermann Hesse, n’a commencé que d’hier à se faire place en France. Trop éternel en la sérénité de sa forme et de sa pensée pour n’être pas dédaigné par les modes du jour ; et trop dédaigneux d’elles pour ne point se passer de leurs suffrages grossiers, dans son ascétique et noble retraite de Montagnola.
Ainsi, également, il a fallu attendre sept ans après la paix pour que paraisse en librairie française, grâce au goût éclairé des directeurs de la maison Stock, la première œuvre du grand écrivain autrichien, qui représente, dans les lettres allemandes, avec le plus d’éclat et une fidélité constante, l’esprit européen, les plus hautes traditions d’art et d’intelligence de la vieille Allemagne, celle dont la basilique est la sainte Weimar.
* * *
C’est pour moi un devoir fraternel de présenter au public français Stefan Zweig. À vrai dire, je l’ai déjà fait, dans mon livre de guerre – de paix pendant la guerre – Les Précurseurs, à propos de son beau drame, Jeremias, symbole de l’éternelle tragédie de l’humanité crucifiant les prophètes qui veulent la sauver : Vox clamantis in deserto.
Et il importe que la France n’oublie point tout ce que Stefan Zweig a été pour elle, pour son art : le parfait traducteur et critique, qui répandit en Allemagne les poèmes de Baudelaire, Rimbaud, Samain, Marceline Desbordes-Valmore, l’œuvre entière de Verhaeren, qui lui doit son rayonnement dans toute l’Europe centrale – le compagnon, pendant la guerre, de l’auteur de Jean-Christophe et de Clerambault – celui en qui s’est incarnée, aux jours les plus sombres de la tourmente européenne, quand tout semblait détruit, la foi inaltérable en la communauté intellectuelle de l’Europe, la grande Amitié de l’Esprit, qui ne connaît pas de frontières.
Mais Stefan Zweig n’est pas de ces écrivains qui n’ont été soulevés au-dessus du niveau que par les flots de la guerre et par l’effort désespéré pour réagir contre elle. Il est l’artiste-né, chez qui l’activité créatrice est indépendante de la guerre et de la paix et de toutes les conditions extérieures, celui qui existe pour créer : le poète, au sens goethéen. Celui pour qui la vie est la substance de l’art ; et l’art est le regard qui plonge au cœur de la vie. Il ne dépend de rien, et rien ne lui est étranger : aucune forme de l’art, aucune forme de la vie.
Poète, et déjà illustre dès l’adolescence, essayiste, critique, dramaturge, romancier, il a touché toutes les cordes, en maître.
Le trait le plus frappant de sa personnalité d’artiste est la passion de connaître, la curiosité sans relâche et jamais apaisée, ce démon de voir et de savoir et de vivre toutes les vies, qui a fait de lui un Fliegender Holländer, un pèlerin, passionné et toujours en voyage, parcourant tous les champs de la civilisation, observant et notant, écrivant ses œuvres les plus intimes dans des hôtels de passage, dévorant tous les livres et de tous les pays, raflant les autographes, dont il a rassemblé, en sa belle demeure sur la colline abrupte qui domine la ville de Mozart, une collection magnifique, dans sa fièvre de découvrir le secret des grands hommes, des grandes passions, des grandes créations, ce qu’ils taisent au public, ce qu’ils n’ont pas avoué – l’amoureux indiscret et pieux du génie, qui force son mystère, mais afin de mieux l’aimer –, le poète armé de la clef redoutable du Dr Freud, dont il fut l’admirateur et l’ami de la première heure, à qui il a dédié son plus grand livre de critique : Le Combat avec le Démon –, le chasseur d’âmes. Mais celles qu’il prend, il les prend vivantes, il ne les tue point. À pas feutrés, il erre à l’orée des bois : et, tout en feuilletant un beau livre, il écoute, il guette, le cœur battant, les bruits d’ailes, les branches froissées, le gibier qui rentre au nid et au terrier ; et sa vie est mêlée à celle de la forêt…
On a dit que la sympathie est la clef de la connaissance. Cela est vrai pour Zweig. Et vrai, aussi, le contraire : que la connaissance est la clef de la sympathie. Il aime par l’intelligence. Il comprend par le cœur. Et les deux mêlés ensemble font que chez lui, comme chez le personnage d’une des nouvelles qu’on va lire, l’ardente curiosité psychologique a tous les caractères de la « passion charnelle ».
Il en est affamé, dirait-on, comme des heures de fusion, où se résout la dualité, qui l’inquiète en lui, du Blut et du Geist1, de l’instinct vital et de l’esprit.
On peut avancer, sans trop de risques de se tromper, que cette préoccupation sourde, ce besoin à la fois voluptueux et angoissé est le motif central, la raison essentielle du choix qui préside au groupement de ses livres les plus importants d’essais ou de nouvelles, en particulier de celui que j’introduis ici.
* * *
Au sujet d’Amok, je crois devoir faire une remarque préliminaire. L’excellente traduction de MM. Alzir Hella et Olivier Bournac, qui présente au public français ce volume de nouvelles, n’a point conservé la composition et l’ordre établis par l’auteur dans son livre original. Sur cinq nouvelles appartenant à l’Amok allemand, deux seulement ont été maintenues : Amok et Lettre d’une inconnue. On y a joint une nouvelle : Les Yeux du Frère éternel, appartenant à un ordre d’art et de pensée différent. On a cru devoir ainsi, sans doute, répondre au besoin de variété, chez le lecteur français. Mais je le regrette, comme artiste.
La caractéristique principale de Stefan Zweig en art est précisément dans l’importance qu’il attache à la composition non seulement d’une nouvelle ou d’un essai, mais d’un recueil d’essais, d’un groupe de nouvelles. Chaque livre est une harmonie, calculée et réalisée avec un art précis et raffiné. Rien de plus exceptionnel, à notre époque d’incohérence naturelle ou voulue, d’impromptus et d’impressions heurtées. Ce haut et fin sens musical, que ne remarque pas assez l’oreille tumultueuse du temps, est ce qui m’attache le plus à l’œuvre de Zweig. Et je tiens à le mettre en lumière.
Chacun de ses volumes est comme une symphonie, dans une tonalité choisie et en plusieurs morceaux. Son œuvre se divise en séries : chacune est comme un polyptique, dont chaque livre est un volet, qui se relie au panneau central.
En critique, ses deux volumes essentiels sont, jusqu’à présent : Drei Meister (Trois Maîtres), 1920, et Der Kampf mit dem Dämon (Le Combat avec le Démon), 1925. Ils font partie tous deux d’une Typologie des Geistes, d’une classification des familles de l’esprit. Le premier est la psychologie du Romancier (Balzac, Dickens, Dostoïevsky), du romancier de race, de « celui qui crée son Cosmos entier, son univers propre avec ses espèces et ses lois propres de gravitation… » – Le second (Hölderlin, Kleist, Nietzsche) est le Dreiklang, l’accord wagnérien de trois esprits créateurs en lutte avec l’Inquiétude éternelle. Pour mieux le faire ressortir, Zweig, dans son Introduction, y oppose l’accord parfait classique de Goethe, pour qui le « Combat avec le Démon » a été le problème décisif de toute l’existence et qui l’a résolu par la victoire absolue, implacable, sans rémission. Mais Zweig se garde de nier, au nom de l’un des accords, la légitimité de l’autre et la splendeur de ses harmonies. L’un fait mieux valoir l’autre. Tout est juste, tout est sain, qui est beau. Et la grande symphonie est faite de l’harmonie de tous les accords, savamment distribués.
Le cycle des nouvelles comprend, à ce jour, trois beaux groupes, dont chacun est bâti sur un thème principal ; et chacun est précédé, comme d’un prélude, d’un sonnet mélodieux, qui en dégage l’essence.
Le premier : Erstes Erlebnis (Première Épreuve de vie). « Quatre Histoires du pays des enfants » (Vier Geschichten aus Kinderland) (1911) – dédié à Ellen Key – à la mélancolie douce et l’attente angoissée de l’aube matinale…
O süsse Angst der ersten Dämmerungen…
Le second : Amok (1922), dédié à Frans Masereel, l’artiste, l’ami fraternel, est l’enfer de la passion (Unterwelt der Leidenschaften), au fond duquel se tord, brûlé, mais éclairé par les flammes de l’abîme, l’être essentiel, la vie cachée :
« Brûle donc ! Seulement si tu brûles, tu connaîtras dans ton gouffre le monde. La vie ne commence qu’au seuil où le mystère est en acte… »
(Erst wo Geheimnis wirkt, beginnt das Leben…)
Le troisième : Verwirrung der Gefühle (La Confusion des sentiments) (1927), va plus profond encore [… in das dornendichte]
Gestrüpp des Herzens, Wirrnis des Gefülhls…
dans les âmes détruites par le choc, soit momentanément, soit définitivement, et qui livrent leur secret, en succombant. J’avoue mes préférences pour ce livre. Il est, à mon sens, le plus puissant que Zweig ait écrit avec le Kampf mit dem Dämon. Le plus tragique. Le plus humain. Non pas son dernier mot. Car je connais les ressources inépuisables de cet esprit, qui toujours renouvelle son trésor d’expériences, ses provisions de vie, – et toujours en éveil, sans repos exerçant son activité créatrice, n’est jamais satisfait, sait jouir, certes, du succès, et non sans épicurisme, mais sans illusions, n’en est jamais la proie, se juge avec rigueur, voit plus loin, voit plus haut… Remettons-nous-en à lui, de son incessante montée et des plus grandes œuvres que nous ménage son avenir ; mais admirons le présent ! De l’œuvre déjà réalisée, je mets hors de pair, dans le troisième livre de nouvelles, les Vingt-Quatre Heures de la vie d’une femme, et la Destruction d’un cœur. Elles comptent parmi les plus lucides tragédies de la vie moderne, de l’éternelle humanité. La nouvelle Amok y appartient aussi, avec son odeur de fièvre, de sang, de passion et de délire malais.
Je ne veux pas analyser les nouvelles qu’on va lire. Je n’aime pas à me substituer au public. Quand j’étais jeune, j’enrageais contre le conférencier, à la Sarcey, dont le ventre et la faconde encombraient, selon la mode du jour, l’entrée des plus belles pièces classiques. Je lui criais, dans mon cœur : « Ôte-toi de mon soleil !… » Il faut être philistin, pour trouver un plaisir dans tous ces commentaires autour des œuvres d’art. L’œuvre est là. Humez-la ! lampez-la ! Que le public en reçoive, toute pure, l’impression directe ! C’est un crime contre l’art, de la fausser, d’avance…
Donc, je m’en tiens ici à faire connaître non l’œuvre, mais l’atmosphère de l’esprit qui l’a créée, à en faire entrevoir la généreuse ardeur, la passion nomade qui parcourt l’âme humaine, de la base à la cime, dans ses forêts, dans ses replis, dans ses cavernes et sur ses hauts plateaux, qui veut la pénétrer toute. Et qui l’aime, dans toutes ses manifestations. Rien n’est exclu de son avide sympathie. Mais elle va de préférence au plus de vie, au flot de feu créateur.
Dans la préface révélatrice au Combat avec le Démon, que le public français lira prochainement, Zweig, célébrant ceux que le Démon d’inquiétude déchira et ensemença, les génies labourés par le soc de la folie et qui se couvrent de moissons, montre la fausseté de la conception qui les a réduits à des cas pathologiques – « Pathologique n’a de sens, dit-il, que pour l’improductif. » Partout où l’anormal est un principe de force, une source de création, il n’est pas normal, il est supranormal, comme les cyclones et les typhons, qui sont la frénésie de la Nature, son paroxysme, et peut-être sa suprême expression, les Révolutions qui fraient à coups de hache, sur les grands abattis, la route dans la forêt, les sanglantes étapes, où s’acheminent, de l’une à l’autre, les Époques de la Nature.
Par-delà les troubles humains, par-delà l’homme, je sens, chez Stefan Zweig, l’Esprit de la Nature et ses Révolutions, l’éternelle force destructrice, créatrice, « cette valeur, comme il dit, au-dessus de toutes les valeurs, ce sens au-dessus de tous nos sens… :
… Wert über allen Werten, Sinn über unsern Sinnen…
Je serais bien surpris si la suite de sa marche, le développement de son art ne le montraient épousant cet Esprit de la Terre, en des œuvres où s’unisse à la rigueur de l’analyse scientifique le chaud rayonnement du soleil Poésie.
ROMAIN ROLLAND,
Novembre 1926.
1Voir le sonnet qui précède le livre de nouvelles Verwirrung der Gefühle.
Ouvre-toi, monde souterrain des passions1 !
Et vous, ombres rêvées, et pourtant ressenties,
Venez coller vos lèvres brûlantes aux miennes,
Boire à mon sang le sang, et le souffle à ma bouche !
Montez de vos ténèbres crépusculaires,
Et n’ayez nulle honte de l’ombre que dessine autour de vous la peine !
L’amoureux de l’amour veut vivre aussi ses maux,
Ce qui fait votre trouble m’attache aussi à vous.
Seule la passion qui trouve son abîme
Sait embraser ton être jusqu’au fond ;
Seul qui se perd entier est donné à lui-même.
Alors, prends feu ! Seulement si tu t’enflammes,
Tu connaîtras le monde au plus profond de toi !
Car au lieu seul où agit le secret, commence aussi la vie.
1Ce sonnet précédait le recueil Amok, sous-titré Nouvelles d’une passion, publié en 1922. Il était dédié « À Franz Masereel, l’artiste et l’ami fraternel ».
AMOK OU LE FOU DE MALAISIE
(1)
Au mois de mars 1912, il se produisit dans le port de Naples, lors du déchargement d’un grand transatlantique, un étrange accident sur lequel les journaux donnèrent des informations abondantes, mais parées de beaucoup de fantaisie. Bien que passager de l’Océania, il ne me fut pas plus possible qu’aux autres d’être témoin de ce singulier événement, parce qu’il eut lieu la nuit, pendant qu’on faisait du charbon et qu’on débarquait la cargaison et que, pour échapper au bruit, nous étions tous allés à terre passer le temps dans les cafés ou les théâtres. Cependant, à mon avis, certaines hypothèses qu’en ce temps-là je ne livrai pas à la publicité contiennent l’explication vraie de cette scène émouvante ; et maintenant l’éloignement des années m’autorise sans doute à tirer parti d’un entretien confidentiel qui précéda immédiatement ce curieux épisode.
Lorsque, à l’agence maritime de Calcutta2, je voulus retenir une place sur l’Océania pour rentrer en Europe, l’employé haussa les épaules en signe de regret : il ne savait pas s’il lui serait possible de m’assurer une cabine, car à la veille de la saison des pluies, le navire était d’ordinaire archi-complet dès son départ d’Australie ; et le commis devait attendre, pour me répondre, une dépêche de Singapour.
Le lendemain, il me donna l’agréable nouvelle qu’il pouvait me réserver une place ; à la vérité, ce n’était qu’une cabine peu confortable, située sous le pont et au milieu du navire. Comme j’étais impatient de rentrer dans mon pays, je n’hésitai pas longtemps, et je retins la cabine.
L’employé ne m’avait pas trompé. Le navire était surchargé et la cabine mauvaise : c’était un étroit quadrilatère, resserré près de la machine et uniquement éclairé par la lumière trouble d’un hublot rond. L’air épais et stagnant sentait l’huile et le moisi : on ne pouvait échapper un instant au bourdonnement du ventilateur électrique qui, comme une chauve-souris d’acier devenue folle, tournait au-dessus de votre front. En bas, la machine ahanait et geignait, comme un porteur de charbon qui remonte sans cesse, tout haletant, le même escalier ; et, d’en haut, on entendait continuellement glisser sur le pont le va-et-vient des promeneurs. Aussi à peine avais-je introduit ma malle dans cette sorte de tombeau, cloisonné de traverses grises, aux émanations fétides, que je courus me réfugier sur le pont ; et, sortant de la profondeur, j’aspirai comme de l’ambre le vent de terre doux et tiède qui soufflait au-dessus des flots.
Mais le pont, lui aussi, n’était que gêne et tapage : c’était un papillonnement, une mêlée de promeneurs qui, dans l’agitation nerveuse d’hommes enfermés, condamnés à l’inaction, montaient, descendaient et papotaient sans répit. Le badinage gazouillant des femmes, la circulation incessante sur l’étroit couloir du pont où l’essaim des passants déferlait au pied des chaises dans la rumeur des conversations pour n’aboutir qu’à retomber sur lui-même, tout cela me causait je ne sais quel malaise.
Je venais de parcourir un monde nouveau, et j’avais gardé dans l’esprit une foule d’images qui, l’une l’autre, se pressaient d’une hâte furieuse. À présent, je voulais y réfléchir, clarifier, ordonner et donner une forme au tumultueux univers qui s’était précipité dans mes yeux ; mais ici, sur ce boulevard envahi par une multitude, il n’y avait pas une minute de repos et de tranquillité. Si je prenais un livre, les lignes du texte se brouillaient sous les ombres mouvantes de la foule qui passait en bavardant. Impossible de se recueillir un peu dans cette rue sans ombre qui marchait avec le navire.
Durant trois jours, je m’y efforçais et je considérais avec résignation les hommes et la mer. Mais la mer restait pareille à elle-même, bleue et vide, sauf au coucher du soleil, qui l’inondait soudain de toutes les couleurs ; quant aux hommes, je les connus tous, parfaitement, au bout de trois fois vingt-quatre heures. Chaque visage me devint familier jusqu’à satiété ; le rire aigu des femmes ne m’intéressait plus ; la dispute tapageuse de deux officiers hollandais qui étaient mes voisins ne m’irritait plus. Il ne me restait qu’à me réfugier ailleurs ; mais ma cabine était brûlante et chargée de vapeur ; et dans le salon, de jeunes Anglaises produisaient sans relâche leur méchant pianotage, accompagnateur de valses sans harmonie. Finalement, j’intervertis résolument l’ordre des temps, et je descendis dans la cabine dès l’après-midi, après m’être étourdi avec quelques verres de bière, afin de pouvoir dormir pendant que les autres dînaient et dansaient.
Lorsque je me réveillai, tout était sombre et moite dans le petit cercueil qu’était ma cabine. Comme j’avais arrêté le ventilateur, l’air gras et humide brûlait mes tempes. Mes sens étaient comme assoupis : il me fallut plusieurs minutes pour reconnaître le moment et l’endroit où j’étais. Il était, à coup sûr, plus de minuit déjà, car je n’entendais ni la musique, ni le glissement continuel des pas. Seule la machine, cœur essoufflé du Léviathan, poussait toujours, en haletant, la carcasse crépitante du navire vers l’invisible.
Je montai sur le pont en tâtonnant. Il était désert. Et, comme je levais mon regard vers la tour fumante de la cheminée et vers les mâts dressés tels des fantômes, une clarté magique m’emplit brusquement les yeux. Le firmament brillait. Autour des étoiles qui le piquaient de scintillations blanches, il y avait de l’obscurité, mais malgré tout, le ciel étincelait. On eût dit qu’un rideau de velours était placé là, devant une formidable lumière, comme si les étoiles n’étaient que des fissures et des lucarnes à travers lesquelles passait la lueur de cette indescriptible clarté. Jamais je n’avais vu le ciel comme cette nuit-là, d’un bleu d’acier si métallique et pourtant tout éclatant, tout rayonnant, tout bruissant et tout débordant de lumière, d’une lumière qui tombait, comme voilée, de la lune et des étoiles, et qui semblait brûler, en quelque sorte, à un foyer mystérieux. Comme une laque blanche, toutes les lignes du navire brillaient crûment au clair de lune, sur le velours sombre de la mer ; les cordages, les vergues, tous les apparaux, tous les contours disparaissaient dans cette splendeur flottante : les lumières des mâts et, plus haut encore, l’œil rond de la vigie semblaient suspendus dans le vide, comme de pâles étoiles terrestres parmi les radieuses étoiles du ciel.
Précisément, au-dessus de ma tête, la constellation magique de la Croix du Sud était fixée dans l’infini, avec d’éblouissants clous de diamant, et il semblait qu’elle se déplaçât, alors que c’était le navire seul qui créait le mouvement, lui qui, se balançant doucement, la poitrine haletante, montant et descendant comme un gigantesque nageur, se frayait son chemin au gré des sombres vagues. J’étais debout et je regardais en l’air : j’avais l’impression d’être dans un bain, où de l’eau chaude tombe d’en haut sur vous, avec cette différence qu’ici c’était de la lumière qui coulait, blanche et tiède, sur mes mains, qui m’enveloppait doucement les épaules et la tête et qui, en quelque sorte, paraissait vouloir pénétrer dans mon être, car toute torpeur s’était brusquement éloignée de moi. Je respirais, délivré, en toute sérénité ; et avec une volupté neuve, je savourais sur mes lèvres, comme un pur breuvage, l’air moelleux, clarifié et légèrement enivrant qui portait en lui l’haleine des fruits et le parfum des îles lointaines. Maintenant, pour la première fois depuis que j’étais à bord, le pur désir de la rêverie s’empara de moi, ainsi que cet autre désir, plus sensuel, qui me faisait aspirer à livrer, comme une femme, mon corps à cette mollesse qui me pressait de toutes parts. Je voulus m’étendre, le regard tourné vers les blancs hiéroglyphes là-haut, mais les fauteuils de repos, les chaises de pont étaient enlevés, et nulle part, sur le pont-promenade désert, il n’y avait de place pour s’adonner à une calme rêverie.
C’est ainsi qu’en tâtonnant je m’approchai peu à peu de la proue du navire, complètement aveuglé par la lumière qui semblait tomber des choses, avec une vivacité toujours plus grande pour pénétrer en moi. Cette lumière des étoiles, d’une blancheur glacée et d’un éclat éblouissant, me faisait déjà presque mal ; mais je voulais m’enfouir quelque part dans l’ombre, m’étendre sur une natte, ne plus sentir en moi, mais simplement au-dessus de moi, ce rayonnement réfléchi par les choses, tout comme l’on regarde un paysage de l’intérieur d’une chambre plongée dans l’obscurité. Enfin, trébuchant aux cordages et passant contre les étais de fer, j’atteignis le bordage et regardai la proue du navire s’avancer dans l’ombre, et la clarté liquide de la lune jaillir, en écumant, des deux côtés de l’éperon. Toujours cette charrue marine se relevait et s’enfonçait de nouveau dans cette glèbe de flots noirs ; et dans ce jeu étincelant, je sentais toute la douleur de l’élément vaincu, je sentais toute la joie de la force terrestre. Au sein de cette contemplation, j’avais oublié le temps : y avait-il une heure que j’étais ainsi contre le bastingage, ou y avait-il seulement quelques minutes ? Au gré de l’oscillation, le gigantesque berceau du navire me balançait et m’emportait au-delà du temps. Et je sentais seulement venir en moi une lassitude, qui était comme une volupté. Je voulais dormir, rêver, et cependant ne pas m’éloigner de cette magie, ne pas redescendre dans mon cercueil. Involontairement, mon pied tâta sous moi un paquet de cordages. Je m’y assis, les yeux fermés, mais non remplis d’ombre, car sur eux et sur moi rayonnait l’éclat argenté. Au-dessous, je sentais l’eau bruire doucement, et au-dessus de moi, avec une résonance imperceptible, le blanc écoulement de ce monde. Petit à petit, ce murmure s’insinua dans mes veines, et je perdis la conscience de moi-même ; je ne savais plus si cette haleine était la mienne ou si c’était les battements du cœur lointain du navire ; j’étais emporté et anéanti dans le murmure continuel de la minuit.
Une légère toux sèche, tout près de moi, me fit sursauter. Je sortis, effrayé, de la rêverie qui m’avait presque enivré. Mes yeux, aveuglés par la clarté blanche qui tombait sur mes paupières depuis longtemps fermées, clignotèrent pour tâcher d’y voir : tout en face de moi, dans l’ombre du bastingage, brillait comme le reflet d’une paire de lunettes, et voici que jaillit une épaisse et ronde étincelle, qui venait du brasillement d’une pipe. Lorsque je m’étais assis, regardant uniquement l’éperon écumeux du navire au-dessous de moi, et vers le haut la Croix du Sud, je ne m’étais pas aperçu de la présence de ce voisin, qui avait dû passer ici tout ce temps dans l’immobilité. Involontairement, et l’esprit encore engourdi, je dis, en allemand : « Pardon. » – « Il n’y a pas de quoi », répondit une voix sortie des ténèbres.
Je ne saurais dire combien étrange et sinistre à la fois était ce voisinage muet, dans l’obscurité, tout près de quelqu’un que l’on ne voyait pas. Malgré moi, j’avais l’impression que cet homme me regardait fixement, de même que j’avais les yeux fixés sur lui ; mais la lumière qui était au-dessus de nous, ce flot de lumière à l’étincelante blancheur, était si forte qu’aucun de nous ne pouvait apercevoir autre chose qu’une silhouette dans l’ombre. Il me semblait seulement entendre sa respiration, et l’aspiration sifflante des bouffées de sa pipe.
Le silence était insupportable ; j’aurais bien voulu m’en aller, mais cela me paraissait trop brusque, trop soudain. Dans mon embarras, je pris une cigarette. L’allumette craqua, et, pendant une seconde, une lueur palpita dans l’étroit espace. J’aperçus alors, derrière des verres de lunettes, une figure inconnue que je n’avais jamais vue à bord ni pendant mes repas, ni au cours de la promenade ; et, soit que la flamme soudaine me fît mal aux yeux, soit que ce fût une hallucination, elle me parut affreusement bouleversée, lugubre et semblable à celle d’un gnome. Mais avant que j’eusse discerné les détails, l’obscurité engloutit de nouveau les traits éclairés un court instant, et je ne vis plus qu’une sombre silhouette affaissée dans l’ombre et parfois aussi, se détachant dans le vide, le rouge anneau de feu de la pipe. Nous restions sans parler, et ce silence était lourd et accablant comme l’air des tropiques.
Enfin je ne pus y tenir davantage ; je me levai et je dis poliment : « Bonne nuit. » – « Bonne nuit », répondit du sein de l’obscurité une voix enrouée, dure et comme rouillée.
Je marchai péniblement, en trébuchant à travers les agrès et les madriers. Voici que, derrière moi, un pas retentit, rapide et incertain. C’était mon voisin. Involontairement, je m’arrêtai. Il ne s’approcha pas tout à fait de moi, et dans l’obscurité, je sentais en sa marche comme une angoisse et un accablement.
« Excusez-moi, dit-il d’une voix précipitée, si je vous adresse une prière. Je… je… » – il balbutia et fut obligé de s’interrompre, tant il était embarrassé – « je… j’ai des raisons… personnelles… tout à fait personnelles de me retirer ici… Un deuil… J’évite la société, à bord… Je ne parle pas pour vous… non, non… Je voudrais seulement vous prier… Vous m’obligeriez beaucoup si vous ne disiez à personne, sur le navire, que vous m’avez vu ici… Ce sont… disons… des raisons personnelles qui m’empêchent maintenant de fréquenter les gens… Oui… maintenant… maintenant… il me serait désagréable que vous disiez qu’une personne, ici la nuit… que je… » La parole lui manqua de nouveau. Je mis fin à son embarras en m’empressant de lui assurer que j’accomplirais son désir. Nous échangeâmes une poignée de main. Puis je rentrai dans ma cabine, et je dormis d’un sommeil lourd, étrangement agité et rempli de visions confuses.
Je tins ma promesse et ne parlai à personne sur le bateau de ma singulière rencontre, bien que la tentation en fût grande, car au cours d’une traversée, la moindre chose devient un événement : une voile à l’horizon, un dauphin qui saute, un flirt nouvellement découvert, une frivole plaisanterie. En même temps, la curiosité me tourmentait d’être mieux renseigné sur cet homme peu banal : je fouillai la liste des passagers pour y découvrir un nom qui pût être le sien ; je passai les gens en revue, comme s’ils pouvaient être en relations avec lui. Tout le jour, je fus en proie à une impatiente nervosité, et j’avais hâte que le soir fût là pour voir si je le rencontrerais de nouveau. Les énigmes psychologiques ont sur moi une sorte de pouvoir inquiétant ; je brûle dans tout mon être de découvrir le rapport des choses, et des individus singuliers peuvent par leur seule présence déchaîner en moi une passion de savoir qui n’est guère moins vive que le désir passionné de posséder une femme. La journée me parut longue, vide, et elle s’émietta entre mes doigts. Je me couchai de bonne heure : je savais que je m’éveillerais à minuit, que cela m’arracherait au sommeil.
Et en effet, je m’éveillai à la même heure que la veille. Sur le cadran phosphorescent de ma montre3, les deux aiguilles se recouvraient, ne formant qu’un seul trait lumineux. Je sortis à la hâte de mon étouffante cabine pour rencontrer une nuit plus étouffante encore.
Les étoiles brillaient comme la veille, et elles répandaient une lumière diffuse sur le navire vibrant ; très haut, dans le ciel, flambait la Croix du Sud. Tout était comme la veille, car aux tropiques, les jours et les nuits se ressemblent comme de véritables jumeaux, beaucoup plus que sous nos latitudes ; mais le bercement fluide, langoureux et rêveur de la veille n’était plus en moi. Quelque chose m’attirait, me troublait, et je savais vers où j’étais attiré : vers les étais noirs du bordage, afin de savoir si cet homme mystérieux y était encore, immobile, assis. En haut, retentit la cloche du navire ; alors je me laissai entraîner. Pas à pas, partagé entre l’aversion et le désir, je ne résistai plus. Je n’étais pas encore arrivé à l’étrave que, soudain, j’y vis fulgurer quelque chose comme un œil rouge : la pipe… Donc il était assis là !
Malgré moi, j’eus un mouvement d’effroi, et je m’arrêtai. Un instant de plus, et j’allais partir. Voici que là-bas, dans l’ombre, quelque chose s’agita, se leva, fit deux pas, et soudain j’entendis juste devant moi sa voix, à la fois polie et oppressée.
« Excusez-moi, dit-il, vous voulez, il me semble, revenir à votre place, et j’ai l’impression que, lorsque vous m’avez aperçu, vous avez eu un mouvement de fuite. Je vous en prie, asseyez-vous tranquillement, car je m’en vais. »
Je le priai vivement de rester : je n’étais demeuré en arrière que pour ne pas le gêner. « Vous ne me gênez pas, dit-il avec une certaine amertume. Au contraire, je suis heureux, pour une fois, de n’être pas seul. Je n’ai pas prononcé une parole depuis dix jours. À vrai dire, depuis des années… et c’est une chose si douloureuse de garder tout en soi, précisément peut-être parce que cela étouffe… Je ne puis plus rester dans la cabine, dans ce… ce cercueil… Je ne puis plus, et je ne puis pas supporter les hommes, parce qu’ils rient toute la journée… Cela, je ne peux plus maintenant le supporter… Je les entends jusque dans ma cabine et je me bouche les oreilles… Il est vrai qu’ils ne savent pas que… non, ils ne le savent pas… Et puis, qu’est-ce que cela fait aux étrangers… »
Il s’arrêta de nouveau, et il ajouta tout à coup, hâtivement : « Mais je ne veux pas vous importuner… excusez mon bavardage. »
Il s’inclina et fit le geste de s’en aller. Mais je lui répliquai avec insistance : « Vous ne m’importunez pas du tout. Moi aussi, je suis heureux d’échanger en paix, ici, quelques paroles… Voulez-vous une cigarette ? »
Il en prit une. Je lui donnai du feu. De nouveau, son visage se détacha, vacillant, sur le bordage noir, mais maintenant il était entièrement tourné vers moi : derrière ses lunettes, ses yeux examinaient avidement mon visage, comme animés par la violence d’un délire. Un frisson me parcourut. Je compris que cet homme voulait parler, qu’il fallait qu’il parlât. Et je savais que je devais me taire pour l’aider.
Nous nous assîmes. Il avait là une seconde chaise de pont, qu’il m’offrit. Nos cigarettes étincelaient ; à la façon dont le point lumineux de la sienne dansait nerveusement dans l’ombre, je vis que sa main tremblait. Mais je me tus, et il se tut. Puis, soudain, il demanda à voix basse : « Êtes-vous très fatigué ?
– Non, pas du tout. »
La voix qui venait de l’obscurité hésita de nouveau. « Je voudrais vous demander quelque chose… C’est-à-dire je voudrais vous raconter quelque chose. Je sais, je sais combien il est absurde, de ma part, de m’adresser ainsi à la première personne qui me rencontre, mais… je suis… je suis dans un état psychique terrible… J’en suis à un point où il faut absolument que je parle à quelqu’un, sinon je suis perdu… Vous me comprendrez, lorsque… oui, lorsque je vous aurai raconté… Je sais que vous ne pourrez pas m’aider… mais ce silence me rend comme malade… et un malade est toujours ridicule pour les autres… »
Je l’interrompis et le priai de ne pas se tourmenter. S’il voulait bien me raconter… Je ne pouvais naturellement rien lui promettre, mais c’était un devoir, du moins, de montrer quelque bonne volonté. Quand on trouve quelqu’un dans la détresse, on est naturellement tenu de lui rendre service…
« Le devoir… de montrer quelque bonne volonté… le devoir d’essayer… Vous pensez donc, vous aussi, qu’on a quelque devoir… qu’on a le devoir d’offrir sa bonne volonté… »
Trois fois il redit la phrase. Cette façon sourde et obtuse de répéter les choses me fit frissonner. Cet homme était-il fou ? Était-il ivre ?
Mais, comme si cette supposition avait passé mes lèvres, il dit soudain, d’une voix toute différente :
« Vous me croirez peut-être ivre ou fou. Non, je ne le suis pas… pas encore. Seulement, le mot que vous avez prononcé m’a ému bien étrangement… Bien étrangement, parce que c’est cela qui me tourmente maintenant : est-ce qu’on a le devoir… le devoir… »
Il balbutiait encore. Puis il s’arrêta net ; ensuite il reprit avec un nouvel élan :
« Voyez, je suis médecin. Et, pour un médecin, il y a souvent de ces cas, tellement terribles !… Oui, disons des cas extrêmes, où l’on ne sait pas si l’on a le devoir… En effet, il n’existe pas qu’un devoir unique, celui qu’on a envers autrui, mais il y a aussi un devoir envers soi-même, un devoir envers l’État et un autre envers la Science… Il faut être secourable, certes ; c’est pour cela qu’on est là… Mais ce genre de maximes, ce n’est jamais que de la théorie… Dans quelle mesure, en effet, doit-on se montrer secourable ?… Vous êtes un étranger, et je vous suis étranger, et je vous demande de ne pas dire que vous m’avez vu… Bon ! vous vous taisez : vous remplissez ce devoir… Je vous prie de causer avec moi, parce que je crève de mon silence… Vous êtes prêt à m’entendre… Bien… mais c’est là une chose facile… Or, si je vous demandais de m’empoigner et de me jeter par-dessus bord… Ici, certainement, s’arrête la complaisance, l’obligeance. Il y a, à coup sûr, une limite quelque part… là où votre propre existence, votre responsabilité entrent en jeu… Il faut que cette limite soit… Le devoir est, à coup sûr, limité… Ou bien, peut-être, ce devoir pour un médecin ne s’arrêterait-il à rien ? Faut-il qu’il soit le sauveur, la providence universelle, uniquement parce qu’il possède un diplôme avec des mots latins ? Faut-il que, vraiment, il sacrifie sa vie et se tourne les sangs quand une femme… quand un homme vient lui demander d’être noble, secourable et bon4 ? Oui, le devoir, le devoir s’arrête quelque part… là où l’on n’a plus le pouvoir de l’accomplir, précisément là… »
Il s’interrompit encore et se leva brusquement.
« Excusez-moi… voilà que je m’emporte… mais je ne suis pas ivre… pas encore ivre… C’est là une chose qui m’arrive souvent maintenant, je vous l’avoue sans ambages, dans cette diabolique solitude… Pensez que, depuis sept ans, je vis presque exclusivement parmi les indigènes et les animaux… Alors on désapprend de parler posément. Et, quand on commence à s’épancher, ça déborde tout de suite. Mais attendez… oui, je sais maintenant… je voulais vous demander, je voulais vous exposer un cas dans lequel il s’agit de savoir si l’on a le devoir de rendre service… de rendre service avec une candeur véritablement angélique, si l’on… Du reste, je crains que cela ne dure longtemps. C’est bien vrai, vous n’êtes pas fatigué ?
– Non, pas du tout.
– Je… je vous remercie… En prenez-vous ? »





























