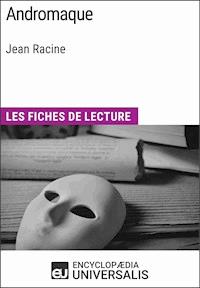
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Französisch
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalis
Après avoir polémiqué avec Port-Royal en défendant le théâtre dans un pamphlet anonyme (
Lettre à l’auteur des « Hérésies imaginaires », 1666), Racine (1639-1699) conquiert la Cour.
Une fiche de lecture spécialement conçue pour le numérique, pour tout savoir sur Andromaque de Jean Racine
Chaque fiche de lecture présente une œuvre clé de la littérature ou de la pensée. Cette présentation est couplée avec un article de synthèse sur l’auteur de l’œuvre.
A propos de l’Encyclopaedia Universalis :
Reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopaedia Universalis met la connaissance à la portée de tous. Écrite par plus de 7 400 auteurs spécialistes et riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins…), l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable collection de référence disponible en français. Elle aborde tous les domaines du savoir.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 27
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782852296008
© Encyclopædia Universalis France, 2019. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Nito/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Encyclopædia Universalis.
Ce volume présente des notices sur des œuvres clés de la littérature ou de la pensée autour d’un thème, ici Andromaque, Jean Racine (Les Fiches de lecture d'Universalis).
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
ANDROMAQUE, Jean Racine (Fiche de lecture)
Après avoir polémiqué avec Port-Royal en défendant le théâtre dans un pamphlet anonyme (Lettre à l’auteur des « Hérésies imaginaires », 1666), Racine (1639-1699) conquiert la Cour. Henriette d’Angleterre, belle-sœur du roi, assiste aux lectures préliminaires d’Andromaque, les comédiens de l’Hôtel de Bourgogne répètent avec l’auteur, et, le 17 novembre 1667, la pièce est donnée au Louvre, dans l’appartement de la reine Marie-Thérèse, et devant le roi qui applaudit. La ville confirme le succès : on vient en foule pleurer à ce spectacle galant. La pièce est publiée dès janvier 1668.
• L’enchaînement des passions
Pyrrhus, roi d’Épire et fils d’Achille, revient de la guerre de Troie avec Andromaque, veuve d’Hector, pour captive. Il est amoureux d’elle au point de repousser son mariage avec Hermione et veut l’obliger à lui céder sa main sous peine de tuer Astyanax, son fils. Oreste est envoyé par les Grecs, inquiets, pour s’emparer de l’enfant. Lui-même, amoureux d’Hermione, espère que Pyrrhus ne cédera pas à leur demande et lui abandonnera sa fiancée. De son côté, Andromaque résiste aux injonctions de Pyrrhus qui lui représente pourtant la menace des Grecs, si bien qu’il finit par se déclarer prêt à livrer Astyanax : Hermione triomphe, repousse les pleurs d’Andromaque, tandis qu’Oreste désespère. Mais une entrevue entre le roi d’Épire et l’épouse d’Hector change tout, puisque Andromaque accepte enfin de l’épouser pour sauver son fils. Ce qu’elle lui cache, c’est qu’elle compte se tuer une fois qu’elle aura obtenu pour son enfant une protection durable. Hermione, éperdue de douleur et de rage, incite alors Oreste à tuer Pyrrhus. Mais dès qu’elle apprend la nouvelle de sa mort, elle repousse l’assassin et va s’immoler sur le cadavre du roi. Oreste devient fou.
Cette troisième tragédie, fondée sur l’histoire et la mythologie grecques, s’accorde au goût du temps, en le dépassant : on y retrouve la structure à cinq de la pastorale galante, celle d’Alexandre le Grand (1665), à ceci près que le dernier maillon, représenté ici par le souvenir magnifié d’Hector, précipite la fable vers le tragique. La fameuse chaîne des amours non partagées exclut la résolution galante, et les deux mariages de la fin ne peuvent plus avoir lieu puisque Hector, idéalisé, ne saurait changer.





























