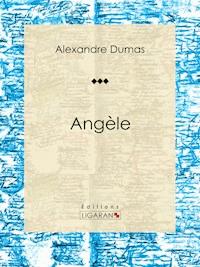
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Extrait : "ERNESTINE, regardant par la fenêtre à gauche : Depuis une heure, il se promène avec elle, sans daigner s'apercevoir que je suis là, le regardant et pleurant ; ou plutôt il m'a vue ; mais, maintenant, que lui importe, et qu'a-t-il besoin de se cacher ? ne me suis-je pas mise entièrement à sa merci ? – Oh ! je ne puis supporter plus longtemps ce supplice ! ( Elle sonne. ) Louise ! Louise !"
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 120
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335054767
©Ligaran 2015
Un appartement de l’hôtel des Bains à Cauterets ; sur le premier plan, deux fenêtres latérales ; sur le deuxième, deux portes ; au fond, une alcôve fermant avec des rideaux ; de chaque côté de l’alcôve, cabinets de toilette.
ALFRED D’ALVIMAR.
HENRI MULLER.
JULES RAYMOND, jeune peintre.
MULLER père.
DOMINIQUE, domestique d’Alfred.
UN NOTAIRE.
UN CHASSEUR.
UN INVITÉ.
UN DOMESTIQUE.
LA COMTESSE DE GASTON.
ANGÈLE.
ERNESTINE, MARQUISE DE RIEUX.
MADAME ANGÉLIQUE, tante d’Angèle.
LOUISE, femme de chambre d’Angèle.
FANNY, femme de chambre de la comtesse.
UNE DAME.
INVITÉS, DOMESTIQUES.
Le premier et le second acte, à Cauterets, dans les Pyrénées ; les trois derniers, à Paris.
Ernestine, puis Louise.
Depuis une heure, il se promène avec elle, sans daigner s’apercevoir que je suis là, le regardant et pleurant ; ou plutôt il m’a vue ; mais, maintenant, que lui importe, et qu’a-t-il besoin de se cacher ? ne me suis-je pas mise entièrement à sa merci ? – Oh ! je ne puis supporter plus longtemps ce supplice ! (Elle sonne.) Louise ! Louise !
Madame ?…
Allez dire à M. d’Alvimar que sa sœur l’attend pour prendre le thé.
Où le trouverai-je ?
Tenez, là. Ne le voyez-vous pas dans le jardin ?
Avec mademoiselle Angèle ?… Oui, oui ; j’y vais, madame.
(Elle sort.)
Depuis la nouvelle de la révolution qui a éclaté à Paris, il a complètement changé à mon égard. Cette enfant, qu’il ne songeait pas même à regarder, maintenant il ne la quitte plus ; ses yeux la poursuivent et la fascinent à son tour, comme ils m’ont fascinée et poursuivie… Oh ! cet homme a un but caché que Dieu connaît seul.
(Alfred entre par une des portes du cabinet de toilette.)
Ernestine, Alfred.
Eh quoi ! vous entrez de ce côté ?
N’est-ce point pour cela que vous m’avez donné cette clef ?
Mais, si l’on voyait entrer chez moi par cette porte dérobée, que voudriez-vous qu’on pensât ?
Il m’aurait fallu faire le tour par le grand escalier.
Au fait, ce serait prendre trop de peine, quand il ne s’agit que de l’honneur d’une femme.
Est-ce pour me faire faire un cours de prud’hommie que vous m’avez dérangé ?
Dérangé !… le mot est gracieux.
Il a le mérite d’exprimer exactement ma pensée.
Et vous ne prenez plus la peine de la cacher, n’est-ce pas ?
Ma chère Ernestine, vous êtes, depuis quelques jours, dans une disposition d’esprit bien fâcheuse.
Vous mettez tant de soin à l’entretenir !
Prenez-vous une tasse de thé ?
Merci.
Ah ! il est question de votre mari.
Du marquis de Rieux ?… Et comment ?
Il suit la famille déchue.
Dans sa position auprès d’elle, c’est presque un devoir.
Qu’il remplit par ostentation.
Vous calomniez jusqu’au dévouement.
Jusqu’à ce qu’on m’en cite un véritablement désintéressé.
Celui du marquis.
Pourquoi plus qu’un autre ?
Mais c’est celui du lierre qui s’attache aux débris.
Parce qu’il ne sait comment s’accrocher aux murs neufs.
Athée !
Sceptique, tout au plus… – Hélas ! la vie humaine est ainsi faite, Ernestine ; sa superficie est resplendissante de passions généreuses et d’actions désintéressées. C’est l’eau d’un étang dont la surface reflète les rayons du soleil. Mais, regardez au fond, elle est sombre et boueuse. Certes, votre mari fera sonner bien haut son attachement à ses princes légitimes, son exil volontaire près d’un exil forcé ; en le répétant aux autres, il finira peut-être par croire lui-même qu’il est un modèle de générosité ; il ne fera pas attention que sa grandeur d’âme n’est qu’un composé de petites bassesses ; qu’il bâtit une pyramide avec des cailloux. Il y a plus ; si quelqu’un allait lui dire : « Vous quittez la France, non que vous soyez dévoué à vos princes légitimes, non parce que les grands malheurs réclament les grands dévouements, mais parce que votre titre de marquis vous fait plaisir à entendre prononcer, et qu’à la cour du roi déchu seulement, on vous appellera marquis ; parce que vous aviez trois ou quatre croix qui ne vont bien que sur un habit à la française, et que vous tenez à conserver votre habit à la française et à porter vos croix, lesquelles font la seule différence qui existe entre vous et le valet de chambre de Sa Majesté ; parce que toutes vos habitudes enfin étaient enfermées dans un cercle qui s’est déplacé, et que vous avez suivi, comme l’atmosphère suit la terre. » Je crois que celui qui lui dirait cela l’étonnerait tout le premier.
Mais je ne vous ai jamais entendu parler ainsi.
C’est que, pour la première fois, je pense tout haut devant vous.
Je ne vous eusse pas aimé, Alfred.
Et vous eussiez bien fait, Ernestine.
Oh ! mon Dieu !
Je désirais être pour vous l’objet d’un caprice et non d’une passion ; pourquoi m’avez-vous donné plus que je ne demandais ?
Mais dites-moi donc que tout cela n’est qu’une plaisanterie atroce ! N’est-ce pas, n’est-ce pas que vous raillez ?
Je n’ai jamais parlé si sérieusement.
Vous me torturez à plaisir.
Non, je vous éclaire à regret. Rappelez-vous ma conduite, et vous me rendrez plus de justice. Quand je vis ce que je n’avais envisagé que comme une liaison passagère devenir, de votre part, un sentiment profond, je pensai qu’il était temps de l’arrêter là : je prétextai un voyage aux eaux. Je suis venu ici ; car je présumais que vous finiriez par faire quelque imprudence qui nous perdrait tous deux. Cette imprudence n’a pas tardé ; et, un jour, sous prétexte que vous ne pouviez vivre sans moi, vous êtes arrivée ici sous le titre de ma sœur.
Malheur ! mais je vous aimais tant, que je ne pouvais supporter votre absence.
Un jour de plus, peut-être, et vous eussiez craint mon retour.
Mais, malheureux ! vous ne croyez donc à rien ?
Vous vous trompez, Ernestine ; je ne révoque pas les choses en doute ; je vois au-delà ; voilà tout.
Vous êtes glaçant.
Je suis vrai.
Mais où donc avez-vous étudié le monde ?
Dans le monde.
Et sans doute vous vous croyez meilleur que les autres.
Je le fus.
Et vous vous êtes lassé de l’être ?
La vie humaine se divise généralement en deux parties bien tranchées : la première se passe à être dupe des hommes.
Et la seconde ?
À prendre sa revanche.
Vous en êtes à la dernière ?
J’ai trente-trois ans.
Est-ce un rêve ?
Tenez, Ernestine, vous n’êtes point une femme ordinaire. Écoutez, et vous me connaîtrez.
Je ne vous connais que trop pour mon malheur !
Et, si je guéris, avec des paroles vraies, l’amour que j’ai fait naître avec des paroles fausses, ne demeurerez-vous pas mon obligée, puisque vous aurez l’expérience de plus ?
Parlez donc.
Je n’ai pas toujours été désenchanté de tout, comme je le suis, Ernestine. Je suis entré dans la vie par une porte dorée. Mon père était maître d’une fortune immense et j’étais son seul enfant. En 1819, j’avais vingt et un ans : la mort m’enleva mon père ; un procès injuste, ma fortune. C’est de là que date mon premier doute. Le doute, quand il naît, commence aux hommes et ne s’arrête pas même à Dieu. Je rassemblai les débris de ma fortune, vingt mille francs, à peu près. Ce n’était pas tout à fait la moitié de ce que je dépensais en un an. L’éducation universitaire que j’avais reçue et qui m’avait fait vingt fois le premier du collège ne m’avait rien appris pour la vie réelle. J’avais tout effleuré, rien approfondi. Au milieu d’un salon, je paraissais apte à tout ; rentré chez moi, j’étais accablé moi-même de la conviction de mon impuissance. N’importe, je ne voulus pas me rendre sans lutter. Je divisai la faible somme qui me restait, je me donnai quatre ans pour rétablir ma position, ou pour m’en créer une autre, par tous les moyens honorables que l’industrie met aux mains des hommes. Ce fut une espèce de défi porté au monde et à Dieu, et après lequel je pensai que je ne devrais plus rien ni à l’un ni à l’autre, si je ne réussissais pas. Je tentai tout. En quatre ans, j’usai en forces et en courage ce qui suffirait à une existence tout entière de douleurs. À la fin de ce terme, les derniers restes de ma fortune glissèrent petit à petit entre mes mains, et je me trouvai, à vingt-cinq ans, ruiné, las de tout, isolé, sans un seul ami sur la terre, sans un seul parent au monde, malheureux autant qu’il est donné à une créature humaine de le devenir, et cependant n’ayant pas en face de Dieu une seule action mauvaise à me reprocher, je vous le jure, Ernestine, sur tout ce que je regardais autrefois comme sacré. Je balançai un instant entre le suicide et la vie nouvelle où j’allais entrer.
Mais c’est tout un monde nouveau que vous m’ouvrez là.
Oui, n’est-ce pas ? vous ne pouviez vous douter, quand vous voyiez l’homme des salons et des femmes, l’homme des petits soins futiles et de la galanterie empressée, que cette tête éventée et ce cœur joyeux eussent jamais pu renfermer une pensée profonde et une amère agonie ! Cela est pourtant ainsi : il y a en moi deux hommes, dont le second, dans quelque temps, n’aura rien conservé du premier… Du moment que je m’étais décidé à vivre, je jetai les yeux sur le monde ; il semblait qu’un voile fût tombé de ma vue, tant chaque chose m’apparut sous sa véritable forme. Je reconnus des hommes qui étaient encore ce que j’avais été, et je me pris à rire en voyant comme, autour d’eux, chacun tirait à soi un lambeau de leur honneur ou de leur fortune, jusqu’à ce qu’à la fin ils se trouvassent nus et désespérés comme je l’étais. Puis, dès que je fus convaincu que le mal particulier concourait au bien général, il me parut de droit incontestable de rendre aux individus le mal que la société m’avait fait, du moment que du mal des autres naîtrait un bien pour moi ; car faire le mal pour le plaisir du mal est un travail inutile. Alors je me pris à réfléchir. Je me dis qu’il serait d’un homme de génie de rebâtir, avec les mains frêles et délicates des femmes, cet échafaudage de fortune que la main de fer des évènements et des hommes avait renversé. Ce calcul en valait un autre, et j’y trouvais, de plus, le plaisir. Dès lors je devins courtisan de caresses ; les boudoirs furent mes antichambres ; une déclaration d’amour me valut une place ; un premier baiser, la croix. Les femmes sont d’admirables solliciteuses : j’utilisai le crédit de chacune d’elles ; j’obtins pour moi et je n’ôtai rien à personne ; une brouille leur laissait leur crédit, où je voyais qu’elles allaient l’user en ma faveur ; c’est de la délicatesse ou je ne m’y connais pas.
Mais aucune ne vous a donc aimé ?
Toutes en ont eu l’air ; mais, comme, jusqu’à présent, aucun malheur n’en est résulté, je commence à en douter. Je vous en fais juge vous-même, Ernestine. Vous connaissez quelques-unes des femmes qui m’ont porté où je suis : je dus à madame de Breuil un secrétariat d’ambassade à Madrid. J’y restai trois mois ; quand je revins, je n’eus pas besoin de me brouiller avec elle. La jolie madame d’Orsay voulait un amant titré : grâce à elle, je devins baron. Nous nous séparâmes ; son amour n’en devint que plus aristocratique, et je fus remplacé par un comte. À vous, Ernestine, je dus cette croix et un bonheur si réel, que je tremblai de le voir finir, et cela est si vrai, que, dès que je m’aperçus que votre amour prenait les symptômes d’une passion, je partis. Ce qui devait nous sauver tous deux vous perdit seule ; vous vîntes me rejoindre, et vous eûtes tort. Eh bien, comprenez-vous maintenant ? Cet ouragan de trois journées qui a soufflé sur la vieille cour, en l’emportant avec lui, vient de renverser l’édifice que six ans de calculs et de peine avaient bâti. Pensions, titres, croix, le bras nu du peuple vient de m’arracher tout cela ; tout est à recommencer, tout est à refaire, et j’ai trente-trois ans !… et là, là… (frappant son cœur) du dégoût, comme un homme qui sort vieux de la vie. Oh ! je crois que j’échangerais volontiers cette existence pleine de force et de santé contre l’existence de ce jeune Henri Muller, le fils de notre hôte, qui mourra avant un an peut-être, qui mourra du moins les yeux sur la vie, regrettant ce monde et croyant à un autre.
Oh ! Alfred, qui m’eût dit que ce serait vous que je plaindrais ?
Oui, plaignez-moi ! car vous êtes la seule femme qui, me connaissant, puisse me plaindre. Et il a fallu, pour que je vous dise ces choses, il a fallu que mon cœur fût brisé, et ce n’a pu être que par une blessure que sortît à vos yeux tout le secret de ma vie passée et future.
Et maintenant ?…
Maintenant, je vous l’ai dit, j’ai tout perdu.
Tout… Écoutez, Alfred ; moi aussi, j’ai tout perdu : la fortune du marquis était en pensions et en places ; mais il me reste pour quarante mille francs, à peu près, de diamants ; partageons.
Merci, Ernestine, vous êtes bonne ; gardez-les : je vois que vous ne m’avez pas compris.
Mais qu’allez-vous devenir ?
Je vous ai dit que c’était tout un édifice à rebâtir.
Et vous allez vous remettre à l’œuvre ?
Je m’y suis remis.
Comment ! cette jeune Angèle ?…
En sera la première pierre.
Faites préparer ma voiture.
Vous partez ?
Je pars.
Je n’ai pas besoin de vous dire que je ne vous accompagne pas.
Je le devine.
Et où allez-vous ?
Le sais-je ?… M’enfermer… m’ensevelir dans une retraite.
À quoi bon ? et qu’y ferez-vous ?
J’y pleurerai ma faute !
Ernestine !… avant un an, je vous donne rendez-vous dans le monde, des perles au cou, des fleurs sur le front.
Mais vous oubliez, malheureux !… que, par vous, j’ai tout perdu… fortune et position…
Vous changerez de position et vous referez une fortune.
Par quels moyens ?





























