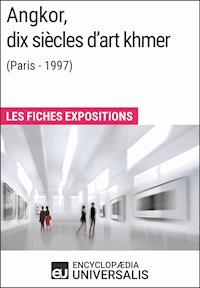
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
C'est à l'acharnement du lieutenant de vaisseau Louis Delaporte que l'on doit la création avant 1875 du premier musée d'art khmer, installé à Compiègne faute d'avoir pu trouver place à Paris. Delaporte avait obtenu, en 1871, une mission pour collecter des statues et recueillir des moulages...
À PROPOS DE L’ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS
Reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopaedia Universalis met la connaissance à la portée de tous. Écrite par plus de 7 400 auteurs spécialistes et riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins…), l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable collection de référence disponible en français. Elle aborde tous les domaines du savoir.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 47
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782341010511
© Encyclopædia Universalis France, 2019. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Bluraz/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Les grandes expositions sont l’occasion de faire le point sur l’œuvre d’un artiste, sur une démarche esthétique ou sur un moment-clé de l’histoire des cultures. Elles attirent un large public et marquent de leur empreinte l’histoire de la réception des œuvres d’art.
Sur le modèle des fiches de lecture, les fiches exposition d’Encyclopaedia Universalis associent un compte rendu de l’événement avec un article de fond sur le thème central de chaque exposition retenue : - pour connaître et comprendre les œuvres et leur contexte, les apprécier plus finement et pouvoir en parler en connaissance de cause ; - pour se faire son propre jugement sous la conduite de guides à la compétence incontestée.
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
Angkor, dix siècles d’art khmer (Paris - 1997)
C’est à l’acharnement du lieutenant de vaisseau Louis Delaporte que l’on doit la création avant 1875 du premier musée d’art khmer, installé à Compiègne faute d’avoir pu trouver place à Paris. Delaporte avait obtenu, en 1871, une mission pour collecter des statues et recueillir des moulages, non sans avoir préalablement demandé au roi Norodom « l’autorisation de prendre dans ses États des richesses artistiques auxquelles nous attachions du prix », autorisation du reste gracieusement accordée par le roi, qui répondit que « les ordres étaient donnés et [que l’équipe de Louis Delaporte trouverait] dans ses États toutes les facilités possibles pour [ses] travaux ». Du musée khmer de Compiègne, les statues et les moulages furent transportés à Paris, au palais du Trocadéro en 1889, puis rejoignirent en 1925 le musée Guimet.
Ce musée regroupe incontestablement la plus importante et la plus belle collection d’art khmer existant en dehors du Cambodge ; elle l’est pourtant moins que celle du Musée national de Phnom Penh. Ce fut donc une excellente initiative que d’avoir cherché à réunir les chefs-d’œuvre de ces deux musées pour les présenter au public, en profitant notamment du fait que le musée Guimet était à ce moment-là fermé pour réparations.
Du 31 janvier au 26 mai 1997 s’est donc tenue, dans les Galeries nationales du Grand Palais, à Paris, une exposition intitulée Angkor, dix siècles d’art khmer. À l’occasion de cette exposition, le gouvernement français avait heureusement décidé de moderniser l’atelier de restauration du Musée national de Phnom Penh et de faire former par une équipe des ateliers de restauration des musées nationaux un certain nombre de jeunes restaurateurs khmers. C’est ainsi qu’avant même d’être transportées à Paris, la plupart des statues présentées ont été restaurées à Phnom Penh ; les autres, en raison de la complexité des problèmes, l’étant en France même. Ces pièces avaient certes été restaurées au début du XXe siècle, au moment de la création par l’École française d’Extrême-Orient d’un musée khmer à Phnom Penh, transféré bientôt dans le Musée national – appelé à l’époque musée Albert Sarraut – que George Groslier a fondé puis dirigé jusqu’à sa mort, en 1944. Mais il était évidemment nécessaire de leur faire subir un traitement plus moderne.
La tête qui a servi pour l’affiche de l’exposition est l’une des deux têtes « présumées » de Jayavarman VII présentées. On sait parfaitement, d’après les statues entières, que le roi est représenté en méditation et le visage penché vers l’avant (voir notamment l’article « Le Portrait dans l’art khmer » de G. Cœdès, in Arts asiatiques, 1960). D’après une heureuse hypothèse suggérée dans cet article, le roi était probablement placé devant le Bouddha, dans les grands temples de l’empire. On connaît du roi ces deux têtes semblables – il en existe peut-être une troisième – et deux statues entières, dont l’une, dite de Krol Romeas (Angkor), est exposée au musée de Phnom Penh, elle provient en réalité de plusieurs points du célèbre site, l’autre étant aujourd’hui exposée à Phimai, en Thaïlande, où elle avait été découverte, après être restée longtemps au Musée national de Bangkok. On a tenté de distinguer l’âge du roi selon les expressions de ces statues : cela paraît un peu illusoire, les différences venant de l’art propre à chaque sculpteur. Il devait exister un certain nombre de telles statues à Angkor même, mais elles ont été vraisemblablement détruites au XIIIe siècle, au moment de la réaction antibouddhiste ; celle dite de Krol Romeas témoigne du carnage. Autre statue-portrait, cette touchante Prajnāpāramitā enfant, représentant sans doute une princesse morte dans son adolescence.
Parmi tant de beauté, il est difficile de faire un choix. Dans les pièces pré-angkoriennes, on notera d’abord l’admirable Harihara du Prasat Andet, datant du VIIIe siècle, qui grâce à sa nouvelle restauration a retrouvé des pieds correctement ajustés à son corps et un système de soutien moins disgracieux que celui que l’on connaissait jusqu’à présent. Mais on n’oubliera pas la force de la Mahishāsuramardinī de Sambor Prei Kuk, non plus que le puissant Krishna soulevant le mont Govardhana pour protéger ses troupeaux de la colère d’Indra, ou la dame de Koh Krieng, si réaliste.
De l’époque « angkorienne », on pouvait apprécier l’ensemble des pièces provenant de Banteay Srei, avec notamment les deux grands frontons, illustrant l’un un épisode de la guerre du Mahābhārata, l’autre l’histoire de l’apsaras (danseuse céleste) Tilottamā que s’arrachent en s’entre-tuant, pour le bien du monde, les deux asura





























