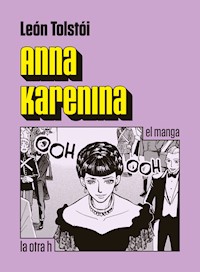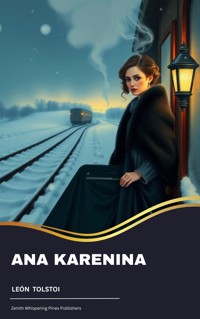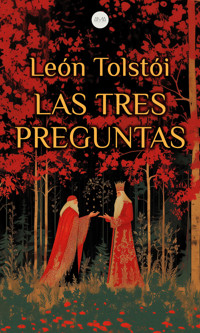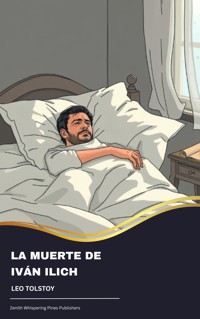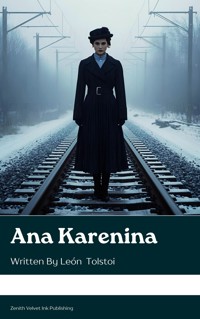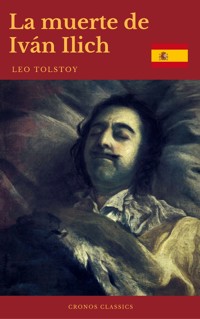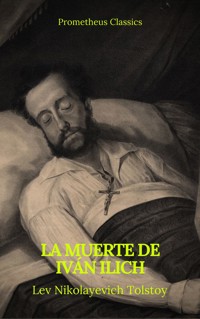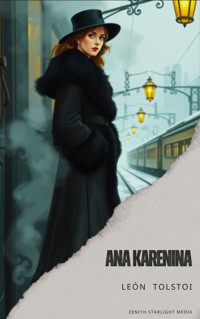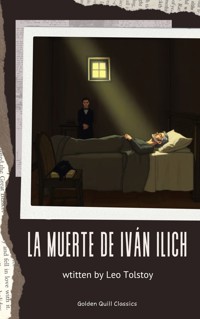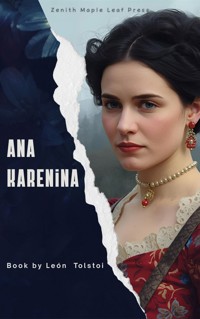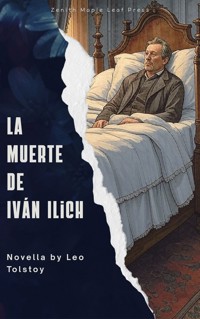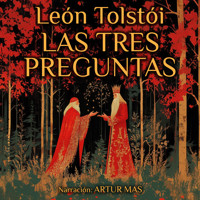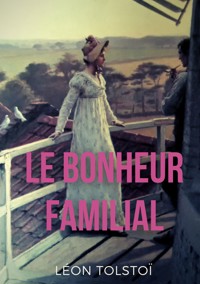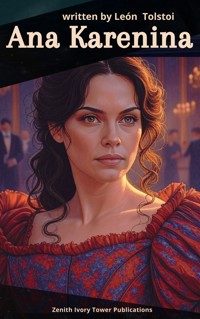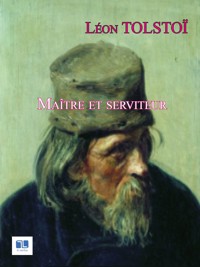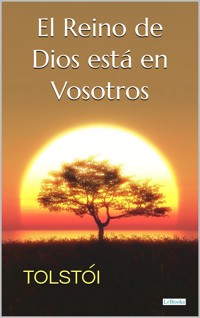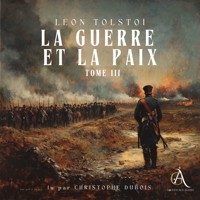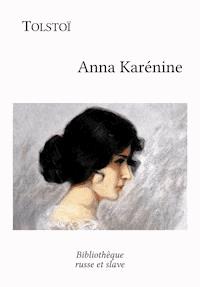
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bibliothèque russe et slave
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Anna Karénine semble tout avoir : la beauté, la richesse, une haute position dans la société mondaine, mais sa rencontre avec un jeune officier, le comte Vronski, fait naître en elle une passion à laquelle elle sacrifie tout. Anna Karénine est une histoire d'amour, mais c'est également l'histoire du cheminement moral d'un homme, Lévine, double de Tolstoï qui abandonnera longtemps la fiction après avoir écrit son chef-d'œuvre.
Traduction intégrale d'Henri Mongault, 1935.
EXTRAIT
Les familles heureuses se ressemblent toutes ; les familles malheureuses sont malheureuses chacune à leur façon. Tout était sens dessus dessous dans la maison Oblonski. Prévenue que son mari entretenait une liaison avec l’ancienne institutrice française de leurs enfants, la princesse s’était refusée net à vivre sous le même toit que lui. Le tragique de cette situation, qui se prolongeait depuis tantôt trois jours, apparaissait dans toute son horreur tant aux époux eux-mêmes qu’aux autres habitants du logis. Tous, depuis les membres de la famille jusqu’aux domestiques, comprenaient que leur vie en commun n’avait plus de raison d’être ; tous se sentaient dorénavant plus étrangers l’un à l’autre que les hôtes fortuits d’une auberge.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Léon Tolstoï, nom francisé de Lev Nikolaïevitch Tolstoï, né le 28 août 1828 à Iasnaïa Poliana et mort le 7 novembre 1910 à Astapovo, en Russie, est un écrivain célèbre surtout pour ses romans et nouvelles qui dépeignent la vie du peuple russe à l'époque des tsars, mais aussi pour ses essais, dans lesquels il prenait position par rapport aux pouvoirs civils et ecclésiastiques et voulait mettre en lumière les grands enjeux de la civilisation.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1495
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BIBLIOTHÈQUE RUSSE ET SLAVE
— LITTÉRATURE RUSSE —
Léon Tolstoï
Толстой Лев Николаевич
1828 — 1910
ANNA KARÉNINE
Анна Каренина
1878
Traduction d’Henri Mongault, Paris, Gallimard, 1935.
© La Bibliothèque russe et slave, 2014
© Henri Mongault, 1935, 1948
Couverture : École russe, XXe siècle
Chez le même éditeur — Littérature russe
1. GOGOLLes Âmes mortes. Traduction d’Henri Mongault
2. TOURGUENIEVMémoires d’un chasseur. Traduction d’Henri Mongault
3. TOLSTOÏLes Récits de Sébastopol. Traduction de Louis Jousserandot
4. DOSTOÏEVSKIUn joueur. Traduction d’Henri Mongault
5. TOLSTOÏAnna Karénine. Traduction d’Henri Mongault
6. MEREJKOVSKILa Mort des dieux. Julien l’Apostat. Traduction d’Henri Mongault
7. BABELCavalerie rouge. Traduction de Maurice Parijanine
À MOI LA VENGEANCE ET LA RÉTRIBUTION1
1. Deutéronome,XXXII, 36. Cf. aussi Épître aux Romains, XII, 19 et Épître aux Hébreux, X, 30. — J’emprunte à la traduction du chanoine Crampon tous les passages de la Bible cités par Tolstoï. — M.
PREMIÈRE PARTIE
I
LES familles heureuses se ressemblent toutes ; les familles malheureuses sont malheureuses chacune à leur façon. Tout était sens dessus dessous dans la maison Oblonski. Prévenue que son mari entretenait une liaison avec l’ancienne institutrice française de leurs enfants, la princesse s’était refusée net à vivre sous le même toit que lui. Le tragique de cette situation, qui se prolongeait depuis tantôt trois jours, apparaissait dans toute son horreur tant aux époux eux-mêmes qu’aux autres habitants du logis. Tous, depuis les membres de la famille jusqu’aux domestiques, comprenaient que leur vie en commun n’avait plus de raison d’être ; tous se sentaient dorénavant plus étrangers l’un à l’autre que les hôtes fortuits d’une auberge.
La femme ne quittait plus ses appartements, le mari ne rentrait pas de la journée, les enfants couraient abandonnés de chambre en chambre ; après une prise de bec avec la femme de charge, la gouvernante anglaise avait écrit à une amie de lui chercher une autre place ; dès la veille à l’heure du dîner le chef s’était octroyé un congé ; le cocher et la fille de cuisine avaient demandé leur compte.
Le surlendemain de la brouille, le prince Stépane Arcadiévitch Oblonski — Stiva pour ses amis — se réveilla à huit heures, comme de coutume, mais dans son cabinet de travail, sur un divan de cuir et non plus dans la chambre à coucher conjugale. Désireux sans doute de prolonger son sommeil, il retourna mollement sur les ressorts du canapé son corps gras, bien soigné et, l’entourant de ses bras, il appuya la joue sur l’oreiller ; mais il se redressa d’un geste brusque et ouvrit définitivement les yeux.
« Voyons, voyons, comment était-ce ? songeait-il, cherchant à se remémorer les détails d’un songe. Oui, comment était-ce ? Ah ! j’y suis ! Alabine donnait un dîner à Darmstadt, mais Darmstadt était en Amérique... Alabine donnait un dîner sur des tables de verre, et les tables chantaient E mio tesoro... non, pas cet air-là, un autre bien plus joli... Et il y avait sur les tables je ne sais quelles petites carafes qui étaient des femmes. »
Un éclat de joie brilla dans les yeux de Stépane Arcadiévitch. « Oui, se dit-il en souriant, c’était charmant, tout à fait charmant, mais une fois éveillé, ces choses-là, on ne sait plus les raconter, on n’en a même plus la notion bien exacte. »
Remarquant un rais de lumière qui s’infiltrait dans la pièce par l’entrebâillement des rideaux, il laissa d’un geste allègre pendre hors du lit ses pieds en quête des pantoufles de maroquin mordoré, cadeau de sa femme pour son dernier anniversaire, tandis que, cédant à une habitude de neuf années, il tendait sa main vers sa robe de chambre, suspendue d’ordinaire au chevet de son lit. Mais, se rappelant soudain l’endroit où il se trouvait et la raison qui l’y avait amené, il cessa de sourire et fronça le sourcil.
« Ah, ah, ah ! » gémit-il sous l’assaut des souvenirs. Une fois de plus son imagination lui représentait tous les détails de la scène fatale, tout l’odieux d’une situation sans issue ; une fois de plus il dut — et rien n’était plus pénible — se reconnaître l’auteur de son infortune.
« Non, elle ne pardonnera pas et elle ne peut pas pardonner ! Et le plus terrible, c’est que je suis cause de tout sans être pourtant coupable. Voilà le drame. Ah, ah, ah ! » répétait-il dans son désespoir en évoquant les minutes les plus atroces de la scène, la première surtout, alors que rentrant tout guilleret du théâtre, d’où il rapportait une énorme poire à l’intention de sa femme, il n’avait pas trouvé celle-ci dans le salon, ni même à sa grande surprise, dans son cabinet, et qu’il l’avait enfin découverte dans la chambre à coucher, tenant entre les mains le malencontreux billet qui lui avait tout appris.
Elle, cette Dolly qu’il tenait pour une bonne ménagère, perpétuellement affairée et quelque peu bornée, était assise immobile, le billet à la main, le regardant avec une expression de terreur, de désespoir et d’indignation.
— Qu’est-ce que cela ? répétait-elle en désignant le billet.
Et, comme il arrive souvent, ce qui laissait à Stépane Arcadiévitch le plus fâcheux souvenir, c’était moins la scène en elle-même que la réponse qu’il avait faite à sa femme.
Il s’était alors trouvé dans la situation d’une personne subitement convaincue d’une action par trop honteuse, et, comme il advient toujours en pareil cas, il n’avait point su se composer un visage de circonstance. Au lieu de s’offenser, de nier, de se justifier, de demander pardon, d’affecter même l’indifférence, — tout aurait mieux valu ! — il se prit soudain à sourire, oh, fort involontairement (action réflexe, pensa Stépane Arcadiévitch, qui aimait la physiologie), et ce sourire stéréotypé et bonasse ne pouvait forcément qu’être niais.
Ce sourire niais, il ne pouvait maintenant se le pardonner, car il avait provoqué chez Dolly un frisson de douleur ; avec son emportement habituel, elle avait accablé son mari d’un flot de paroles amères, et, lui cédant aussitôt la place, s’était depuis lors refusé à le voir.
« C’est ce bête de sourire qui a tout gâté ! » songeait Oblonski. « Mais que faire, que faire ? » se répétait-il désespérément sans trouver de réponse.
II
SINCÈRE envers lui-même, Stépane Arcadiévitch ne se faisait point illusion : il n’éprouvait aucun remords et s’en rendait fort bien compte. Cet homme de trente-quatre ans, bien fait de sa personne et de complexion amoureuse, ne pouvait vraiment se repentir de négliger sa femme, à peine plus jeune que lui d’une année et mère de sept enfants, dont cinq vivants ; il regrettait seulement de ne pas avoir mieux caché son jeu. Mais il comprenait toute la gravité de la situation et plaignait sa femme, ses enfants et lui-même. Peut-être aurait-il mieux pris ses précautions s’il avait pu prévoir l’effet que la découverte de ses fredaines produirait sur sa femme. Sans jamais avoir bien sérieusement réfléchi à la chose, il s’imaginait vaguement qu’elle s’en doutait depuis longtemps et fermait volontairement les yeux. Il trouvait même que Dolly, fanée, vieillie, fatiguée, excellente mère de famille certes mais sans aucune qualité qui la mît hors de pair, aurait dû en bonne justice faire preuve d’indulgence. L’erreur avait été grande.
« Ah ! c’est affreux, affreux, affreux ! » répétait Stépane Arcadiévitch, sans pouvoir trouver d’issue à son malheur. « Et tout allait si bien, nous étions si heureux ! Je ne la gênais en rien, je lui laissais élever les enfants, tenir la maison à sa guise... Évidemment il est fâcheux que cette personne ait été institutrice chez nous. Oui, c’est fâcheux. Il y a quelque chose de trivial, de vulgaire à faire la cour à l’institutrice de ses enfants. Mais aussi quelle institutrice ! (Il revit les yeux noirs, le sourire fripon de Mlle Roland). Et puis enfin, tant qu’elle demeurait chez nous, je ne me suis rien permis... Le pire, c’est qu’elle est déjà... Et tout cela comme un fait exprès. Ah, mon Dieu, mon Dieu, que faire ? »
De réponse il n’en trouvait point, sinon cette réponse générale que la vie donne à toutes les questions les plus compliquées, les plus insolubles : se plonger dans le tran-tran quotidien, c’est-à-dire oublier. Il ne pouvait plus, du moins jusqu’à la nuit suivante, retrouver l’oubli dans le sommeil, dans la berceuse des petites femmes-carafes ; il lui fallait donc s’étourdir dans le songe de la vie.
« Nous verrons plus tard », conclut en se levant Stépane Arcadiévitch. Il endossa sa robe de chambre grise doublée de soie bleue, en noua la cordelière, aspira l’air à pleins poumons dans sa large cage thoracique, puis, de cette démarche balancée qui enlevait à son corps vigoureux toute apparence de lourdeur, il s’avança vers la fenêtre, en écarta les rideaux et donna un énergique coup de sonnette. Le valet de chambre Mathieu, un vieil ami, entra aussitôt, portant les habits et les bottines de son maître ainsi qu’un télégramme ; derrière lui venait le barbier avec son attirail !
— A-t-on apporté des papiers du bureau ? s’enquit Stépane Arcadiévitch, qui prit la dépêche et s’assit devant le miroir.
— Ils sont sur la table, répondit Mathieu, en jetant à son maître un coup d’œil complice ; au bout d’un moment, il ajouta avec un sourire rusé : — On est venu de chez le loueur de voitures.
Pour toute réponse Stépane Arcadiévitch croisa dans le miroir son regard avec celui de Mathieu ; le geste prouvait à quel point ces deux hommes se comprenaient. « Pourquoi cette question ? ne sais-tu pas à quoi t’en tenir ? » avait l’air de demander Stépane Arcadiévitch.
Les mains dans les poches de sa veste, une jambe à l’écart, un sourire imperceptible aux lèvres, Mathieu contemplait son maître en silence. Il laissa enfin tomber cette phrase évidemment préparée d’avance :
— Je leur ai dit de revenir l’autre dimanche, et d’ici là de ne déranger inutilement ni Monsieur ni eux-mêmes.
Stépane Arcadiévitch comprit que Mathieu avait voulu se signaler par une plaisanterie de sa façon. Il ouvrit le télégramme, le parcourut, rétablissant au petit bonheur les mots défigurés, et son visage s’éclaircit.
— Mathieu, ma sœur Anna Arcadievna arrive demain, dit-il en arrêtant pour un instant la main grassouillette du barbier en train de tracer à l’aide du peigne une raie rose entre ses longs favoris bouclés, frisés.
— Dieu soit loué ! s’écria Mathieu d’un ton qui prouvait qu’il comprenait lui aussi l’importance de cette nouvelle : Anna Arcadievna, la sœur bien-aimée de son maître, pourrait contribuer à la réconciliation des époux !
— Seule ou avec son mari ? demanda-t-il. En guise de réponse, Stépane Arcadiévitch, qui abandonnait au barbier sa lèvre supérieure, leva un doigt. Mathieu fit un signe de tête dans le miroir.
— Seule. Faudra-t-il préparer sa chambre en haut ?
— Où Darie Alexandrovna l’ordonnera.
— Darie Alexandrovna ? répéta Mathieu d’un air de doute.
— Oui. Porte-lui ce télégramme et fais-moi connaître sa décision.
« Ah, ah, vous voulez faire une tentative ! » songea Mathieu, mais il répondit simplement : — Bien, Monsieur.
Stépane Arcadiévitch, sa toilette achevée et le barbier congédié, allait passer ses vêtements quand Mathieu, le télégramme à la main, fit à pas feutrés sa rentrée dans la pièce.
— Darie Alexandrovna fait dire qu’elle part, et que Monsieur agisse comme bon lui semblera, déclara-t-il, ne souriant que des yeux, les mains plongées dans ses poches, la tête penchée de côté, le regard fixé sur son maître.
Stépane Arcadiévitch se tut quelques instants ; puis un sourire plutôt piteux passa sur son beau visage.
— Qu’en penses-tu, Mathieu ? dit-il en hochant la tête.
— Cela se tassera, Monsieur.
— Cela « se tassera » ?
— Certainement Monsieur.
— Tu crois ?... Mais qui va là ? demande Stépane Arcadiévitch en percevant du côté de la porte le frôlement d’une robe.
— C’est moi, Monsieur, répondit une voix féminine ferme, mais agréable ; et la figure grêlée et sévère de Matrone Philimonovna, la bonne des enfants, apparut dans l’encadrement de la porte.
— Qu’y a-t-il, Matrone ? demanda Stépane Arcadiévitch en s’avançant vers elle.
Bien qu’il eût, de son propre aveu, tous les torts envers sa femme, la maison entière était pour lui, y compris Matrone, laquelle était pourtant la grande amie de Darie Alexandrovna.
— Qu’y a-t-il ? répéta-t-il d’un ton abattu.
— Vous devriez, Monsieur, aller trouver Madame et lui demander encore une fois pardon. Peut-être que le bon Dieu vous sera miséricordieux. Madame se désole, c’est pitié de la voir, et tout va de travers dans la maison. Il faut avoir pitié des enfants, Monsieur. Demandez pardon, Monsieur. Que voulez-vous, quand le vin est tiré...
— Mais elle ne me recevra pas...
— Allez-y toujours. Dieu est miséricordieux ; priez-le, Monsieur, priez-le.
— Eh bien, c’est bon, va, dit Stépane Arcadiévitch, devenu soudain cramoisi. Allons, donne-moi vite mes affaires, ordonna-t-il à Mathieu, en rejetant d’un geste sa robe de chambre.
Soufflant sur d’invisibles grains de poussière, Mathieu tendait déjà comme un collier la chemise empesée qu’il laissa retomber avec un plaisir évident sur le corps délicat de son maître.
III
UNE fois habillé, Stépane Arcadiévitch se parfuma à l’aide d’un vaporisateur, arrangea ses manchettes, fourra machinalement dans ses poches ses cigarettes, son portefeuille, ses allumettes, sa montre dont la double chaîne s’ornait de breloques, chiffonna son mouchoir, et se sentit frais, dispos, parfumé et d’une incontestable bonne humeur physique en dépit de son malaise moral. Il se dirigea, d’un pas quelque peu sautillant, vers la salle à manger, où l’attendaient déjà son café et son courrier.
Il parcourut les lettres. L’une d’elles, celle d’un négociant avec lequel il était en pourparlers pour une vente de bois dans la propriété de sa femme, le contraria fort. Cette vente était nécessaire ; mais tant que la réconciliation n’aurait pas eu lieu, il n’y voulait point songer, répugnant à mêler à cette grave affaire une question d’intérêt. La pensée que sa démarche pourrait être influencée par la nécessité de cette vente lui parut particulièrement odieuse.
Après la lecture du courrier, Stépane Arcadiévitch attira vers lui ses dossiers en parcourut deux à la hâte, y fit quelques annotations avec un gros crayon, et, repoussant ces paperasses, se mit enfin à déjeuner : tout en prenant son café, il déplia son journal, encore humide, et se plongea dans la lecture.
Stépane Arcadiévitch recevait un de ces journaux de couleur libérale, mais point trop prononcée, qui conviennent à la majorité du public. Bien qu’il ne s’intéressât guère ni à la science, ni à l’art, ni à la politique, il partageait pleinement sur toutes ces questions la manière de voir de son journal et de la majorité ; il ne changeait d’opinions que lorsque la majorité en changeait — ou plutôt il n’en changeait point, elles se modifiaient en lui imperceptiblement.
Stépane Arcadiévitch ne choisissait pas plus ses façons de penser que les formes de ses chapeaux ou de ses redingotes : il les adoptait parce que c’étaient celles de tout le monde. Comme il vivait dans une société, où une certaine activité intellectuelle est considérée comme l’apanage de l’âge mûr, les opinions lui étaient aussi nécessaires que les chapeaux. Au conservatisme que professaient bien des gens de son bord il préférait, à vrai dire, le libéralisme, non point qu’il trouvât cette tendance plus sensée, mais tout simplement parce qu’elle cadrait mieux avec son genre de vie. Le parti libéral prétendait que tout allait mal en Russie ; et c’était en effet le cas pour Stépane Arcadiévitch qui avait beaucoup de dettes et peu de ressources. Le parti libéral proclamait que le mariage, institution caduque, réclame une réforme urgente ; et pour Stépane Arcadiévitch la vie conjugale présentait effectivement peu d’agréments, elle le contraignait à mentir, à dissimuler, ce qui répugnait à sa nature. Le parti libéral soutenait ou plutôt laissait entendre que la religion était un simple frein aux instincts barbares du populaire ; et Stépane Arcadiévitch, qui ne pouvait supporter l’office le plus court sans souffrir des jambes, ne comprenait pas que l’on pût se livrer à des tirades pathétiques sur l’autre monde alors qu’il faisait si bon vivre dans celui-ci. Joignez à cela que Stépane Arcadiévitch, d’humeur fort plaisante, s’amusait volontiers à scandaliser les gens tranquilles : tant qu’à faire parade de ses aïeux, affirmait-il, pourquoi s’en tenir à Rurik et renier le premier ancêtre, le singe ? Le libéralisme lui devint donc une habitude : il aimait son journal comme son cigare après dîner, pour le plaisir de sentir un léger brouillard flotter autour de son cerveau.
Il parcourut l’article de fond, lequel démontrait que de notre temps on avait grand tort de voir dans le radicalisme une menace à tous les éléments conservateurs, et plus encore d’inciter le gouvernement à prendre des mesures pour écraser l’hydre révolutionnaire. « À notre avis, au contraire, le danger ne vient point de cet hydre prétendue mais de l’entêtement traditionnel qui met obstacle à tout progrès, etc., etc... » Il parcourut également un autre article, dont l’auteur traitait de finances, citait Bentham et Mill et lançait des pointes au ministère. Son esprit prompt et subtil lui permettait de saisir chacune de ces allusions, de deviner d’où elle partait et à qui elle s’adressait, ce qui lui causait un certain plaisir. Mais aujourd’hui ce plaisir était gâté par le souvenir des conseils de Matrone Philimonovna, par le sentiment que tout n’allait pas pour le mieux dans la maison. Il apprit encore qu’on croyait le comte de Beust parti pour Wiesbaden, qu’il n’existait plus de cheveux gris, qu’on vendait un coupé, qu’une jeune personne cherchait une place, mais ces nouvelles ne lui procurèrent pas la douce satisfaction quelque peu ironique qu’elles lui procuraient d’ordinaire.
Quand il eut terminé sa lecture et absorbé une seconde tasse de café avec une brioche beurrée, il se leva, secoua les miettes qui s’étaient attachées à son gilet, redressa sa large poitrine et sourit de plaisir. Ce sourire béat, signe d’une excellente digestion plutôt que d’un état d’âme particulièrement joyeux, lui remit toutes choses en mémoire et il se prit à réfléchir.
Deux jeunes voix se firent entendre derrière la porte ; Stépane Arcadiévitch reconnut celles de Gricha, son fils cadet, et de Tania, sa fille aînée. Les enfants avaient renversé un objet qu’ils s’amusaient à traîner.
— J’avais bien dit qu’il ne fallait pas mettre de voyageurs sur l’impériale, criait la petite fille en anglais ; ramasse-les maintenant.
« Tout va de travers, se dit Stépane Arcadiévitch ; les enfants sont abandonnés à eux-mêmes ». Il s’approcha de la porte pour les appeler. Abandonnant la boîte qui leur représentait un train, les petits accoururent.
Tania entra hardiment, et se précipita au cou de son père dont elle était la favorite, s’amusant à respirer le parfum bien connu qu’exhalaient ses favoris. Quand elle eut enfin baisé à son aise ce visage empourpré par la pose inclinée et rayonnant de tendresse, l’enfant détacha ses bras et voulut s’enfuir ; mais le père la retint.
— Que fait maman ? demanda-t-il en caressant le cou blanc et délicat de sa fille... Bonjour, ajouta-t-il à l’adresse du petit garçon qui le saluait à son tour.
Il s’avouait qu’il aimait moins son fils et tâchait de tenir la balance égale ; mais Gricha sentait la différence, aussi ne répondit-il point au sourire contraint de son père.
— Maman ? Elle est levée, répondit la petite.
Stépane Arcadiévitch soupira.
« Elle a de nouveau passé une nuit blanche », songea-t-il.
— Est-elle gaie ?
La petite fille savait que son père et sa mère étaient en froid : sa maman ne pouvait donc être gaie, son père ne l’ignorait point et dissimulait en lui faisant cette question d’un ton léger. Elle rougit pour son père. Celui-ci la comprit et rougit à son tour.
— Je ne sais pas, dit-elle. Elle ne veut pas que nous prenions nos leçons ce matin et nous envoie avec miss Hull chez grand-maman.
— Eh bien, vas-y, ma Tania. Un moment, ajouta-t-il en la retenant et en caressant sa petite main potelée.
Il chercha sur la cheminée une boîte de bonbons qu’il y avait placée la veille, et lui donna deux bonbons, en ayant soin de choisir ceux qu’elle préférait, un au chocolat et un autre à la crème.
— Celui-là est pour Gricha ? fit-elle en désignant le bonbon au chocolat.
— Oui, oui.
Après une dernière caresse à ses petites épaules, un baiser sur ses cheveux et son cou, il la laissa partir.
— La voiture est avancée, vint annoncer Mathieu. Et il y a une solliciteuse, ajouta-t-il.
— Depuis longtemps ? s’informa Stépane Arcadiévitch.
— Une petite demi-heure.
— Combien de fois ne t’ai-je pas ordonné de me prévenir immédiatement !
— Il faut pourtant vous donner le temps de déjeuner, rétorqua Mathieu, d’un ton si amicalement bourru qu’il eût été vain de se fâcher.
— Eh bien, fais-la vite entrer, se contenta de dire Oblonski en fronçant le sourcil.
La solliciteuse, épouse d’un certain capitaine Kalinine, demandait une chose impossible et qui n’avait pas le sens commun ; mais, fidèle à ses habitudes aimables, Stépane Arcadiévitch la fit asseoir, l’écouta sans l’interrompre, lui indiqua longuement la marche à suivre et lui écrivit même de sa belle écriture large et bien nette un billet fort alerte pour la personne qui pouvait lui venir en aide. Après avoir congédié l’épouse du capitaine, Stépane Arcadiévitch prit son chapeau et s’arrêta en se demandant s’il n’oubliait pas quelque chose. Il n’avait oublié que ce qu’il souhaitait d’oublier : sa femme.
« Ah oui ! » Il baissa la tête, en proie à l’anxiété. « Faut-il ou ne faut-il pas y aller ? » se demandait-il. Une voix intérieure lui disait qu’il valait mieux s’abstenir, qu’il allait se mettre dans une situation fausse, qu’un raccommodement était impossible : pouvait-il la rendre attrayante comme autrefois, pouvait-il se faire vieux et incapable d’aimer ? Non, à l’heure actuelle, il n’y avait à attendre de pareille démarche que fausseté et mensonge : et la fausseté comme le mensonge répugnaient à sa nature.
« Cependant il faudra bien en venir là, les choses ne peuvent rester ainsi », conclut-il en essayant de se donner du courage. Il se redressa, prit une cigarette dans son étui, l’alluma, en tira deux bouffées, la rejeta dans un cendrier de nacre, traversa le salon à grands pas et ouvrit la porte qui donnait dans la chambre de sa femme.
IV
DANS un pêle-mêle d’objets jetés à terre, Darie Alexandrovna, en négligé, vidait les tiroirs d’une chiffonnière ; des tresses hâtives retenaient sur la nuque sa chevelure qui avait été belle mais devenait de plus en plus rare, et la maigreur de son visage dévasté par le chagrin faisait étrangement ressortir ses grands yeux effarouchés. Quand elle entendit le pas de son mari, elle s’arrêta un instant, le regard tourné vers la porte, et s’efforça de prendre un air sévère et méprisant. Elle se rendait compte qu’elle redoutait et son mari et cette entrevue. Pour la dixième fois depuis trois jours elle se reconnaissait impuissante à réunir ses effets et ceux de ses enfants pour se réfugier chez sa mère ; pour la dixième fois cependant elle se disait qu’elle devait entreprendre quelque chose, punir l’infidèle, l’humilier, lui rendre une faible partie du mal qu’il lui avait causé. Mais, tout en se répétant qu’elle le quitterait, elle sentait qu’elle n’en ferait rien, car elle ne pouvait se désaccoutumer de l’aimer, de le considérer comme son mari. D’ailleurs elle s’avouait que si dans sa propre maison elle avait grand’peine à venir à bout de ses cinq enfants, ce serait bien pis là où elle comptait les mener. Un bouillon tourné avait rendu le petit malade, et les autres avaient failli ne pas dîner la veille... Elle comprenait donc qu’elle n’aurait jamais le courage de partir, mais elle cherchait à se donner le change en rassemblant ses affaires.
En apercevant son mari, elle se reprit à fouiller ses tiroirs et ne leva la tête que lorsqu’il fut tout près d’elle. Alors, au lieu de l’air sévère et résolu qu’elle comptait lui opposer, elle lui montra un visage ravagé par la souffrance et l’indécision.
— Dolly ! dit-il d’une voix sourde.
La tête rentrée dans les épaules, il affectait des façons pitoyables et soumises, qui ne cadraient guère avec son extérieur brillant de santé. D’un rapide coup d’œil elle l’enveloppa des pieds à la tête et put constater la fraîcheur parfaite, rayonnante, qui émanait de tout son être. « Mais il est heureux et content, songea-t-elle, tandis que moi !... Et cette affreuse bonhomie qui le fait chérir de tout le monde, comme je la déteste ! » Sa bouche se contracta, et sur son visage pâle et nerveux un muscle de la joue droite frissonna.
— Que me voulez-vous ? demanda-t-elle sèchement d’une voix de poitrine qu’elle ne se connaissait pas.
— Dolly ! répéta-t-il avec un tremblement dans la voix, Anna arrive aujourd’hui.
— Que m’importe ! s’écria-t-elle. Je ne puis la recevoir.
— Mais, Dolly, il faudrait pourtant...
— Allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en ! cria-t-elle sans le regarder comme si ce cri lui était arraché par une douleur physique.
Loin de sa femme Stépane Arcadiévitch avait pu garder son calme, espérer que tout « se tasserait », selon le mot de Mathieu, lire tranquillement son journal et prendre non moins tranquillement son café ; mais quand il vit ce visage bouleversé, quand il perçut ce son de voix résigné, désespéré, sa respiration s’arrêta, quelque chose lui monta au gosier, des larmes perlèrent à ses yeux.
— Mon Dieu, qu’ai-je fait ! Dolly, au nom du ciel ! Vois-tu, je...
Il ne put continuer : un sanglot le prit à la gorge.
Elle ferma violemment la chiffonnière et se tourna vers lui.
— Dolly, que puis-je te dire ? un seul mot : pardonne-moi. Rappelle tes souvenirs : neuf années de ma vie ne peuvent-elles racheter une minute... une minute...
Les yeux baissés, elle l’écoutait avidement et semblait le conjurer de la convaincre.
— Une minute d’entraînement, prononça-t-il enfin, et il voulut continuer. Mais le mot l’avait blessée : de nouveau ses lèvres se contractèrent, de nouveau les muscles de sa joue droite tressaillirent.
— Allez-vous-en, allez-vous-en ! cria-t-elle de plus en plus excitée. Ne me parlez point de vos entraînements, de vos vilenies.
Elle voulut sortir, mais faillit choir et dut s’appuyer au dossier d’une chaise. Le visage d’Oblonski se dilata, ses lèvres se gonflèrent, ses yeux se remplirent de larmes.
— Dolly, supplia-t-il déjà sanglotant, au nom du ciel, songe aux enfants, ils ne sont pas coupables ! Il n’y a que moi de coupable, punis-moi, dis-moi comment je puis expier. Je suis prêt à tout. Oui, je suis coupable, très coupable. Je ne trouve pas de mots pour exprimer mon repentir. Pardonne-moi, Dolly, je t’en conjure !
Elle s’assit. Il écoutait avec un sentiment de pitié infinie cette respiration courte et oppressée. Plusieurs fois elle essaya de parler, sans y parvenir. Il attendait.
— Tu songes aux enfants quand il te prend envie de jouer avec eux, put-elle enfin proférer ; mais moi, j’y songe sans cesse et je sais que les voilà perdus sans retour.
C’était là sans doute une des phrases qu’elle s’était mainte et mainte fois répétées au cours de ces trois jours.
Elle lui avait dit « tu » ; il la regarda avec reconnaissance et fit un mouvement pour prendre sa main, mais elle le repoussa d’un geste de dégoût.
— Je songe aux enfants et ferais tout au monde pour les sauver, mais je ne sais encore ce qui vaut mieux pour eux : les emmener loin de leur père ou les laisser auprès d’un débauché... Voyons, après... ce qui c’est passé, dites-moi s’il est possible que nous vivions ensemble ? Est-ce possible ? Répondez donc, voyons, est-ce possible ? répéta-t-elle en haussant la voix. Lorsque mon mari, le père de mes enfants, entretient une liaison avec leur institutrice...
— Mais que faire ? que faire ? demanda-t-il d’une voix dolente, ne sachant trop ce qu’il disait et baissant de plus en plus la tête.
— Vous me répugnez, vous me révoltez, s’écria-t-elle au comble de l’irritation. Vos larmes ne sont que de l’eau ! Vous me dégoûtez, vous me faites horreur, vous ne m’êtes plus qu’un étranger, oui, un ÉTRANGER, répéta-t-elle en appuyant avec un emportement douloureux sur ce mot fatal qu’elle jugeait effroyable.
Il leva les yeux sur elle : sa physionomie courroucée le surprit et l’effraya. La commisération qu’il lui témoignait exaspérait Dolly : qu’avait-t-elle besoin de pitié quand elle attendait de l’amour. Mais il ne le comprit pas. « Non, se dit-il, elle me hait, elle ne me pardonnera jamais. »
— C’est terrible, terrible ! murmura-t-il.
En ce moment, un des enfants, qui avait sans doute fait une chute, se mit à pleurer dans la chambre voisine ; Darie Alexandrovna tendit l’oreille et son visage s’adoucit. Elle parut revenir à elle, hésita quelques instants, puis, brusquement dressée, se dirigea vers la porte.
« Elle aime pourtant « mon enfant », songea-t-il ; comment alors peut-elle me haïr ? »
— Dolly, encore un mot ! insista-t-il en la suivant.
— Si vous me suivez, j’appelle les domestiques, les enfants. Qu’ils soient tous témoins de votre infamie. Je pars aujourd’hui, je vous laisse la place libre : installez ici votre maîtresse.
Elle sortit en fermant violemment la porte.
Stépane Arcadiévitch soupira, s’essuya la figure et se dirigea à pas lents vers la porte. « Mathieu prétend que cela « se tassera », mais je ne vois vraiment pas comment. Ah ! quelle horreur ! Et quelles façons vulgaires elle a vraiment, se disait-il en se rappelant son cri ainsi que les mots « infamie » et « maîtresse ». Pourvu que les petites n’aient rien entendu ! Oui, tout cela est par trop trivial. » Il s’arrêta un moment, s’essuya les yeux, soupira, se redressa et sortit.
C’était un vendredi ; dans la salle à manger l’horloger — un Allemand — remontait la pendule. Stépane Arcadiévitch se rappela que, frappé par la régularité de cet homme chauve, il s’était écrié un jour que l’Allemand avait été créé et mis au monde pour remonter « les pendules sa vie durant ». Le souvenir de cette plaisanterie le fit sourire. Une bonne plaisanterie ne le laissait jamais indifférent. « Après tout, peut-être que cela se tassera. » Le mot est joli d’ailleurs, il faudra le placer.
— Mathieu, cria-t-il, et quand celui-ci eut fait son apparition : Matrone et toi, ordonna-t-il, vous aurez soin de préparer le petit salon pour l’arrivée d’Anna Arcadievna.
— Bien, Monsieur.
Stépane Arcadiévitch endossa sa fourrure et gagna la sortie, suivi de Mathieu.
— Monsieur ne dînera pas à la maison ? s’enquit le fidèle serviteur.
— Cela dépend. Tiens, voici pour la dépense, dit Oblonski en tirant de son portefeuille un billet de dix roubles. Est-ce assez ?
— Assez ou pas assez, faudra bien qu’on s’arrange, répliqua Mathieu en fermant la portière.
Cependant Darie Alexandrovna avait consolé l’enfant ; avertie du départ de son mari par le bruit que fit la voiture en s’éloignant, elle s’empressa de regagner sa chambre, son seul refuge contre les tracas domestiques. Pendant cette courte échappée, l’Anglaise et Matrone Philimonovna ne l’avaient-elles point accablée de questions pressantes et qu’elle seule pouvait résoudre : « quels vêtements fallait-il mettre aux enfants pour la promenade ? devait-on leur donner du lait ? fallait-il se mettre en quête d’un autre cuisinier ? »
« Ah, laissez-moi tranquille ! » leur avait-elle dit. Et revenue à la place où s’était déroulé l’entretien avec son mari, elle en repassait maintenant les détails dans sa mémoire, serrant l’une contre l’autre ses mains décharnées dont les doigts ne retenaient plus les bagues. « Il est parti ! Mais a-t-il rompu avec « elle » ? Se peut-il qu’il « la » voie encore ? Pourquoi ne le lui ai-je pas demandé ? Non, non, impossible de reprendre la vie commune. Si même nous restons sous le même toit, nous n’en serons pas moins des étrangers, oui, des étrangers pour toujours ! » répéta-t-elle en insistant avec une énergie particulière sur ce mot fatal. « Et pourtant comme je l’aimais, mon Dieu, comme je l’aimais !... Comme je l’aimais ? Mais est-ce qu’à l’heure actuelle je ne l’aime pas encore et peut-être même davantage ?... Ce qu’il y a de plus dur, c’est... »
L’entrée de Matrone Philimonovna interrompit ses réflexions.
— Ordonnez au moins qu’on aille chercher mon frère, dit celle-ci. Il fera le dîner. Sinon, ce sera comme hier et les enfants n’auront pas mangé à six heures.
— C’est bon, je vais venir et donner des ordres. A-t-on fait chercher du lait frais ?...
Darie Alexandrovna se plongea dans le tran-tran quotidien et y noya pour un moment sa douleur.
V
GRÂCE à d’heureux dons naturels, Stépane Arcadiévitch avait fait de bonnes études, mais, paresseux et dissipé, il était sorti du collège dans un mauvais rang. Néanmoins, malgré son genre de vie dissolu, son grade médiocre, son âge peu avancé, il occupait un poste important et bien rémunéré, celui de président de section dans un établissement public de Moscou. Il devait cet emploi à la protection du mari de sa sœur Anna, Alexis Alexandrovitch Karénine, un des pivots du ministère dont dépendait l’établissement en question ; mais, à défaut de son beau-frère, une bonne centaine d’autres personnes : frères et sœurs, oncles et tantes, cousins et cousines, auraient procuré à Stiva Oblonski cette place ou quelque autre du même genre, ainsi que les six mille roubles d’appointements dont il avait besoin pour joindre les deux bouts, en dépit de la fortune assez considérable de sa femme.
Stépane Arcadiévitch comptait la moitié de Moscou et de Pétersbourg dans sa parenté ou dans ses relations. Il était né parmi les puissants de ce monde — ceux d’aujourd’hui comme ceux de demain. Un tiers des personnages influents, gens âgés, anciens camarades de son père, l’avait connu en brassière ; le second tiers le tutoyait ; les autres étaient gens de connaissance ; par conséquent les dispensateurs des biens de la terre sous forme d’emplois, de fermes, de concessions, etc... étant tous de ses amis, ils n’auraient eu garde de négliger un des leurs. Il ne se donna donc pas grand’peine pour obtenir une situation avantageuse : on lui demandait seulement de ne se montrer ni cassant, ni jaloux, ni emporté, ni susceptible, défauts d’ailleurs bien incompatibles avec sa bonté naturelle... Il eût trouvé plaisant qu’on lui refusât la place et le traitement dont il avait besoin. Qu’exigeait-il de si extraordinaire ? Un emploi comme en obtenaient autour de lui les gens de son âge et de son monde et qu’il se sentait capable de remplir aussi bien que quiconque.
On n’aimait pas seulement Stépane Arcadiévitch à cause de son aimable caractère et de son incontestable loyauté. Son extérieur séduisant, ses yeux vifs, ses sourcils et ses cheveux noirs, son teint d’un rose laiteux, bref toute sa personne exhalaient je ne sais quel charme physique qui mettait les cœurs en joie et les emportait vers lui irrésistiblement. « Ah bah ! Stiva ! Oblonski ! le voilà donc ! » s’écriait-on presque toujours avec un sourire joyeux quand on le rencontrait ; la rencontre avait beau ne laisser que des souvenirs plutôt vagues, on se réjouissait tout autant de le revoir le lendemain ou le surlendemain.
Depuis tantôt trois ans qu’il occupait à Moscou sa haute fonction, Stépane Arcadiévitch s’était acquis non seulement l’amitié mais encore la considération de ses collègues, et de toutes les personnes qui avaient affaire à lui. Les qualités qui lui valaient cette estime générale étaient tout d’abord, une extrême indulgence envers ses semblables fondée sur le sentiment de ses propres défauts ; en second lieu, un libéralisme absolu, non pas celui dont ses journaux exposaient les principes, mais un libéralisme inné qui lui faisait traiter tout le monde sur un pied d’égalité, sans aucun égard pour le rang ou la fortune ; enfin — et surtout — une parfaite indifférence pour les affaires dont il s’occupait, ce qui lui permettait de ne point se passionner et par conséquent de ne point commettre d’erreurs.
Dès son arrivée au bureau, Stépane Arcadiévitch, accompagné à distance respectueuse par le suisse, qui s’était emparé de sa serviette, se rendit dans son cabinet pour y revêtir l’uniforme et passa dans la salle du conseil. Les employés se levèrent et le saluèrent avec une affabilité déférente, Stépane Arcadiévitch se hâta, comme toujours, de gagner sa place et s’assit après avoir serré la main aux autres membres du conseil. Il causa et plaisanta avec eux autant que l’exigeaient les convenances, puis il ouvrit la séance. Personne ne savait comme lui tempérer le ton officiel par cette bonhomie, cette simplicité qui rendent si agréable l’expédition des affaires. D’un air dégagé, mais respectueux, commun à tous ceux qui avaient le bonheur de servir sous ses ordres, le secrétaire s’approcha de Stépane Arcadiévitch, lui présenta des papiers et lui adressa la parole sur le ton familier et libéral qu’il avait mis en usage.
— Nous sommes enfin parvenus à obtenir les renseignements demandés au conseil provincial de Penza ; si vous le permettez, les voici...
— Enfin, vous les avez ! proféra Stépane Arcadiévitch en posant un doigt dessus... Eh bien, Messieurs...
Et la séance commença.
« S’ils pouvaient se douter, pensait-il, les yeux rieurs, tout en penchant la tête d’un air important pour écouter le rapport, quelle mine de gamin pris en faute avait tout à l’heure leur président ! »
La séance ne devait être interrompue qu’à deux heures pour le déjeuner. Deux heures n’avaient pas encore sonné lorsque la grande porte vitrée de la salle s’ouvrit et quelqu’un entra. Heureux de la diversion, tous les membres du conseil — ceux qui siégeaient sous le portrait de l’empereur comme ceux que cachait à demi le miroir de justice1 — tournèrent la tête de ce côté, mais l’huissier de garde fit aussitôt sortir l’intrus et ferma la porte derrière lui.
Quand la lecture du rapport fut terminée, Stépane Arcadiévitch s’étira, se leva, et sacrifiant au libéralisme de l’époque, osa prendre une cigarette en pleine salle du conseil ; puis il passa dans son cabinet, suivi de deux collègues, un vieux routier, Nikitine, et un jeune gentilhomme de la chambre, Grinévitch.
— Nous aurons le temps de terminer après déjeuner, déclara Stépane Arcadiévitch.
— Certainement ! confirma Nikitine.
— Ce doit être un joli coquin que ce Fomine, dit Grinévitch faisant allusion à l’un des personnages de l’affaire.
Par son silence et une moue significative, Stépane Arcadiévitch fit entendre à Grinévitch l’inconvenance des jugements anticipés.
— Qui donc est entré dans la salle ? demanda-t-il à l’huissier.
— Quelqu’un qui vous demandait, et qui m’a glissé dans les mains pendant que j’avais le dos tourné. Mais je lui ai dit : veuillez attendre que ces messieurs sortent...
— Où est-il ?
— Probablement dans le vestibule, car il était là tout à l’heure. Tenez le voilà, ajouta l’huissier en désignant un beau gaillard aux larges épaules et à la barbe frisée, qui, sans se donner la peine d’ôter son bonnet de fourrure, prenait d’assaut l’escalier de pierre, dont les collègues de Stépane Arcadiévitch, serviette sous le bras, descendaient en ce moment les marches usées. L’un d’eux, personnage d’une maigreur extrême, s’arrêta, considéra sans la moindre aménité les jambes du grimpeur et se retourna pour interroger du regard Oblonski, debout, au haut de l’escalier, et dont la face rayonnante, rehaussée par le collet brodé de l’uniforme, s’épanouit encore davantage quand il eut reconnu l’arrivant.
— C’est bien lui ! Lévine, enfin ! s’écria-t-il en le gratifiant d’un sourire affectueux, bien que narquois. Comment, tu ne fais pas le dégoûté et tu viens me chercher dans ce « mauvais lieu », continua Stépane Arcadiévitch, qui, non content de serrer la main de son ami, lui donna encore l’accolade. Depuis quand es-tu ici ?
— J’arrive et j’avais hâte de te voir, répondit Lévine en promenant autour de lui des regards méfiants et effarouchés.
— Eh bien, viens dans mon cabinet, dit Stépane Arcadiévitch, qui connaissait la sauvagerie renforcée de son ami ; et le prenant par le bras, il l’entraîna à sa suite, comme pour lui faire franchir un passage difficile.
Stépane Arcadiévitch tutoyait presque toutes ses connaissances : des vieillards de soixante ans, des jeunes gens de vingt, des acteurs, des ministres, des négociants, des aides de camp de l’empereur, et bien des personnes ainsi tutoyées aux deux bouts de l’échelle sociale eussent été fort surprises d’apprendre qu’il y avait, grâce à Oblonski, un point de contact entre elles. Il tutoyait tous ceux avec qui il sablait le champagne, autrement dit tout le monde : mais quand il rencontrait un de ses tutoyés peu flatteurs en présence de ses subordonnés, il avait le tact de soustraire ceux-ci à une impression désagréable. Bien que Lévine n’appartînt certes pas à cette catégorie, il croyait peut-être que son ami ne tenait point à le traiter devant ses inférieurs sur un pied d’intimité : avec son savoir-vivre habituel Oblonski s’en était aussitôt rendu compte ; voilà pourquoi il l’avait entraîné dans son cabinet.
Lévine et Oblonski avaient à peu près le même âge et leur tutoiement marquait autre chose qu’un compagnonnage de table. Camarades d’adolescence, ils s’aimaient, malgré la différence de leurs caractères et de leurs goûts, comme s’aiment des amis qui se sont liés dès la prime jeunesse. Néanmoins, ainsi qu’il arrive souvent à des gens qui ont embrassé des professions différentes, chacun d’eux, tout en approuvant par le raisonnement la carrière de son ami, la méprisait au fond de l’âme ; chacun d’eux tenait la vie qu’il menait pour la seule vie réelle, et celle que menait son ami pour un pur mirage. À la vue de Lévine, Oblonski ne pouvait jamais retenir un léger sourire ironique. Combien de fois ne l’avait-il pas vu arriver de la campagne, où il s’adonnait à des travaux dont Stépane Arcadiévitch ignorait au juste la nature et qui d’ailleurs ne l’intéressaient guère ! Toujours Lévine apparaissait en proie à une hâte fébrile, un peu pataud et gêné de l’être ; et presque toujours il apportait des vues nouvelles et imprévues sur la vie et les choses. Ces façons amusaient fort Stépane Arcadiévitch. De son côté Lévine méprisait le genre de vie, par trop citadin, de son ami, et ne prenait pas au sérieux ses occupations officielles. Chacun riait donc de l’autre ; mais comme Oblonski suivait la loi commune, son rire était allègre et bon enfant, celui de Lévine hésitant et quelque peu jaune.
— Il y a longtemps que nous t’attendons, dit Stépane Arcadiévitch en pénétrant dans son cabinet et en lâchant le bras de Lévine comme pour lui prouver qu’ici tout danger cessait. — Je suis très heureux de te voir, continua-t-il. Eh bien, comment vas-tu ? que fais-tu ? quand es-tu arrivé ?
Lévine considérait en silence les deux collègues d’Oblonski, qui n’étaient point de ses connaissances ; les mains de l’élégant Grinévitch, ses doigts blancs et effilés, ses ongles longs, jaunes et recourbés du bout, ses énormes boutons de manchettes, absorbaient notamment son attention et l’empêchaient de rassembler ses idées. Oblonski s’en aperçut et sourit.
— Ah oui, c’est vrai. Permettez-moi, Messieurs, de vous faire faire connaissance. Mes collègues Philippe Ivanovitch Nikitine, Michel Stanislavitch Grinévitch — et se tournant vers Lévine : — un homme nouveau, un homme de la terre, un des piliers du « Zemtsvo2 », un gymnaste qui enlève cent cinquante livres d’une main, un grand éleveur, un grand chasseur, et, qui plus est, mon ami, Constantin Dmitriévitch Lévine, le frère de Serge Ivanovitch Koznychev.
— Enchanté, dit le petit vieux.
— J’ai l’honneur de connaître votre frère, dit Grinévitch, en lui tendant une de ses belles mains.
Le visage de Lévine se rembrunit ; il serra froidement la main qu’on lui tendait et se tourna vers Oblonski. Bien qu’il respectât fort son demi-frère, écrivain connu de toute la Russie, il n’aimait guère qu’on s’adressât à lui, non comme à Constantin Lévine, mais comme au frère du célèbre Koznychev.
— Non, je ne m’occupe plus du tout du zemstvo ; je me suis brouillé avec tous mes collègues et n’assiste plus aux sessions, dit-il en s’adressant à Oblonski.
— Cela s’est fait bien vite ! dit celui-ci, en souriant. Mais comment ? pourquoi ?
— C’est une longue histoire. Je te la raconterai quelque jour, répondit Lévine, ce qui ne l’empêcha pas de la raconter aussitôt. Pour être bref, commença-t-il du ton d’un homme offensé, je me suis convaincu que cette institution ne rimait à rien et qu’il n’en pouvait être autrement. D’une part c’est un joujou : on joue au parlement ; or je ne suis ni assez jeune ni assez vieux pour me divertir de la sorte. D’autre part c’est... (il hésita) c’est un moyen pour la coterie3 du district de gagner quelques sous. Autrefois il y avait les tutelles, les tribunaux, maintenant il y a le zemstvo ; autrefois on prenait des pots-de-vin, aujourd’hui on touche des appointements sans les gagner.
Il proféra cette tirade d’un ton véhément, comme s’il redoutait la contradiction.
— Hé, hé ! Te voilà, il me semble, dans une nouvelle phase, tu deviens conservateur ! dit Stépane Arcadiévitch. Mais nous en reparlerons plus tard.
— Oui, c’est cela, plus tard. J’avais grand besoin de te voir, dit Lévine, dont le regard chargé de haine ne pouvait se détacher de la main de Grinévitch.
Stépane Arcadiévitch sourit imperceptiblement.
— Et toi qui ne voulais plus t’habiller à l’européenne ! s’exclama-t-il en examinant le costume neuf de son ami, œuvre évidente d’un tailleur français. Décidément c’est une nouvelle phase.
Lévine rougit subitement, non comme un homme mûr qui ne s’en aperçoit pas, mais comme un jeune garçon que sa timidité rend ridicule, qui le sent et n’en rougit que davantage, jusqu’à verser des larmes. Cette pourpre enfantine donnait à son visage intelligent et mâle un air si étrange qu’Oblonski détourna le regard.
— Mais où donc nous verrons-nous ? J’ai grand, grand besoin de te parler, dit enfin Lévine.
Oblonski réfléchit un instant.
— Veux-tu que nous déjeunions chez Gourine ? Nous y causerons tranquillement. Je suis libre jusqu’à trois heures.
— Non, répondit Lévine après un moment de réflexion, j’ai encore une course à faire.
— Alors, dînons ensemble.
— Dîner ? mais je n’ai rien de spécial à te dire, deux mots seulement, une question à te poser ; nous causerons plus tard à loisir.
— Dans ce cas, dis-les tout de suite tes deux mots, et nous bavarderons pendant le dîner.
— Eh bien, les voici ; ils n’ont d’ailleurs rien de particulier...
Son visage prit soudain une expression méchante, résultat de l’effort qu’il faisait pour vaincre sa timidité.
— Que font les Stcherbatski ? Tout va-t-il comme par le passé ?
Stépane Arcadiévitch savait depuis longtemps que Lévine était amoureux de sa belle-sœur Kitty ; il esquissa un sourire et ses yeux brillèrent gaiement.
— Tu as dit : deux mots, mais je ne puis te répondre de même, parce que... Excuse-moi un instant...
Le secrétaire entra en ce moment, toujours respectueusement familier, mais convaincu, comme tous les secrétaires, de sa supériorité en affaires sur son chef. Il présenta des papiers à Oblonski et, sous une forme interrogatoire, lui soumit une difficulté quelconque. Sans le laisser achever, Stépane Arcadiévitch lui posa amicalement la main sur le bras.
— Non, faites comme je vous l’ai demandé, dit-il en adoucissant son observation d’un sourire, et après avoir brièvement expliqué comment il comprenait l’affaire, il conclut en repoussant les papiers : C’est entendu, n’est-ce pas, Zacharie Nikitytch ?
Le secrétaire s’éloigna, confus. Pendant cette petite conférence, qu’il écouta avec une attention ironique, les deux mains appuyées au dossier d’une chaise, Lévine avait eu le temps de se remettre.
— Je ne comprends pas, non, je ne comprends pas, dit-il.
— Qu’est-ce que tu ne comprends pas ? demanda Oblonski, toujours souriant, en cherchant une cigarette ; il s’attendait à une sortie quelconque de Lévine.
— Je ne comprends pas ce que vous faites ici, répondit celui-ci, en haussant les épaules. Comment peux-tu prendre tout cela au sérieux ?
— Pourquoi ?
— Parce que ça ne rime à rien.
— Tu crois ? Nous sommes pourtant surchargés de besogne.
— Belle besogne, des griffonnages ! Mais, c’est vrai, tu as toujours eu un don spécial pour ces choses-là.
— Tu veux dire qu’il me manque quelque chose ?
— Peut-être bien. Cependant je ne puis me défendre d’admirer ta belle prestance, et suis fier d’avoir pour ami un homme aussi important... En attendant, tu n’as pas répondu à ma question, ajouta-t-il en faisant un effort désespéré pour regarder Oblonski en face.
— Allons, allons, tu y viendras aussi, tôt ou tard. Tu as beau posséder trois mille hectares dans le district de Karazine, des muscles de fer et la fraîcheur d’une gamine de douze ans, tu finiras par y venir. Quant à ce que tu me demandes, il n’y a pas de changement, mais tu as eu tort de tarder si longtemps.
— Pourquoi ? demanda Lévine effrayé.
— Parce que..., répondit Oblonski. Nous en reparlerons. Mais, au fait, quel bon vent t’amène ?
— De cela aussi nous reparlerons plus tard, dit Lévine en rougissant de nouveau jusqu’aux oreilles.
— C’est bien, je comprends, dit Stépane Arcadiévitch. Je t’aurais bien prié de venir dîner à la maison, mais ma femme est souffrante. Si tu veux les voir, tu les trouveras de quatre à cinq au Jardin zoologique : Kitty patine. Vas-y ; je t’y rejoindrai et nous dînerons quelque part ensemble.
— Parfait ; alors au revoir !
— Fais attention, je te connais, tu es bien capable d’oublier ou de repartir subitement pour la campagne ! s’écria en riant Stépane Arcadiévitch.
— Non, non, je viendrai sans faute.
Lévine passait déjà la porte du cabinet quand il s’aperçut qu’il avait oublié de prendre congé des collègues d’Oblonski.
— Ce doit être un gaillard énergique, dit Grinévitch, quand Lévine fut sorti.
— Oui, mon cher, ce garçon-là est né coiffé, répondit Oblonski en hochant la tête ! Trois mille hectares dans le district de Karazine ! Quel avenir, quelle fraîcheur ! Il a plus de chance que nous.
— Vous n’avez guère à vous plaindre pour votre part.
— Si, tout va mal, très mal, rétorqua Stéphane Arcadiévitch en poussant un profond soupir.
VI
QUAND Oblonski lui avait demandé pourquoi au juste il était venu à Moscou, Lévine avait rougi et s’en voulait d’avoir rougi, car vraiment, bien que son voyage n’eût pas d’autre motif, pouvait-il répondre : « Je suis venu demander ta belle-sœur en mariage ? »
Les familles Lévine et Stcherbatski, deux vieilles maisons nobles de Moscou, avaient toujours entretenu d’excellents rapports, qui se firent encore plus étroits à l’époque où Lévine et le jeune prince Stcherbatski, frère de Dolly et de Kitty, suivirent ensemble les cours préparatoires a l’Université, puis ceux de cette docte institution. Dans ce temps-là Lévine, qui fréquentait assidûment la maison Stcherbatski, s’éprit de la dite maison. Oui, si étrange que cela puisse paraître, Constantin Lévine était amoureux de la maison, de la famille et spécialement de l’élément féminin de la famille Stcherbatski. Comme il avait perdu sa mère trop tôt pour se la rappeler et que son unique sœur était plus âgée que lui, ce fut dans cette maison qu’il s’initia aux mœurs honnêtes et cultivées de notre vieille noblesse et retrouva le milieu dont l’avait privé la mort de ses parents. Il voyait tous les membres de cette famille à travers une gaze poétique et mystérieuse : non seulement il ne leur découvrait aucun défaut, mais il leur supposait encore les sentiments les plus élevés, les perfections les plus idéales. Pourquoi ces trois jeunes personnes devaient-elles parler de deux jours l’un français et anglais ? pourquoi leur fallait-il à heure fixe et à tour de rôle taquiner un piano dont les sons montaient jusqu’à la chambre de leur frère où travaillaient les étudiants ? pourquoi des professeurs de littérature française, de musique, de dessin, de danse, se succédaient-ils auprès d’elles ? pourquoi, à certaines heures de la journée, les trois jeunes filles accompagnées de Mlle Linon, se rendaient-elles en calèche au boulevard de Tver, puis, sous la garde d’un valet de pied, cocarde d’or au chapeau, se promener le long de ce boulevard dans leurs pelisses de satin, dont l’une, celle de Dolly, était longue, l’autre, celle de Natalie, demi-longue, la troisième, celle de Kitty, si courte qu’elle faisait ressortir ses petites jambes bien faites, moulées dans des bas rouges ? Toutes ces choses et beaucoup d’autres lui demeuraient incompréhensibles. Néanmoins, ce qui se passait dans ce monde mystérieux ne pouvait qu’être parfait ; cela, il le « savait », et c’est justement cette atmosphère de mystère qui l’avait captivé.
Pendant ses années d’études, il faillit s’éprendre de Dolly, l’aînée ; quand on l’eut mariée à Oblonski, il rejeta son affection sur la cadette. Il éprouvait l’obligation confuse d’aimer l’une des trois sans savoir au juste laquelle. Mais Natalie eut à peine fait son entrée dans le monde qu’elle épousa un diplomate, nommé Lvov. Kitty n’était qu’une enfant quand Lévine quitta l’université. Peu après son admission dans la marine, le jeune Stcherbatski se noya dans la mer Baltique, et les relations de Lévine avec sa famille se firent plus rares, en dépit de l’amitié qui le liait à Oblonski. Mais quand, au commencement du présent hiver, il avait revu à Moscou les Stcherbatski après toute une année passée à la campagne, il avait compris laquelle des trois sœurs lui était destinée.
Rien de plus simple en apparence que de demander la main de la jeune princesse Stcherbatski ; un homme de trente-deux ans, de bonne famille, de fortune convenable, avait toute chance d’être accueilli comme un beau parti. Mais, Lévine était amoureux : il voyait en Kitty un être supra-terrestre, souverainement parfait, et lui-même au contraire un individu fort bas et fort terre à terre ; il n’admettait donc pas qu’on pût — elle encore moins que les autres — le juger digne de cette perfection.
Après avoir passé à Moscou deux mois qui lui parurent un rêve, rencontrant tous les jours Kitty dans le monde, qu’il s’était mis à fréquenter pour la voir, il avait soudain juge ce mariage impossible et repris sur-le-champ le chemin de ses terres.
Lévine s’était convaincu qu’aux yeux des parents il n’était pas un parti digne de leur fille et que l’exquise Kitty elle-même ne pourrait jamais l’aimer.
Aux yeux des parents il n’avait aucune occupation bien définie, aucune position dans le monde. Tel de ses camarades était déjà colonel et aide de camp de Sa Majesté ; tel autre, professeur ; celui-ci directeur de banque ou de chemin de fer ; celui-là occupait, comme Oblonski, un poste élevé dans l’administration. Quant à lui, on devait certainement le tenir pour un hobereau féru d’élevage, de bâtisses, de chasse à la bécasse, c’est-à-dire pour un raté s’adonnant aux occupations ordinaires des ratés.
L’exquise, la mystérieuse Kitty n’aimerait jamais un homme aussi laid, aussi simple, aussi peu brillant que celui qu’il croyait être. Ses relations de vieille date avec la jeune fille, qui, en raison de son ancienne camaraderie avec le frère aîné, étaient celles d’un homme mûr pour une enfant, lui semblaient un obstacle de plus. On pouvait bien, pensait-il, avoir quelque amitié pour un brave garçon comme lui, en dépit de sa laideur, mais seul un être beau et doué de qualités supérieures était capable de se faire aimer d’un amour semblable à celui qu’il éprouvait pour Kitty. Il avait bien entendu dire que les femmes s’éprennent souvent d’hommes laids et médiocres, mais il n’en croyait rien, car il jugeait les autres d’après lui-même, qui ne s’enflammait que pour de belles, de poétiques, de sublimes créatures.
Cependant, après deux mois passés dans la solitude, il se convainquit que le sentiment qui l’absorbait tout entier ne ressemblait en rien aux engouements de sa prime jeunesse ; qu’il ne pourrait vivre sans résoudre cette grave question : serait-elle, oui ou non, sa femme ; enfin qu’il s’était fait des idées noires, rien ne prouvant après tout qu’il serait refusé. Il partit donc pour Moscou avec la ferme intention de faire sa demande et de se marier, si elle était agréée. Sinon... il ne pouvait se représenter les conséquences d’un refus.
VII
ARRIVÉ à Moscou par le train du matin, Lévine s’était fait conduire chez son demi-frère utérin, dans l’intention de lui exposer tout de go le motif de son voyage et de lui demander conseil comme à son aîné. Sa toilette faite, il pénétra dans le bureau de Koznychev, mais ne le trouva pas seul. Un célèbre professeur de philosophie était venu tout exprès de Kharkov pour éclaircir un malentendu qui s’était élevé entre eux au sujet d’un très grave problème. Le professeur faisait une guerre acharnée aux matérialistes ; Serge Koznychev, qui suivait avec intérêt sa polémique, lui avait, à propos de son dernier article, adressé quelques objections : il lui reprochait de se montrer trop conciliant. Il s’agissait d’une question à la mode : existe-t-il, dans l’activité humaine, une limite entre les phénomènes psychiques et les phénomènes physiologiques, et où se trouve cette limite ?
Serge Ivanovitch accueillit son frère avec le sourire froidement aimable qu’il accordait à tout le monde, et après l’avoir présenté à son interlocuteur, il continua l’entretien. Le philosophe, un petit homme à lunettes, au front étroit, s’arrêta un moment pour répondre au salut de Lévine, puis sans plus lui accorder d’attention, reprit le fil de son discours. Lévine s’assit, attendant le départ du bonhomme, mais bientôt le sujet de la discussion l’intéressa.
Il avait lu dans des revues les articles dont on parlait ; il y avait pris l’intérêt général qu’un ancien étudiant ès sciences naturelles peut prendre au développement de ces sciences, mais jamais il n’avait fait de rapprochements entre les conclusions de la science sur les origines de l’homme, sur les réflexes, la biologie, la sociologie, et les questions qui depuis quelques temps le préoccupaient de plus en plus, à savoir le sens de la vie et celui de la mort.
Il remarqua, en suivant la conversation, que les deux interlocuteurs établissaient un certain lien entre les questions scientifiques et les questions psychiques, maintes fois même il lui sembla qu’ils allaient aborder ce sujet, selon lui capital ; mais aussitôt qu’ils en approchaient, ils s’en éloignaient brusquement pour s’enfoncer dans toutes sortes de divisions, subdivisions, restrictions, citations, allusions, renvois aux autorités, et c’est à peine s’il les comprenait.
— Je ne puis, disait Serge Ivanovitch dans son langage clair, précis, élégant, je ne puis en aucun cas admettre avec Keiss que toute ma représentation du monde extérieur provienne de mes impressions. La conception fondamentale de l’être ne m’est pas venue par la sensation, car il n’existe pas d’organe spécial pour la transmission de cette conception.
— Oui, mais Wurst, Knaust et Pripassov vous répondront que la conscience que vous avez de l’être découle de l’ensemble des sensations. Wurst affirme même que sans la sensation la conscience de l’être n’existe pas.
— Je prétends au contraire..., voulut répliquer Serge Ivanovitch.
Mais à ce moment Lévine, croyant une fois de plus qu’ils allaient s’éloigner du point capital, se décida à poser au professeur la question suivante :
— Dans ce cas, si mes sens n’existent pas, si mon corps est mort, il n’y a pas d’existence possible ?
Le professeur, plein de dépit et comme blessé de cette interruption, dévisagea ce questionneur plus semblable à un rustre qu’à un philosophe et reporta sur Serge Ivanovitch un regard qui semblait dire : pareille question vaut-elle une réponse ? Mais Serge Ivanovitch n’était pas à beaucoup près aussi exclusif, aussi passionné que le professeur ; il avait l’esprit assez large pour pouvoir, tout en discutant avec lui, comprendre le point de vue simple et naturel qui avait suggéré la question ; il répondit donc en souriant :
— Nous n’avons pas encore le droit de résoudre ce problème.
— Nous manquons de données, confirma le professeur, qui renfourcha aussitôt son dada. Non, je démontre que si le fondement de la sensation est l’impression, comme le dit nettement Pripassov, nous devons cependant les distinguer rigoureusement.
Lévine ne l’écoutait déjà plus et n’attendait que son départ.
VIII
LE professeur enfin parti, Serge Ivanovitch se tourna vers son frère.
— Je suis content de te voir. Vas-tu nous rester longtemps ? Comment vont nos affaires ?
Koznychev s’intéressait fort peu aux travaux des champs et n’avait posé cette question que par condescendance. Lévine, qui ne l’ignorait point, se borna donc à quelques indications sur les rentrées et la vente du blé. Il était venu à Moscou dans l’intention formelle de consulter son frère sur ses projets de mariage ; mais, après l’avoir entendu discuter tout d’abord avec le professeur et lui poser ensuite, sur un ton volontairement protecteur, cette banale question d’intérêt (ils possédaient indivis le domaine de leur mère et Lévine gérait les deux parts), il ne se sentit plus la force de parler, comprenant vaguement que son frère ne verrait pas les choses comme il aurait souhaité qu’il les vît.
— Et que devient votre zemstvo ? demanda Serge qui prenait grand intérêt à ces assemblées et leur attribuait une énorme importance.
— Je n’en sais ma foi, rien.
— Comment ? N’es-tu pas membre de la commission exécutive ?
— Non, j’ai donné ma démission, et n’assiste même plus aux sessions.
— C’est dommage ! déclara Serge en fronçant le sourcil.
Pour se disculper, Lévine voulut raconter ce qui passait durant ces assemblées, mais son frère eut tôt fait de l’interrompre.
— Il en va toujours de même avec nous autres, Russes. Peut-être est-ce un bon trait de notre nature que cette faculté de constater nos défauts, mais nous l’exagérons, nous nous complaisons dans l’ironie, qui jamais ne fait défaut à notre langue. Laisse-moi te dire que si l’on accordait nos privilèges, j’entends notre self-gouvernement local, à quelque autre nation de l’Europe, l’Allemagne ou l’Angleterre par exemple, elle saurait en extraire la liberté ; mais nous, nous en faisons un objet de plaisanterie.
— Que veux-tu que j’y fasse ? répondit Lévine d’un ton contrit. C’était ma dernière expérience. J’y ai mis en vain toute mon âme. Je suis décidément incapable.
— Mais non ! rétorqua Serge. Seulement tu n’envisages pas les choses comme il le faudrait.
— C’est possible, concéda Lévine accablé.
— À propos, sais-tu que Nicolas est de nouveau ici ?
Nicolas Lévine, frère aîné de Constantin, et frère utérin de Serge Ivanovitch, était un dévoyé ; il avait mangé la plus grande partie de sa fortune et, brouillé avec sa famille, vivait maintenant en fort mauvaise et fort étrange compagnie.
— Que dis-tu là ? s’écria Lévine effrayé. Comment le sais-tu ?
— Procope l’a rencontré dans la rue.
— Ici, à Moscou ? Tu sais où il habite ?
Et Lévine se leva précipitamment, prêt à se mettre sur-le-champ à la recherche de son frère.
— Je regrette de t’avoir dit cela, reprit Serge à qui l’émoi de son cadet fit hocher la tête. Je l’ai fait rechercher et, quand son adresse m’a été connue, je lui ai envoyé sa lettre de change qu’il avait signée à Troubine et dont j’ai bien voulu faire les frais. Voici ce qu’il m’a répondu.
Et Serge tendit à son frère un billet qu’il prit sous un presse-papiers. Lévine déchiffra sans peine ce griffonnage qui lui était familier : « Je prie humblement mes chers frères de me laisser en paix. C’est tout ce que je leur demande. Nicolas Lévine. »